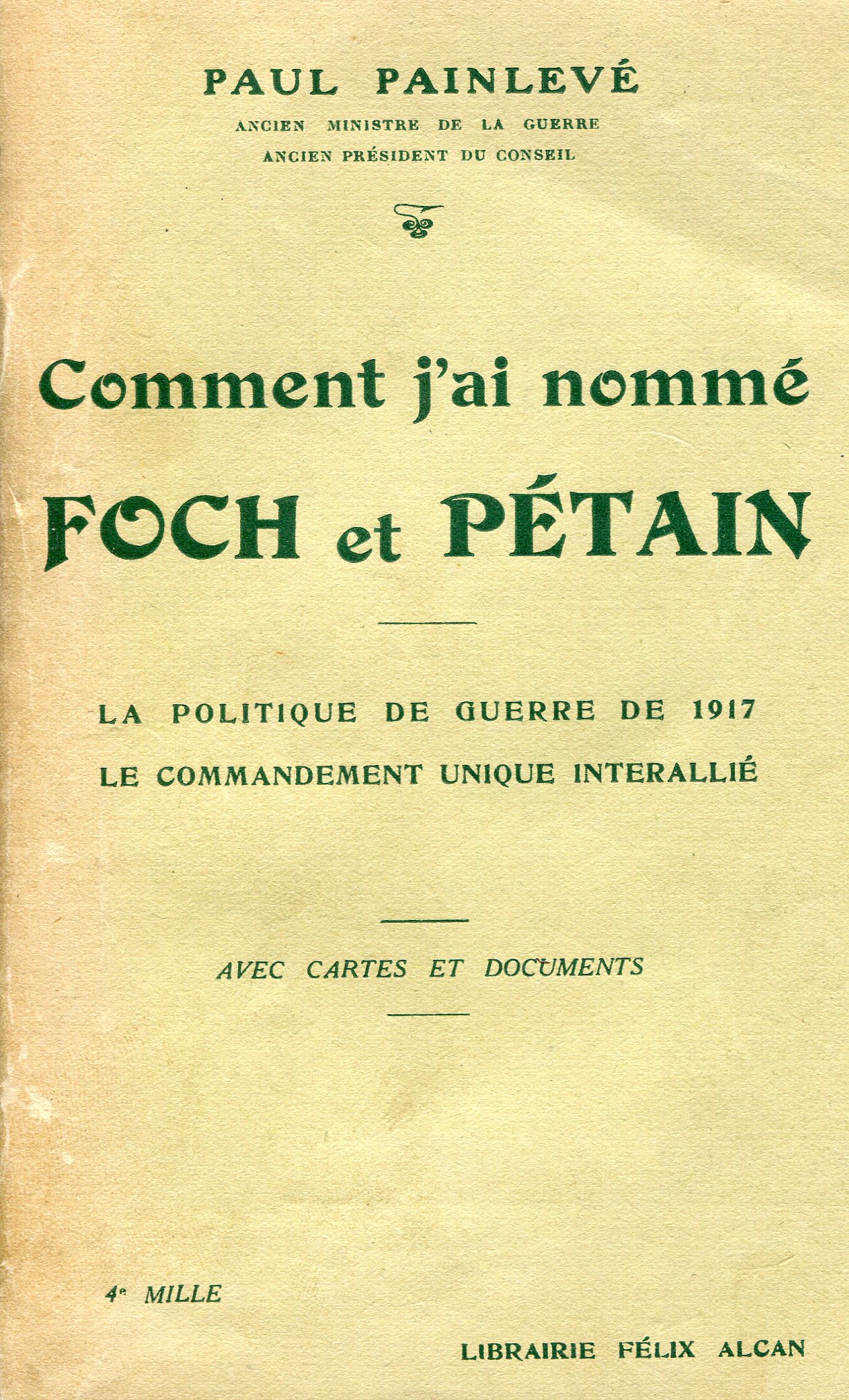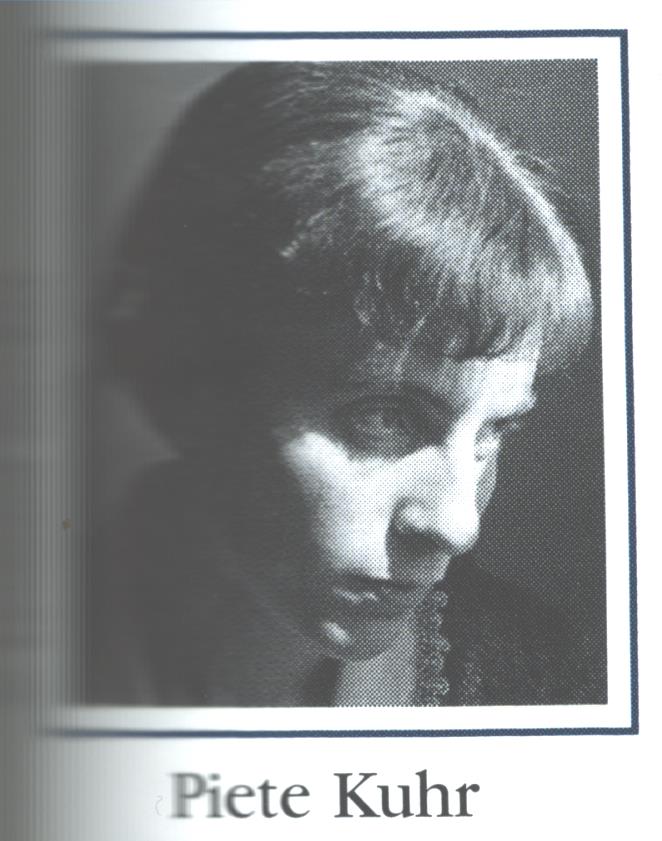Fille du médecin Henri Thorens. Famille protestante des Vosges. Mariée en 1903 avec le banquier Robert Mirabaud. Après la guerre de 14-18, elle préside avec son mari la Société de secours fraternel de Gérardmer qui vient en aide aux familles vosgiennes éprouvées par la guerre. Traductrice de divers auteurs, notamment Emerson et Rabîndramâth Tagore, prix Nobel de littérature. Elle a publié deux volumes de témoignages sur la guerre : Journal d’une civile, en 1917, et En marge de la guerre en 1920, les deux chez le même éditeur, Émile-Paul frères à Paris. Une réédition des deux est envisagée par Edhisto. Je ne peux faire ici que l’analyse du premier titre, acheté chez un bouquiniste. Il est publié avec seulement pour nom d’auteur les initiales H. R. M. La présentation dit que le livre a été victime « des mutilations de la censure, qui ont fait disparaitre d’intéressantes critiques ». Espérons qu’elles pourront être rétablies.
Milieu social
Le texte se présente comme un journal tenu régulièrement du dimanche 26 juillet 1914 (« dans les Vosges ») au vendredi 2 juillet 1915. Le témoignage est sincère (en tenant compte de la crédulité de la narratrice) et de lecture facile. Bien entendu il est marqué par le milieu social d’Henriette : ses fréquentations (des officiers, une marquise, une princesse qui trouve que « le service est plus que défectueux, en ce temps où il n’y a plus de domestiques nulle part », p. 85), ses loisirs (« un bridge de guerre, dont nous étions un peu honteux », p. 87). Même sentiment pour évoquer une « journée mondaine » qui suit l’enterrement de deux soldats (p. 249). Phrase intéressante, p. 70 : « Les enfants, le peuple, ont besoin d’être trompés pour avoir du courage. Pour nous, nous devons en avoir en regardant les réalités en face ! »
Patriotisme
Le 1er août, jour de l’annonce de la mobilisation générale, Henriette écrit : « Si l’on frissonne en pensant aux deuils prochains, on vibre aussi, en imaginant la joie de tant de cœurs alsaciens, quand nos trois couleurs passeront les Vosges… » Elle se réjouit à l’annonce du ralliement des socialistes à l’Union sacrée (« Hervé voulait s’engager », p. 13). Le 9 août, elle décrit des scènes d’enthousiasme et évoque Déroulède (mais elle a aussi noté le ridicule de Hansi « se baladant en pioupiou français », p. 13). Des lettres reçues disent la vaillance du peuple de Paris (p. 27). Les Allemands sont lâches et repoussants ; des Bavarois ont été fusillés par des Prussiens ; « on ne dit que la moitié des atrocités allemandes » (p. 100). Le portrait des Allemands est cependant nuancé ; des actes de bonté sont signalés (p. 103 et autres). Mais « le pauvre curé de la Bourgonce avait mille deux cents bouteilles dans sa cave : il n’en reste plus ! » (p. 108). Quant au pape, il est accusé (p. 330) de soutenir l’Autriche et l’Allemagne.
Rumeurs
« Des bruits divers circulent : Metz et Strasbourg brûleraient. La révolution agiterait l’Allemagne » (2 août). Ce sont les Allemands qui ont fait assassiner Jaurès (p. 13). Une femme aurait raconté à un officier français que « son fils, âgé de sept ans, n’ayant pas voulu donner sa tartine, fut tué d’un coup de sabre » (30 août). Sur plusieurs pages (250, 253, 257, 264, 326, 335) des témoins prétendent avoir vu des enfants aux mains coupées et autres atrocités. Dès les premiers jours, les Français auraient remporté des succès écrasants ; les Russes marcheraient sur Berlin. Parfois elle précise (p. 67) : « Je répète ce que j’entends ! » Un caporal de chasseurs alpins décrit des massacres à la baïonnette (p. 113). En secteur tenu par les Anglais, « à l’heure du thé, les tranchées restent vides » (p. 182) ; comique involontaire ici, mais que Goscinny a repris dans Astérix chez les Bretons ! Quant au commandant F., il a chargé à la baïonnette à la tête de ses hommes et tué de sa main huit Allemands (p. 222).
Espionnite
Dès le 4 août il est question d’espions allemands. Le 30 août, Henriette retranscrit une information venant d’un ami officier : les Allemands sont « renseignés par un espionnage admirable fonctionnant dans nos lignes mêmes, au moyen de téléphones souterrains ». Le 25 septembre, il s’agit d’espions « déguisés en prêtres et en ambulanciers ». Le 27, on aurait fusillé trois espions dont une femme. Le 25 octobre, c’est une femme qui a installé un téléphone dans les W.C. et « un autre truc d’espionnage consiste à faire varier la couleur d’une fumée de ferme : grise, bleue, jaunâtre, blanche. Chaque teinte a une signification. » D’autres espionnes encore le 6 mars 1915.
Opinions politiques et autres
La comtesse de P. lui a décrit « nos gouvernants [qui] actuellement font la fête à Bordeaux où ils ont fait venir leurs maitresses » (p. 104). Antiparlementarisme (« la retraite des quinze mille », allusion au chiffre de l’indemnité des députés, p. 105), mais pas antisémitisme (les Juifs aussi donnent leur vie pour la patrie, p. 102). Henriette pense que le féminisme a fait fausse route (p. 70) : « Nous nous sommes occupés d’antialcoolisme, de socialisme, de féminisme, de syndicalisme, de coopératisme, etc.. Nous cherchions l’esprit de justice. C’était bien, mais ce n’était pas l’essentiel. Il fallait faire du patriotisme. » Et plus loin (p. 260) : « Mes sentiments féministes reçoivent de rudes atteintes ! » Et les « grands précurseurs du pacifisme » nous ont fait beaucoup de mal (p. 209).
Une certaine évolution
Dans sa sincérité spontanée, Henriette est bien obligée de tenir compte aussi de notes discordantes. Elle a des doutes sur l’avance des Russes (28 octobre). Un ami officier signale l’état d’esprit déplorable dans les dépôts où « chacun cherche à exagérer ses incapacités » pour ne pas partir (17 novembre). Le 10 janvier 1915, elle nous dit qu’elle demeure patriote mais que la guerre est une chose « effroyable », tandis que certains industriels « gagnent beaucoup sur la fourniture des munitions ». À Annonay, il y a des Alsaciens qui se comportent mal et qui refusent de s’engager et même de travailler (p. 276 et 289). Des femmes d’Aubenas, « de petite condition », sont heureuses d’avoir leur mari sur le front car, en indemnité, « elles touchent une somme rondelette », tandis que « le mari ne va pas boire au cabaret » (p. 286).
Le Midi
Le 9 novembre 1914, Henriette a déjà évoqué les Méridionaux en citant une lettre d’un ami officier : « Les populations du Midi qu’épargne la guerre auraient grand besoin d’être éduquées par la souffrance. On les sent molles et égoïstes. » À partir de mai 1915, elle entreprend un voyage vers le Sud pour rendre visite aux Alsaciens réfugiés : Lyon, Annonay, Tournon, Privas, Aubenas, Alès… Elle n’aime pas Nîmes (16 mai) : « Beaucoup de monde dans les rues. Du monde prétentieux, et vêtu à la mode d’il y a cent ans. Les voix sont criardes, les robes de couleurs voyantes. Beaucoup de soldats errent par les rues. Visiblement, ils ne sont pas allés au feu […] Ils semblent très satisfaits d’eux-mêmes. » Les réfugiés sont plus ou moins bien accueillis. Ils font baisser les salaires (p. 300). Si Nîmes est laide, Montpellier est pire (p. 303) ; l’hôtel est « de goût fort boche » ; « les cafés pullulent de soldats ». Si Béziers a bien traité les réfugiés, Narbonne est si laide que mieux vaut n’en point parler. Perpignan est bien, mais Madame E. affirme qu’on y voit « quatre ou cinq duels au couteau par semaine ». Henriette aperçoit le Canigou, elle passe à Prades, Carcassonne, Villefranche-de-Lauragais, et retourne à Paris.
Finalement, si sa crédulité est compréhensible – qui rappelle celle de François Blayac, voir ce nom – que dire des bobards contenus dans les lettres qu’elle reçoit de ses amis officiers ?
Dans En marge de la guerre, Henriette Mirabaud-Thorens, bourgeoise parisienne, protestante, féministe d’origine alsacienne possédant une villa à Gérardmer dans les Vosges poursuit ses souvenirs (la période du 26 juillet 1914 au 2 juillet 1915 a été publiée dans l’ouvrage Journal d’une civile, publié aux mêmes éditions en 1917) couvrant la période du 5 juillet 1915 au 30 décembre 1917. L’auteure, très active dans l’aide médicale et philanthropique des poilus poursuit son journal après avoir quitté la cité vosgienne depuis la Suisse puis Paris, où elle côtoie le monde artistique et mondain, puis en faisant quelques retours dans les Vosges. Elle y poursuit sa description d’une petite ville d’arrière-front avec sa sensibilité alsacienne protestante.
Analyse
Deuxième volume du plus important témoin publié de la cité géromoise, ce témoignage d’une bourgeoise active – elle a 5 filleuls de guerre (p. 105) et fait de la photo (p. 295) -, idéalement placée dans l’intelligentsia locale et connectée largement avec les milieux militaires, médicaux et philanthropiques, – elle a également des envolées politiques (p. 228) – en fait un témoin de première importance, notamment sur le paradigme des Alsaciens. Bien entendu, elle rapporte, parfois en toute connaissance de fausseté, les ragots et rumeurs de la guerre mais ceux-ci ne lui sont pas servis par les journaux, mais par son entourage, hétéroclite. De très nombreux éléments sont à dégager et de différents ordres. Un témoignage (presque) complet (il manque l’année 1918) qui mériterait une réédition.
Renseignements tirés de l’ouvrage
Page 12 : Succès de la Fontenelle appris le 27 juillet
13 : Lits démontable des ambulances alpines
14 : Suisse entendant le canon de Verdun
22 : Sur un foyer du soldat refusé à Wesserling par Serret
23 : Sur la guerre manquant au soldat permissionnaire : « Assis pensivement sur les bancs, ils semblaient… s’ennuyer un peu, bien que poliment, sans vouloir le montrer. On sentait que leur âme était ailleurs. La guerre, cela excite, cela agite ; c’est l’imprévu, c’est l’inconnu… Je comprends mieux, depuis que je les ai vus, leurs joyeux retours au front. »
24 : Colis non reçus par les prisonniers
: Marquise conduisant des véhicules à la Croix rouge (fin 28)
25 : Extrait d’un carnet d’un soldat de la Chipotte, abbé Collé ?
28 : Tirs sur des cigognes !
: Lutte contre les alambics par Ribot
32 : Vue de Paris, où le noir est à la mode
33 : Vue du dépôt des éclopés des Champs-Elysées
34 : Retour à Gérardmer, le 10 septembre 1915, trajet, voyage avec Hansi : « … toujours le même, avec son allure de bon géant, taciturne et dégingandé. Mais le pioupiou de 1914 est aujourd’hui sous-lieutenant et décoré. »
35 : « Cela « sent le front » Ceux qui n’y ont jamais été ne peuvent comprendre ce que c’est : mélange d’attente d’angoisse, de vie intense et de mort ». Description de sa villa.
36 : Aviatik descendu au Saut des Cuves
: Rumeur que les Alpins ne font plus de prisonniers
: « Lorrain, vilain ; traître à Dieu et à son prochain » !
37 : Spectacle de la guerre
39 : Général Maud’huy, aimé de ses hommes et le pourquoi
: Promesse de récompense de 20 francs pour l’arrivée au sommet du HWK, qui coûte à un officier 1600 francs
41 : Pouydraguin (vap 79)
42 : « Le pessimisme pour un civil, c’est la désertion pour le militaire »
45 : Orphelines fabriquant des masques à gaz
46 : Rencontre une survivante du Lusitania
49 : Foyer du Gaschney fermé à cause d’un Suisse
54 : Gâchis au front
57 : Artistes camoufleurs, dont Flameng, faux ?
58 : Prophétie d’avant-guerre
62 : Visite de Polybe, Barrès, Rostand, Haraucourt et Daudet.
63 : Mauvais traitement des civils alsaciens (vap 269, 66 le contraire)
: Maquette au cimetière d’un monument aux morts
64 : Anecdote sur un filleul de guerre
70 : Voyant un fumiste mutilé de guerre (borgne), réflexion sur le changement social de la guerre
71 : Joffre à Gérardmer « incognito » !
: Pathéphone
74 : Accident de tramway au Hohneck
75 : Soldat regardant sa femme et sa fille en zone envahie près de Cirey
77 : Grand froid
: Exécution d’un espion
79 : Description de Villaret, Pouydraguin
80 : Anecdote sur l’occupation de Saint-Dié
: Anecdote sur l’alcool
84 : Tardival, couteau de tranchée donné aux Alpins
: Sur les soldats à Paris « trop gâtés »
85 : Sur la capture du 152ème au HWK
86 : Sur les prisonniers de l’ile de Croix, allemands et alsaciens
87 : « J’aurai ou la médaille militaire ou un petit jardin sur le ventre »
89 : Explosion d’un train de munition à Dollwiller
: Espionnite, homme badigeonné de citron pour révéler de l’encre sympathique sur son corps
94 : Récit de la bataille du HWK
97 : Sur les lumières de Paris
101 : Livres français envoyés dans les camps par la société Franklin
102 : Zeppelins sur Paris, ambiance
: Prix pour la capture d’un espion, 3 000 F.
103 : Vue de Jérôme Tharaud, mariage, sa femme
104 : Vue de Barrès et madame
105 : Espionnite à Paris et à Nancy
112 : « Rencontré trois permissionnaires, probablement fraîchement débarqués du train, qui regardaient… on aurait pu croire des magasins d’articles de Paris, des fleurs, etc., non, ils étaient en contemplation devant… des couronnes mortuaires. Ces hommes qui vivent en face de la mort, sont attirés par ce qui la rappelle ».
114 : Phrase attribuée au Kayser : « Si jamais vous reprenez l’Alsace, vous la reprendrez chauve. »
115 : Bruits de Révolution en Suisse, affaire des colonels (vap 116)
116 : Rumeur d’achat d’enfants par les Allemands
117 : Problème médical après le HWK
122 : « Marie me damne », code pour Dannemarie
: Chiffres et statistiques sur les prisonniers
123 : Cite Altiar (une femme, vap 130, 176, 261)
125 : Victime (à Paris) de l’explosion de l’usine de grenades de La Courneuve
129 : Drame populaire intitulé « La Défense de Schirmeck » de Bruno, maire du XVIème arrondissement et professeur à La Sorbonne
130 : Poincaré, nouveaux obus au cyanure de potassium « pouvant tuer instantanément des milliers d’hommes à la fois »
134 : Vue de Mme Péguy, Ferry
135 : Vue de Mme Jules Ferry
138 : « A Mulhouse, on va embrasser les éclats d’obus français qui y tombent !»
: « Je voudrais être une punaise écrasée par les glorieuses bottes de nos poilus »
141 : Vue de Gide
145 : Sur Pétain, qui « saute à la corde tous les matins » (vap 216)
146 : 3 femmes, 3 lumières, espionnite !
150 : Anecdote de la capture de l’ambulance de Perrin en août 14, mais inexactitude (fin 151)
151 : Coterie bourgeoise, princesses, comtesse, etc. et Colette ex-Willy
152 : Usine de brome
: Vue de Mme Brandès aidant des aveugles
154 : Sur la censure touchant la citation d’un fils d’Alfred Dreyfus, infamie ! (vap 265, anecdote)
156 : Boy scouts défilants
177 : Surnoms de tanks anglais, qu’elle appelle « automobiles anglaises blindées qui sautent, sans roues, par-dessus tout », appelées « baleine, requin, limace ». Commentaires sur.
182 : Ambiance et description sociales de Paris, militaires et ouvriers, état d’esprit, mode
184 : « On dit que les Allemands ont choisi pour le rapatriement des prisonniers en Suisse des repris de justice et autres échantillons de ce genre afin que les Français fassent mauvaise impression chez les neutres ».
188 : A son petit musée à la villa, abondé par des militaires en visite
189 : Sur l’assassinat de prisonniers
195 : « Pour le 1er janvier on offrira aux amis un sac de charbon, si l’on en trouve, en guise de sacs de chocolat »
200 : Sur l’alcool au front
204 : Sur les 5 coups de canon de Belfort annonçant la guerre
206 : Subterfuge pour envoyer de la poudre de chocolat à Mulhouse
208 : Œuf dito ?
211 : L’internationalisation de la guerre par l’uniforme
212 : Sarrail épouse Oki (pour Octavie) de Joannis, qui fut infirmière à Gérardmer : « Cette alliance du protestantisme le plus sévère avec l’agnosticisme le plus complet me trouble. Trente printemps alliés à soixante-quatre hivers, c’est amusant. »
217 : Description au 2ème degré de l’horreur des grenades incendiaires
219 : Rumeur d’évacuation de Mulhouse
220 : Barrès à Verdun… pour aller chercher une poupée d’une orpheline de guerre
221 : Sur la TSF et la Tour Eiffel
223 : Sur les champs magnétiques déviant les balles !
227 : Lassitude d’écriture
232 : Long récit sur la fuite de Serbie par les montagnes (fin 255)
249 : Le devenir des Serbes, sont étudiants en France
250 : Colonie pénitentiaire de La Grande Chartreuse pour les délinquants serbes
261 : Indiscipline (mutinerie) à Laveline-devant-Bruyères en juin 1917 : « A Laveline, des officiers ont été sifflés et obligés de se cacher »
: Contact, Allemands bien renseignés, messages lancés par arbalète
263 : Sur sa 1ère parution
264 : Pierres jetées sur un cercueil protestant
267 : Prévision de fin de guerre par un abbé
271 : Contrefeu à l’indiscipline
272 : Consommation d’alcool (vap 279)
275 : Nancy ville morte
276 : Avion français descendu par des Français
: Sur les surintendantes d’usine, femmes à poigne pour gérer les ouvrières femmes
281 : Joute sportive sur le terrain de Ramberchamp (qui leur appartient ?) (vap 295)
283 : Traitement des Kabyles
286 : Vue intéressante d’une scierie canadienne à Martimprey (vap 292, 302, 307)
288 : Vue de Dieterlen (vap 301, 309, 318)
: Vue d’une mission chinoise
289 : Allemands déserteurs
291 : Pétition d’Alsaciens
293 : Visite de Poincaré, Pétain, le roi d’Italie (vap 301)
295 : Faux prisonniers allemands jouant une attaque
296 : Madelon
299 : Pourquoi on met les Américains dans les Vosges, pour les éloigner des Anglais !
306 : Vue du cimetière de Gérardmer
307 : Ambrine contre les brûlures
308 : Vue de l’ouverture du foyer du soldat de La Poste
312 : Tonkinois et Cochinchinois
313 : Epopée d’un Alsacien déserteur
317 : Récriminations contre les grévistes
322 : Noël 17, distribution chaotique de cadeaux aux poilus, contenus des colis. Puis arbre de Noël aux enfants
Rémy Cazals et Yann Prouillet, mai 2021