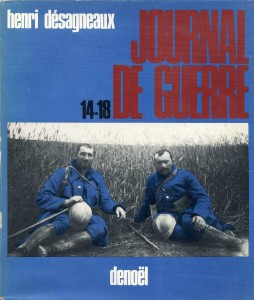1. Le témoin

Henri Desagneaux est né le 24 septembre 1878 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Il fait ses études à la capitale, au collège Massillon, et devient juriste, attaché au Contentieux de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est. Lieutenant de réserve, son ordre de mobilisation prévoit qu’il rejoigne le service des étapes et des chemins de fer à Gray (Haute-Saône). Il débute la guerre dans son domaine et est réaffecté en janvier 1916 dans une unité combattante. Entre-deux-guerres, il devient conseiller municipal, adjoint au maire de Nogent, de 1920 à 1942, après une courte période de remobilisation comme chef de bataillon de réserve pour la campagne 1939-1940. Il a au moins un fils, Jean, qui publie ses souvenirs. Henri Desagneaux meurt le 30 novembre 1969.
2. Le témoignage
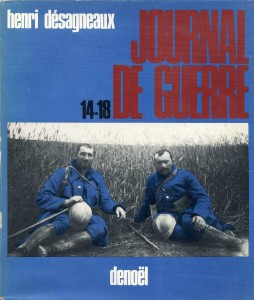
Desagneaux, Henri, Journal de guerre. 14-18. Paris, Denoël, 1971, 291 pages.
L’ouvrage a été traduit en anglais sous le titre A French Soldier’s War Diary, Elmsfield Press, en 1975.
Le vendredi 31 juillet 1914, à la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est, l’ambiance est mêlée d’anxiété quand survient l’ordre de transporter les troupes à la frontière. La France est menacée ; c’est le début d’une gigantesque guerre européenne dans laquelle Henri Desagneaux, alors lieutenant de réserve dans le service des étapes et des chemins de fer à Gray, devra prendre sa place. Pour l’heure, le 3 août, il assure son poste ferroviaire et prend la conduite des trains de ravitaillement. Il rapporte de suite le grand bouleversement des peuples et des choses, des hommes qui partent au front, remplaçant d’autres qui en reviennent dans des trains de blessés. Il entend les invraisemblances des bruits populaires et note les détails de la fourmilière qui l’entoure. Le 18, la mobilisation ferroviaire est terminée alors que s’engage le choc de la bataille des frontières. Le 20 août, il prend un train qui l’emmène à Badonviller et s’approche alors du front, dont il peut sentir le souffle de mort. Il rapporte ses visions de blessés et se fait le vecteur des horreurs boches inventées dans le sein populaire alors que l’ennemi recule. Mais c’est bientôt la retraite d’août, prélude à la bataille d’arrêt qui borde, en terre lorraine, la Marne.
La guerre s’est installée quand Desagneaux apprend sa nomination, à la veille de 1915, au poste d’adjoint au commissaire régulateur de Gray, puis de Besançon. Décideur, il endosse et rapporte alors les fonctions bureaucratiques mais effervescentes qui permettent l’écoulement des besoins d’une armée et le glissement des divisions. Le travail est intense mais monotone et insipide et l’année 15 se passe à compter les trains et leur contenu, hétéroclite ou tragique.
Le 1er décembre 1915, une loi prend naissance pour réintégrer dans leur arme les officiers de chemin de fer de moins de 40 ans. Le 10 janvier, il quitte son « service fastidieux et si peu récompensé ». Il est affecté au 359e RI de la 129e DI et part sans regret aucun au centre d’instruction des commandants de compagnie à Remiremont, dans les Vosges. Après des débuts difficiles – il n’est pas annoncé, n’a pas d’ordres -, il suit un mois de cours intensifs et intègre un secteur en Lorraine le 16 février 1916. Là aussi, il n’y pas de place pour lui mais reçoit toutefois une affectation à la 22e compagnie du 6e bataillon du 359e RI. L’accueil qu’il reçoit est froid et il juge sans complaisance ses nouveaux subordonnés, de tous grades, mais aussi le désordre qu’il constate. Quand éclate l’orage sur Verdun, la division est en réserve en Lorraine, sur la Seille, à Arraye-et-Han. L’activité y est peu importante et les coups de main ne servent qu’à attraper du poisson dans la rivière.
Le 31 mai 1916, c’est Verdun et le fort de Vaux dans la fournaise, domaine d’une artillerie toute puissance qui fait tout trembler, même les « gens avec la croix de guerre » ! Les nuits, les jours sont terribles ; « on vit dans le sang, dans la folie »… « A la 24e compagnie, deux hommes se suicident ». Et Desagneaux de décrire l’enfer et l’hécatombe, les blessés devenus fous qui veulent que leur lieutenant les délivrent à jamais…
Le 5 juillet, le lieutenant Desagneaux passe capitaine à titre définitif, nomination agrémentée d’une citation. Le 14, il est au Bois le Prêtre où le crapouillotage n’est pas moins virulent. Il quitte ce secteur pour une période de manœuvres au camp de Bois l’Evêque.
C’est ensuite – le 20 novembre 1916 – la Somme où une attaque est prévue puis ajournée. Dès lors, l’activité est moindre mais les conditions climatiques d’une pluie quasi perpétuelle liquéfient le moral. Le 11 janvier 1917, Desagneaux n’est pas mécontent de quitter ce secteur pour intégrer le Groupe d’Armée de Rupture, qui sera chargé, avec 400 000 hommes de réaliser une percée.
Pour l’instant et après un voyage de 42 heures, il arrive à nouveau dans les Vosges, à Corcieux, où ne règnent plus le bruit et la boue, mais le froid persiste. Il va connaître un autre type de guerre à la Chapelotte, dernier contrefort vosgien au nord du massif montagneux, en Meurthe-et-Moselle ; la guerre de mines. Le secteur est considéré comme important et le travail n’y manque pas. En effet, le colonel veut des prisonniers ; il faut donc multiplier les coups de main. Préparés à l’arrière par des officiers hors de propos, ils sont systématiquement coûteux et infructueux.
Le mois de mai le renvoie à l’exercice à l’arrière mais « l’esprit de la troupe devient de plus en plus mauvais ». Les mutineries pointent alors que le 359e monte maintenant au Chemin des Dames, à la Royère, où c’est de nouveau le règne du bombardement. Là se produiront les attaques allemandes de juin et juillet devant des troupes débandées qui refusent parfois d’attaquer (comme les 120e et 121e BCP les 22-23 juin). Les troupes environnant notre capitaine ne seront pas à la hauteur, tâche indélébile aux yeux des décideurs de l’arrière. Mais le régiment est tout de même exsangue et Pétain, grand sauveur de l’armée en dérive, se révèle à Desagneaux être une « triple brute » ! Dès lors, la rétorsion s’abat sur le régiment : les citations sont systématiquement refusées, les exercices, les revues et les brimades s’y multiplient, les hommes sont traités comme des bêtes avant la remontée en ligne à Cœuvres puis, à la fin de juillet 1917 dans le secteur de Vauxaillon où l’enfer reprend, où « il faut vous habituer à vivre dans la merde ».
1917 s’achève en travaux et en soutien de l’armée anglaise à Champs, dans la Somme, qui s’est calmée depuis son précédent séjour, terrible. Il creuse, plante des piquets ou attend, dans le froid et la neige.
1918 commence également dans le froid mais sur un autre front où il arrive le 4 février à Saint-Ulrich en Alsace. Là, il travaille encore la terre. En effet, secteur réputé calme, l’Alsace voit venir nombre de politiques et de militaires qui viennent « sur le front ». Le capitaine Desagneaux change d’affectation. Il quitte sa 21ème compagnie le 28 avril et est nommé capitaine adjudant-major, adjoint au commandant du 5e bataillon. La division retourne bientôt sur la Somme où elle reste en réserve de l’armée britannique, en alerte, puis entre en Belgique dans le secteur du Kemmel au nord-ouest d’Armentières. Là, la bataille fait rage et l’espoir d’être relevé ne s’allie qu’à l’idée d’atteindre 60 % de pertes. Les attaques se succèdent et chaque jour passé est une victoire sur la mort. Le 20 mai 1918, c’est l’attaque qui combine l’artillerie et les gaz et les heures terribles d’angoisse.
Le 11 juin 1918, une nouvelle terrible attaque, aidée de tanks, secoue le capitaine Desagneaux et sa compagnie. Les pertes sont considérables mais insuffisantes et l’été se succède en coups de mains. Cet été si terrible pour les Allemands, se passe dans l’Oise, à Courcelles. L’Allemagne lâche pied, c’est la poursuite et la continuation des attaques. Mais la division ne quitte pas le secteur, elle est en ligne depuis juin et a avancé de 30 à 35 kilomètres avant d’enfin, le 5 septembre, quitter le champ de batailles qui a vu tomber tant des siens.
Le 7 septembre, il revient en Lorraine. Les victoires françaises se multiplient et c’est là que le coup de grâce doit être donné. Après une permission de 16 jours, Desagneaux fait retour dans un régiment dissous (le 4 octobre 1918). Il est appelé à la fonction d’adjoint au colonel et est chargé de préparer les coups de mains de l’attaque de novembre, conjointe avec les Américains, soit 600 000 hommes en ligne. L’artillerie s’amasse, le général Mangin est annoncé dans le secteur, quand les plénipotentiaires allemands s’avancent dans le Nord. Il apprend dans la liesse l’Armistice et note qu’il peut maintenant dormir sans entendre le bruit du canon. Le 17 novembre, Desagneaux entre en Lorraine annexée près d’Arracourt et débute une occupation morne avant d’être démobilisé, sans joie, le 30 janvier 1919.
3. Résumé et analyse
Henri Desagneaux livre au lecteur et à l’historien un témoignage brut, dur, dense et précis, tant dans la psychologie du combattant que dans l’horreur vécue, décrite sans fard et sans autocensure. Jean Desagneaux, son fils, à qui l’on doit cette publication, nous renseigne peu sur l’auteur mais indique que ses notes n’ont subi aucune modification postérieure : « elles sont là telles que chaque jour elle furent notées sur le carnet. Plus tard le Capitaine Desagneaux en les recopiant leur adjoint des coupures de presse qui venaient les compléter ou les recouper ». Un journal aide-mémoire donc, qui permit à l’auteur de « prendre conscience de ce qu’il vivait », un moyen d’être sûr qu’il ne devient pas fou (page 8).
La première année de guerre, vécue dans le chemin de fer est une année d’attente. L’auteur est un témoin éloigné des choses du front, aussi il relaye à l’envi les psychoses et les ragots d’août 1914, à défaut d’un véritable intérêt dans l’emploi qu’il occupe. Ainsi, les deux premiers chapitres qui couvrent la première année de guerre, du 2 août 1914 au 10 novembre 1915, ne couvrent que 38 pages.
Début 1916, son affectation dans le 359ème R.I., régiment d’active, sans cesse à la peine, va plonger l’auteur dans un enfer perpétuel de mort et de souffrance. Sans souci de style Desagneaux reporte cette horreur et introduit le lecteur « in situ », dans la tranchée invivable, le froid, la boue, les gaz, les râles et le sang. Dès lors, il livre un excellent témoignage, dont on trouve des similitudes d’intensités avec celui de Dominique Richert (il passe d’ailleurs à Saint-Ulrich, village du poilu alsacien) par le réalisme des descriptions d’attaques.
Henri Desagneaux est de surcroît un officier de réserve, lieutenant puis capitaine ; il n’en a donc pas la retenue militaire et ne se prive ainsi pas dans la description de ses sentiments sur les hommes et les choses militaires qui l’entourent. Sans souci de pondération, il écrit dans ses notes ce qu’il ressent et chacune des inepties qu’il rencontre est rapportée avec zèle. Officiers, techniques, moral, habitudes typiquement françaises sont critiquées au même titre que la gestion déplorable des hommes, tant dans l’attaque, en tout temps, que dans la crise morale de 1917. Desagneaux confirme et enfonce le clou ; le soldat craque, se suicide avant l’attaque, râle en implorant qu’on l’achève, souffre plus que le supportable, mais le soldat est aussi sale, voleur, là où l’officier d’active est planqué et le commandement incompétent et loin de toute réalité. Autant de personnages décrits avec réalisme dans leur diversité. Ce sont donc trois années de guerre qui sont bien décrites, de 1916 à 1918 où Desagneaux, en témoin honnête, déroule sa vie de soldat, dure et teintée de profond dégoût.
Ainsi, l’ouvrage offre une multitude d’anecdotes, de détails et de tableaux sur la guerre dans les différents milieux côtoyés par l’auteur. Les renseignements sur les hommes, bruts et sans retouche littéraire, sont à privilégier. A noter aussi de très bonnes descriptions psychologiques de l’attaque.
En bon agent de chemin de fer, les premières pages en témoignent. Desagneaux déplore ainsi les rames superbes du Paris-Vienne dégradées par la « destruction française » (page 16) et relève la moyenne des trains à la mobilisation ; 2,5 km/h. Il relève les inscription sur les trains (page 18) et la mort de notables en auto, tués par des G.V.C. dans lesquels il y a trop d’alcooliques (page 19). Il relève qu’il y a trop de non-combattants à l’arrière (page 21), les carences dans l’organisation du transport des blessés et du ravitaillement (page 21) et voit arriver au front les voitures hétéroclites de livraisons des magasins parisiens (page 23) mais au final, il conclut pour cette période, le 18 août 1914 : « La mobilisation est terminée ; le tout, au point de vue chemin de fer, s’est passé avec une régularité parfaite, avec un retard de 2 heures sur l’ensemble des 18 jours, pour l’horaire établi » (page 24). Plus loin, il compare la régulation effectuée et le chiffre des denrées transportées pour une armée dans le premier Noël de guerre (page 41).
Sa tâche effectuée, il devient plus critique envers ce qui l’entoure. Il commence, comme tant d’autres, par éreinter le XVe corps dont il dénonce la lâcheté (pages 30 et 37) et les exactions (page 37). Sa rancune semble tenace car il reviendra sur ces « Lâches ! gens du midi » en juin 1918 (page 240). Constatant un grand nombre d’automutilation et de blessures à la main des soldats pour quitter le front (pages 33 et 35), il fustige rapidement le service de santé entre anarchie médicale et débauche (page 34), voyant 180 médecins en réserve à Gray, au comportement écœurant (page 37). Volontiers colporteur d’espionnite, une usine allemande de chaux à Ceintrey, devient une base arrière allemande (page 38). Réaliste, il indique à plusieurs reprises dans son récit la réalité des ordres donnés d’en haut. En avril 1916, il note : « les généraux n’ont tien à mettre sur leur rapport quotidien, alors le même refrain revient chaque jour : faire des prisonniers. On envoie des patrouilles sans succès, cela se passe généralement à aller pêcher du poisson dans la Seille à coups de grenades. Le lendemain, on fait un rapport et on recommence » (page 66). Il relève l’ineptie des travaux commandés selon les unités successives (page 67) mais, arrivé à Verdun, la réalité change : « C’est une lutte d’extermination, l’homme contre le canon. Aucune tactique, la ruée totale » (page 77), « on vit dans le sang, dans la folie » (page 85), pour déféquer, « il faut faire dans une gamelle ou dans une pelle, et jeter cela par-dessus notre trou » (page 84) et « à la 24ème compagnie, deux hommes se suicident » (page 86). Il n’est pas étonnant qu’il reporte le rêve des soldats de la bonne blessure : « On en vient à souhaiter, la mort non, mais la blessure de chacun pour être partis plus vite. (…) L’un abandonne une main, l’autre fait cadeau de son bras, pourvu que ce soit le gauche, un autre va jusqu’à la jambe. » « Quelle vie ! de faire à chaque instant l’abandon d’un membre pour avoir la possibilité de revenir » (pages 201 et 202).
Verdun quittée, le calme revient. Desagneaux évoque dans son secteur (Bois-le-Prêtre) des fraternisations et des échanges de cigarettes (page 95) et voit revenir des notes idiotes comme des inventions inutiles comme les gargarisme contre la diphtérie (page 101). Il note en avril 17 une augmentation de la désertion (page 102) et de l’alcoolisme (pages 102, 121 et 130)et donc une augmentation des conseils de guerre le 3 avril 17. C’est le départ des mutineries qu’il constate et pour lesquelles il est très prolixe puisqu’il y consacre 36 pages (pages 129 à 155).
Bien qu’officier, il n’est pas tendre avec sa hiérarchie amont. Sur une note de colonel, il commente : « la première ligne doit être attractive et non répulsive », toutefois, on ne le voit jamais au front (page 118). Et Pétain, qui a rassemblé ses officiers : c’est une « brute, triple brute (…) [il] ne s’est pas montré un grand chef, tout au moins pas humain » page 151). Plus loin, il accuse un colonel peureux, qui organise toutes les batailles pour sa seule protection ! (page 247) et voit un officier saoul pour l’attaque (page 258). Proposé pour la légion d’honneur, il apprend même, le 10 août 1918, « qu’à la division on ne peut avoir cette récompense que si l’on a été mutilé ! » (page 263). Son amertume grandit ainsi avec l’exercice du commandement sous le feu, tellement différent du « badernisme » (page 275) et devant les pertes que son unité subit en 4 mois (pages 269 et 270). Desagneaux grogne ! Il râle contre la paperasserie inutile (page 192), les citations aux hommes… de l’arrière (page 160), le gâchis, suite à un ordre d’allègement des sacs (page 191), contre les embusqués (page 213) une attaque sans morts … à refaire ! (page 255) ou contre le gendarme qui chasse le braconnier, mais pas sur le front. ! (page 282).
Outre sa mauvaise humeur permanente, nombreuses sont ses descriptions aussi justes que dantesques : une corvée de soupe effroyable sous les obus (page 204), un PC devant le Kemmel (page 208), l’illustration d’une attaque, minute par minute (page 215 ou 234). Ponctuée de tableaux horribles, il décrit horrifié différents visages de morts mutilés (page 248), le résultat dantesque pour les occupants d’une automitrailleuse prise sous des balles anti-chars (page 261) ou, horreur de l’horreur, un homme cadavre vivant (page 267).
L’ouvrage présente au final un intérêt testimonial formidable, rehaussé d’une présentation originale insérant le communiqué officiel ou l’article de presse dans sa situation chronologique, démontrant le fossé entre la réalité et le quotidien du soldat. Sont insérées également en marge des photos, connues ou inédites, malheureusement trop petites et tronquées toutefois.
Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.