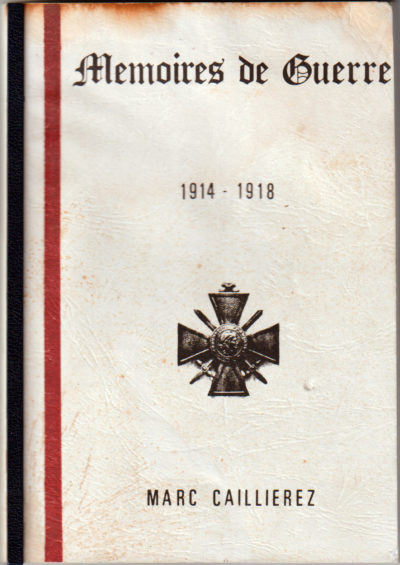HEILIGENSTEIN Gérard, Mémoires d’un observateur-pilote 1912-1919 Auguste Heiligenstein, Paris, Les éditions de l’Officine, 2009, 227 p.
Le témoin
Auguste Heiligenstein est né le 6 décembre 1891 à Saint-Denis. Ses parents, natifs d’Obernai (Alsace), ont quitté cette région après la guerre de 1870, ayant choisi la nationalité française. Artiste décorateur sur verre dans le civil, il est incorporé en 1912 au 26e Régiment d’artillerie pour effectuer son service militaire. Il passe et réussit l’examen de brigadier, puis celui de sous-officier. Transféré avec son régiment à Chartres, il est désigné chef de section de la 23e batterie lorsque la guerre éclate. Il connait le baptême du feu dans la Meuse, lors des combats de Vaudoncourt et Spincourt les 23 et 24 août 1914. Après les affrontements de la bataille de la Marne, son groupe est désigné pour compléter l’artillerie de la 65e DI, et participe aux batailles de Chauvoncourt et des Paroches. Il est nommé sous-lieutenant le 5 novembre 1914, et prend le commandement de la 22e batterie. Cantonné au fort des Paroches, et l’inaction se faisant plus pesante, il devient observateur en ballon. Il monte aussi un service d’élaboration de cartes établies à partir de ses observations, avant qu’en juin 1915, la 65e division ne soit transférée dans la Woëvre et au bois le Prêtre près de Pont-à-Mousson. C’est là qu’il est désigné pour être observateur en avion à l’escadrille de la division, la MF 5, basée à Toul. Un an après, en juin 1916, il passe à l’escadrille MF 44 jusque fin février 1917. C’est dans cette unité qu’il obtient son brevet de pilote. Muté à la C 106 qui deviendra la C 229, il participe à l’offensive du Chemin des Dames du 16 avril 1917 où il est nommé adjoint de son chef de secteur, en charge des observateurs. Nommé lieutenant le 16 mai 1917, sa carrière au front s’interrompt brutalement à la suite d’un accident d’avion le 17 juin 1917. Après sa convalescence, il entre en janvier 1918 au SFA (Service des Fabrications de l’Aviation) où son activité consiste à contrôler certaines usines fabriquant des avions jusqu’à la démobilisation le 15 août 1919. Il reprend alors avec succès sa carrière d’artiste spécialisé dans les émaux transparents sur verre, participant à de nombreuses expositions internationales. En 1939, il est rappelé par l’armée de l’air comme instructeur et donne des cours sur l’observation et la reconnaissance aérienne à la base aérienne 109 de Tours. Nommé capitaine, il évite par son action la captivité du personnel de cette base. Après la Deuxième Guerre mondiale, il reprend sa carrière d’artiste dans l’art de la céramique. Il s’éteint le 23 mars 1976 à l’âge de 85 ans, après une vie bien remplie.
Le témoignage
Les mémoires d’Auguste Heiligenstein ont été retranscrites par son fils Gérard, alors que son père les avait écrites entre 1964 et 1968, soit presque 50 ans après la guerre. Le livre est divisé en 7 chapitres, dont les deux premiers traitent du service militaire et de ses débuts en tant qu’artilleur. Les autres chapitres retracent sa carrière dans l’aviation. L’ouvrage est complété par un cahier iconographique qui présente des extraits des albums de l’auteur, des photographies, quelques croquis et les textes des citations obtenues. A noter aussi quelques pages relatives au parcours d’Auguste Heiligenstein avant et après la Deuxième Guerre Mondiale, ainsi qu’un index des noms cités.
Le texte est malheureusement émaillé de nombreuses coquilles, sans que l’on sache si cela vient du texte d’origine ou si ce sont des erreurs de retranscription. On trouve donc de nombreuses fautes d’orthographe, de conjugaison, une ponctuation parfois hésitante. Certaines phrases semblent tronquées par manque de mots, d’autres en ont trop. Tout cela laisse une désagréable impression au lecteur, et il est étonnant que l’éditeur ait laissé passer de telles erreurs dans la version finale. On dirait qu’il n’y a pas eu de relecture et des fautes qu’il eût été facile de corriger sur les noms de lieux ou de personnes abondent : Pluvenelle pour Puvenelle, Pelltier d’osy pour Pelletier d’Oisy (p. 96), Billy Coopens (p. 169) pour Willy Coppens… Cependant, les témoignages d’aviateurs de la Grande Guerre sont trop rares pour que l’on fasse trop de reproches à la publication de celui-ci.
Analyse
Le parcours d’Auguste Heiligenstein, qui est resté près de 7 ans dans l’armée, a la particularité d’être très varié et il rapporte ce qu’il a vécu en tant qu’artilleur, observateur, pilote, réceptionnaire au S.F.A.. Dans ses souvenirs, on sent à plusieurs reprises que l’auteur a une certaine volonté pédagogique. On le remarque par exemple, quand il détaille la composition et le fonctionnement d’une batterie de 75 (p. 37). Il adopte la même attitude quand il parle de l’aviation, introduisant de cette façon une description des biplans utilisés à cette époque: « Pour les jeunes il faut que je parle de ces ancêtres de l’aviation. » (p. 69) Ce qui semble démontrer l’espoir d’être lu et la volonté de témoigner pour les générations futures.
Il rapporte quelques anecdotes intéressantes de son expérience d’artilleur, comme lorsqu’il aperçoit près du fort de Troyon « des meules de blés qui se déplaçaient », arrêtées net par un tir précis. (37). Ou encore quand il aperçoit les Allemands en train de déménager un piano de la villa qu’occupait en temps de paix, le capitaine du fort des Paroches. Celui-ci averti du larcin en cours, ordonne à Auguste Heiligenstein de tirer. Un seul coup heureux stoppe le déménagement, et fait des dégâts dans le camp adverse, ce qui lui inspire cette réflexion : « J’étais très fier de ce coup heureux, mais vraiment, ce que la guerre peut transformer un homme et le rendre sanguinaire et cruel » (p. 54).
Le baptême du feu est une épreuve difficile pour sa batterie, dont le premier mort est un évènement traumatisant et provoque la consternation parmi ses hommes :
« Nous fûmes pris en enfilade par une batterie ennemie qui fit beaucoup de dégâts. J’étais à côté du capitaine à son observatoire pour essayer de repérer le départ des coups quand j’entendis des hurlements dans la batterie, il me demanda d’aller voir ce qui se passait. En arrivant je trouvais un des servants de ma section blessé très gravement et ses camarades atterrés, un obus explosif avait éclaté en arrière du caisson et un fort éclat avait traversé une des portes en tranchant les fesses du malheureux camarade. Il n’y avait pas d’infirmier dans la composition d’une batterie et aucun des servants n’osait s’occuper du blessé, force me fut de faire le nécessaire, heureusement que le tir cessa. J’ai toujours eu horreur du sang et j’aurais fait un mauvais chirurgien, mais comme personne n’osait toucher le blessé, je pris mon courage à deux mains et après l’avoir débarrassé de ses vêtements je trouvais une plaie affreuse, je fis un premier pansement en utilisant tous les pansements individuels des hommes de la pièce. Les infirmiers ne vinrent pas et il fallut attendre pour évacuer le blessé. […] Nous quittâmes la position de batterie en fixant notre blessé avec des bottes de blé sur un caisson, malheureusement en arrivant sur la route une salve de 77 fusants nous accueilli, l’affolement des chevaux et des conducteurs fit tomber du caisson notre malheureux camarade ce qui lui déclencha une forte hémorragie. En arrivant le médecin alerté ne put que constater le décès et nous l’enterrâmes le lendemain matin dans le petit cimetière du pays. Ce premier mort jeta la consternation dans ma section, nous aimions beaucoup ce camarade très serviable et surtout très gai, ayant toujours un bon mot et une chanson pour remonter le moral de ses camarades. La grande faucheuse, avait dans nos rangs, commencé ses ravages. Nous venions, cette fois de recevoir le vrai Baptême du feu » (p. 35-36).
Il est aussi témoin d’un cas de folie, lorsqu’il rencontre un maître pointeur artilleur du 55e R.A.C., « Dans un croisement j’aperçus un homme qui marchait et paraissait lourdement chargé, en m’approchant de lui je vis avec stupéfaction un artilleur du 55e RAC avec des yeux hagards et qui portait sur son épaule une culasse de 75, celle de son canon. Je lui adressai la parole et sans me répondre il continua son chemin ! Quelques-uns de mes hommes le firent monter sur un caisson, par bribes il nous fit savoir qu’il était maitre pointeur et qu’il appartenait à la batterie qui avait été détruite près de nous. Le massacre de ses hommes l’avait rendu fou » (p. 41).
Il évoque des changements de position journaliers, afin de faire croire à l’ennemi « qu’il y avait beaucoup d’artillerie dans le secteur » (p. 42). Grâce à un certain talent de diplomate, il désamorce un début de rébellion dans son ancienne batterie, provoquée par le comportement d’un capitaine trop tatillon qui s’était mis à dos ses hommes. Faisant office d’observateur au fort des Paroches, et le front s’étant stabilisé, peu à peu, la routine s’installe. Il devient donc aérostier et décrit les difficultés rencontrées lors d’un réglage d’artillerie en ballon. Il n’hésite pas à critiquer le comportement de ses camarades ou de ses chefs que ce soit dans l’artillerie, l’aérostation ou l’aviation. Ainsi dans l’artillerie, un de ses hommes connait une défaillance :
« Je trouvais le pauvre maréchal des logis V., mon chef de pièce, anéanti par terre incapable de faire un mouvement, heureusement que son pointeur était d’une autre trempe. J’ai décidé d’en parler le lendemain au capitaine et de lui faire rendre ses galons qu’il ne méritait pas. La nuit se termina sans notre intervention. Le lendemain il rendit ses galons et nous l’envoyâmes au train des équipages, un peu à l’arrière comme conducteur, ce qui était une grave punition pour lui. C’était la première fois que je prenais une aussi grave décision surtout avec un bon camarade et j’en eus beaucoup de peine, mais la discipline doit être plus forte que l’amitié » (p. 39).
Alors qu’il est aérostier, un obus éclate à proximité de sa compagnie. Le capitaine se réfugie sous le treuil et ses hommes se dispersent. « je ne pus m’empêcher de dire son fait à ce lamentable capitaine qui probablement voyait le feu pour la première fois » (p. 59).
Dans l’aviation il fait des remarques sans concessions sur ses chefs d’escadrille. Quand il passe de la MF 5 à la F 44, il dit ne pas regretter « son chef, pilote d’avant-guerre que je n’avais pas vu voler souvent (il effectuait comme beaucoup d’autres les heures mensuelles nécessaires pour ne pas perdre la prime de vol de 10 f par jour » (p. 88). Son nouveau chef, pour un temps seulement, ne trouve pas grâce complètement à ses yeux, car « lui aussi n’était pas un fanatique pour voler près des lignes ennemies » (p. 88). Son remplaçant, ne semble guère mieux : « Nous ne l’avons jamais complètement adopté car lui aussi ne montait pas souvent dans son zingue » (p. 90).
Il est un fait communément admis que pour avoir le respect et l’entière confiance de ses hommes, un commandant d’escadrille se devait de voler aussi souvent que possible, comme son personnel navigant. Mais les chefs d’escadrille ne sont pas les seuls à connaître des manquements, les pilotes eux aussi peuvent ne pas se montrer à la hauteur. C’est le cas de l’un d’eux, un chasseur, qui devant protéger l’avion d’Auguste parti en mission photographique, manqua le rendez-vous fixé à l’avance. Le chasseur ne s’étant pas montré, Heiligenstein et son pilote furent pris en chasse par un Fokker et essuyèrent des rafales ennemies. « Le Morane avait bien quitté la base et comme il avait peur d’être trop en avance il était allé dans la direction de Nancy et avait eu une panne. Nous n’en crûmes pas un mot car il ne passait pas pour être un foudre de guerre et donc jamais plus nous ne lui adressâmes la parole » (p. 71).
Il témoigne aussi certaines barrières sociales plus ou moins tangibles entre les gens de l’air. Observateur récent dans l’aviation, Auguste Heiligenstein observe ses homologues et ressent l’impression de ne pas appartenir au même monde : « Les observateurs à cette époque étaient pour la plupart brevetés d’état-major polytechniciens ou ingénieurs de Centrale, aussi nous les sortis du rang, nous étions au bout de la table […] Pas souvent admis dans les interminables parties de bridge ou de poker qui se terminaient tard dans la nuit, nous n’étions pas tenus à l’écart mais nous sentions que nous n’étions pas du même bord » (p. 65).
Il évoque aussi les différences qui pouvaient se dresser entre militaires issus d’armes différentes, surtout pour ceux qui étaient issus d’une arme moins prestigieuse ou qui n’avaient pas l’expérience du combat, ce qui pouvait engendrer un certain malaise :
« Dans l’armée il y avait des cloisons bien étanches entre fantassins, cavaliers et artilleurs mais elles étaient encore plus fermées au train des équipages, aussi mon chef d’escadrille en subissait les conséquences quand il venait avec moi, simple sous-lieutenant, en mission auprès des états-majors. Il en revenait toujours un peu gêné car c’était toujours à moi que l’on expliquait les missions et il restait toujours en dehors des discussions. Il était un peu considéré comme un chef de garage, chargé de fournir des avions en ordre de marche. D’autre part nouveau venu dans l’arme, quoique capitaine, il n’avait pas encore reçu de citations ce qui le mettait en état d’infériorité vis-à-vis de moi-même. Aussi nos rapports sans être difficiles n’étaient pas très amicaux, mais il me laissait entièrement libre dans la direction de mes observateurs et je sentais malgré tout une espèce d’animosité » (p. 117).
Auguste Heiligenstein parle aussi, à deux reprises, du rôle important des aviateurs sur le moral des fantassins au cours des missions d’observation et de liaison d’infanterie. Cela est particulièrement vrai dans les périodes d’offensives quand l’infanterie est soumise à rude épreuve : « Avec les renseignements précis que l’on donnait sur les destructions de mitrailleuses que l’on repérait, on pouvait arrêter l’avance et surtout cela remontait le moral des troupes engagées. Notre présence leur montrait qu’elles n’étaient pas abandonnées. Chaque fois que j’allais rendre visite aux colonels des régiments au repos ils me dirent tout le bien que nous faisions aux poilus quand nous les survolions à basse altitude. » (p. 90-91). « Notre présence, en prenant les mêmes risques, avait aussi beaucoup d’importance » (p. 101).
Sur ce point, il rejoint ainsi le témoignage d’un de ses camarades d’escadrille à la MF 44, Jean Béraud-Villars, l’auteur de Notes d’un pilote disparu, publié sous le pseudonyme du lieutenant Marc cité dans le livre de Jean Norton Cru Témoins. Celui-ci expliquait que la présence d’un avion, survolant une unité de fantassins isolée et pratiquement encerclée en première ligne, en prenant des risques insensés, avait pour seul but de montrer aux Poilus qu’ils n’étaient pas complètement oubliés par le commandement et coupés du reste du monde. On apprend par ailleurs, grâce aux mémoires d’Heiligenstein, que Béraud Villars « reçut une balle dans le bras au cours d’un combat qui l’a laissé handicapé pour le restant de ses jours» (p. 111).
A aucun moment, Auguste n’éprouve de haine particulière pour les Allemands. Un chasseur français ayant descendu un adversaire, il vient voir le lieu de chute de l’avion ennemi : « Avec quelques camarades nous allâmes voir le triste spectacle, en arrivant au sol l’avion avait explosé et les deux aviateurs étaient morts sur le coup. Nous pensâmes que c’était peut-être aussi, le sort qui nous attendait. Ayant retrouvé sur eux papiers et argent, un des chasseurs quelques jours après alla jeter un message lesté contenant ce qui avait été trouvé ainsi que l’endroit où ces aviateurs avaient été enterrés. Le geste fut mal interprété au grand état major et une note nous interdit de recommencer cet hommage aux morts ennemis. » (p. 74)
Cette pratique rendant hommage aux adversaires était assez largement répandue et de nombreux témoignages la confirmant existent.
Il expose fréquemment ses idées pour améliorer la communication entre aviateurs et troupes au sol, comme l’usage de draps blancs pour communiquer avec les batteries d’artillerie (p. 76), milite pour l’adoption d’avions monoplaces équipés de la T.S.F., et donne des leçons de pilotage avec des avions à double commande pour donner une chance à l’observateur d’atterrir au cas où son pilote ne serait plus en mesure de le faire lui-même.
On retrouve dans les mémoires d’Auguste Heiligenstein, certains thèmes fréquemment rencontrés dans les témoignages d’aviateurs : la vie d’escadrille (p. 94) et ses inévitables facéties, les nombreux gueuletons pour fêter les récompenses obtenues par les uns ou les autres, les accidents, les combats aériens ou péripéties en cours de vol. Il fournit aussi des détails sur les avions, le matériel utilisé et les conditions dans lesquelles il était employé :
« pour tirer à la mitrailleuse placée sur un support orientable, de même que pour prendre des photos, il fallait se mettre debout et pour ne pas être éjecté dans les remous, il était nécessaire de s’attacher le pied gauche à une attelle placée au fond de l’habitacle » (p. 69). L’armement des avions, surtout au début de la guerre, est souvent inadapté à l’aviation comme ce mousqueton « qu’il fallait réarmer à chaque coup et qui servait surtout à nous donner une contenance » (p. 70). Les mitrailleuses d’infanterie Saint-Etienne ne sont guère mieux : « Nos mitrailleuses s’enrayaient souvent et n’étaient pas pratiques, lourdes à déplacer, alimentées par des bandes de cartouches qu’il fallait enfiler et recharger à chaque rafale. Ce n’était pas facile avec les gants fourrés que l’on était obligé de porter quand il faisait froid et engoncés dans de grosses peaux de bique ce qui gênait beaucoup les mouvements (p. 70) ».
Le témoin rencontre aussi de nombreuses personnalités de l’époque. Dans l’aviation, des as comme Jean Navarre ou Charles Nungesser, dont il prétend même avoir eu à un moment donné la même petite amie que lui (p. 68), mais aussi des sportifs d’avant-guerre, le boxeur Georges Carpentier, le champion de tennis André Gobert. Dans le monde du spectacle (Firmin Germier, Lucien Guitry, Jean Galipeau) et dans celui de la politique (Maurice Barrès). Il n’est pas insensible aux honneurs puisque le jour de sa remise de la légion d’honneur, longtemps convoitée, il considère qu’il s’agit là de la journée la plus importante de sa vie (p. 140).
Un épisode important témoigne de l’écrasante responsabilité qui pouvait peser parfois sur les épaules des officiers observateurs de l’aviation. Une attaque étant prévue sur la côte 304, le 7 décembre 1916, Auguste Heiligenstein est désigné pour assurer la liaison d’infanterie. Le matin de l’attaque, une brume épaisse et persistante recouvre la région, rendant la mission difficile et dangereuse. Constatant que la préparation d’artillerie avait été totalement inefficace, les tranchées allemandes étant restées intactes, il prend la décision de faire arrêter in extremis l’attaque pour éviter un massacre. L’assaut stoppé, il est convoqué et doit rendre compte à l’Etat-major du corps d’armée et se justifier : « J’expliquais dans le détail la mission minute par minute avec les notes qu’heureusement j’avais consignées et malgré mes affirmations je sentais une suspicion. En attendant les résultats d’enquêtes, je m’étais réfugié au mess de l’artillerie ; effondré à bout de nerfs je me mis à pleurer» (p. 104).
Finalement conforté dans sa décision, il recueillit plus tard les fruits de cette belle attitude. L’attaque reportée réussit quelques jours plus tard et fut couronnée de succès. « Après nous avoir donné l’accolade, un « hip hip hip hourra » hurlé par tous les poilus, cette ovation spontanée fut une belle récompense. Ils savaient les risques que nous avions pris, ils avaient entendu les mitrailleuses et les fusils cracher leur mitraille sur notre avion qu’il fallait abattre. C’est dans une telle ambiance que l’on puisait le courage de recommencer à prendre de sérieux risques dans ces missions si importantes » (p. 104).
Un autre temps fort de sa carrière dans l’aviation est son intervention auprès du Service des Fabrications de l’Aviation en tant que réceptionnaire. Ayant relevé des vices de conception dans la construction d’un nouveau prototype d’avion, il fait interrompre la chaîne de fabrication de cet appareil. Mis en cause par l’ingénieur responsable de ce biplan de chasse devant le ministre, sa décision est finalement approuvée après enquête. « Je sus beaucoup plus tard que l’essai avait été truqué pour satisfaire aux épreuves de réception du prototype, il y a eu quelques scandales à Villacoublay à ce sujet » (165-166).
Conscient de l’importance de son rôle, il réitère un peu plus tard une décision similaire concernant un avion Salmson blindé. « Il était très important de ne laisser partir dans les escadrilles que des avions sérieusement contrôlés, car il y avait assez de danger en remplissant les missions sans avoir les risques d’appareils impropres à celles-ci et qui risquaient de se casser en l’air » (p. 170).
Auguste Heiligenstein, en guise de conclusion, clôt ses mémoires en estimant que la guerre a complètement transformé sa vie. « Le fait d’avoir été nommé officier m’a fait gravir d’un seul coup de nombreux échelons dans l’échelle sociale et m’a permis de fréquenter sur un pied d’égalité des hommes qui sortaient de milieux que j’ignorai totalement ce qui m’a permis de mesurer ma valeur réelle. » (p. 175)
Eric Mahieu