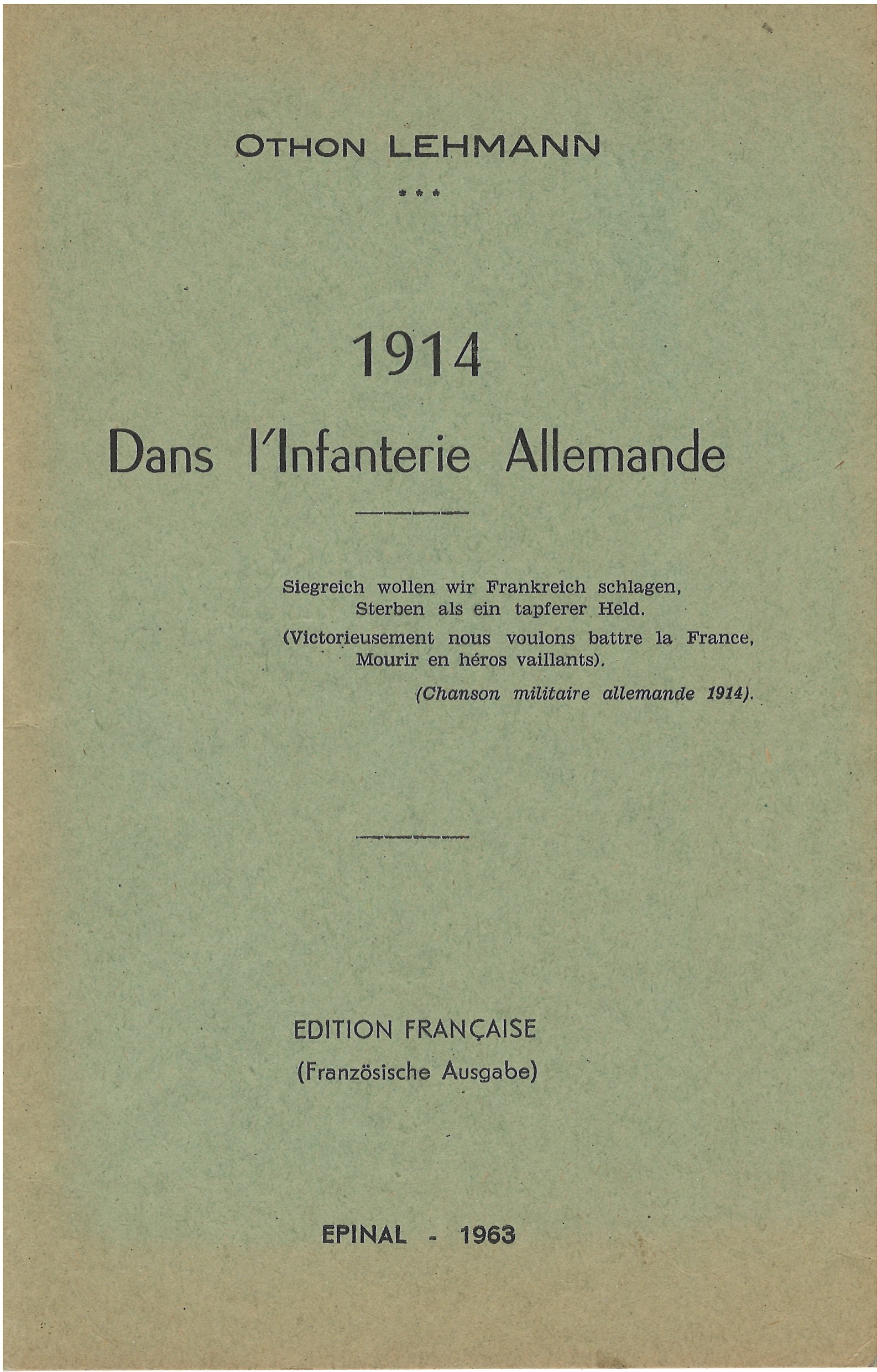Résumé de l’ouvrage :
Sur la ligne d’un front indéterminé, un simple sergent anonyme, dans un régiment non désigné, se mue en témoin de la vie et d’épisodes de quelques compagnies, aux personnages pittoresques, dont le soldat Baris, venant des « Joyeux » (soldats issus du 5ème Bataillon de Chasseurs d’Afrique). Celui-ci gagne héroïquement ses galons noirs, les deux ficelles de laine qui marquent maintenant son grade de caporal. Hélas, à la suite d’une bagarre déclenchée dans un débit de boissons, un lieutenant, sur la fausse déclaration d’un soldat, entraîne la cassation du grade de Baris. Ces deux derniers disparaissent ensuite dans les tourbillons d’une attaque qui disloque le petit monde décrit par l’auteur, qui retrouve quelques survivants après la guerre.
Commentaires sur l’ouvrage :
Comme pour Jérôme et Jean Tharaud, c’est Jean-Norton Cru qui, par son enquête sur la véracité du témoignage et le parcours des auteurs des grands ouvrages sur la Grande Guerre, nous donne les éléments biographiques utiles à retracer le parcours militaire de Georges Gaudy, complété par sa fiche wikipédienne (Georges Gaudy – Wikipédia (wikipedia.org)) et dont le « grand œuvre » est un triptyque de souvenirs intitulé « Souvenirs d’un poilu du 57ème régiment d’infanterie ». Comme les frères Tharaud, auxquels est dédié ce livre en incipit, Georges Gaudy est né à Saint-Junien, en Haute-Vienne (87), le 18 février 1895, d’un père comptable. Georges Gaudy décède le 9 février 1987 à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Alors qu’il est encore étudiant en langue étrangère, il précède de quelques mois l’appel de sa classe et se porte volontaire. Il intègre alors le 57ème RI à partir de septembre 1915, régiment dans lequel il fera toute la guerre. Il arrive au front le 19 février 1916, dans le secteur de Troyon (Aisne) puis fait Verdun (mai 1916) et attaque au Chemin des Dames en 1917. Le 25 mars 1918 il est engagé vers Noyon et participe au mois d’avril suivant à la défense du Mont-Renaud (Oise), en avant de Ribécourt. Il est nommé caporal en mai 1916 puis sergent en avril 1918, est blessé plusieurs fois, cité deux fois à l’ordre du régiment, bénéficiant d’excellentes notations. En février 1919, il est promu aspirant avant d’être démobilisé en septembre. Il sera plusieurs fois décoré. Il n’est donc pas étonnant de trouver ces trois grades dans cet ouvrage ; le narrateur anonyme qui se présente dès la première phrase est sergent (p. 7) ; le soldat Baris, dont le parcours donne le titre à cet ouvrage, est caporal (p. 90) et le dernier chapitre trouve le narrateur à Saint-Cyr, préparant le grade d’aspirant (p. 211). L’autre emprunt à l’œuvre des frères Tharaud vient de la construction de l’ouvrage, similaire dans sa composition à « Une relève », Tharaud, Jérôme (1874-1953) et Tharaud, Jean (1877-1952) – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org), suite de tableaux de courtes durées sur la période de la Grande Guerre. Toutefois, ces « Galons Noirs » n’en sont qu’une pâle copie sans réel intérêt de ce qui semble en effet basé sur les propres souvenirs de l’auteur, le livre étant écrit après 1925, et le parcours militaire de Gaudy. Aussi peu d’éléments sont à tirer de cet ouvrage imprécis, à l’apparence d’une pièce de théâtre, introduisant des tableaux mais traités de manière incomplète (le vol, la bagarre, l’attaque, la considération sur le soldat, le meurtre même) qui sont traités de manière incomplète et stylistiquement maladroite. De même, la vision d’une armée brutale (le premier chapitre est par exemple fortement teinté d’une frénésie de militarisme casernier) et martyrisante teinte le livre d’une couleur gauchement pacifiste. Dans Les galons noirs, Gaudy n’atteint donc pas la qualité des souvenirs composites qu’il a pu produire dans son œuvre précédente.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 46 : Sur la guerre révélant l’homme : « Dix jours de bataille dénudent mieux une âme que trente ans de vie commune dans une province morte »
53 : Sur la difficulté de comprendre la guerre : « Ceux qui n’ont pas vu la nuit descendre sur un champ de bataille ne peuvent me comprendre ».
57 : Hallucination collective du guetteur au créneau nocturne.
88 : Sur le devenir du héros après la guerre : « Dispersé par la paix, nous irions, chacun dans notre voie, poursuivre nos destinées. Les archives du régiment garderaient l’histoire des faits qui nous honorent plus que tout. Mais qui viendrait les feuilleter ? »
95 : Vue sommaire d’un artisan de tranchée
134 : Officier assassinant un soldat trouillard
Yann Prouillet, juin 2024
Tharaud, Jérôme (1874-1953) et Tharaud, Jean (1877-1952)
Une relève, Paris, Plon-Nourrit, 1924, 247 pages.
A l’occasion du déplacement du régiment pour une relève, un caporal dresse une succession de tableaux des paysages et des situations qui défilent sous ses yeux dans le secteur de Reims à une date inconnue de la Grande Guerre. Il s’agit en fait de tableaux littéralisés permettant l’évocation de lieux ou de situations glorifiant les hommes (de toutes nationalités), la Nature et les sentiments. Le premier de ses tableaux évoque la rumeur, les « canards du front » qui font voyager à l’estime, depuis les Flandres, le régiment dons toutes les directions possibles. Le second amène l’unité du narrateur sur « les pentes longuement inclinées de la montagne de Reims », à Verzenay, d’où « de ce haut belvédère, [il] regarde Reims qui brûle ». Relevant une brigade russe, il en profite dans son troisième tableau pour décrire quelque peu le « contraste entre deux humanités », dont « le grand troupeau moscovite » mêlant « mine enfantine et brutale à la fois ». Ce rapprochant de la première ligne, « derrière la berge d’un canal », la, description du paysage, martyrisé mais tranquille, même si « sans héroïsme » permet la réflexion et la contemplation de la nature et de sa faune abandonnée. La tranchée se conjugue avec « l’idée d’une menace prochaine [qui] agit sur l’âme un peu à la façon dont l’exalte l’amour (…) ; tout émeut à l’excès ». C’est le règne de l’obus qui pulvérise tout, homme comme village ». Le sixième tableau débute ainsi : « Ce soir, nous prenons la tranchée », un boyau qui mène à un « poste où [il] tombe ce soir est installé dans les sous-sols d’une ancienne ferme modèle », une cave qui mêle sépulcre et nid protecteur à ces quatre occupants qui doivent tenir le lieu et renseigner le commandement par le seul lien qui les relie au monde de l’extérieur, le téléphone. « Une prison sans portes sans verrous, sans barrières, mais plus strictement enfermés par les consignes idéales que par la plus rigide clôture, et vraiment séparés du monde par ces lignes de fer barbelé, ces hautes herbes non fauchées et l’inextricable dédale des boyaux et des tranchées ». Ce milieu particulier confine à l’introspection et à l’analyse du soi. Ce téléphone et le personnage du septième tableau, qui permet de décrire le rôle comme la vie de l’escouade désœuvrée, son rôle météorologique et tout compte-rendu insignifiant réalisé. Dès lors, « pour échapper à l’ennui, on se réfugie dans le sommeil ou bien dans la lecture, comme on monte dans un arbre pour fuir une inondation » ou « on écrit une lettre ; on attend celle qui se promène sur les routes », prétexte à s’épancher sur ce seul lien avec l’être aimé comme avec l’humanité. Mais « ce téléphone sans vie, que nous veillons comme un mort et qui n’annonce jamais rien » annonce un jour un jour « le Kaiser a démissionné ! », « folle invention » qui jette un émoi diviseur (d’une demi-heure seulement toutefois), au sein du petit groupe humain, « braves gens de chez nous ! honnête peuple de France ! » le 8ème tableau revient sur les compagnons de tombeau qui se catalyse autour du Capitaine Fracasse, prétextes aux bavardages dont le caporal se plaint finalement, y préférant un silence finalement la denrée la plus rare au front. Le neuvième tableau souligne le contraste entre la vie souterraine, « où chacun est emprisonné dans la terre » et l’extérieur, où existe encore fleurs et oiseaux dans le « miracle de la lumière ». Le 10e tableau est celui du calme quasi-mortuaire déchiré tout à coup par l’obus qui trouve son chemin vers le téléphone dont il ne parvient pas à briser la boîte toutefois et qui finalement ne change rien à la « platitude ordinaire » de la morne existence. Le 11e chapitre fait état du résultat du bombardement, qui laisse derrière lui poussière et gravats de ce que furent maisons, église et village. Le dernier chapitre finit en parabole. Le caporal quitte enfin cave et boyau ; c’est tout aussi enfin la permission, la maison bruyante et animée de la vie des femmes et des enfants, d’où le caporal écrit, évoquant à mots couverts la mort de Jean, absent de la table et pleuré par les enfants du lieu.
Commentaires sur l’ouvrage :
En fait, c’est Jean Norton Cru qui, par son enquête sur la véracité et le parcours des auteurs, décrypte la matérialité des souvenirs contenus dans les 12 tableaux du caporal Jean. Jérôme Tharaud (18 mars 1874, Saint-Junien (87) – 28 janvier 1953, Varangeville-sur-Mer (76)) et Jean Tharaud (né Pierre Marie Martial Charles, 9 mai 1877, Saint-Junien (87) – 8 avril 1952, Paris) furent bien mobilisés au 94e RIT d’Angoulême (178e brigade de la 89e division territoriale) dès le début d’août 1914. Ils font à plusieurs reprise référence à ces soldats de Charente et du Limousin. Le parcours du 94e RIT les amène bien pendant 6 mois (1914-1915) sur le canal de l’Yser puis sur l’Aisne (jusqu’au 5 mai 1915) puis pour faire des travaux dans les secteurs de Reims et de Fismes de mi-décembre 1915 à mi-février 1916. Du 16 février au 5 mai, le régiment occupe effectivement le secteur entre la ferme des Marquises (nord-est de Prunay) et le Fort de La Pompelle. C’est donc bien ce secteur et ce créneau temporel qui sont décrits dans les 12 chapitres d’Une Relève. On y retrouve également des éléments biographiques factuels contenus dans ces douze tableaux ; le narrateur est caporal téléphoniste, comme Jérôme, et l’autre est vaguemestre (cf. le 7e tableau Le Kaiser a démissionné). Ceci étant dit, il devient clair que les quelques données dégageables de ces quelques semaines décrites permettent de confirmer que le récit est basé sur une expérience de guerre, ce qui confirme par ailleurs le classement de Jean-Norton Cru dans la catégorie Souvenirs. Toutefois, le récit est très fortement littéralisé dans ce parcours, les quelques épisodes décrits dans ce parcours, dont la guerre n’est que le tableau de fond de scène, ne sont finalement que le prétexte à louanges à la nature (on trouve ici des similitudes avec Genevoix ou, dans la démarche stylistique, avec Pierre Jolly dans son 13 octobre Jolly, Pierre – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org)), les hommes ou les lieux, en une introspection sur le caporal dans son escouade dans la guerre. L’ensemble apparaît donc finalement superficiel et outre son style et quelques réflexions intéressantes n’apporte que peu, donnant à Une relève l’identité d’un roman plus que d’un livre de souvenirs. Cette impression est appuyée de surcroît par le dernier chapitre qui, plaçant le caporal en permission chez lui, donne l’impression que seul l’esprit du mort est revenu autour de la table familiale.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 12 : Sur la tranchée : « Les autres, préférant la tranchée, plus périlleuse assurément, mais où la discipline est plus souple et la ration de vin plus forte ».
Définition de la rumeur, semblable au moustique : « Et les fausses rumeurs de s’élever et de danser au-dessus du cantonnement, comme en été les moustiques au-dessus d’un marécage ».
50 : Vue de flamands, anglais, russes
65 : Réflexion sur le patrimoine vernaculaire de la guerre à conserver : « De l’autre côté du canal, en bordure d’un grand bois, on voit encore, clouées contre les peupliers, les niches de chapelle, où chaque soit les artilleurs plaçaient une lanterne pour guider leur tir dans la nuit. Elles sont aujourd’hui inutiles ces petites chapelles désaffectées, mais je pense que, la paix venue, il faudra garder pieusement ces fragiles abris de lumière qui nous ont protégés, comme on conserve dans les rues des vieilles villes, à l’angle de chaque muraille, ou bien dans les forêts, au creux d’un chêne vénérable, ces niches consacrées à la Vierge ou à quelque Saint rustique, longtemps après que la Vierge ou le Saint a délaissé son sanctuaire bocager ».
86 : Hypersensibilité à la Nature.
87 : Sur la protection du vivant confinant à la superstition : « … Je crois, ma parole, que j’aimerais mieux me fouler le pied que de détruire sous mon soulier une misérable fourmi, avec cet espoir inavoué qu’en ménageant une existence, si petit soit-elle, la mienne sera aussi épargnée ». (Vap p. 86 sur « la croyance aux présages »).
145 : Bruit « soyeux » des obus
159 : Sur les carnets et la pratique d’écriture du soldat. (Vap p. 162 sur la force du ressenti par rapport aux carnets de guerre).
174 : « La guerre a pris pour moi l’aspect d’un voyage en troisième classe, que je fais depuis trois ans, vers une destination inconnue ».
184 : Mort d’un pigeon, enterré par un sergent dans le cimetière des soldats
Yann Prouillet, juin 2024
Messimy, Adolphe (1869-1935)
Le témoignage du général Messimy, sous le titre Mes souvenirs, a paru en 1937 aux éditions Plon à Paris, selon la volonté de l’auteur d’attendre après sa mort (1er septembre 1935) pour la publication. Il comprend une introduction de 22 pages sans nom d’auteur, le texte principal de 382 pages et des documents justificatifs en annexe sur 42 pages. Le texte de Messimy est divisé en trois parties chronologiques : 1869-1911 ; 1911-1914 ; 1914. Il ne traite pas des commandements exercés à partir de septembre 1914, mais l’introduction en donne le résumé. À la fin de la guerre il était général de brigade, commandant une division.
La première partie évoque sa naissance à Lyon le 31 janvier 1869, fils de notaire, et son enfance dans une famille bourgeoise. Études classiques, Saint-Cyr, école de guerre. Il assiste à la dégradation de Dreyfus, persuadé comme tous les Français de la culpabilité du capitaine juif, puis la campagne de Zola lui ouvre les yeux. Il décrit ainsi les antidreyfusards :
« Dans le clan antidreyfusard, une foule de braves gens, ardents patriotes et Français de vieille souche, qui, n’ayant jamais lu que le Petit Journal ou l’Éclair, considéraient la culpabilité de Dreyfus comme une des bases fondamentales de la défense nationale, vérité révélée qu’il était criminel de discuter. Tout amour-propre mis à part, c’était là qu’on rencontrait le plus d’imbéciles. »
« Mis au ban de la société », selon son expression, il démissionne en août 1899 de l’armée dans laquelle on ne peut parler librement et dont l’honneur aurait été de réviser elle-même le procès Dreyfus. Il exerce alors pendant trois ans la profession d’agent de change en continuant à s’intéresser aux questions militaires. Dans un article qui attire l’attention, il préconise un service court, l’utilisation intensive des réserves et la forte organisation de l’armée de couverture. Il se lance en politique en devenant en 1902 député radical du 14e arrondissement de Paris.
La deuxième partie commence avec 1911, « l’année d’Agadir ». Messimy occupe le poste de ministre des Colonies pour un temps très court. Surtout il est le ministre de la Guerre du cabinet Caillaux, de juin 1911 à janvier 1912, pour quelques mois seulement, mais en une période critique. Messimy admire Caillaux, « un homme au cerveau lucide, qui désirait la paix mais ne la bêlait point » et qui a su obtenir un accord favorable à la France sur la question marocaine. Pour le poste de commandant en chef des armées françaises en cas de guerre, il faut choisir entre deux candidats, Gallieni et Joffre. Le premier invoque son grand âge, et Joffre est retenu. Messimy reconnait ses qualités de calme et d’organisation rigoureuse, mais il aura en période de guerre, dès 1914 et au cours des années suivantes, à le critiquer et à constater la supériorité de Gallieni :
« Pendant les années 1915 et 1916, alors que, commandant de régiment ou de brigade, je recevais l’ordre de préparer, sans raisons plausibles, des attaques vouées à l’échec certain et que je considérais comme des sacrifices inutiles, j’ai souvent maudit Joffre, son grignotage sanglant, son entourage d’officiers brevetés qui n’avaient jamais marché à l’ennemi sous le feu des mitrailleuses et des canons. Et je me suis adressé bien souvent le véhément reproche de ne pas avoir choisi Gallieni. »
Messimy rectifie une erreur commune selon laquelle l’idée de renforcer l’artillerie lourde aurait été combattue par le Parlement ; en fait, l’opposition est venue des services techniques de l’artillerie attachés au canon de 75. Quant à développer les forces locales en Afrique du Nord, l’opposition aurait été celle des colons inquiets de l’armement des indigènes.
Aux élections législatives de 1912, Messimy choisit le département de l’Ain, plus sûr que Paris. Dans ses souvenirs, place est faite à l’épisode amusant qui voit l’ex-ministre de la guerre résister aux avances de Mata Hari, pourtant « d’un éclat de beau fruit doré au soleil ». En mars et avril 1913, il visite les champs de bataille de Thrace où il apprend beaucoup des conditions de la guerre moderne. Conscient du danger pressant en 1913, il est cependant contre la prolongation inutile de l’encasernement mauvais pour le moral. Il s’oppose au pantalon rouge avec des arguments sensés mais se heurte à l’Écho de Paris, l’Illustration, l’Éclair et divers politiciens intervenant au nom du prestige de l’uniforme : « Faire disparaitre tout ce qui est couleur, tout ce qui donne au soldat son aspect gai, entrainant, rechercher des nuances ternes et effacées, c’est aller à la fois contre le goût français et contre les exigences de la fonction militaire. » (L’Illustration, 9 décembre 1911, cité par Messimy)
La troisième partie est centrée sur sa nouvelle fonction de ministre de la guerre dans le cabinet Viviani, de juin à août 1914. Il est d’abord question de la non-application des poursuites prévues au carnet B, puis d’aider Joffre à « ne pas perdre la guerre », tant ses plans sont ineptes. Messimy affronte « l’écrasante tache de porter la France sur le pied de guerre ». Il fait appel aux troupes d’Afrique. Il obtient l’accélération de l’offensive russe contre l’ennemi principal en Prusse orientale. Il s’occupe de la liaison avec les armées britannique et belge. Il nomme Gallieni gouverneur militaire de Paris et il oblige Joffre à lui donner des forces pour attaquer le flanc de l’aile droite allemande.
Messimy reconnait que l’article du sénateur Gervais stigmatisant les troupes du Midi du 15e Corps était « une injustice, une erreur et une maladresse », et qu’il aurait dû le censurer : « La vérité m’oblige à dire que d’autres grandes unités, originaires d’autres régions de France, ne tinrent pas mieux dans les premières rencontres. » Le 15e Corps n’est pas responsable de l’écroulement du plan de campagne du général en chef.
Les rapports avec le GQG sont difficiles, Joffre ne donnant pas d’informations au gouvernement, surtout quand les nouvelles sont mauvaises, et elles le sont. D’autre part, le conseil des ministres est composé d’hommes « pour lesquels parler c’est agir ». La « brutalité » de Messimy et son franc-parler déplaisent. Pour faire place à une combinaison politique intégrant Millerand, Delcassé et Briand, Messimy est écarté. Nouveau ministre de la Guerre, Millerand restera inféodé à Joffre, et celui-ci sera intouchable après la victoire de la Marne qui doit beaucoup à Gallieni.
Le témoignage est intéressant à lire et assez convaincant. Comme il est de règle pour les personnalités ayant exercé de hautes responsabilités, Messimy présente les documents nécessaires à la justification de son action. Bien que plusieurs de ses positions sur l’organisation de l’armée soient proches de celles de Jaurès, cette proximité n’est jamais revendiquée.
Rémy Cazals, février 2024.
On peut consulter le livre de Christophe Robinne, tiré de sa thèse d’histoire, Adolphe Messimy 1869-1935, Héraut de la République, Paris, Éditions Temporis, 2022.
Boujonnier, Paul (1905 – 1999)
Paul Boujonnier, Nous les gosses dans la guerre en Picardie, 1914 – 1918, éditions JPB, Villemandeur, 1988, 63 pages.
1. Le témoin
Né à Abbeville en 1905, Paul Boujonnier habite depuis 1912 à Guerbigny (Somme) avec ses parents cultivateurs. Son père une fois mobilisé, lui et sa mère vont habiter chez le grand-père à Bouillancourt, à 12 km plus à l’ouest, car Guerbigny est trop près du front (Roye).
2. Le témoignage
Paul Boujonnier a publié en 1988 « Nous les gosses dans la guerre en Picardie » 1914 – 1918 aux éditions JPB de Villemandeur, probablement à compte d’auteur (63 pages). L’auteur avait de 9 à 13 ans pendant la guerre et au dos de l’ouvrage il indique qu’il a voulu par ce livre prolonger le souvenir au-delà de son existence, « pour que les plus jeunes sachent ».
3. Analyse
Ce petit livre contient les « souvenirs de guerre » d’un petit paysan picard qui a passé une partie de son enfance à proximité du front. Il commence par évoquer la rentrée de janvier 1914 à l’école: leur nouvel instituteur condamne les fusils de bois et ordonne de les monter au grenier. Si les élèves le détestent sur le moment pour cette interdiction, l’auteur souhaite en 1988 lui rendre hommage car (p. 8) « lui savait malheureusement ce que nous allions apprendre, c’est-à-dire la guerre. »
En août 1914 la famille fuit l’arrivée des Allemand lors d’un premier exode, mais les Uhlans les rattrapent à Esclainvillers, chez l’instituteur qui les hébergeait pour la nuit. Cette scène l’a d’autant marqué que pour le protéger, sa mère l’a habillé en fille, lui graissant les cheveux et le couchant dans une chambre pour faire croire à une maladie. En effet la version « bourrage de crâne » que P. Boujonnier évoque ici (p. 11) est que les Allemands « coupent les doigts des mains des garçons afin qu’ils ne puissent pas faire de futurs soldats. ». Ce sont ces mêmes Allemands qui les incitent à repartir chez eux, et ce sera à Bouillancourt, chez le Grand-père maternel qu’ils se fixent : ils retrouvent la maison intacte de pillage car elle est située en bout de village.
Paul fait revivre un village servant de cantonnement surtout à des hommes du génie, de l’artillerie et du train, avec passage incessant de voitures et de troupes ; l’instituteur, qui est en même temps secrétaire de mairie, est souvent dérangé pendant la classe pour des questions de cantonnement ou d’intendance : il écrit rapidement un problème au tableau et s’éclipse une demi-heure, ce qui est l’occasion de chahuts que l’on peut imaginer. Le jeune Paul évoque les soldats qui autorisent parfois les gamins à monter sur les wagons du Decauville et qui leur font goûter leur rata. L’enfant va parfois poser des collets ou pêcher le brochet avec eux. C’est ainsi une suite d’anecdotes, comme celle du Noël 1915 où des grands magasins de Paris avaient parrainé des régiments en leur achetant des oranges. Dans un wagon destiné au 139e RI, une grande partie des oranges avait gelé (p. 26) « On finit par nous abandonner ce qui était à moitié gelé (…) Après en avoir mangé à en être malades, l’idée nous vint pour nous distraire, de bombarder d’oranges tous les trains qui passaient. » Notre auteur fait beaucoup de bêtises, monte dans une voiture d’artillerie qui passe et se retrouve à 17 km de chez lui, va guider de nuit des soldats qui braconnent le sanglier, fait une découverte non contrôlée du Byhrr lorsque lui et ses copains vont voir évoluer les avions Caudron du terrain proche, etc… La chute de ses petits récits, marquée par les corrections que lui inflige son grand-père, évoque par sa récurrence celle des Malheurs de Sophie :
p. 23 « Le retour ne fut pas joyeux, je ne vous dis que ça ! »
p. 26 « Oh mes pauvres fesses, qu’est-ce qu’elles prirent encore ce jour-là ! »
p. 31 « Arrivé à la maison, ma réception ne m’a pas laissé le temps d’avoir froid. »
p. 39 « L’arrivée à la maison fut comme toujours une belle réception pour moi ! »
Il raconte aussi avoir voulu sciemment repartir avec l’unité d’un vaguemestre avec qui il avait sympathisé, s’être fait un paquetage en secret avec ce qu’il avait pu récupérer des soldats, mais son nouvel ami, se doutant de quelque chose, avait prévenu sa mère, qui avait subtilisé le sac hors de sa cachette (poids : 32 livres).
Devant la poussée allemande de mars 1918, La famille doit fuir malgré les résistances du grand-père, qui se pense protégé parce que la maison a été épargnée en 1914. Ils se fixent à Fumechon, à côté de Saint-Just-en-Chaussée (Oise). En août 1918, le père légèrement blessé est arrivé en permission de convalescence, et Paul fait une description intéressante de l’expédition menée vers Bouillancourt, malgré l’interdiction des gendarmes, pour voir ce qu’est devenue la maison (p. 55 – 61). Il est très impressionné par les traces de la bataille, ruines, cadavres de chevaux, traces humaines, et ils trouvent le village entièrement détruit. Paul finit la guerre à Fumechon entre travail à la ferme, école et fréquentation des militaires jusqu’à l’Armistice, moment auquel s’arrête ce petit livre attachant (p. 60) : « cette maudite guerre… Maudite soit-elle à tout jamais ! C’est comme cela que je perdis mon titre de « gosse dans la guerre en Picardie. »
Vincent Suard, mai 2024
Lyon, Georges 1853 – 1929
Jean-François Condette (éd.), Souvenirs de guerre du recteur Georges Lyon, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, 476 p.
1. Le témoin
Né en 1853, normalien et agrégé de philosophie, Georges Lyon enseigne d’abord à l’École Normale Supérieure (1888), puis est directeur de cabinet au Ministère des Affaires étrangères (1895). Recteur de l’académie de Lille (1903 – 1924), sa fonction lui fait représenter le ministre de l’Instruction publique, et en même temps présider l’Université de Lille. Pendant la guerre, c’est un « véritable ministre de l’instruction publique des territoires occupés» (J. F. Condette, 2006), et il se bat pour faire continuer à fonctionner l’enseignement secondaire et supérieur. De 1918 à sa retraite en 1924, il organise la restauration et le développement des différents services d’enseignement de l’académie.
2. Le témoignage
Les « Souvenirs de guerre du recteur Georges Lyon » ont été publiés par Jean-François Condette, professeur des Universités à l’INSPÉ de Lille (Éditions Septentrion, 2016, 476 pages). Le manuscrit conservé à la Bibliothèque Universitaire de Lille comprend 18 dossiers, et ce total de 257 pages a été rédigé sur feuilles volantes, souvent à chaud, sans continuité chronologique, et aussi parfois annoté par la suite. L’important dossier scientifique de présentation (p. 13 à p. 112) est remarquable de précision érudite comme de clarté pédagogique.
3. Analyse
Les souvenirs de Georges Lyon sont précieux, car ce recteur agit au plus près des acteurs décisionnels (préfet, maire, proviseurs, praticiens hospitaliers…) et est bien informé des faits saillants de l’occupation de Lille (bombardement initial, otages, réquisitions, extorsions financières, évacuations forcées, etc…). Ces thèmes divers ne forment pas un journal continu de l’occupation, et l’auteur en reconnait l’aspect subjectif (p. 140) [avec autorisation de citation] « Quiconque parmi nous consigne par écrit ce qu’il a vu, ce qu’il a su, ce qu’il a ressenti ne peut que donner une version partielle, unilatérale de la tragédie dont nous fûmes ou les témoins ou les victimes. » G. Lyon parle assez peu du cœur de son métier, l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement secondaire dans la zone occupée, et malgré son poste de responsable, il est peu mobile, soumis comme les autres à l’autorité pointilleuse des occupants ; bien mieux informé que le commun des occupés, il reprend toutefois aussi des rumeurs et, comme les autres, il essaie de se faire une idée de la réalité en lisant la détestée Gazette des Ardennes. Si la question des réquisitions financières aux collectivités est bien présente, les souffrances alimentaires et matérielles et le quotidien pénible de la population laborieuse sont moins évoqués, même s’il mentionne parfois la misère; il signale toutefois les œuvres de sa femme, envers les blessés et les prisonniers au début de l’occupation puis à destination des enfants pauvres (« œuvre des Courettes lilloises »).
On peut prendre trois thèmes d’illustration parmi d’autres.
Les occupants
Il a été otage à la Citadelle avec d’autres notables, mais sur la durée ses rapports avec l’occupant consistent surtout en questions de locaux, de mobilier et de matériel, qu’il défend inlassablement contre les réquisitions, en protestations pour récupérer des étudiants commis au travail forcé, et en pétitions pour appuyer des demandes de clémence.G. Lyon présente les Allemands à qui il a affaire comme des brutes intraitables à l’occasion du service, mais aussi souvent comme des gens convenables dans l’intimité du logement forcé, ce qui n’est pas l’opinion d’autres témoins (A. Cellier, T. Maquet). Si les occupants sont brutaux avec leurs mesures inutilement cruelles, c’est lié à leur atavisme germanique et au militarisme prussien, mais on peut s’entretenir posément avec certains officiers, souvent eux-mêmes intéressés par des thèmes culturels (opinion partagée par M. Bauchond).Ne parlant pas l’allemand, notre auteur dépend du français de ses interlocuteurs, et il signale une conversation en latin avec un occupant savant. Il indique qu’il n’y a pas de pillage individuel, et qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de viol à Lille, hormis (p. 197) six soldats arrêtés qui furent au tout début de l’occupation, « à la requête de l’évêque [Mgr Charost], poursuivis, jugés et fusillés » (aucune possibilité de vérifier cette information). L’attachement progressif de l’occupant aux enfants du logis, les classiques larmes mentionnées lors du départ pour les tranchées du Landsturm, soldat allemand lui-aussi chargé de famille, représentent un classique de la description des accommodements domestiques. Répétons que tous les témoins ne sont pas de cet avis (sans-gêne, bruit, femme introduite au logis, repas nocturnes, ivresse, chants, etc…), et que Monsieur le Recteur loge en général des officiers « choisis ». Il reste que la teneur de ses propos est d’abord hostile à l’envahisseur.
Les évacuations forcées de Pâques 1916
Il s’agit ici de la déportation temporaire de jeunes gens et de jeunes adultes, garçons et filles, dans la campagne du sud du département et dans celui des Ardennes, pour des travaux agricoles d’avril à l’automne 1916. Il s’agit pour l’occupant, dans un contexte inquiétant de disette pour l’agglomération Lille – Roubaix – Tourcoing, de se débarrasser des bouches inutiles pour une longue période, sous prétexte de traquer l’oisiveté (chômeurs et jeunes inactifs, lutte contre la prostitution). La rafle des jeunes gens traumatise les habitants, comme elle choque notre auteur, et il parle d’atrocités (« La plus grande douleur morale qui, depuis l’occupation, ait été infligées aux familles du Nord (p. 327). » Même si ce n’est pas ici uniquement la rafle des femmes, puisqu’elles ne représentent qu’entre un quart et un tiers des déportés, c’est cette déportation des jeunes filles qui frappe l’opinion et les diaristes témoins.
Ce qui choque le plus ceux qui évoquent ce drame, c’est la promiscuité forcée entre des jeunes filles « de bonne famille », et des ouvrières et des femmes du peuple, l’horreur étant représentée par le mélange avec des prostituées elles-aussi déportées. (p. 324) « Oui, la jeune fille brutalement enlevée au foyer dont elle était le charme (…) dans quelque grange où les déportés s’entasseront (…) la jeune fille, dis-je, va être mêlée aux filles, tout court, subira leurs propos grossiers, leurs apostrophes ordurières, leurs gestes obscènes. Le cœur se lève à une telle ignominie. Jamais, non jamais ne s’effacera le souvenir d’une telle honte. Et je dois à la vérité cet hommage que pas un des officiers résidants en nos murs (…) n’a pu contenir, devant ce scandale, ses sentiments de désaveu et s’il n’osait d’indignation. »L’autre élément du traumatisme, très violent, est l’évocation de la visite médicale, avec examen intime, faite aux jeunes femmes par le médecin militaire allemand ; c’est assimilé dans les écrits au viol, et on retrouve cette indignation centrale dans d’autres témoignages.
G. Lyon mentionne que les enseignants sont dispensés de départ, et que certaines familles ne sont pas concernées (p. 337) « Partout, les médecins et membres de l’enseignement n’avaient eu qu’à décliner leurs titres pour qu’eux-mêmes et leurs familles – à peu d’exceptions près – fussent épargnés. » Un des apports les plus instructifs de ce passage montre qu’il n’y a pas eu de réquisition de jeunes gens dans le 1er arrondissement de Lille (Centre, p. 340) : «Il est vrai que c’est celui où habitent de préférence les riches industriels, et à mesure que se succédèrent les évacuations, l’autorité allemande évita visiblement d’envelopper dans le réseau qu’elle tendait les jeunes filles et femmes de la bourgeoisie fortunée. » Donc on déporte les ouvrières et des jeunes femmes de la classe intermédiaire, mais pas les jeunes bourgeoises aisées, et cette inégalité ne semble pas indigner ce notable républicain : c’est d’abord la promiscuité sociale introduite par les sévères mesures allemandes qui le fait bondir.
Après la lecture du Feu de H. Barbusse
Georges Lyon aime faire des phrases. Si son témoignage est précieux par les informations qu’il procure à l’historien, son style, académique, est celui d’un intellectuel du XIXe siècle, pétri de formules ciselées, avec citations latines et références antiques (tel officier cruel est un Néron, la censure Argus, etc…). Son style, assez daté lorsqu’on le met en relation avec d’autres témoignages de la même période, s’accompagne d’un ton satisfait, d’une forme de contentement de soi, accompagné d’une gourmandise de mots choisis, qui est probablement liée à des années de discours prononcés devant des publics captifs, des subordonnés acquis d’avance par fonction et par prudence (enseignants du secondaire…). Peut-être cette phrase travaillée, qui lui est naturelle, est-elle destinée à un projet ultérieur de publication ? En effet, les notes « pour soi-même » sont en général souvent plus sobres et moins construites. Par chance, le dernier sujet du recueil permet de reposer cette question de la tradition et de la modernité, dans le style comme dans la perception politique, puisqu’il s’agit de la réaction de G. Lyon à la lecture du Feu d’H. Barbusse.
Avec – sans surprise – une forme dissertative, notre recteur consacre au prix Goncourt 1916 un long propos (p. 444 à 456), témoignant de la forte impression que lui a fait l’ouvrage. Ce passage a peut-être été rédigé à la fin de l’été 1918, G. Lyon tient son volume (sur la couverture « 18ème mille ») du Dr. Barrois : cet ami l’a acquis sans se cacher et a précisé (p. 444) : « L’autorité allemande en a, pendant quelques jours, autorisé la vente chez Tersot ! » Sans développer ici (ce passage mériterait une étude plus approfondie, dans l’optique des travaux d’Yves Le Maner), on peut dire que l’auteur est d’abord séduit par la volonté de Barbusse de représenter le vrai, la vérité. Ensuite, c’est un Georges Lyon « en grande forme » qui est très frappé par l’argot des tranchées (p. 447) « Il est un mot surtout qui évoque à ma mémoire ce manuel scolaire d’autrefois, Le jardin des racines grecques du bon humaniste Lancelot. On y trouvait alignés ces radicaux fussent-ils aux dérivés sans nombre. Le mot que je veux dire est celui-là même qu’a immortalisé l’héroïque Cambronne. Combien de composés, adjectifs, verbes et substantifs n’engendre-t-il pas juste ciel ! Oh oui ; c’est une racine d’une rare richesse mais comment ne pas lui préférer, ne fût-ce que pour leur parfum, celles de l’honnête jardinier Lancelot. » Il est aussi séduit par les scènes de la vie de tranchée, de l’arrière, avec, dit-il, une vérité vivante et frissonnante, (p. 448) « Je crois retrouver l’impression si vive (…) que me laisse chaque fois que je le relis, le festin de Trimalcion dans le Satiricon. »
Pour la partie « désaccord », il se dit conscient que si « les mentors bottés » de Lille ont autorisé cette lecture, c’est parce que c’était un écrit pacifiste. Dans l’ouvrage, il est déçu de ne pas voir présents les officiers, car il pensait que la communauté de vie hommes – officiers, à la différence de l’Allemagne, existait. Par ailleurs, il tempère la représentativité du poilu barbussien car un ami, rentré de déportation (Montmédy), y a fréquenté des prisonniers français plein d’entrain et de belle humeur : les poilus décrits dans le Feu n’y seraient probablement que quelques « grognards » minoritaires, « geignards que l’on ne reconnaîtrait plus, transformés (…) en riants optimistes. » Il s’inquiète aussi des conséquences morales du livre, de l’effet à craindre sur les jeunes recrues. De plus il refuse d’admettre que la guerre ne ressemble qu’à ce qui est décrit : « Quoi vraiment ce n’est pas là un moment de la guerre, c’est la guerre elle-même dans son entier ! » Alors, s’il doit admettre que c’est vraiment la vérité, à qui il voue un culte, il pense alors, comme R. Cadot par exemple, que le livre vient trop tôt (p. 456) : « En d’autres termes Le Feu ne devrait pas être le livre d’aujourd’hui. Il devrait être celui de demain. »
Donc en somme un bon document historique (personnage informé, apport de faits, aperçu de l’opinion…) qui permet de compléter ce que nous savons de la période d’occupation de la région de Lille, et en même temps un document intéressant d’histoire sociale et culturelle, qui permet de réfléchir sur l’habitus et les représentations d’un notable républicain lettré pendant l’occupation.
Vincent Suard, mai 2024
Guenot, Marcel (1893 – 1975)
« Le Sang de la Liberté » – Guillaume Moingeon, Peirre Guénot (éd.)
1. Le témoin
Né à Besançon, Marcel Guenot est déjà incorporé au 60 RI (classe 13) au moment de la mobilisation. Ce caporal entre en Alsace en août, puis est rapidement embarqué pour la Picardie (combat de Proyart). Il participe à la bataille de la Marne (Bouillancy) et est blessé le 8 septembre (sa F.M. indique le 18.09.14). Revenu au dépôt, où il passe l’année 1915, il revient en ligne en 1916 comme sergent au 44 RI. Il passe l’hiver à la Main de Massige, puis participe à l’attaque le 16 avril. Passé ensuite par Verdun, l’Alsace et la Flandre (avril 1918), où il est gazé sans séquelles graves, il est démobilisé en août 1919.
2. Le témoignage
Pierre Guenot a demandé à l’écrivain Guillaume Moingeon de retranscrire, d’adapter et de publier le récit de guerre de son père Marcel Guenot. Ce livre a paru en 2005 aux éditions Cheminements sous le titre Le sang de la Liberté (323 pages). J’étais perplexe sur la valeur de témoignage de ce livre adapté et réécrit, mais Guillaume Moingeon, contacté, m’a expliqué les principes qui avaient guidé sa rédaction (mai 2023), et aussi avec gentillesse m’a communiqué le document d’origine (manuscrit dactylographié). La comparaison des deux versions montre que le livre édité n’a modifié que certains détails (temps des verbes par exemple, choix du titre) pour permettre une lecture plus aisée, et qu’il ne trahit pas la version de départ : c’est le témoignage très vivant d’un poilu bisontin qui a fait toute la guerre. G. Moingeon m’a précisé aussi que Marcel Guenot avait pendant le conflit un gros carnet à reliure de cuir sur lequel il notait les faits à chaud, ou peu après. C’est ce carnet qui a été saisi au format Word, et donc ce témoignage est assimilable à un journal de guerre, non modifié par la suite. Quelques d’indices font toutefois penser à une reprise partielle ultérieure, les Allemands, par exemple, étant appelés une fois doryphores (p. 244).
3. Analyse
Récit formulé à hauteur d’homme, le Sang de la Liberté voit se succéder des récits de combat, de cantonnement, et de nombreuses anecdotes : ce sont ses « histoires de guerre » que nous raconte ici Marcel Guénot. Le récit de l’engagement d’août 14 en Alsace est précis, puis le passage sur la retraite avant la Marne est très vivant : de garde dans un petit poste en Picardie au tout début septembre, sa compagnie décroche sans le prévenir ; c’est alors une aventure de trois jours avec trois autres « lascars » pour essayer de retrouver leur unité, avec le passage de l’Oise sur les restes d’un pont détruit, abus de Dubonnet et altercation violente avec un capitaine (p. 61, avec autorisation de citation) :
– « Je fais un rapport et vous aurez de mes nouvelles ! »
Je lui rétorque, la fatigue et le Dubonnet m’obligeant :
– « Je vous emmerde. »
Les quatre hommes finissent par retrouver leur unité à Écouen. Le combat d’infanterie de Bouillancy est ensuite restitué, avec les mouvements collectifs d’avancée, de contact, de recul, de pause, puis à nouveau de reprise de contact, et ce plusieurs fois dans la journée, le tout avec peu d’artillerie française. Ainsi en fin d’après-midi le 7 (p. 68) « Un nouvel engagement a lieu, le contact est repris, le combat recommence, furieux. Le soleil va se coucher. De nouveau, l’ordre est rompu. Comme à l’exercice, chacun fait corps, dans la mesure du possible, avec son voisin de combat. Les blessés sont encore nombreux, les morts sont moins visibles. De tous côtés, on entend des commandements :
– En avant, tenez bon les enfants, ne lâchez pas, des renforts vont arriver !
Blessé le 8, il est évacué et soigné en Normandie. Après une longue convalescence, il revient au dépôt du 60 RI à Besançon. Nommé caporal d’ordinaire, il explique comment il se crée une réserve de vin de 250 litres pour parer aux imprévus, en mettant son pouce dans le quart à chaque distribution. Il se réjouit de devenir instructeur de la classe 16, car cela lui évite de devoir rejoindre le Labyrinthe en Artois. En manœuvre au camp du Valdahon, il fait une description pittoresque des cafés du village (p. 99) ; il y a chez «la Grande Nana » ou chez un autre « où trois sœurs servent en salle. Elles sont fortes, bien rondelettes, et, lorsqu’elles marchent, elles actionnent leur derrière proéminent. Cet établissement n’a de nom que le mot café. Les poilus lui en ont trouvé un : pour le désigner, on dit « aux six fesses ». Le vin a une grande importance pour eux, l’auteur signalant à la fin de 1916 (Main de Massige) que les hommes boivent en moyenne deux litres de vin par jour en plus de la ration réglementaire (p. 129) « En plus du ravitaillement officiel, chaque soir, à la tombée de la nuit, un homme dévoué part en corvée de vin. Sanglé d’une vingtaine de bidons de deux litres, (…) le pauvre gars se tape 14 km à l’aller et naturellement autant au retour [il revient souvent par le Decauvile]. (…) Du dévouement, il en a, mais, pendant son absence en ligne, il a la vie sauvée, d’autant plus que nous l’exemptons de tout service de jour. »
L’auteur évoque ensuite un curieux épisode en ligne à Massige (Hiver 1916, p. 136), celui des cagnas (abris dans la tranchée) qui sont condamnées par des planches : il est alors impossible de s’abriter ; de plus sur ces planches sont clouées des affiches qui disent : « Avant de demander un tir de barrage assurez-vous qu’il est indispensable. Voici ce que coûte un tir de barrage : un obus de 75 coûte 25 francs. Un obus de 120 coûte 75 francs. » Les poilus finissent par se révolter en arrachant les affiches et en détruisant les portes des cagnas, « il en résulte durant quelques temps une certaine grogne dans nos tranchées. »
Notre sergent essaie de faire obéir par les quelques apaches qu’il a dans sa section. Il décrit Mesnard, une brute alcoolique, qui a bu en une fois le bidon de deux litres de rhum destinés à vingt hommes ; le lieutenant lui demande d’attacher Mesnard pendant deux heures sur le parapet à un poteau proche des barbelés. M. Guénot note que le pieu aurait très bien pu devenir « piquet d’exécution si une rafale de mitrailleuse avait été distribuée et c’est ce que je craignais le plus pour moi. Cela reste envisageable pour lui, mais au moins il l’a cherché. »
Le narrateur fait ensuite un récit précis de l’attaque du 16 avril 1917, devant la ferme du Godat (p. 173) : «dans notre front d’attaque, la distance à franchir s’élève à environ cent cinquante mètres en certains points, le double en d’autres endroits. Nous devons au départ traverser une combe puis attaquer les premières lignes ennemies établies à flanc de coteau, donc monter avec tout notre chargement extraordinairement lourd. Une utopie ! Une pure folie plutôt.» Le colonel du 44e RI attaque en même temps que la troupe et la progression est réelle jusqu’au Bois en Potence, au point que le silence qui s’établit rassérène l’auteur et lui fait penser qu’effectivement, il atteindra Laon. Une contre-attaque le fait brusquement déchanter (p. 177) « Ah merde ! ils sont là ! » Les pertes se multiplient, les Français se battent sur la ligne conquise, mais le mouvement en avant a échoué, ils quittent « piteusement ces lieux de malheur » le 21 avril.
Il décrit ensuite (p. 192) l’exécution en arrière de Reims d’un jeune de la classe 1916, qui a fui lors de l’attaque du 16 avril. Tout le monde est convoqué pour une prise d’arme sans en connaître le motif. Après l’exécution, « les poilus rentrent de cette pénible scène sans livrer leur état d’âme, chacun conservant son jugement. C’était donc le motif de notre promenade ici…Beaucoup d’entre nous s’en seraient volontiers passé. » M. Guenot raconte ensuite qu’un dénommé Petit, de sa compagnie, porté disparu au soir du 16 avril, a été vu à la roulante. Son lieutenant le charge de lui ramener le déserteur. En revenant avec Petit, qui a accepté d’obtempérer, l’auteur pense que celui-ci n’a pas vu l’exécution du fuyard de la classe 16 : lui seul pourtant aurait eu besoin de ce spectacle (les autres ayant fait leur devoir), mais d’un autre côté, s’il avait vu l’exécution, il ne se serait pas laissé faire si facilement, « Petit est un couard et il veut échapper à son devoir. Mais je n’aimerais pas le voir face à un peloton d’exécution. Nous portons le même uniforme. Cette guerre est en plus dégueulasse que je ne pensais. » Arrivés au P.C., le lieutenant, avec son revolver, intime l’ordre à Petit de monter en première ligne ; celui-ci essaie de se saisir de l’arme, une échauffourée a lieu et le lieutenant l’abat de 5 balles. » M. Guenot, très secoué par la scène, termine son récit (p. 202) : « Jusqu’à la brigade, on félicite le lieutenant. Plus haut, il écope d’un blâme, on lui rappelle qu’il existe des conseils de guerre. »
Il évoque ensuite le secteur de la Cote au Poivre à Verdun en septembre 1917 (cote 344). C’est l’occasion d’évoquer de durs combats sur la rive droite, avec une attaque allemande brusquée repoussée par la tactique du « mur de grenades » (p. 256) : « Voilà les Boches, venez vite ! » « Vite, des grenades à main sont déposées tout au long de la tranchée, à hauteur d’homme. Nous n’avons qu’à les prendre, les percuter et les lancer. Sans distinction de leur catégorie, nous en saisissons une, la percutons, la lançons et passons à la suivante ; sans arrêt, nous percutons, nous lançons. Nous n’avons pas intérêt à mollir, ne disposant plus de fusées demandant le tir de barrage, puisqu’elles ont été épuisées la veille en vain (…) Les Allemands, comme les nôtres la veille, ont été stoppés net devant nos positions par notre mur de grenades. Paradoxe : ce bon résultat n’a été obtenu que parce que nous ne disposions d’aucun abri et que, de ce fait, tout le monde était instantanément au poste de combat dès les premières secondes, celles qui s’avèrent souvent décisives. »
En avril 1918 M. Guenot et son unité embarquent vers la Flandre et viennent relever les Anglais au Mont Kemmel. Il y est gazé et doit être évacué sur l’hôpital de Guingamp. Après sa convalescence, il rallie son régiment et la poursuite des Allemands les ramène sur les lieux de l’offensive de Champagne (p. 318) « Nous savons tous que devant Maisons-en-Champagne, en 1915, nos camarades ont livré des assauts particulièrement sanglants. Il en reste une trace effroyable qui nous glace le sang : nous passons devant une fosse commune où reposent mille cinq cents soldats du 44 RI. (…) Vivement notre victoire et la fin de ce cauchemar collectif. Tout cela n’a que trop duré. » Le 11 novembre l’auteur et ses camarades se trouvent dans une position avancée, la ferme des Vaches, « isolés de tout et de tous », et l’annonce de la bonne nouvelle les laisse presque « amorphes »: (p. 321) « Que de fois nous étions-nous promis de fêter l’événement ! Mais c’est dans un lieu totalement isolé, puant le souffre et la mort, et dans des conditions atmosphériques médiocres, et d’absence de ravitaillement surtout, que la formidable nouvelle nous parvient. C’est tout juste si nous disposons d’un peu d’eau potable pour lever notre verre ! Et encore devons-nous la chercher à un point d’eau éloigné. » Il n’empêche que Marcel Guenot conclut ses mémoires de guerre par cette ligne (p. 322) « Béni soit ce 11 novembre 1918 et que plus rien de tel ne se produise jamais. »
Vincent Suard, février 2024
Grivelet, Maurice (1888 – 1972)
« Mémoires d’un curé : Fantassin, Aviateur, Résistant ».
1. Le témoin
Maurice Grivelet, fils d’un vigneron bourguignon, est vicaire à Sélongey (Côte-d’Or) en août 1914 et sous-lieutenant de réserve. Mobilisé au 44e RI, il est blessé le 8 septembre 1914. Revenu en ligne en mars 1915, il est alors lieutenant au 104e RI jusqu’à août 1916, passant ensuite dans l’aviation. D’abord officier-observateur puis pilote, ce capitaine commande en 1918 l’escadrille So 252 (sur Sopwith). Démobilisé en août 1919, il reprend ses fonctions ecclésiastiques mais effectue aussi des périodes de réserve dans l’armée de l’air. Mobilisé en 1939, il échappe à la captivité ; résistant en Côte d’Or à partir de 1942, il rejoint ensuite la cure de Saulx-le-Duc en 1945.
2. Le témoignage
La Société d’Histoire Tille-Ignon a réédité en 2019 les Mémoires d’un Curé : Fantassin, Aviateur, Résistant (112 pages). Le site EGO 1939 – 1945 signale une première édition « chez l’auteur » en 1970. L’auteur signale que c’est à la demande de son neveu qu’il a écrit ses mémoires, la rédaction en a été faite pendant l’hiver 1964 – 1965. La partie qui concerne la Grande Guerre va de la page 15 à la page 68. Merci pour son aide à Serge Thozet, président de la Société d’Histoire Tille-Ignon.
3. Analyse
Un curé sac au dos et galon au bras
Jeune séminariste, Maurice Grivelet remplit ses obligations militaires de 1909 à 1911 et devient sous-lieutenant de réserve : la vie militaire ne lui déplaît pas. Il entre en Alsace en août 1914 avec le 44e RI de Besançon (entrée dans Altkirch puis Mulhouse), puis évacue la région ; rapidement transporté en Picardie, il évoque les combats des 6, 7 et 8 septembre auxquels il participe (bataille de l’Ourcq) ; revenu au front après blessure en 1915, il raconte les préparatifs de l’offensive de Champagne au 104e RI, avec le creusement des parallèles de départ à 300 mètres devant la première ligne française. Il est dans le bataillon de réserve le matin de l’offensive du 25 septembre, mais le soir, il doit rejoindre seul vers l’avant une compagnie d’attaque du matin qui n’a plus de cadres, et c’est l’occasion (p. 41) d’une description saisissante de l’état de ces hommes épars et épuisés, faite par un officier encore frais.
André Guéné
Le récit comprend auparavant un épisode d’enfant-soldat. Le 2 septembre, le sous-lieutenant Grivelet découvre dans sa section un enfant de douze ans qui a fui de chez lui et qui veut rester avec eux. L’auteur réussit à le confier à un aumônier dans une voiture d’ambulance, mais il faut l’y faire entrer de force, malgré ses pleurs et ses cris. Le soir venu, André qui s’est sauvé et a réussi à les rattraper (p. 22) « Je fus bien obligé d’adopter – provisoirement – ce pauvre gosse. Le moyen de faire autrement ? » Blessé le 8 septembre, l’auteur voit le jeune garçon lui ramener de l’aide sous le feu, ayant prévenu des soldats qui vont le transporter vers l’arrière. L’enfant reste avec lui lors de l’évacuation en train sanitaire, et ils sont logés ensemble à l’hôtel Riva Bella (Calvados) transformé en hôpital (p.31), «un petit lit fut installé pour André dans ma chambre. ». Un député du Calvados, Fernand Enguerrand, qui fait la tournée des blessés, lui demande qui est cet enfant, et deux jours après, l’histoire est dans « l’Écho de Paris » (p. 31) « et je lu, en caractères d’un centimètre, le titre d’un article de deux colonnes en première page : « Un enfant héroïque ». » L’auteur doit rédiger sans notes, puisque l’article (voir site BNF Rétronews), est sur une seule colonne (bas de la Une, 19 septembre 1914) et a comme titre « Un héros de douze ans » : l’essentiel correspond toutefois. Le plus intéressant de cette histoire réside dans ses suites (p. 32) « une énorme correspondance venue des quatre coins de la France : parents, amis, curés, instituteurs, etc… me demandaient des photos, des détails sur l’aventure d’André. « Je ferai ma première classe sur cet « Enfant héroïque » m’écrivait l’un de ces instituteurs. Des cartes postales furent mises en circulation, me représentant la tête bandée, appuyé sur l’épaule d’André, avec en arrière-plan, des obus qui éclataient, des cavaliers qui chargeaient… » Nulle part dans l’article, le député ne dit que M. Grivelet est prêtre. Celui-ci quitte André, dont on ne connaît pas le destin ultérieur, lorsqu’il part en convalescence.
Aviation
L’auteur a fait une première demande pour entrer dans l’aviation à l’automne 1914, sollicitant dans le même temps son autorité hiérarchique religieuse. L’évêché de Dijon lui a répondu (p. 33) « sans vous le défendre, suis d’avis de vous abstenir. » Il obéit, mais signale que « le démon de l’aviation n’était pas exorcisé en lui ». Il souffre de l’hiver en Champagne, « Ville-sur-Tourbe, ce nom dit tout » (p. 42), ne se sent pas d’atomes crochus avec les Normands du 104e RI puis refait une demande pour l’aviation, qui est acceptée en août 1916. « Aviateur! Le rêve de ma vie. » (p. 47). Passé capitaine, il est formé comme observateur au Plessis-Belleville, puis vole à la C 56 (sur Caudron). Il raconte ses missions photo, et évoque l’échec de l’aviation le 16 avril, à cause des mauvaises conditions météorologiques : « Nous ne servions à rien, il ne nous était pas possible d’être utiles à quelque chose, mais il fallait tout de même foncer dans la tempête de neige au ras des sapins, ou de ce qu’il en restait. » (p. 53). Il vole d’abord seulement comme observateur, puis il est formé au pilotage, notamment par Octave Lapize (p. 54), par ailleurs vainqueur du Tour de France cycliste 1910. Ce curé peu conventionnel semble goûter la coquetterie « pilote » (p. 48) « Mais pour être aviateur, il fallait être chaussé de grandes bottes lacées et porter de grands galons en trèfle qui montaient jusqu’au coude. Avec quelques nouveaux arrivants comme moi, nous allâmes donc à Paris acheter bottes et galons. » On sait par ailleurs (témoignage « Trémeau ») que ces bottes sont chères et que les sous-officiers pilotes n’ont souvent pas les moyens de s’en procurer, ce qui est source d’humiliation. Il prend ensuite le commandement de la So 252 sur Sopwith, narre quelques anecdotes dont une évoquant le mépris du général Schmidt (erreur sur la 163 DI, c’est plutôt la 167 DI, p. 57) : « Aviateur ! morphinomane, cocaïnomane, qui dans un accès de folie montez en avion pour faire des pitreries au-dessus des tranchées… » Il fait aussi une description intéressante de la pagaille qui règne lors de la percée des Allemands en mai 1918 au Chemin des Dames (p. 58), l’infanterie française ayant perdu les fanions qui permettaient de reconnaître les unités : « On demanda à l’aviation de situer les lignes d’après la couleur des uniformes, ce qui nous obligeait à descendre très bas. Cela nous coûte cher et le plus souvent, les renseignements obtenus de cette façon, étaient erronés. (…). Des avions signalèrent des troupes françaises en marche sur telle ou telle route, et en réalité, il s’agissait de convois de prisonniers… ». Il évoque enfin un 11 novembre qui (p. 67) « fut plutôt une déception ; nous avions l’impression que cet armistice était prématuré, et que l’armée allemande n’était pas assez vaincue (…). Notre pressentiment n’était que trop justifié. » Il faut s’interroger sur ce type de jugement écrit en 1965, longtemps après l’événement, les autres carnets n’évoquant que très rarement ce type de déception dans leur mention du jour de l’Armistice. Notre capitaine – aviateur – curé est démobilisé le 1er août 1919, et rejoint la cure du village de Saulx-le-Duc qu’il ne quittera plus.
Un curé peu banal
Curieux prêtre que ce truculent militaire, aviateur enthousiaste et par ailleurs grand chasseur de sanglier. Certes les membres du clergé en même temps officiers de réserve ne sont pas rares, et on connait d’autres religieux pilotes, comme le missionnaire Léon Bourjade, chasseur de Drachen en 1918, mais celui-ci se caractérise d’abord par sa réserve, ce qui n’est pas le cas de M. Grivelet, très à l’aise dans ses bottes d’aviateur. La suite des mémoires évoque l’Occupation, avec la résistance de l’auteur du côté gaulliste, et il a à la Libération le grade de Lieutenant-Colonel F.F.I., avec des responsabilités à l’E.M. de Dijon. On ne peut s’empêcher de s’interroger : pourquoi un sujet aussi brillant n’a-t-il desservi pendant toute sa carrière que la petite paroisse du village de Saulx-le-Duc, soit pendant près de 50 ans ? Sa mémoire y est restée populaire, mais ses relations avec son évêque n’étaient pas bonnes, et les renseignements fournis par l’association historique locale montrent que la raison pourrait en être une trop grande proximité, établie sur la durée, avec une paroissienne du lieu.
Vincent Suard, février 2024
Lebrun, Mathilde (1879 – )
Le témoignage
Mathilde Lebrun (1879, Nantes – ?) habitante de Pont-à-Mousson, où elle tient un commerce, est en 1914 veuve d’un militaire (adjudant) décédé en 1908, avec lequel elle a eu trois enfants. La guerre déclarée, et ayant eu une culture militaire qui l’a habitué à côtoyer ce milieu (elle a habité plusieurs années dans des forts, dont à Toul, et a été élevée par un oncle, ancien combattant de 1870), elle monte un débit de boissons ambulant au plus près des troupes, activité qu’elle poursuit alors que la ville est envahie pendant quelques jours entre le 4 et le 10 septembre 1914. Sur sa répugnance à côtoyer « les boches », elle se justifie et dit : « Je domptai mon instinctive répugnance, en songeant que j’avais tout intérêt à approcher ces gens, à les étudier, à les connaître » (p. 39). Elle profite de ce côtoiement pour visiter les organisations de l’ennemi et collecter tout renseignement qui lui semble utile. Le recul allemand et la cristallisation du front font qu’elle pense pouvoir être utile aux français ; elle veut « jouer un rôle », non en s’engageant comme vivandière ou infirmière, mais comme espionne, destination qu’elle se fixe possiblement après avoir désigné un espion présumé en pleine bataille pour défendre la ville, mais peut-être aussi en ayant été désignée elle-même comme telle après la réoccupation de la ville. Le 1er décembre suivant, elle est approchée puis finalement, le 13, recrutée à Nancy par le Service des Renseignements de l’Armée de Lorraine. Son « agent recruteur » la missionne de se rendre à Metz, toute proche, afin d’y collecter tout information utile. Elle dit sur son nouveau « métier » : « On m’apprit mon rôle et je compris que j’étais un peu dans la situation de quelqu’un qu’on jette à l’eau pour lui apprendre à nager ». Laissant à la garde de tiers ses enfants qu’elle a éloignés du front à Contrexéville, et devient alors Simonne autrement surnommée « Tout-Fou ». Sa première mission, le 23 décembre 1914, consiste à passer la ligne de front (à Norroy-lès-Pont-à-Mousson) ce qu’elle fait avec une étonnante facilité. Après plusieurs jours d’enquête, elle est finalement approchée par le capitaine Reibel, puis plus tard le lieutenant von Gebsattel, autrement appelé monsieur de Bouillon. Pour les Allemands, elle devient R2, ou madame Blum, autrement surnommée également « Faim-et-Soif ». Le 4 janvier 1915, elle revient en France par la Suisse, fait son compte-rendu au capitaine de B… sur ce qu’elle a vu et entendu durant les 15 jours en territoire allemand qu’a duré sa mission : « Je pus révéler l’emplacement des batteries de Norroy et les dépôts de munitions, la profondeur des lignes de tranchées, le numéro des régiments. Je signalai l’importance des envois de troupes sur la Belgique. Je ne manquai pas non plus de parler des espions que j’avais rencontrés, travaillant pour l’Allemagne » (p. 99). A partir de cette première mission réussi, Simonne, pendant toute l’année 1915, fait des allers et retours entre Nancy et l’Allemagne, en passant par la Suisse (elle cite successivement Metz, Montmédy, Luxembourg, Mondorf, Trêves, Mayence, Coblentz, Cologne, Francfort et même Berlin, passant par Offenburg, Saverne, Appenweiher, Strasbourg et Sarrebourg dans une liste certainement non exhaustive). En tout, elle réalise 13 voyages entre lesquels, missionnée par l’ennemi, elle se rend dans le sud de la France (Marseille et Nice) afin de contacter des agents doubles françaises dont elle sera à l’origine des arrestations. Ce sont Félicie Pfaadt (agent R17), exécutée le 22 octobre (elle dit août) 1916 à Marseille [voir dans ce dictionnaire la fiche de Jauffret, Wulfran (1860-1942) – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org) qui décrit l’exécution de l’espionne le 22 août, qu’il avait défendue vainement devant le conseil de guerre en mai et dont il témoigne de sa réprobation] et Marie Liebendall, épouse Gimeno-Sanches, également condamnée à mort et emprisonnée dans la même ville. Côté allemand, elle distille des informations fournies par le Service de Renseignements qui, apparemment savamment construits, lui valent même en novembre 1915 la Croix de Fer ! Elle reçoit de côté-là des missions dont l’une des dernières confiées est rien moins que de récupérer la formule des gaz de combat français. Risquant, par ces deux principaux « faits d’armes » d’être « brûlée », c’est-à-dire découverte en Allemagne, elle est « mutée » quelques jours à Tours, revient à Nancy avant de participer aux enquêtes et aux procès Pfaadt et Liebendall puis d’être convoquée, le 16 août 1917 à Marseille pour témoigner dans l’enquête sur le député C[eccaldi], mentionné dans ses rapports, accusé lui aussi d’intelligence avec l’ennemi. C’est très possiblement ce qui lui vaut d’être « rayée du service », teintant son dernier chapitre comme une conclusion amère qu’elle a été mal utilisée et oubliée, tant dans l’honneur que dans la récompense nationale.
Mathilde Lebrun, Mes treize missions, préfacé par Léon Daudet (Député de Paris) Paris, Arthème Fayard, sans date, ca 1920, 285 p.
Commentaires sur l’ouvrage
Ecrit en 1919 et les années suivantes, apparemment publié plusieurs années plus tard (1934), ce récit simple, chronologié, sans réel talent d’écriture et descriptif, mais manifestement sincère peut apparaître comme une curiosité littéraire voire fictionnelle. Pourtant, le livre de Mathilde Lebrun est bien la narration testimoniale d’un parcours d’espionne agent double comme les Services de Renseignements français en ont utilisé de nombreuses pendant la Grande Guerre. Le parcours et les actions de Mathilde, manifestement à la personnalité évidente, se construit et évolue en territoire ennemi avec une apparente facilité et légèreté malgré les risques énormissimes pris par ces femmes particulières qui exercèrent leur patriotisme par des voies aussi dangereuses que volontaires. L’ouvrage n’est pas iconographié et contient quelques erreurs topographique (Noviant pour Novéant) ou points tendancieux qui mériteraient des vérifications plus approfondies pour en confirmer la véracité ou la plausibilité. Par exemple, son premier parcours débute en pleines fêtes de Noël et du réveillon dans la Lorraine envahie de l’hiver 1914 et elle n’en décrit pas une ligne. De même par exemple, elle attribue à ses renseignements l’origine d’une contre-offensive sur le Hartmannswillerkopf (entre le 8 et le 15 mars 1915) qui ne semblent pas correspondre à une telle activité sur le massif. Enfin, sa narration est aussi le prétexte à des tableaux, le plus souvent grotesques voire injurieux des personnages qu’elle croise et qu’elle caricature à l’envi (cf. la famille Rihn à Metz dont elle garde les enfants et dont elle dit par que le père à « une bonne tête… d’abruti »), celui lui permettant d’appuyer sur son patriotisme exacerbé.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Liste des missions effectuées en Allemagne par Mathilde Lebrun
1re mission : Du 23 décembre 1914 au 4 janvier 1915
2e mission : Du 11 au 17 janvier 1915 (avec une erreur de date page 112)
3e mission : Du 27 janvier au 1er février 1915
4e mission : Du 15 au 21 février 1915
5e mission : Du 08 au 15 mars 1915
6e mission : Du 26 mars au 2 avril 1915
7e mission : Du 19 avril au (jour non précisé) avril 1915
8e mission : Du 04 au 22 juin 1915 (dont voyage à Berlin)
9e mission : Entre le 26 juin et le 18 juillet 1915, d’une durée de 18 jours
10e mission : Du 18 au 23 juillet 1915
11e mission : Du 11 au 23 août 1915
12e mission : Du 07 au 09 septembre 1915
13e et dernière mission en Allemagne : Du 3 au 11 novembre 1915
Page 22 : Vue tonitruante et sonore de la mobilisation à Pont-à-Mousson
33 : Distribue des bouteilles de vins en pleine attaque allemande
34 : Décrit Pont-à-Mousson sous attaque
176 : 2 canons de 75 français et 6 belges en trophée à Berlin
: Taux de change 100 pour 87,50 marks
178 : Croix de fer en bois plantée de clous d’or et d’argent achetés (elle en plante un)
219 : Obtient (mais trop tard) un sauf-conduit pour toute l’Allemagne
227 : Manque d’être arrêtée en Allemagne à cause de la Gazette des Ardennes (pas logique)
230 : Doit récupérer la formule des gaz de combat français
233 : Obtient la Croix de fer
Yann Prouillet, juillet 2023
Lehmann, Othon (1896 – 1968)
Le témoin
Othon Lehmann (1er janvier 1896 – Froeschwiller (Bas-Rhin) – 11 décembre 1968 – Epinal (Vosges)) est un jeune mosellan de 18 ans dont le père, de souche alsacienne, habitait Landau, quand la guerre se déclenche. Les premiers jours mêlent impressions militaires, ignorance de la situation et conscience du drame. Un mélange d’effervescence et d’inquiétude comme en témoigne ce tir sur un espion imaginaire (?) en gare de Landau mais aussi de doute déjà. Ainsi le maire de Landau doutant d’une grande victoire en constatant la prise de … 10 canons. Othon, qui a peur que la guerre se termine victorieuse sans lui, intègre enfin, fin août 1914, le 23e RI bavarois de Landau. Il démarre à Landau puis à Kaiserslautern une vie de caserne et de formation, dont les exercices sont difficiles sous les ordres d’un Kompagnie-Exerzieren, modèle de « véritable vieux soldat ». Il dit : « Je ne me souviens pas d’avoir vu un officier pendant mon séjour à Landau », (il refait d’ailleurs la même réflexion après plusieurs jours de première ligne). En effet, il précise que c’est au sous-officier qu’est confiée l’instruction du soldat brossant quelques tableaux divers de personnages représentatifs. Jeune, il est parti inconscient, confiant espérant avec sa mère « qu’on ne mettrait jamais de si jeunes gens en première ligne, qu’on nous emploierait plutôt pour transporter des munitions, du matériel, des malades… ». Après un mois d’instruction, il est feldmarschbereit, prêt à entrer en campagne. Le 6 novembre 1914, il est enfin dirigé sur le front et dit : « Nous ne chantions pas. (…) Au fond de nos cœurs, nous étions restés optimistes, ne croyant pas au triste sort qui planait au-dessus de nos têtes ». Le train qui l’emporte dépose le soldat à Comines (Belgique) puis, affecté à la 4e compagnie, il est dirigé dans un secteur « formant une chaîne de protection, véritable bastion avançant dans la ligne ennemie » en avant de la ferme du Eickhof (ferme des Trois-Chênes), à l’ouest de la ville. Au créneau, à la défense de la ferme, il prend corps avec le front et en découvre les dangers. Mais il dit : « Je n’avais pas peur ; je crois que je ne me rendais même pas compte de la situation. C’était peut-être très dangereux, peut-être rien du tout ! Pas un coup de fusil, aucune trace d’ennemi. En face de nous, il y avait probablement les mêmes « héros » qu’ici, c’est-à-dire de pauvres gamins sans expérience, déguisés en soldats ». La guerre commence toutefois de l’impressionner. A la vue d’un mort, il dit : « Jamais de ma vie, je n’oublierai la vision de ce beau mort ». Mais le créneau de nuit est fantasmagorique et il déclenche des fusillades, voyant des français dans des troncs de saule, et tuant probablement… une vache. Il se forme toutefois à la guerre, apprend à utiliser se pelle de tranchée « trop petite » (page 15) et expérimente la pitance immangeable et sans pain. Mais rapidement il commence à en éprouver la douleur sous l’omniprésence d’une déprimante artillerie, augmentée du froid et de la pluie. Il dit : « Mais nous étions déprimés et pas assez aguerris pour supporter de telles épreuves » (page 16). Il n’a à ce moment connu que 4 jours de première ligne pourtant. Il avoue avoir abattu un français ayant agi par imprudence (et pour lui manque d’expérience) mais avoir manqué d‘être tué en retour pour le même motif. Très en pointe, il semble oublié, sans ravitaillement, et souffre de la faim. Mais c’est bientôt l’attaque devant son front, impressionnante, terrible et meurtrière, à son avantage. Il dit : « La situation des assiégés était devenue intenable. Les Français sortirent sans arme, se rendirent et furent conduits vers l’arrière. Aucune violence sur eux. C’était la guerre sincère entre braves soldats de première ligne » (p. 21). Atteint d’une balle, il n’ose plus utiliser son fusil et tente de récupérer sans succès celui d’un mort qu’un soldat enterre. Le 14 novembre, pris dans un bombardement, il est blessé au dos par plusieurs éclats d’obus en protégeant un camarade, tous deux blottis dans le parapet d’une tranchée. Se sentant en sureté avec ses camarades et ne voulant pas les exposer au feu, il refuse d’abord son évacuation. Il dit : « Dans le danger de mort, dans les situations sombres de la bataille, les camarades sont toute notre vie, ce sont seulement eux qui comptent. Et si au commencement d’une bataille, on hésite, pour des raisons humaines, de tirer sur des hommes d’en face, tout sentiment de pitié ou de générosité nous abandonne dès qu’un camarade tombe ou est blessé à côté de nous » (p. 25). Il est finalement évacué à la nuit mais dois menacer de son revolver des « infirmiers froussards » qui se trompent de direction et partent vers l’ennemi. Doté d’un revolver civil acheté pour le front avant d’y arriver, ils le prennent pour un officier ! Arrivé à l’ambulance, il est hissé dans un fourgon sanitaire, veut encore aider un français en pantalon rouge, lui rappelant les images d’Epinal de son adolescence (évoquant ici la francophilie de sa famille, précisant « Du roi de Prusse, nous ne parlions jamais ») et la guerre de 1870. Evacué par trains, dans un desquels, par imprudence il manque de retourner au front, il échoue dans un hôpital où il souffre atrocement. Au printemps de 1915, il est dirigé sur le dépôt de son régiment, à Kaiserslautern et jugé « apte seulement pour le service de garnison » (p. 32) et employé au bureau de la Ersatzkompagnie. « Jamais je n’ai vu un seul de mes camarades du front. Peu à peu, j’ai appris que tous étaient morts dans les combats devant Ypres. Parmi mes camarades de chambre, 13 avaient subi l’examen du service militaire d’un an. De ces 13, je suis le seul survivant. Pendant mon temps de service au bureau de la compagnie, j’ai obtenu de temps en temps quelques renseignements sur la mort de mes camarades et les communiquer à leurs parents. C’est le seul service que j’ai pu rendre à ces malheureux » (p. 32). Il cite d’ailleurs parfois le nom de quelques-uns de ses camarades (cf. p. 19). 35 ans après sa blessure, des médecins ont découvert qu’un éclat d’obus se trouvait encore dans le dos d’Othon Lehmann.
Othon Lehmann, 1914 dans l’infanterie allemande, Epinal, chez l’auteur, 1963, 33 p.
Le témoignage
Ce court ouvrage, souvenirs écrits par l’auteur en 1962 « sans jamais avoir rien noté » (p. 27), est simple et superficiel tout en étant relativement descriptif de sa place dans son minuscule morceau de front devant sa femme belge cominoise et des états psychologiques d’un jeune soldat sous l’uniforme feldgrau blessé après seulement 8 jours de front. Il renseigne peu sur sa position sociale mais semble indiquer en note finale avoir un équivalent de brevet supérieur. Il fait aussi montre d’une certaine francophilie qui pourrait s’expliquer en sa qualité de mosellan du nord, d’une commune, Reichshoffen, fortement marquée par la guerre de 1870. Sa narration se veut pédagogique, Lehmann traduisant systématiquement en français les termes militaires, uniformologiques ou techniques dont il a conservé voire expliqué en note la signification.
L’ouvrage n’est pas iconographié mais comporte un croquis et une carte de la ferme Eickhof, seul champ de bataille qu’il aie jamais connu. Se reporter à l’ouvrage pour son usage de terminologie allemande « de guerre » (organisation civile et militaire, uniformologie, usages, expressions, etc.).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Parcours suivi par l’auteur : Landau – Kaiserslautern – frontière belge à Herbesthal – Liège – Lille – Comines (Belgique) – Eickhof / ferme des Trois-Chênes – Bruxelles – Dillingen an der Donau – Kaiserslautern.
Page 5 : Tableau d’une mobilisation à Landau qui l’impressionne (« Landau était le siège de deux régiments d’artillerie (n°5 et n°12), d’un régiment d’infanterie (n°18), du premier bataillon du 23ème RI, d’une formation de mitrailleuses et d’un dépôt de cavalerie (chevaux-légers) » (sic)).
6 : Voit les premiers blessés français dont certains portent des chaussures civiles vernies !
: Tir surréaliste sur espion sur un toit proche de la garde Landau, espionnite
7 : Couleur des uniformes, il touche le felgrau plus tard
8 : Liste des unités de Landau
9 : Poursuit sa formation à Kaiserslautern
18 : Pain surnommé Pumpernickel, dû à Napoléon qui l’avait donné à son cheval en disant « Bon pour Nickel » !
24 : A acheté avant de partir en guerre un revolver Hammerless
30 : Vue d’une dysenterie dans un train, expédients divers (bottes, casques puis « marche du train hors de la porte, retenus aux mains par des camarades ») pour déféquer
31 : Solution de Sublimé pour traiter sa blessure
Yann Prouillet, juillet 2023
Von Salomon, Ernst (1902-1972)
Né le 25 septembre 1902 à Kiel, il est le fils d’un haut fonctionnaire prussien. Il n’avait donc que 12 ans lors de la déclaration de guerre en 1914, mais le récit de son expérience d’élève à l’école impériale des Cadets constitue un témoignage fort utile : Die Kadetten (1930), de même que Die Geächteten (1933) sur son rôle dans les Corps Francs dans l’immédiat après-guerre. Pour la suite de sa biographie, on pourra se référer à d’autres sources, par exemple à Wikipedia. Je reprends ici les notes rédigées pour mon cours sur la République de Weimar en 1970. Les deux livres dont je disposais avaient paru en Livre de Poche, Les Cadets en 1966 (n° 1950) et Les Réprouvés en 1969 (n° 2553).
Le livre Les Cadets décrit le type d’éducation que reçoivent ces enfants et adolescents : discipline, cachot, entrainement militaire intensif, étude des types de saluts, des types d’uniformes, de la forme et de la couleur des boutons, des pattes d’épaule et autres colifichets militaires. En 1918, ce monde s’écroule : l’Empereur est renversé ; la guerre est finie (il n’y a pas de plus grande cruauté que celle-là pour des Cadets qui n’aspirent qu’à se battre) ; le corps des Cadets est dissous. Les compositions sur des sujets comme « Pourquoi nous, Allemands, aimons-nous notre Kaiser ? », des attitudes comme celle du Cadet qui n’a qu’une ambition, « mourir à 20 ans devant Paris » n’ont plus cours. L’ancien monde a disparu et on comprend que le Cadet se trouve devant une situation qu’il est incapable de comprendre et à plus forte raison d’approuver. Il ne lui reste que l’action contre tout ce qu’il n’aime pas, les communistes, les Français occupants et tout l’édifice de la République de Weimar, démocrate et capitularde. Jusqu’à son emprisonnement en 1923, il est partout où on se bat.
À Berlin, aux premiers jours de la révolution, il arbore, fier et méprisant, son uniforme. Il est pris à partie par la foule qui veut lui arracher ses pattes d’épaule. Il est frappé, mais un officier le sauve. Dès lors, son mépris pour « la canaille » ne fait que croître. Il essaie de soulever ses amis contre le nouveau régime. Il amasse chez lui un véritable dépôt d’armes : « Sous mon étroit lit de fer se trouvaient trois caisses de grenades et dix caisses de cartouches. Les fusils bien graissés, enveloppés et mis en tas, occupaient un tiers de la pièce. » Les conditions de l’armistice lui font pousser des cris d’indignation et de haine.
Il s’engage dans les corps francs et prend part au combat du Marstal contre les marins et à la répression du mouvement spartakiste en janvier 1919 à Berlin. Il est ensuite envoyé à Weimar pour protéger l’Assemblée. Mais ce rôle ne lui convient pas : « Nous avons sauvé la patrie du chaos. Que Dieu nous pardonne, ce fut notre péché contre l’esprit. Nous avons cru sauver le citoyen et nous avons sauvé le bourgeois. Le chaos est plus favorable au devenir que l’ordre. La résignation est l’ennemie de tout mouvement. En sauvant la patrie du chaos nous fermions la porte au devenir et nous ouvrions les voies à la résignation. »
Il part pour la Baltique où il se bat sans cesse. Il revient, participe de loin au putsch de Kapp, mais son groupe est encerclé et capturé après une farouche résistance dans une petite ville proche de Hambourg. Il s’échappe. On le retrouve en Rhénanie, luttant contre les forces françaises d’occupation et contre les séparatistes. Il est en Haute-Silésie au moment du plébiscite et des combats qu’il a provoqués.
Après la Silésie, on parle beaucoup de la Sainte Vehme, organisation chargée de punir les traitres à l’Allemagne. Von Salomon nie qu’il y ait eu une vaste organisation contrôlant tout le pays. Il dit que les combattants de Haute-Silésie, rentrés chez eux dans toutes les régions d’Allemagne, se sont groupés sur le plan local en associations mal reliées entre elles. Cependant, leur but et leurs méthodes étant semblables, on a pu croire à de mystérieux chefs dirigeant les forces cachées de l’Allemagne. Von Salomon les présente ainsi : « Ces associations étaient un symptôme. C’est là que se groupaient les hommes qui se sentaient trahis et trompés par l’époque. Rien n’était plus réel, tous les piliers étaient ébranlés. Là se réunissaient tous ceux qui espéraient encore beaucoup et ceux qui n’espéraient plus du tout ; leurs cœurs étaient grands ouverts, mais leurs mains s’accrochaient encore aux choses accoutumées. Le rassemblement de tous ces êtres intensifiait ce tourbillon mystérieux d’où, par le jeu des forces et des croyances contradictoires, pouvait monter ce que nous appelions le Nouveau. Si jamais du nouveau vient en ce monde, c’est bien du chaos qu’il surgit, à ces moments où la misère rend la vie plus profonde, où, dans une atmosphère surchauffée, se consume ce qui ne peut pas subsister, et se purifie ce qui doit vaincre. Dans cette masse en ébullition, en fermentation, nous pouvions jeter nos désirs et nous pouvions v
Né le 25 septembre 1902 à Kiel, il est le fils d’un haut fonctionnaire prussien. Il n’avait donc que 12 ans lors de la déclaration de guerre en 1914, mais le récit de son expérience d’élève à l’école impériale des Cadets constitue un témoignage fort utile : Die Kadetten (1930), de même que Die Geächteten (1933) sur son rôle dans les Corps Francs dans l’immédiat après-guerre. Pour la suite de sa biographie, on pourra se référer à d’autres sources, par exemple à Wikipedia. Je reprends ici les notes rédigées pour mon cours sur la République de Weimar en 1970. Les deux livres dont je disposais avaient paru en Livre de Poche, Les Cadets en 1966 (n° 1950) et Les Réprouvés en 1969 (n° 2553).
Le livre Les Cadets décrit le type d’éducation que reçoivent ces enfants et adolescents : discipline, cachot, entrainement militaire intensif, étude des types de saluts, des types d’uniformes, de la forme et de la couleur des boutons, des pattes d’épaule et autres colifichets militaires. En 1918, ce monde s’écroule : l’Empereur est renversé ; la guerre est finie (il n’y a pas de plus grande cruauté que celle-là pour des Cadets qui n’aspirent qu’à se battre) ; le corps des Cadets est dissous. Les compositions sur des sujets comme « Pourquoi nous, Allemands, aimons-nous notre Kaiser ? », des attitudes comme celle du Cadet qui n’a qu’une ambition, « mourir à 20 ans devant Paris » n’ont plus cours. L’ancien monde a disparu et on comprend que le Cadet se trouve devant une situation qu’il est incapable de comprendre et à plus forte raison d’approuver. Il ne lui reste que l’action contre tout ce qu’il n’aime pas, les communistes, les Français occupants et tout l’édifice de la République de Weimar, démocrate et capitularde. Jusqu’à son emprisonnement en 1923, il est partout où on se bat.
À Berlin, aux premiers jours de la révolution, il arbore, fier et méprisant, son uniforme. Il est pris à partie par la foule qui veut lui arracher ses pattes d’épaule. Il est frappé, mais un officier le sauve. Dès lors, son mépris pour « la canaille » ne fait que croître. Il essaie de soulever ses amis contre le nouveau régime. Il amasse chez lui un véritable dépôt d’armes : « Sous mon étroit lit de fer se trouvaient trois caisses de grenades et dix caisses de cartouches. Les fusils bien graissés, enveloppés et mis en tas, occupaient un tiers de la pièce. » Les conditions de l’armistice lui font pousser des cris d’indignation et de haine.
Il s’engage dans les corps francs et prend part au combat du Marstal contre les marins et à la répression du mouvement spartakiste en janvier 1919 à Berlin. Il est ensuite envoyé à Weimar pour protéger l’Assemblée. Mais ce rôle ne lui convient pas : « Nous avons sauvé la patrie du chaos. Que Dieu nous pardonne, ce fut notre péché contre l’esprit. Nous avons cru sauver le citoyen et nous avons sauvé le bourgeois. Le chaos est plus favorable au devenir que l’ordre. La résignation est l’ennemie de tout mouvement. En sauvant la patrie du chaos nous fermions la porte au devenir et nous ouvrions les voies à la résignation. »
Il part pour la Baltique où il se bat sans cesse. Il revient, participe de loin au putsch de Kapp, mais son groupe est encerclé et capturé après une farouche résistance dans une petite ville proche de Hambourg. Il s’échappe. On le retrouve en Rhénanie, luttant contre les forces françaises d’occupation et contre les séparatistes. Il est en Haute-Silésie au moment du plébiscite et des combats qu’il a provoqués.
Après la Silésie, on parle beaucoup de la Sainte Vehme, organisation chargée de punir les traitres à l’Allemagne. Von Salomon nie qu’il y ait eu une vaste organisation contrôlant tout le pays. Il dit que les combattants de Haute-Silésie, rentrés chez eux dans toutes les régions d’Allemagne, se sont groupés sur le plan local en associations mal reliées entre elles. Cependant, leur but et leurs méthodes étant semblables, on a pu croire à de mystérieux chefs dirigeant les forces cachées de l’Allemagne. Von Salomon les présente ainsi : « Ces associations étaient un symptôme. C’est là que se groupaient les hommes qui se sentaient trahis et trompés par l’époque. Rien n’était plus réel, tous les piliers étaient ébranlés. Là se réunissaient tous ceux qui espéraient encore beaucoup et ceux qui n’espéraient plus du tout ; leurs cœurs étaient grands ouverts, mais leurs mains s’accrochaient encore aux choses accoutumées. Le rassemblement de tous ces êtres intensifiait ce tourbillon mystérieux d’où, par le jeu des forces et des croyances contradictoires, pouvait monter ce que nous appelions le Nouveau. Si jamais du nouveau vient en ce monde, c’est bien du chaos qu’il surgit, à ces moments où la misère rend la vie plus profonde, où, dans une atmosphère surchauffée, se consume ce qui ne peut pas subsister, et se purifie ce qui doit vaincre. Dans cette masse en ébullition, en fermentation, nous pouvions jeter nos désirs et nous pouvions voir s’élever la vapeur de nos espoirs. »
Parmi les actes de ces associations, le plus caractéristique est l’assassinat de Rathenau, un des rares adversaires que les Réprouvés admirent et justement le plus dangereux parce que le plus digne et le plus brillant représentant de l’Allemagne de Weimar qu’ils haïssent. Von Salomon ne participe pas directement au meurtre mais ce sont ses proches qui l’accomplissent. Un mouvement d’indignation saisit les partisans de la République de Weimar : les assassins sont traqués et tués ; leurs amis sont poursuivis. Arrêté, Ernst von Salomon est condamné pour complicité à cinq ans de réclusion et, quelque temps plus tard, à trois ans de plus pour une tentative d’assassinat sur un traitre à sa cause.
Rémy Cazals, janvier 2023