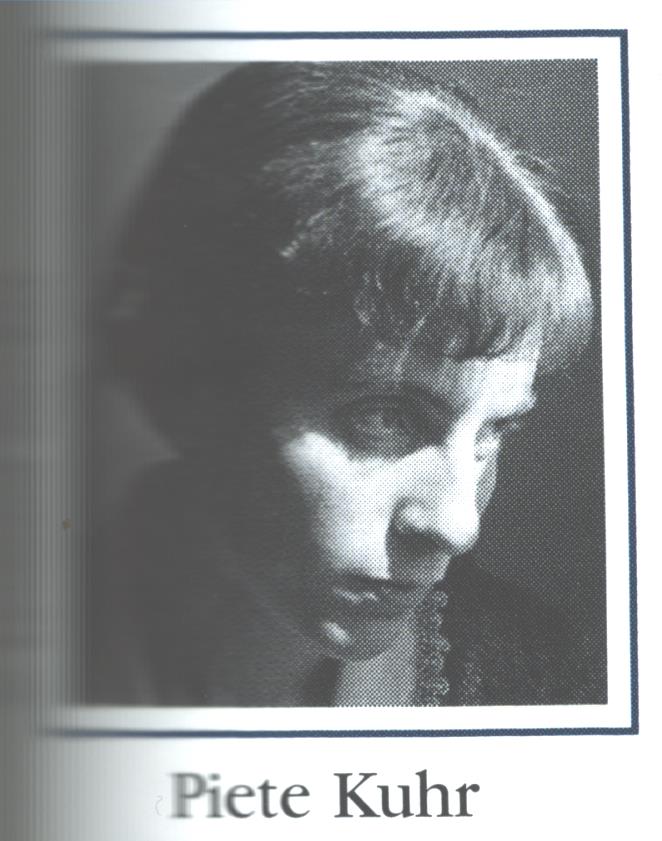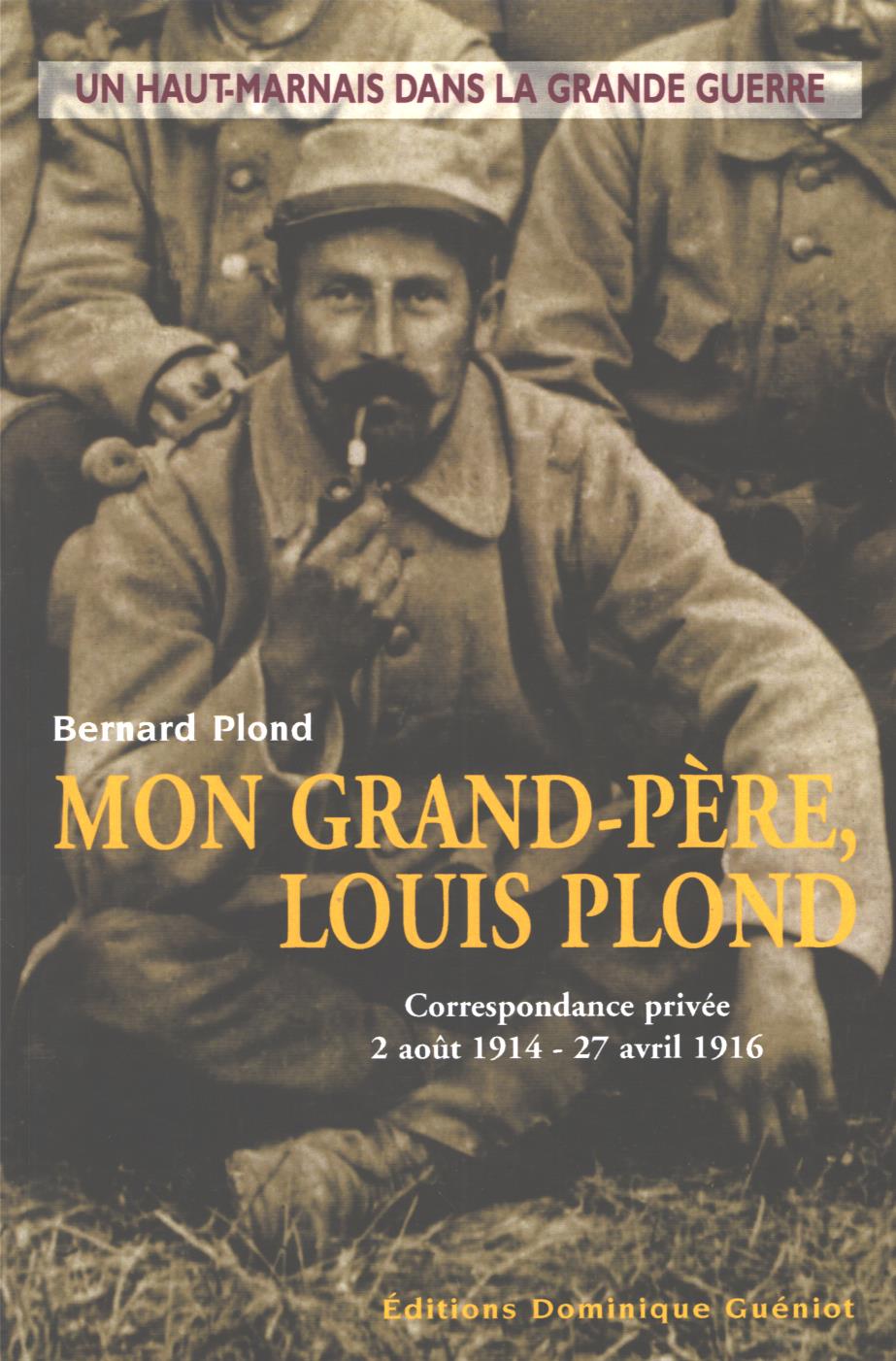Soissonnais 14 – 18, Germaine Servettaz, Claude Lavedrine et Hervé Vatel (éd.), Les Carnets d’un ambulancier et pharmacien. (De la bataille de Quennevières aux combats du Soissonnais 1915 – 1918), Paris, Éditions des Équateurs, 2007, 317 pages.
1. Le témoin
Jean Prévot est né à Montauban en 1890. Bachelier en 1908, la guerre le trouve à Bordeaux alors qu’il n’a pas encore terminé ses études de pharmacie. Incorporé au 108e RI de Bergerac, et passé dans une section d’infirmiers non endivisionnée en janvier 1915, il est transféré en avril 1915 à l’ambulance 4 de la 37ème DI, division composée de régiments de tirailleurs et de zouaves. Il est au front ou dans la zone des étapes d’avril 1915 à septembre 1918. Revenu à la vie civile, il exerce les fonctions de pharmacien à Toulouse, Carcassonne et Lautrec. Il décède à Orléans en 1960.
2. Le témoignage
Les Carnets d’un ambulancier et pharmacien (« De la bataille de Quennevières aux combats du Soissonnais 1915 – 1918») ont été publiés en 2007 par Germaine Servettaz, Claude Lavedrine et Hervé Vatel, en association avec l’association « Soissonnais 14 – 18 » aux éditions des Équateurs (317 pages). C’est à Orléans, dans la maison où est décédé Jean Prévot (ne pas confondre avec Jean Prévost, écrivain et journaliste mort en 1944 au Maquis), « qu’en 1970 son petit-fils Marc retrouvera intacts dans une malle entreposée dans le grenier les carnets écrits par son grand-père. » (p. 11). L’introduction de G. Servettaz montre l’importance de la transmission mémorielle, avec un voyage fait par les transcripteurs de l’ouvrage sur les lieux évoqués par l’auteur, et notamment la ferme-ambulance 4/37. À noter une ambiguïté p. 11 « il est nommé 1re classe de réserve le 9 juillet 1919 », c’est bien-sûr aide-major (pharmacien) de 1ère classe, c’est-à-dire l’équivalent du grade de lieutenant.
3. Analyse
Février 1915 – mars 1916 – infirmier à l’ambulance
Il s’agit de la partie la plus intéressante des carnets, car c’est là que J. Prévôt est le plus disert quand il évoque avec précision ses fonctions d’infirmier dans une ambulance (hôpital de campagne). Jeune étudiant, il n’a pas été reconnu pharmacien dans cette spécialité car son cursus est incomplet, mais cet état lui permet d’échapper à son régiment en janvier 1915 (passage à la 12e section d’infirmier) puis d’intégrer l’ambulance 4/37. Il mentionne ses tentatives infructueuses pour se faire reconnaître comme pharmacien [avec autorisation de citation] (p. 29) « non, des pharmaciens, on en a, à ne savoir qu’en faire ! ». Pour lui cette affectation non enrégimentées est tout de même appréciable, en témoigne cette menace affichée à la 12e section d’infirmiers (avril 1915) : « Tout absent à deux appels : versé dans l’infanterie. » Les carnets décrivent le quotidien des gardes d’infirmier, dans une ambulance proche des lignes ; elle reçoit en 1915 des blessés du secteur de Quennevières (Offémont, Oise). La force de ces mentions, qui rappellent le Georges Duhamel de 1917, est faite d’un mélange de description des blessés, d’évocation de leurs souffrances, avec un ton détaché et neutre, sans empathie particulière, une sorte de froideur clinique qui renforce la dureté de la perception. Ainsi par exemple en avril 1915 (p.53) : « La salle 5 (12 lits) est à moitié pleine de types plus ou moins amochés. (…) On a amené trois Boches blessés. En voici un des plus amochés, pieds broyés, les fesses emportés par les obus. Il n’y a pas moyen de le prendre et après un pansement on le laisse sur son brancard et on le met tel quel sur le lit. La plupart sont blessés à la tête. On ne voit point de figure. On n’entend que des corps qui gémissent et se plaignent des cris du blessé : à boire. Le premier en entrant à droite est déjà mort, les traits calmes comme s’il dormait encore. Au fond un zouave râle, il a une fracture du crâne et ne va pas tarder lui non plus à entrer dans le grand sommeil. » L’auteur est souvent acerbe à propos des talents médicaux des majors, sans qu’il soit possible de savoir si c’est vraiment justifié (p. 58) « Le type à la fracture du crâne qui était dans la tente de la cour et qui râlait depuis hier est mort sur la table d’opération. Jocaveille en sortant de la salle était tout souriant. Ce matin Deveze a amputé le zouave d’hier soir arrivé avec l’hémorragie du bras, il va parfois un peu vite en besogne. » L’auteur évoque p. 73 « un sidi gratifié d’une balle dans la tête, on ne l’a guère regardé. Tout n’est certes pas pour le mieux, et que dire ? » Rien ne permet ici de dire que les blessés sont moins bien soignés parce qu’ils sont indigènes, il s’agit plutôt d’un doute sur les compétences professionnelles de certains majors, dont certains s’improvisent chirurgiens. L’auteur mentionne souvent le fait que lorsque c’est son tour de repos, il ne peut dormir et récupérer à cause des cris persistants des blessés. Ainsi p. 73 « On apporte un tirailleur gravement atteint d’un éclat dans le dos. Le major dit que l’on pourra lui donner à boire ce qu’il voudra, ce qui est sa condamnation sans plus de phrase. Il se voit perdu; d’ailleurs en arrivant dans la salle il se met à hurler et ne cesse guère ce qui m’ôte toute envie de dormir. (…) Bordes vient lui faire une injection de morphine, cela le calme un peu mais point complètement cependant. Quand à minuit Béneyssie vient me réveiller, je n’ai pas encore pu fermer l’œil. » Ces carnets restituent bien la lourde ambiance régnant à l’ambulance lorsque le front est actif, et que des blessés, souvent gravement atteints, sont amenés avant transfert, opération sur place, ou pour attendre le décès si on estime le cas sans espoir.
L’auteur signale plus loin la lecture d’un ordre général (27 avril 1915, p. 66) qui mentionne la citation octroyée à une autre ambulance, puis la liste de soldats qui ont été fusillés, la plupart pour abandon de poste, « quelques-uns pour mutilation volontaire, des tirailleurs surtout. »
J. Prévôt évoque ensuite la bataille de Quennevières (Moulin-sous-Touvent, juin 1915) telle qu’elle est perçue par une ambulance proche du front ; il mentionne les récits et bruits rapportés de la première ligne, par exemple le 1er juin, des affiches allemandes demandent si l’attaque « est pour aujourd’hui ? » (p. 95), ou des ordres de ne pas faire de prisonniers (p. 103), mention relativisée par la mention récurrente d’arrivées de prisonniers allemands. L’activité est éreintante, avec un bombardement qui n’épargne pas les abords de l’ambulance, des blessés nombreux, et des prisonniers allemands souvent blessés eux-aussi. A la fin de la bataille (recul français 15 et 16 juin 1915) il mentionne (p. 117) « Le nombre de blessés entrés est de 357 pour les trois derniers jours dont 195 pour aujourd’hui. »
L’évocation de l’offensive de Champagne (octobre 1915) est beaucoup moins précise, l’auteur est plus à l’arrière, et c’est davantage un témoignage d’ambiance, nous « aurions » attaqué, il y « aurait » déjà deux régiments boches de prisonniers, etc…
Mars 1916 – septembre 1916 – pharmacien auxiliaire – La Somme.
J. Prévot est nommé pharmacien auxiliaire, tout en restant simple soldat, il dépend alors du groupe de brancardiers de corps de la VIIIe Armée. À l’arrière du front, il s’occupe des médicaments, du chlore pour les exercices de gaz, et travaille aussi au laboratoire bactériologique. Sa localisation à Bar-le-Duc ne lui permet de décrire la bataille de Verdun que par ouï-dire. Il n’en est pas de même lorsqu’il arrive dans la bataille de la Somme (août 1916) : dans le secteur de Bouchavesnes, il fait sous le bombardement des liaisons avec les postes de santé avancés. Les progressions sont dangereuses et harassantes, il apporte des fournitures, des médicaments mais aussi du chlore pour des inhumations de fortune à faire sous le bombardement :
3 août 1916 (p. 229) « A 19 heures 30 ordre pour aller à Tatoï. Je pars avec 32 G.B.D., un pharmacien auxiliaire et du chlore. Arrivé au poste du 363e, le médecin-chef me remercie, il ne veut pas faire tuer des vivants pour enterrer des morts. »
19 août (p. 234) « Les Boches nous envoient pas mal de balles (…) Sur 100 mètres nous inhumons 51 cadavres, presque tous des Boches qui ont été tués et ensevelis par le tir des torpilles. »
20 août 1916 « Nous sommes de retour à Vaux, sans casse heureusement. Odeur épouvantable, cadavres vieux de 15 jours. Plusieurs rendent leur repas ! »
Octobre 1917 – juillet 1918 – pharmacien de régiment
Les carnets sont interrompus de septembre 1916 à octobre 1917, et on sait par sa F.M. que l’auteur a été promu pharmacien aide-major de 2e classe (sous-lieutenant) au 8e zouave (Division Marocaine). Les mentions deviennent plus rapides, indiquant déplacements, relations de blessures de connaissances, attaques aériennes, résultats de pêche, statistiques de pertes, etc…
L’engagement du 8e zouave pour tenter d’endiguer les offensives allemandes du printemps 1918, ranime la tension dans les notations. Son unité vient au secours des Anglais fin avril, dans le secteur de Villers-Bretonneux. (26 avril, p. 277) « À 4 heures, reçois l’ordre de rejoindre le poste de santé à Bois-Labbé. Très violente canonnade vers 5 heures. Pas mal de blessés par mitrailleuse. Nous sommes complètement assourdis par batterie anglaise voisine. Pas mal d’officiers touchés, Cadiot, Minard, Binder. Courtois arrive dans l’après-midi le cou traversé par une balle. Les tirailleurs auraient une grosse casse et ne tiennent pas le coup. Vu passer 2 tanks. L’un d’eux a déchargé deux blessés à la tête par balle ayant traversé les parois. »
L’auteur évoque ensuite les durs combats de la fin mai 1918, pour stopper l’avancée allemande du Chemin des Dames. Il participe aux combats de juillet 1918, mais les carnets s’arrêtent définitivement le 22 de ce mois. On sait qu’il est évacué gazé en septembre, mais pas s’il retourne en ligne avant l’Armistice : il sera plus tard pensionné (gazé) à 30%.
La partie la plus évocatrice de cet intéressant témoignage est donc celle qui concerne en 1915 la vie et la mort à l’intérieur d’une ambulance proche des lignes du Soissonais.
Vincent Suard, mai 2024