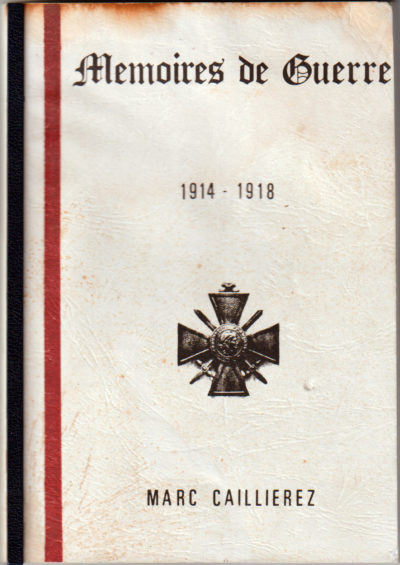1. Le témoin
Robert Hertz (Saint-Cloud, 22 juin 1881 – Marchéville, 13 avril 1915). Sociologue, normalien, reçu premier à l’agrégation de philosophie en 1904, il est proche de Durkheim. Dès 1905, il collabore à L’Année sociologique. Ses travaux portent sur les représentations collectives religieuses, avec des thèmes de recherche comme le culte des saints1, la mort et ses rites, le péché (sujet de sa thèse inachevée). Hertz est aussi un alpiniste et un sportif. Ces caractéristiques se retrouvent dans sa pratique scientifique : il a le goût de l’ethnographie au grand air, des enquêtes de terrain (ce dont il doit d’ailleurs se justifier à l’époque envers l’Université). Issu d’un milieu de commerçants aisés, il est rentier et n’a pas besoin d’une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, mais il connaît néanmoins des expériences d’enseignement avant-guerre.
Politiquement, c’est un intellectuel socialiste, proche de la sensibilité de la Fabian Society anglaise. Son socialisme est parlementaire, réformiste, intellectualiste, laïciste, scientiste et positiviste. À ses yeux, la science sociale doit nourrir la réflexion politique et le progrès. Il participe ainsi à la fondation du Groupe d’Études Socialistes en 1908. Pour compléter ce profil rapide, on n’omettra pas de mentionner les activités de sa femme Alice Bauer (1877-1927, mère d’Antoine Hertz, né en 1909), pédagogue d’avant-garde, parmi les pionnières de l’éducation des très jeunes enfants en France. Ceci explique l’importance accordée par Robert Hertz aux questions de transmission et de diffusion des savoirs, position d’ailleurs en cohérence avec sa conception d’une imbrication nécessaire de la pratique scientifique et de la vie citoyenne. Sur ce point, Robert Hertz est très représentatif des élites juives de l’époque, très attachées à la République. Un fort patriotisme (visant l’intégration dans la communauté nationale, toujours ambivalent quelques années seulement après l’Affaire Dreyfus) en découle assez naturellement la Grande Guerre venue.
2. Le témoignage
Un ethnologue dans les tranchées (août 1914-avril 1915). Lettres de Robert Hertz à sa femme Alice, Paris, CNRS éditions, 2002, 265 p., présentation par Alexander Riley et Philippe Besnard, préfaces de Jean-Jacques Becker et Christophe Prochasson.
Le recueil présente un extrait des lettres envoyées par Robert Hertz à sa femme Alice. La taille exacte du corpus n’est pas précisée. Ce volume ne reproduit pas les lettres dans leur intégralité, ce que signalent préalablement A. Riley et P. Besnard : « nous n’avons généralement pas reproduit les passages des lettres qui ne concernent que des affaires strictement privées, événements familiaux, questions financières, considérations pratiques sur l’envoi des colis au front » (p. 37). Ce choix a ceci de fâcheux qu’il contribue à rendre de Robert Hertz, déjà très porté sur les réflexions sociologiques et patriotiques, une image excessivement désincarnée et idéaliste. Le gommage des aspects prosaïques de sa vie obère en l’occurrence l’intérêt du document en tant que source historique, l’inadaptation de Hertz aux exigences pratiques et manuelles de la condition de combattant revêtant, comme on le verra, une importance cruciale. Il est dans le même ordre d’idées regrettable que les éditeurs n’aient pas publié les lettres de sa femme, qui permettent de comprendre en reflet bien des choses quant à l’exaltation de Robert Hertz, laquelle se manifeste aussi en réponse aux questions et affirmations d’Alice. (cf. MARIOT (N.), art. cit., n. 24)
Parcours militaire :
– 2 août 1914 – 14 août 1914 : sergent au 44e Régiment territorial d’infanterie (15eCie) (Verdun, caserne Miribel)
– 14 août 1914 – 21 octobre 1914 : sergent au 44e Régiment territorial d’infanterie (15eCie) (village de Bras, région de la Woëvre)
– 21 octobre 1914 – 13 avril 1915 : sergent au 330e Régiment d’Infanterie (17e Cie) Lieux : Verdun, Braquis(20 kms à l’est de Verdun, nord de la crête des Éparges). Le 330e R.I. participe à l’offensive de la cote 233 à partir de Fresnes-en-Woëvre les 12 et 13 avril 1915, date de la mort de Robert Hertz, qui avait été promu sous-lieutenant le 3 avril : « l’attaque avait coûté quarante morts, cent cinquante blessés et seize disparus » (préface de Jean-Jacques Becker, p. 23).
3. Analyse
La guerre (presque) sans combats. Traits de la vie dans l’arrière-front :
Dans ses lettres, Robert Hertz s’étend régulièrement sur le quotidien de la vie dans les tranchées, en ayant le souci, commun dans ce type d’écrits combattants, de ne pas engendrer trop d’anxiété pour les proches. Il décrit par suite les activités diverses auxquelles lui est ses hommes sont affectés (terrassements et travaux divers notamment), ainsi que les repas, nuits en plein air, marches… qui constituent l’essentiel de cette vie de sentinelles d’un pays en guerre. Il délivre des appréciations concises et précises la condition du troupier :
« après deux jours et deux nuits de repos passés au village, j’ai regagné le bois où nous sommes aux avant-postes (…) je suis sous une hutte construite avec des fagots de bois (…) une mince couche de paille à moitié pourrie constitue notre literie. Mais ce qui fait le charme de notre demeure, c’est un petit feu que nous sommes autorisés à entretenir à l’intérieur parce que nous sommes bien en arrière de la lisière du bois. Il faut vivre au bivouac par ces jours-ci pour apprécier vraiment la vertu d’un feu. Il ne faut pas trop plaindre les soldats en campagne – s’ils ont des privations, des misères, ils ont de grandes joies : se sécher au coin d’un bon feu, une rafle de cochons dans un village abandonné, une vieille bouteille oubliée dans un recoin, etc. » (30 octobre 1914, p. 88).
Un intellectuel à la guerre. Écrire, lire et réfléchir…
Robert Hertz note à plusieurs reprises le moindre intérêt qu’il porte à la lecture du fait de la guerre. Il lit essentiellement les livres qu’Alice lui envoie, ou bien qui lui tombent sous la main (Antigone de Sophocle, 3 octobre 1914, p. 69). Il ne cesse par contre de se projeter dans ses travaux et publications d’après-guerre.
Il exerce ses compétences d’intellectuel en produisant de nombreuses réflexions sur le cours de la guerre, sa signification, les traits de mentalité de ceux qui y participent… Il nous faut ici détailler un peu le fond de ces pensées : à travers elles, en effet, ce sont plusieurs penchants typiques des intellectuels dans la Grande Guerre qui peuvent être saisis. Car si Robert Hertz pense, analyse et disserte comme sa formation lui a appris à le faire, il démissionne dans le même temps quant au devoir de critique. Cette posture, qu’il endosse explicitement au nom des circonstances, constitue une part pourtant essentielle de l’éthique de sa profession et ce à plus forte raison pour un sociologue comme lui, ayant à cœur de ne pas dissocier les apports de la science de leurs implications sociales.
Dans un tel cadre, on le trouve fréquemment en train de relativiser certaines notions issues du discours dominant sur la guerre, tout en assumant de ne pas trop pousser sa réflexion.
Ainsi l’idée de guerre d’agression menée par l’Allemagne, pourtant un élément-clef de l’acceptation de la guerre par sa famille politique, est-elle fort judicieusement mise en balance avec les sentiments éprouvés par la masse des Allemands, eux aussi convaincus de lutter contre les menaces pesant sur leur patrie. Mais ce constat lucide une fois posé, aucune conséquence n’en est tirée :
« comme cette distinction entre la guerre d’agression et de conquête et la guerre de défense paraît futile à l’épreuve des faits. Heureusement nul besoin de raisonner » (17 novembre 1914, p. 113).
De telles abdications de l’analyse critique objective se rencontrent ailleurs : il remet en cause le rationalisme d’un autre mobilisé, l’ingénieur Chiffert, qui voit dans la guerre un gâchis de vies, de forces et de richesses :
« L’idée que cette guerre pût être embrassée comme un événement salutaire et saluée par l’un de nous comme l’heure culminante de sa vie lui paraissait billevesée, mystique et le faisait sourire. Pour ce catholique très pratiquant, la religion était une affaire d’un tout autre ordre – il n’y avait pas communication… », (16 décembre 1914, p. 149).
Reprochant de la sorte à un catholique le cloisonnement de ses valeurs (attitude très laïque au fond), Robert Hertz n’est guère crédible quand il s’irrite ailleurs, avec une rhétorique très banalement anticléricale du retour aux autels. C’est là pour lui la marque des esprits faibles et superstitieux : il faut en effet« peu de choses pour faire vaciller leur raison » (28 novembre 1914, p.127). On notera la contradiction dans les termes avec la tirade émise onze jours plus tôt.
Cette mise en jachère des exigences du travail intellectuel se traduit de diverses façons : généralisations à partir de cas isolés (sur les qualités innées du Français, 10 août 1914, p. 42), désir d’une « absorption dans le service » (26 décembre 1914, p. 167), éloges à Maurice Barrès (28 novembre 1914, p. 128), le pacifisme et les idéaux d’avant-guerre comme « illusions perdues »(1er novembre 19114, p. 92) ouvrant sur l’inévitable dévouement sacrificiel à l’intérêt collectif (3 novembre 1914, p. 98, 8 novembre 1914, p.105 et surtout 20 février 1915, p. 215-216, où sont convoquées l’Union sacrée, la charité, la guerre juste…)
Son consentement/« contentement » (préface de Christophe Prochasson, p. 31) à la guerre est certes effectif, il n’est toutefois pas univoque. Le même qui clame les vertus de l’oubli de soi et le sacrifice intégral ne décourage pas les efforts de ses proches pour lui obtenir une affectation de faveur en usant notamment des réseaux normaliens autour d’Albert Thomas (cf. p.107, 109, 119, 124, 133, 135).
En outre, toute sa vision de la guerre doit être rapportée à la tranquillité des secteurs où il est mobilisé jusqu’à ses derniers jours2. Cette précaution analytique doit notamment s’appliquer à son approche – ambivalente – de l’ennemi. Il entre d’une part dans le cercle fermé de ceux qui vivent la guerre comme une croisade (5 décembre 1914, p. 139), en véritable moine-soldat (25 novembre 1914, p. 120). Cela doit bien être rattaché à son affectation relativement protégée et à sa mort prématurée, qui préservent de telles conceptions de l’épreuve des faits. Mais cette situation abritée agit sur un autre versant de ses réflexions. Hertz ne manifeste pas, en effet, de haine de l’ennemi : « pourquoi chercher à dénigrer, à rabaisser son ennemi, qui, comme dit Nietzsche quelque part, est notre partenaire, notre camarade de lutte ? » (28 novembre 1914, p. 127). Une telle conception, celle du « pur guerrier » et de la communauté de sort des combattants de part et d’autre du front, aurait pu évoluer dans la durée en pacifisme, mais ce n’est là qu’une conjecture. Telle quelle, elle interpelle par sa proximité avec d’autres considérations métaphysiques sur le soldat, telles celles d’Ernst Jünger. Par exemple :« lorsque nous nous tombons dessus dans un brouillard de feu et de fumée, alors nous ne faisons plus qu’un nous sommes deux parties d’une seule force, fondus en un seul même corps » (La guerre comme expérience intérieure, Paris, Christian Bourgois, 2008, p. 155). Sauf que si Jünger a bel et bien vécu le combat de première ligne, ce qui fait de telles assertions des témoignages d’un état d’esprit spécifique (et marginal), le propos de Robert Hertz, par suite, ne nous renseigne guère que sur les élucubrations personnelles de ce dernier.
Mettre en évidence un tel degré de décalage entre les écrits de Robert Hertz et le vécu de sa guerre, c’est rappeler que sa formation et son statut ne font pas automatiquement de lui le »super-témoin » qu’une appréciation un peu rapide peut mettre an avant : « voir et avoir la capacité d’en rendre compte sont deux choses totalement différentes. Rendre compte, cela signifie avoir d’abord le talent d’observation, ensuite celui d’écriture, en d’autres termes être ou devenir un écrivain ou, comme dans le cas présent, être ethnologue » (préface de Jean-Jacques Becker, p. 24).
C’est aussi dire clairement qu’il serait erroné d’accorder au contenu analytique, largement extrapolé, des lettres de Robert Hertz une valeur représentative quant aux convictions de la masse des soldats. Ceux-ci sont en moyenne, comme il va en faire maintes fois l’expérience, bien plus attirés par la perspective de survivre à la guerre que de la mettre au profit pour réaliser un destin patriote modèle.
Vivre dans la nature, avec le peuple
En même temps qu’elle lui offre le contexte de spéculations politiques et métaphysiques, la guerre est pour Robert Hertz le théâtre d’expériences personnelles nouvelles, soit la vie au grand air en compagnie d’hommes des classes populaires. On a dit que le sociologue était familier de l’activité physique (membre du Club Alpin français), mais la guerre de tranchées rend quotidien ce qu’il ne connaissait qu’en termes de loisirs, la vie en extérieur. Il s’en trouve très bien, et répète à l’envi les bienfaits d’une telle existence. Comme n’importe quel individu amené à passer beaucoup de temps en extérieur, il est attentif au temps qu’il fait, aux changements de saisons, à la multitude de signes que la nature donne à ceux qui savent y prêter attention. Cette proximité – inédite parce que permanente – avec l’environnement naturel se double d’une autre, celle vécue avec les autres combattants, issus de milieux populaires et ruraux pour la plupart. Le tout relié aux références culturelles du normalien forme un drôle d’attelage, où les classes sociales sont simultanément estompées et affirmées, sur fond de retour à la Nature :
« Doux et gai rayon de soleil qui nous dit que la boue ne submergera pas tout. Et puis, dans le bois effeuillé, que de promesses déjà : des feuilles mortes à demi décomposées ont levé, drue, une moisson de mousse très verte, très fraîche. Et comme je la remarquais, les gars de la campagne m’ont dit : c’est la saison – les saules au bord de la petite rivière débordée (qui marque en ce moment la frontière entre l’ennemi et nous) – argentées aujourd’hui – les saules sont tout roses – les bourgeons des charmes commencent à se déployer et à montrer leurs feuilles »
(13 décembre 1914, p. 145).
« Plus je vois des hommes ici et plus je me convaincs que la campagne est indispensable pour régler et calmer les hommes, et je crois que que la chasse pratiquée avec des hommes du terroir, un tantinet braconniers, doit être une école merveilleuse (d’observation aiguë, d’endurance, de poursuite tenace, etc.) Ce que je souhaite le plus à nos petits, c’est de ne pas être prisonniers de la tradition citadine, livresque et bourgeoise, c’est d’être des hommes frais en contact direct avec la nature, capables de créer. La lecture de La Campagne de France de Goethe m’a de nouveau fait vivre dans cette atmosphère légère, libre et sereine que fait naître toujours cet étonnant annonciateur de l’Europe nouvelle ».
(3 octobre 1914, p. 68)
Hertz amalgame assez automatiquement le milieu naturel avec les hommes d’origine sociale modeste : les deux font corps dans ses représentations. Il exerce sur eux son regard d’ethnologue, dans lequel se mêlent empathie, admiration et condescendance. Un relevé des expressions employées par Hertz au fil des jours pour qualifier ses compagnons est très significatif quant à ces équivoques : « bons camarades », « les gars » (39), « braves meusiens », « ouvriers parisiens dégourdis et habiles » (45) ; « bons gars débrouillards » (46), « grands enfants de trente à quarante-six ans » (48), « belle race » (54), « rudes lapins », « amis » (70), « inculte mais gentil » (71), « leurs propos sont toujours savoureux et instructifs » (71), « gais et insouciants » (85), « mes oiseaux de basse-cour ». Les « Mayennais » sont tels des « enfants heureux » (cf. 117-119, 141, 200-216).
Robert Hertz est aussi très à l’écoute de ses camarades : il note leurs dictons et expressions, relève des éléments de folklores, de croyances. Il est également prompt à évoquer leurs mérites et leurs limites. Si Hertz lui-même est assez porté sur les abstractions patriotiques, il a toutefois la lucidité de reconnaître que ce trait est tout sauf répandu dans la zone des combats, où les formes diverses du rire populaire ont tôt fait de tourner en ridicule les péroraisons officielles :
« ils ont une sorte de répugnance instinctive à la phrase, au lyrisme. Je leur ai lu le manifeste socialiste, du Barrès, l’article de Lavisse aux soldats de France. Rien de tout cela ne m’a paru mordre. Leur puissance est dans la blague (…) ils ne se laissent pas « bourrer le crâne » (…) ils poussent la légèreté jusqu’au sublime. Stoïcisme spontané, simple, élégant » (1er janvier 1915, p. 175).
Il n’est au fond pas très étonnant de constater par le biais de ces observations la facilité avec laquelle les usages de la culture populaire demeurent actifs malgré la guerre. Hertz raconte ailleurs comment, tombés sur diverses têtes de bétail, les hommes « jouaient à se vendre les bêtes (…) tout comme au champ de foire de chez eux » (14 février 1915, p. 207).
Par moments, Robert Hertz s’approprie un peu du réalisme troupier, de ses satisfactions prosaïques et néanmoins essentielles. Un très bon exemple est ce petit moment de liberté individuelle retrouvée quand RH doit effectuer un trajet à pied seul, libre de ses mouvements pour quelques kilomètres : « pour la première fois [depuis deux mois] j’avais l’espace devant moi, la bride (relativement) sur le cou » (6 janvier 1915, p. 180).
Cette expérience de vie – et non de temps passé en enquête de terrain – avec des ouvriers et des paysans l’amène plus largement à redéfinir une échelle politique et morale des valeurs. Si le parcours scolaire et universitaire de Robert Hertz n’est en rien celui d’un paresseux, il vaut néanmoins d’apprécier le regard qu’il porte sur le travail manuel. Ainsi, quand des « bûcherons de l’Argonne » viennent « construire de nouvelles baraques », il se dit : « c’est beau de les voir travailler le bois d’une main sûre et vigoureuse (…) la plupart des hommes d’ici, ouvriers, cultivateurs, bûcherons, aiment leur travail, ils en ont la fierté et la nostalgie » (19 septembre 1914, p. 57). Ce thème ne le lâche pas, et quelques mois plus tard, il en fait le fondement d’une éthique patriotique et sociale renouvelée en le rapportant à l’inscription dans la durée de la guerre de position :
« ce long effort patient et obscur, ces progrès lents, assurés par tant de sacrifices, c’est le type même de l’action féconde, disciplinée, que nous avions à apprendre et qu’il faudra bien continuer dans tous les domaines après la guerre. Nous avons appris à avoir juste la confiance en nous qu’il faut pour bien vivre et qui est aussi éloignée de la sotte infatuation que du méchant dénigrement de soi auquel nous nous laissions trop aller » (13 décembre 1914, p. 145-146). Ajoutons simplement ici que cette découverte des vertus du labeur assidu, sans éclat ni valorisation individuelle est une réalité vécue de longue date par la France des ouvriers, employés et paysans : encore une fois, la vision de Robert Hertz est modelée par son habitus de savant et de bourgeois.
Cette dernière caractéristique est essentielle pour une compréhension embrassant l’intégralité de son expérience de guerre. L’intérêt du rapport de Robert Hertz au travail manuel réside aussi dans le constat que l’on peut faire de ses inaptitudes personnelles en la matière. Malgré ce que l’on pourrait appeler une « bonne volonté manuelle », il ne fait guère de progrès en la matière, et se trouve souvent ébahi par les compétences de ses congénères. Ce fossé de l’habileté entre lui et ces derniers dit bien l’étendue, malgré le « communisme chaud, intime » des tranchées (14 février 1915, p. 208), du décalage issu des origines sociales de chacun.
Sur ce point, dans sa préface, Christophe Prochasson avance l’idée que durant la guerre, si « pour un socialiste comme Hertz, le « peuple« , la « classe ouvrière« s’incarnent soudainement (…) la tranchée n’est pas pour lui un lieu propice à la critique sociale. Le grand thème idéologique d’après-guerre, celui de la fusion sociale qu’on prétendait s’y être réalisée, trouve dans cette correspondance, si peu politique, un sévère démenti tant les barrières culturelles semblent infranchissables » (p. 28-29). Je souligne au passage l’expression culturelle, à mon sens inappropriée et euphémisante. C’est bien de barrières sociales qu’il faut en effet parler, ainsi que le montre en de multiples occurrences cette correspondance. Au fond de tous les sentiments mêlés que l’on décèle chez lui vis-à-vis du peuple, on retrouve toujours une certaine condescendance, celle du (bon) maître envers la domesticité – qu’il évoque le cuisinier Jamin, « bon type de troupier français » usant d’expressions approximatives mais débrouillard (15 octobre 1914, p. 76) ou la cuisinière familiale Laurence (« gentille fille de la campagne française, je suis content que ses yeux clairs et francs ne nous aient pas trompés, et ne cachent point comme tu dis, une âme vile », 21 novembre 1914, p. 116).
Mais les inégalités sociales se manifestent aussi à des signes concrets, des attitudes. Il décourage ainsi sa femme de lui faire parvenir des effets pour les soldats :
« Quant à m’envoyer des choses pour les hommes, en particulier de ces « salopettes » qui leur seraient certes utiles, je juge inopportun de m’ériger en Mécène, même anonyme, de la compagnie où je suis un « humble et obscur sergent ». Tout ce qui rappelle les anciennes inégalités de fortune, de classe, etc. est mauvais, et, avec tous mes précieux accessoires, couteau, montre, jumelle, musette somptueuse, couverture de Léon, etc. je tranche déjà trop sur le commun » (15 décembre 1914, p. 147). Rien de culturel ici, assurément, et pas davantage dans l’extrait suivant, où Robert Hertz est dérangé dans la rédaction de sa correspondance par une petite fille du village de cantonnement :
« Tandis que j’écris, elle veut à tout prix m’ôter mon alliance. « Tiens Maman, le monsieur, il a une dent en fer ! » (Je t’ai déjà dit, je crois, combien mes dents en or font d’impression par ici) » (8 novembre 1914, p. 105).
Si l’on tente, pour finir, une synthèse de la façon d’être en guerre de Robert Hertz, sociologue, rentier, juif patriote et socialiste, il faut mettre en avant la richesse des entrelacs entre classes sociales auxquels ses lettres nous permettent d’accéder, souvent malgré Hertz lui-même. Il demeure en effet captif de son intellectualisme malgré toutes les perceptions inédites (du peuple, de la nature, des hiérarchies sociales) que lui a apporté la guerre. Il reste indéfectiblement persuadé que son point de vue est issu (un peu comme par nature) de la raison critique distanciée, quand ses positions témoignent au contraire d’un suivisme patent quant au conformisme de ce temps. Il se voit en guerrier idéaliste mais demeure naïf, empoté, livresque, le tout avec une exaltation à laquelle on ne peut retirer aucune part d’honnêteté ou de sincérité. Sa mort, au-devant de laquelle Émile Durkheim n’est pas loin de penser qu’il s’est porté par exaltation patriotique (cf. présentation, p. 14), pourrait dans un tel ordre d’idées être comprise comme celle de l’échec d’un homme à devenir un soldat malgré toute sa bonne volonté. Ainsi, une dizaine de jours avant sa mort, il écrit à sa femme : « Aimée, je n’écris pas ce que je voudrais, je suis las d’écrire et un peu dérangé par le bruit et par les petits soins du métier. Près de moi, mes gentils poilus, appliqués et sérieux, vérifient l’état de leurs fusils et nettoient leurs cartouches comme pour une revue, pour qu’elles n’encrassent pas leur canon » (2 avril 1915, p. 248). Ce commentaire un peu agacé ne révèle-t-il pas l’étendue des lacunes du sergent Hertz ? Car, ce qu’il prend comme un zèle un peu mécanique de la part de ses subordonnés, c’est avant tout un geste essentiel de soldat. Les paysans qui l’entourent sont habitués à porter un soin méticuleux à leurs outils, et ont transféré cet usage dans leur métier de soldat. Davantage accoutumé à compter sur les autres pour les aspects pratiques de l’existence, Hertz tombe peut-être, par contre, pour des raisons fort peu métaphysiques mais, comme l’indique en raccourci l’exemple choisi, très liées à son statut social.
4. Autres informations :
Notes :
1 – Cf. Nicolas MARIOT, « Les archives de saint Besse. Conditions et réception de l’enquête directe dans le milieu durkheimien », Genèses, 63, juin 2006, pp. 66-87.
2 – Cf. Rémy CAZALS, « Non, on ne peut pas dire : « À tout témoignage on peut en opposer un autre » », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 91, juillet-septembre 2008, pp. 23-27.
(François Bouloc, mars 2010)
Voir Nicolas Mariot, Histoire d’un sacrifice. Robert, Alice et la guerre, Paris, Seuil, 2017, 442 pages.