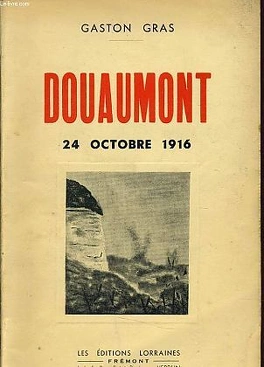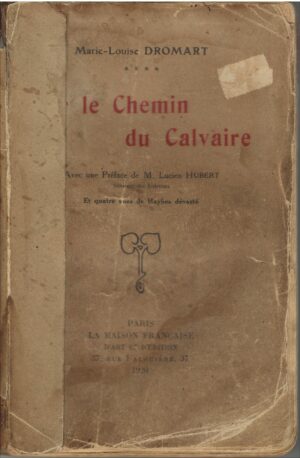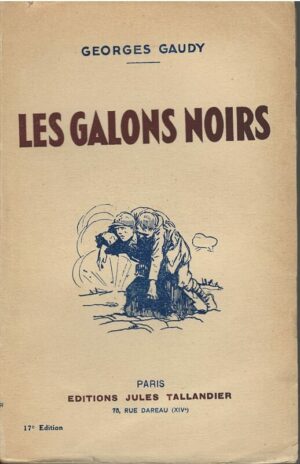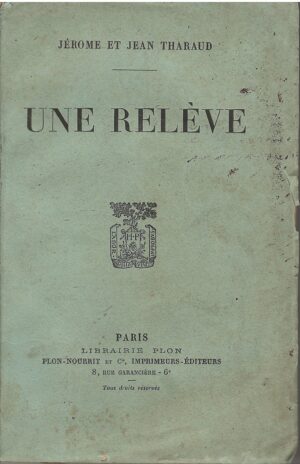Hugues Le Roux, Au champ d’honneur et Te souviens-tu…, Paris, Plon, 1916 et 1920, 297 et 289 pages
Résumé de l’ouvrage :
Hugues Le Roux, journaliste parisien ayant ses entrées dans les ministères, évoque l’entrée en guerre de son fils, Robert, sous-lieutenant au 356ème R.I. de Toul, dès le 1er août 1914, la mobilisation décidée. Par de courtes descriptions et l’appui de quelques lettres échangées entre son fils et sa fiancée, Hélène, il suit son parcourt et les premiers combats que le fils connaît dans la bataille des frontières et du Grand Couronné qui défend la ville de Nancy. Le 26 septembre, il reçoit un avis de blessure qui semble peu grave mais qui contient la mention d’une paralysie des jambes. Le père obtient l’autorisation de rejoindre son fils à l’hôpital Gama de Toul où, très gravement blessé, il est sur son lit de souffrance. Dès lors, l’ayant rejoint, il recueille les circonstances de sa blessure héroïque puis assiste à son agonie et à sa mort, qui survient le 18 octobre à 3 heures du matin. Il l’enterre alors dans un cimetière de la ville. Son second ouvrage, placé à la suite dans l’édition présentement étudié, est un hommage, Robert Le Roux étant le fil dans ses voyages divers, sur le front comme autour de la terre, entre novembre 1914 et juin 1919.
Eléments biographiques :
Robert Charles Henri Le Roux, est un journaliste parisien connu sous le pseudonyme d’Hugues Le Roux. Il est né le 23 novembre 1860 au Havre (Seine-Maritime), de Charles Clovis et de Henriette Gourgaud. Il collabore avec plusieurs grand journaux parisiens (Le Matin, Le Journal, Le Figaro ou Le Temps mais aussi la Revue politique et littéraire) et est également auteur de près d’une quarantaine d’ouvrages entre 1885 et 1920. Dans son dernier livre, Te souviens-tu…, il raconte d’ailleurs comment il trouve l’un de ceux-ci, Ô mon passé…, sur une étagère dans un local de la gare à Haparanda, en Suède. Grand voyageur, il dit, page 91 de Tu te souviens… « …le Celte que je suis ne se sent tout à fait chez lui qu’en mer ». Il a deux fils, Guy et Robert, et une fille, Marie-Rose, qui a 18 ans en 1914. Ceux-ci semblent avoir été miraculés lors d’une attaque de croup lorsqu’ils étaient jeunes. Avant la guerre, il a la douleur de perdre son épouse, puis son premier fils. Un paragraphe nous renseigne aussi sur le « poids » de la guerre sur toute la famille : « Dans le Midi, mon beau-frère, le professeur à la Faculté de chirurgie, est placé d’office à la tête d’un hôpital de la Croix-Rouge. Mon second beau-frère, le père de Charles, reprend son uniforme de médecin-major. Mes deux sœurs ont revêtu l’une et l’autre la robe de l’infirmière. Ma chère fille, Marie-Rose, ma nièce Alice, entrent comme assistantes dans des hôpitaux normands que leur tante administre en qualité de Présidente de l’Union des Femmes de France. Moi je suis accrédité auprès du Ministre de la Guerre. J’ai charge de recueillir à son cabinet et puis de commenter, ces nouvelles que, chaque jour, le Grand Quartier Général, assisté du Gouvernement, met au point vers minuit. À l’heure tardive où je viens chercher cette manne qui, demain, nourrira les cœurs d’espoir ou d’inquiétude, la porte du ministère est gardée comme un accès de forteresse » (pages 25 et 26). Il fait après-guerre une carrière politique, conseiller général puis sénateur (1920). Il meurt à son domicile, 58 rue de Vaugirard à Paris, le 14 novembre 1925. Au Champ d’honneur évoque la vie et la mort du dernier fils qui lui reste, Robert Charles Henri, né le 15 août 1887 à Sèvres, en Seine-et-Oise. Licencié es-sciences, il a fait des études d’ingénieur-chimiste dans une école du Luxembourg. Il parle plusieurs langues, ayant voyagé en Allemagne, où il passe une année, et en Angleterre. Peu avant la déclaration de guerre, il se fiance avec Hélène Aigner, jeune artiste-peintre, née en 1891, membre du Salon des artistes français depuis 1912, puis rejoint son corps à la mobilisation. Il dirige une section de la 19ème compagnie du 356ème R.I. de Toul, partie de la 145ème Brigade de la 73ème division du XXème Corps. L’ouvrage ne mentionne aucun toponyme précis mais le JMO précise les conditions des combats de Lironville, dans lesquels il est gravement blessé et un temps laissé paralysé sur le terrain avant d’être enfin relevé et envoyé à l’hôpital de Toul. Il meurt finalement le 18 octobre 1914.
Commentaire sur l’ouvrage :
L’ouvrage, composite, d’Hugues Le Roux, débute par une série de tableaux dont le premier se situe le 1er août 1914 à Paris. Le père indique la mobilisation de Robert, comme sous-lieutenant, en partance pour l’Est (Toul), puis son départ, dès le 2. Il s’adresse alors à lui, narre ses activités liées à l’écriture des communiqués pour son journal, avant de recevoir l’annonce des premiers morts de son entourage, qu’il cache à son fils, déjà au combat. A partir du 21 septembre (page 49) ; il publie des « fragments » de lettres échangés entre les deux promis, entre le 2 août et le 20 septembre 1914 (page 79). C’est dans cette partie de l’ouvrage que se trouvent des éléments utiles à l’étude du témoignage de Charles Le Roux. Sur sa mobilisation, et avant même son premier engagement, il fait ré-aiguiser son sabre mais dit « mes bonshommes sont ma meilleure arme » (page 57). Mobilisé dans un régiment de réserve, il dit : « Ne croyez pas qu’on nous juge inutilisables. Nous sommes prêts. On nous garde pour nous porter au point où nous serons le plus utiles quand aura lieu ce choc dans lequel nous vaincrons… » (page 58). Il tient au comportement irréprochable de ses hommes, réprime le pillage ou le simple vol, et dit : « Je suis très sévère sur ce point-là. Je veux qu’ils se comportent poliment » (page 62), (il y revient page 74, au grand étonnement même de propriétaires lorrains de fruits). Volontaire et patriote, il puise sa force dans l’amour de la Patrie et de sa fiancée ; le 30 août, il déclare : « Je me donnerai corps et âme pour mon pays et pour vous ; vous ne faites qu’un dans mon cœur. Mais lorsque j’aurai fait tout ce que je dois, je tâcherai de revenir » (page 67). Il avance même le 17 septembre, à l’endroit de l’ennemi : « Mais pour les rosser il va falloir les rattraper chez eux » (77). Ce avant qu’Hugues Le Roux reçoive lui-même la lettre terrible dans laquelle son fils annonce sa blessure. Il dit « Mon cher papa, j’ai : 1° le bras traversé, et ce n’est rien, 2° la poitrine traversée de droite à gauche, avec plaie à la moelle : c’est plus ennuyeux, car cela paralyse mes jambes… » (page 81). Dès lors, Hugues Le Roux, grâce à ses contacts avec les ministères, parvient à obtenir rapidement du Gouverneur de Paris, Joseph Galliéni en personne, l’autorisation de se rendre à Toul au chevet de son fils. Il le trouve gravement blessé mais ayant pleine conscience. Il recueille alors les circonstances dans lesquelles il a été blessé (sans toutefois en donner les précisions toponymiques). Hélène et sa mère le rejoignent pour voir une dernière fois le mourant, que le père assiste jusqu’à son dernier souffle, le 18 octobre, à 3 heures du matin. Ayant acheté un cercueil, il inhume son fils dans le cimetière de la ville puis rentre à Paris, dès le 20 octobre, devant une ultime réflexion sur la belle terre de France qui défile devant lui sur le chemin de son retour. Ayant perdu le dernier de ses fils, et donc sans descendance, l’ouvrage s’achève sur un éditorial et un projet de Loi, en juillet 1916, visant à faire perdurer le nom des morts dont la lignée s’éteint avec le dernier fils. Robert Le Roux fera, sur son lit de mort, ce constat désabusé : « Ma guerre, çà été une demi-heure et trois cents mètres » (page 158). Au final, l’ouvrage apparaît globalement double, ayant l’apparence d’un témoignage, composite car contenant des lettres échangées ou reçues, s’étalant du 1er août au 20 octobre 1914, mais qui en fait forme une biographie militaire sommaire et un recueil daté de réflexions, souvent poignantes, d’un père orphelin de ses fils. L’ouvrage rappelle, dans la démarche mémorielle, celui de Roger Allier, enquêtant sur la mort de son fils dans les Vosges, à Saint-Dié, à l’été 1914. Au Champ d’honneur, publié en 1916, est en fait le premier volet d’un diptyque à croiser avec le livre Te souviens-tu…, publié aux mêmes éditions quatre ans plus tard, deux ans plus tôt (1920). Ce second volume, prolongeant l’hommage à son fils, est quant à lui un livre de réflexion psychologique faisant état de ses voyages, multiples, autour du monde, entre novembre 1914 et la signature du traité de Versailles en juin 1919. Leur relation, localisée et datée, est prétexte à se souvenir de son fils et à penser qu’il l’accompagne dans chacune de ses stations. Il est en effet mandé, tout au long de la guerre, de parcourir les pays soit pour exercer une mission péri-diplomatique, soit pour faire acte de propagandisme, soit pour recueillir des fonds ; notamment pour la Croix Rouge, aux Etats-Unis. Il annonce avoir recueilli 10 millions de dollars dans cette action. Il dit, au Japon, en septembre 1915 : « On m’envoie ici, mon Enfant, pour que je m’efforce à lire dans l’âme indéchiffrable de nos Alliés, à deviner jusqu’où il leur plaira de collaborer avec nous » (page 100). C’est parfois l’occasion d’en décrire, par des tableaux simples, ambiance et caractéristiques, parfois anthropologiques. Il revient sur la mort de son fils et sur ce qui survient dans les 5 années qui suivent. Par exemple il dit recevoir, en mars 1916, un diplôme de chancellerie attestant de la blessure à mort de son fils dans les combats de Lironville (page 142) puis un autre, en 1918 ; en hommage de la Nation, dont il fait une poignante et sobre description (pages 237 à 242). Après son tour du monde, il effectue un court pèlerinage sur les terres lorraines, en 1916, parcourant les « Pays-de-Sans-Femmes » (page 150). Il visite un fort, monte en avion avec « Pivolo », surnom de l’as Georges Pelletier-Doisy (page 215), espérant avoir tué à la mitrailleuse des boches pris pour cible depuis le ciel. Aussi, la fin de son récit itinérant bascule parfois dans le bourrage de crâne et l’invraisemblance des témoignages par procuration. Mais de belles lignes psychologiques d’un père qui ne se remet pas de la mort de son fils peuvent être toutefois relevées.
Renseignements tirés de l’ouvrage Au Champ d’honneur :
Page 15 : Vue de la mobilisation à Paris
45 : « À cette heure, toutes lumières éteintes ou voilées, la lune triomphante fait de Paris un grand mausolée »
65 : Description de la chambre d’une enfant lorraine, concluant « … ce qui fait l’âme de Jeanne d’Arc… »
68 : Comment il fait matriculer ses effets et complète (p. 75) « …le propre de la guerre est de modifier les uniformes »
77 : Wigwam = tipi
: Pain grillé à la pointe de la baïonnette
103 : Sur les blessés graves : « Ils savent encore qu’ils vivent, parce qu’ils souffrent »
153 : Vue poignante de l’intérieur d’un ambulance
204 : L’autorité militaire de Toul autorise l’ouverture de magasins pendant quelques heures
205 : Fait un oreiller mortuaire en cousant deux mouchoirs bourrés de coton
212 : Cité à l’ordre de l’armée
254 : Colonel Dehay, commandant le 356ème R.I., décousant les rubans de ses croix pour les donner à Hugues Le Roux
272 : « On voit sur le pommeau [de son épée] de petites éraflures en cercle. C’est la marque des dents de sa fiancée. À Paris, au moment du départ, il lui a demandé de mordre dans cet acier. Elle y a laissé une trace que ses lèvres à lui ont effleurée bien des fois »
Renseignements tirés de l’ouvrage Te souviens-tu :
Parcours suivi dans l’ouvrage :
1915 : Dans l’Atlantique – New-York, mars – Harvard, avril – Potomac, mai – Washington, Far West, San Francisco, Océan Pacifique, août – Polynésie, septembre – Yokohama, septembre – Tokyo, octobre – Miyajima, Pékin, novembre – De Pékin à Petrograd, décembre 1915 – janvier 1916.
1916 : Haparanda, février – Paris, mars – Lorraine, Verdun, Montreuil-sur-Mer, avril – Paris, juin
1917 : Somme (à la N69), été – Camp de Mailly, octobre
1918 : A bord de La Lorraine, avril – Washington, West Virginia, mai – Paris, juin à novembre
1919 : Saint-Germain-en-Laye, 23 juin
Page 46 : Evoque en mars 1915 le torpillage du Lusitania (qui aura lieu le 7 mai suivant)
59 : « Et les morts sont bien morts quand nul ne parle d’eux » (Victor Hugo)
105 : Fait dire une messe à Tokyo le 18 octobre 1915
108 : « Si aujourd’hui, je suis venu dans ce temple rendre visite à ta mémoire, c’est que je souffre trop de ne plus te rencontrer nulle part »
128 : Soldat russe crachant par terre sur le passage de l’Impératrice en janvier 1916
132 : Perd des cadeaux dans le naufrage du paquebot Ville-de-la-Ciotat (le 24 décembre 1915)
138 : Il se questionne sur sa foi
142 : Mur-mausolée pour son fils dans son appartement parisien
218 : Nommé « Oncle de la 69 », N69 à l’été 1917
246 : Récolte d’argent jeté dans un drap aux Etats-Unis
277 : Comment il apprend l’Armistice à Paris
284 : Coup de canon Place du Carrousel à Paris pour la signature du 23 juin 1919
Yann Prouillet, 24 août 2025
Testes (-)
TESTES, Vies sacrifiées, Paris, Spès, 1926, 176 pages
Résumé de l’ouvrage :
L’auteur, TESTES, qui pourrait être Marie Le Mière, présente un recueil de biographies, ayant valeur de Livre d’Or, 19 contemporains du fondateur de l’Union Catholique des Malades, au premier semestre de 1914, avec pour point de catalyse le sanatorium de Leysin, en Suisse, spécialisé dans le traitement des tuberculeux. Autant de personnages dont la vie, sacrifiée par la maladie, se sont, en entrant dans l’association, rapprochés de Dieu.
Commentaires sur l’ouvrage :
Très peu d’intérêt dans ces biographies de malades qui se sont, à un moment de leur vie brisée par la maladie, tournés vers la religion dans l’U.C.M. Malgré qu’ils soient contemporains de la Grande Guerre, certains n’ont pour la plupart qu’un lien assez ténu avec « l’expérience de guerre ». Aussi très peu d’éléments peuvent être dégagés à la lecture de cet ouvrage qui fait un lien profond entre l’Histoire de l’Union Catholique des Malades et de ses créateurs ainsi que des sanatoriums, dont celui de Leysin. L’ouvrage donne aussi quelques éléments sur l’association protestante des Coccinelles, fondée par les suissesses Adèle Kamm et Louise Dévenoge en 1909 et dont Louis Peyrot s’inspira. L’ouvrage peut toutefois se révéler intéressant dans le cadre d’une étude de parcours des malades et des empêchés dans la Grande Guerre.
Louis Peyrot (fondateur de l’U.C.M. le 4 mars 1914) est né le 11 janvier 1888 à Néris-les-Bains, près de Montluçon (Allier) d’un père docteur. Il est dans cette commune lorsque la guerre se déclenche et les blessés y affluent rapidement. C’est probablement lors de son service militaire, en octobre 1906, au 121ème qu’il commence à développer sa maladie, il sera à jamais écarté de la Grande Guerre à cause de sa tuberculose, qui lui ôtera finalement la vie en août 1916.
Jean Girardot, fondateur de l’U.C.M., qui semble avoir toujours été malade, dit, la guerre déclarée : « Nous sommes des contemplatifs par force » (page 42) avant de distiller, dans un court extrait de journal de maladie en guerre, ses pensées religieuses, se disant, le 24 février 1917, très heureux d’être malade à la maison entourés des siens. Il meurt le 24 juillet suivant.
Thérèse Mias, rémoise, sœur d’un médecin, tombe malade à l’âge de 22 ans, en juin 1915. Elle aussi fréquente Leysin, foyer religieux qui l’invite à entrer dans les ordres, le Tiers-Ordre de Saint-François, qu’elle intègre en mai 1916.
Charles Rheinart, autre fondateur de l’U.C.M., naît le 25 mai 1873 à Charleville dans les Ardennes. Militaire, malade, il se tourne vers la religion avant de décéder le 18 mai 1914.
Marie Louise Geneviève Marcellot, né en 1891, se destine à la religion dès l’âge de 8 ans en entrant dans une église près d’Eurville, en Haute-Marne. Mais au cours d’un voyage en Angleterre et à Rome, elle tombe malade et la guerre la surprend dans son village, à quelques kilomètres au sud-est de Saint-Dizier. Malgré la menace de l’invasion, elle ne le quitte pas et y installe même une ambulance. Se démultipliant, elle dit : « Sans l’avoir choisie, j’ai la meilleure part », ajoutant : « Ici, on a presque la nostalgie du champ de bataille », se morfondant d’un front si proche mais pour tant si lointain, où elle pourrait rencontrer « le grand souffle » de la guerre et « l’élan vivifiant de la bataille » (pages 74 et 75). Deux années de ce « régime » l’affaiblissent à nouveau, l’obligeant elle-aussi à Leysin. Elle rechute en 1921 avant de mourir le 1er juin 1923, dans sa 32ème année, d’une hémoptysie.
Marie-Thérèse Pinot « fit à 11 ans sa première communion sous l’égide de son oncle, l’abbé de Cabanous, curé de Saint-Thomas d’Aquin » (page 84). Elle perd ses parents très tôt et rêve d’embrasser une carrière médicale pour se consacrer aux pauvres. Un de ses frères combat en Argonne, dont elle s’occupe lorsqu’il est évacué pour pieds gelés. Malade, elle rechute en octobre 1915. Elle décède à Boulogne-sur-Seine le 16 janvier 1916.
Madeleine Vernhett, qui a habité Nîmes et Genolhac, dans le Gard, semble mourir en 1919.
Anaïck Petit de la Villéon, appelée familièrement Yeddy, a 14 ans quand elle entre à l’U.C.M. Ayant passé la quasi-totalité de sa vie malade et alitée, elle meurt le 19 mai 1920.
L’abbé Louis Delcroix, qui souffre étant enfant d’Hémoptysie, fait le Grand Séminaire à Lille. Habitant la Belgique lorsque la guerre se déclenche, il raconte en quelques phrases l’arrivée des Allemands à Lille le 4 septembre 1914, échappant de justesse à l’occupation et au bombardement, contrairement à ses deux sœurs, restées dans la ville. Il meurt le 8 mai 1918 au Dorat, en Haute-Vienne.
Albert Lapied, né en 1903, est issu d’une famille d’artisans parisiens de 8 enfants. Son père est imprimeur, l’un de ses frères sera typographe, un autre lithographe. Il perd sa mère en août 1919 et est quant à lui gravement malade, passe de sanatoriums en sanatoriums. Il meurt paisiblement à Paris.
Florence Peyrard est la 15ème de 17 enfants. Née dans une famille pauvre, elle travaille dès l’âge de treize ans dans une des deux usines Sainte-Julie et Sainte-Marthe de tissage de soieries à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. Elle y subit les grèves de 1917 qui lui font perdre son emploi. Elle a 17 ans lorsque ses parents la placent comme domestique à Lyon, puis à Paris, mais elle y attrape la tuberculose. Elle décède en mars 1921.
Mme Philippe habite à Solal, petite commune de Suisse où elle est paysanne. Elle épouse un français qui est mobilisé dès le 3 août alors qu’elle est enceinte d’une petite fille qui naît le 21 septembre 1914. Son mari, cité à l’ordre du jour et déjà croix de guerre, vient en permission à Soral le 3 août 1915, faisant connaissance enfin avec son enfant. Elle ressent les premiers symptômes de sa maladie le 14 septembre suivant. Elle donne à sa fille une petite sœur le 15 juillet 1916. Mais, son état s’aggravant, elle doit elle-aussi intégrer le sanatorium de Leysin et le 2 novembre 1918, elle s’éteint quelques jours avant l’Armistice et le retour de son mari.
Alors qu’il est admissible aux examens de l’école Polytechnique en juin 1910, Louis Teisserenc doit partir pour Leysin, qu’il quitte en 1913 pour entrer à Combo-les-Bains. Il retourne enfin dans sa famille à Lodève en mai 1914 mais finit par s’éteindre le 13 juillet 1915.
L’ouvrage cite encore Anne-Marie de Germiny, dont le frère aîné meut meurt au champ d’honneur, Mme Fagneux, dont le mari et les quatre frères sont au front, Marthe Hortet, Marguerite Ducrest, Georgette Francey, Suzanne Legoux, de Mantes, tombant malade en quêtant pour les orphelins de 1915. Suivent encore Pierre Colin et Pierre Vallot, « qui connurent tous deux la douleur d’être retenus par la maladie loin des champs de gloire, aux jours de la Grande Guerre » (page 157) aux sanas de Durtol, Cambo, Montana ou Leysin.
Henriette Ferté naît quant à elle le 17 juillet 1892 à Acy, près de Soissons, dans l’Aisne, dans une vielle famille de propriétaires terriens. Elle perd son père à l’âge de trois ans et demi et se destine à entrer chez les petites Sœurs de l’Assomption, le 15 octobre 1913. Mais la maladie l’en empêche et, moins d’un an plus tard, elle fuit devant l’invasion allemande, pour s’arrêter dans le Limousin. Elle revient à Acy, où les tranchées de seconde ligne commencent derrière la ferme. Son état s’aggrave en février 1916 et elle entre à Leysin en juillet suivant. Le 27 mai 1918, la famille Ferté doit à nouveau fuir devant l’avancée allemande, exode organisé par Victor, le frère aîné d’Henriette, pour échouer comme réfugiée au château d’Arthé, dans l’Yonne. Son frère tente à plusieurs reprises de rentrer en pleine bataille : « Il a vu les ruines plus nombreuses qu’au premier voyage, écrit-elle le 30 août, et n’a pu demeurer même 24 heures, étant repéré par avion ou enveloppé de ces gaz odieux… La maison tenait toujours, et le jardin, transformé en forêt vierge, embaumait. Un silence désertique sur le village. Pas une âme alentour. Et, seule, la voix du canon pour scander les heures. Les Barbares ont pris nos vieilles cloches, fidèles amies de toujours, qui avaient tant sonné pour nos joies et nos deuils » (page 170). Elle quitte toutefois le manoir d’Arthé le 1er octobre pour renter dans une maison restée miraculeusement debout malgré une guerre si proche, et où elle va vivre les « jours exaltants de la victoire » (page 170). La vie d’après-guerre reprend et Henriette s’installe à Soissons le 13 août 1919. Mais la maladie trouve son chemin et elle finit par s’éteindre le 21 octobre 1920 à midi.
Sur l’U.C.M., la lecture de cet ouvrage peut être complétée par celle de L’apostolat d’un malade : Louis Peyrot et l’Union catholique de malades / Jean-Paul Belin | Gallica
Yann Prouillet, 29 juillet 2025
Gaston, Gras (1896-1961)
Résumé de l’ouvrage :
Douaumont, 24 octobre 1916, Frémont (Verdun), 1929, 159 p.
Gaston Gras, classe 1916, jeune sergent, commandant une escouade de la 4e section de la 3e compagnie du 4e bataillon du régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM) se souvient, à Toulon, le 3 mars 1928, de l’attaque et de la reprise du fort de Douaumont, le 24 octobre 1916. Son récit de deux semaines haletantes débute à Stainville, le 20 octobre, relate la montée en ligne, la capture du fort, l’état dans lequel il se trouve, reconquis aux Allemands, sa réorganisation, la relève, épique et mortifère, le repos à Verdun et son retour à Stainville, le 3 novembre, auréolé de victoire.
Eléments biographiques :
Gaston, Marius, Joseph, Antoine Gras naît le 28 février 1896 à Toulon (83) de Victor, François, Pierre, Gras et de Marie, Gabrielle, Joséphine, Françoise Funel. Il est marié à Germaine, Paula, Adèle Bergondy et, après la guerre, fait une brillante carrière d’avocat, terminant bâtonnier. Il s’éteint étonnamment à l’opéra de Toulon le 7 janvier 1961. Son épouse décède quant à elle le 26 juin 1975 à l’âge de 75 ans.
Commentaires sur l’ouvrage :
Gaston Gras ouvre son ouvrage sur ces mots : « Ces pages, écrites voici près de trente ans, parues pour la première fois en 1929. (…) j’ai pensé que ces souvenirs – ce témoignage de bonne foi – ne seraient point inopportuns ». L’ouvrage s’ouvre également ensuite sur le RICM, premier Régiment du Monde, qui écrit la page de gloire qui suit, également rappelé dans la préface du lieutenant-colonel, alors capitaine, Dorey.
C’est à Stainville, le 20 octobre 1916, que Gaston Gras, à la tête de sa section, monte dans les camions qui, par Bar-le-Duc, le déposent à la Citadelle de Verdun. Par le Faubourg Pavé, il monte en ligne, sur le Bled. Suivent les pages épiques de l’attaque du Fort de Douaumont, son description après sa reprise à l’ennemi qui l’a occupé depuis le 25 février, et son organisation pour sa conservation. Quelques jours plus tard, l’ordre de relève, la tâche accomplie, arrive ; c’est le retour à Verdun dans une marche vers l’arrière épique et mortifère. Il revient à Verdun, qu’il décrit, au tout début de novembre avant de revenir, en camion, à Stainville, pour que le régiment y reçoive, des mains du Président de la République, la Légion d’Honneur. L’ouvrage se décompose donc ainsi en épisodes : Montée en ligne, en avant !, le Fort, après la conquête, retour… et Stainville encore. Ces deux semaines homériques sont précisément décrites, à quelques rares exceptions, les noms sont indiqués dans un style quasi journalistique, fourmillant de tableaux vivants et de données utiles. L’ouvrage est bien entendu teinté d’hommage, voire un hymne au RICM qui a payé un lourd tribu (rappelé page 19) pour cette reprise au retentissement mondial.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 15 : Peinture des camions
16 : Parachute de fusée utilisé comme foulard
19 : Pertes et captures du RICM à la guerre
20 : Légende des gendarmes pendus à Verdun à des crocs de bouchers
21 : Comment on prononce shrapnels
29 : Caresse hideuse de la boue, son bruit
: Eau sortant de la tranchée dans le champ de bataille de Verdun au « goût indécis de terre grasse et de poudre délayée, de sang peut-être »
: Horreur d’un soulier 28/4 dépassant dans la tranchée
32 : Odeur d’une cagna
42 : Nuit d’avant-combat
43 : Sur les Sénégalais « ce sont des électeurs, mais on voit sur leur poignet, à moitié caché sous les manches, des courroies de cuir brun ; leurs gri-gri, qu’ils serrent fanatiquement »
Martiniquais et le froid
44 : Eclat d’obus terminant sa course dans sa capote (vap 48)
: Humour, bravade factice à la mort imminente
: Belles phrases que quelques minutes avant l’assaut, finalement libératoire
45 : Calepin réclame de Pétrole-Hahn, bloc-note de coopé
48 : Touché par une balle sans force
: Horreur
50 : Service de récupération et délai de retours des sacs
51 : « Cigares gros comme des Zeppelins »
: Prisonniers allemands heureux
55 : Calicots blancs pour signaler la présence aux avions
: Annonce de la prise de Douaumont (vap 58 comment)
57 : Fusées et signalisation
62 : Rôle et difficulté des nettoyeurs
66 : Sur la légende du drapeau, de la prise par le 321
67 : Sergent Belton Chabrol, « flic » à Paris, décisif dans la prise du fort
68 : Problème de l’aiguille de la boussole déviée par le fer du casque et l’acier du révolver
69 : Compagnie 19/2 du Génie, nettoyeuse du fort
: Sergent Salles, un des premiers à pénétrer dans le fort, qui capture le capitaine allemand Prollius, commandant le fort
: Surprise allemande
71 : Etat des allemands : « Ce sont de pauvres loques humaines, qui ont faim, qui ont froid, qui ont peur, et qui portent dans ls portefeuilles grossiers qu’ils nous tendent des photographies de femmes ou d’enfants, comme on aurait trouvé dans nos portefeuilles de faux cuir. Alors je comprends que la Victoire, ce n’est guère que de la Pitié »
72 : Singe en boîte rouge
75 : Pour Dessendié, « on est embusqué toutes les fois qu’on, est pas « à portée de grenade des Boches » »
77 : « Nous avons bu ce soir-là pour la première fois, de cette eau bourbeuse qui stagnait dans les trous de 105 ou de 210. Un affreux relent de terre pourrie, de fumier humain régnait dans nos bouches, mais il fallait calmer la fièvre » (vap 99)
81 : Bilan de la prise de Douaumont : 200 prisonniers et le commandant, pertes : 2 morts et une douzaine de blessés légers
85 : Odeur de l’ennemi, « odeur de rat mouillé qui le caractérise à notre odorat – cette odeur que nous devions exhaler aussi bien que lui après cinq ou six jours de négligence corporelle »
: « Mais Fritz avait le génie de l’installation » et explication
86 : La Chipotte et Charleroi citées comme des lieux de combats de 1914
91 : Couleurs des cartouches des pistolets lance-fusée de signalisation
: Description du contenu de la musette, trophées : bidon allemand et une patte d’épaule
92 : Gros homme surnommé « Crapouillot »
96 : Pêche à la grenade dans la Meuse, qui a détruit une passerelle
: Ode à la toile de tente : « La toile de tente, c’était notre maison volante, c’était notre édredon nocturne, et ce pouvait être aussi notre linceul éternel »
103 : Ravitaillement dans les sacs allemands : « A la guerre on boit ce qu’on peut »
114 : Fiche rouge d’évacuation
: Homme blessé alors qu’il urinait
117 : Boue s’insinuant partout, jusque dans les parties intimes
121 : Sur la miction au front
122 : Lecture du journal au garde à vous
123 : Sa tentative de réveiller deux hommes morts le fait analyser la mort des hommes
132 : Horreur d’un coup direct sur un homme projeté par l’explosion
141 : Son aspect après la bataille
142 : Roulante surnommée le « torpilleur »
143 : Liste des survivants de sa compagnie (vap 148, 100/800 au début de la bataille)
: Photo grotesque de soldats déguisés à Verdun dans l’Illustration
: Vue de Verdun fin octobre 1916
146 : Le sommeil « c’est une sorte de mort accablée qui vous absorbe entièrement »
147 : Coupe sa capote à cause de la boue
155 : Effets changés et hommes tondus
156 : Revue et décoration du RICM par Poincaré, Nivelle, Mangin, Guyot de Salins, colonel Régnier
159 : Assassinat par un officier allemand prisonnier du commandant Nicolay
Yann Prouillet,15 avril 2025
Dromart, Marie-Louise (1880-1937)
Le chemin du Calvaire, Paris, La Maison Française d’Art et d’Edition, 1920, 167 p.
Résumé de l’ouvrage :
Marie-Louise Dromart demeure à Haybes, petite commune aux confins des Ardennes, à l’entrée de la pointe de Givet, en bordure de La Meuse. En 1914, elle est vice-présidente du Comité des Dames Françaises de la Croix-Rouge de Fumay, Haybes et Revin. A ce titre, elle témoigne des terribles journées d’août, à partir du 16, qui voient l’invasion de son village par les troupes allemandes. Après quelques jours d’exode des habitants des localités voisines auxquels sont mêlés des ressortissants belges, qui témoignent d’exactions, résolue, elle dit : « Vice-présidente d’une société locale de la Croix-Rouge, j’avais assumé la tâche rigoureuse et difficile de tenir tête à l’orage et, si je ne songeai pas un seul instant à déserter mon poste, je jugeai que mon premier devoir était d’écarter ma mère et mes deux enfants du péril imminent » (p. 3). Hélas, le 24, alors qu’elle s’apprête à traverser le fleuve avec sa famille, son fils et son père, « les Hussards de la Mort (du 19e) arrivaient comme une trombe » (p. 3), notamment « sur le Chemin du Calvaire, tristement symbolique, et ainsi nommé parce qu’un beau Christ de pierre le domine et le protège de toute sa détresse miséricordieuse » (p.11) qui donne son titre à son livre testimonial. Dans la tourmente, elle perd un temps sa fille et sa mère, séparée d’elles par la guerre. Devant cette détresse qui la dépasse, elle dit : « Je glissai dans ma poche deux paquets de sublimé, bien décidée à partager le poison avec les miens si les choses tournaient au pire » (p. 17), envisageant ainsi d’assassiner sa famille. Rassérénée, elle va dès lors se démultiplier pour tenter d’influer, en pleins combats, sur l’attitude des allemands qui vont multiplier les répressions et les exactions envers la population. Elle relate par le détail tant son action devant les troupes, et notamment les officiers, qu’en tant qu’infirmière, au château de Moraypré, tout en tentant d’éviter que sa propre famille ne subisse le même sort que son village, centre de combats de résistance, et où les destructions s’accumulent. Se démultipliant, également comme interlocutrice, voire médiatrice, elle assiste au simulacre d’un procès et rapporte (elle n’en n’est pas le témoin direct) celui d’une Cour martiale à l’encontre d’un des prêtres du village. Début septembre, elle constate son village en ruines, qui s’est résolument enfoncé dans l’occupation, la guerre ayant poursuivi son chemin vers le sud. Mais il faut gérer les blessés. Omnipotente, elle organise l’évacuation de ceux de l’hôpital de fortune qu’elle avait créé avec l’instituteur local vers l’hôpital de Fumay, commune limitrophe au sud, par-delà la rivière. Elle dit pour cela bénéficier de l’aide du docteur Mangin, lorrain de Château-Salins, manifestement francophile et francophone (p. 91). La suite de son récit est une succession de tableaux, le plus souvent issus de faits rapportés. Elle dit parfois : « Je n’ai pas vu l’autre scène, celle que je vais rapporter, mais elle me fut contée par des témoins avec une telle minutie de détails impressionnants que j’en ai gardé la macabre obsession » (p. 114), ce qui minore la matérialité testimoniale de ses récits. Ainsi, la description de la mort christique d’un soldat dans un ambulance n’amène pas à la nomination de ce soldat. Elle dit enfin « être rapatriée après un internement de six longs mois en pays occupé » (p. 129), donnant un ouvrage composite construit entre Haybes (le 24 août 1914) et La Guerche (Indre-et-Loire) (le 24 août 1916). L’ouvrage s’achève sur des appendices rapportant les atrocités à Haybes, issu du rapport Bédier (p. 158 à 165), et sa citation pour son attitude courageuse dans les tragiques journées d’août 1914.
Commentaires sur l’ouvrage :
Marie-Louise Grès, épouse Dromart, née à Haybes le 29 juillet 1880, est connue comme poétesse [elle obtient en 1924 le prix Archon-Despérouses puis le prix de l’académie des jeux floraux de Toulouse en 1931]. Son père, Pierre Lambert Édeze Grès, évoqué dans l’ouvrage, est fabricant de pavés en ardoise et sa mère est Adèle Maria Sulin. Marie-Louise Grès est le second enfant du couple qui aura 4 filles. Elle évoque d’ailleurs l’une de ses sœurs, Louise, morte à 20 ans (page 17). Après des études secondaires à Charleville-Mézières, elle se destine au métier d’infirmière. Elle se marie à 19 ans avec François Joseph Dominique Dromart, directeur d’usine. Elle aura une fille (née en 1900) et un garçon (né en 1903), tous deux également cités dans le livre, notamment dans leur tentative avortée de fuite devant l’invasion (p. 19). Elle se fait une place dans la littérature, obtenant quelques critiques encourageantes, notamment de Georges Duhamel, dès avant la Grande Guerre, ce en publiant un premier livre de poésie dès 1912. Elle témoigne également dans un livre recueillant la parole de femmes parisiennes, en compagnie par exemple de Mme Alphonse Daudet ou la duchesse d’Uzès, collectés par Camille Clermont, actrice et autrice. Après la guerre qu’elle a passé réfugiée dans la capitale ou le centre de la France, elle revient à Haybes en 1919, y fait partie des notables (elle narre ainsi succinctement la réception du président Poincaré à Haybes le 1er décembre 1919) (p. 156) et son action au cours des journées terribles d’août 1914 lui valent deux citations à l’Ordre de la Nation, la médaille de la Reconnaissance française et la Légion d’Honneur. Elle meurt à Paris le 23 octobre 1937. Son témoignage, dense et haletant, est issu de son expérience directe sur la période allant du 16 août à octobre 1914 soit un peu plus de la moitié de l’ouvrage. Son style, pétri de patriotisme et d’emphase, mêlant devoir et religion, est un modèle de la littérature emphatique et martyrologe. Elle y multiplie ce style à l’envi : « La voilà bien l’exaltation patriotique des martyrs et des héros qui seront morts sans gloire, mais qui donneront aux siècles futurs la mesure du délire sacré dont notre époque aura frémi » (p. 93) ou un peu plus loin : « De ces riens s’exhale le parfum de la délicatesse française, fleur vivace de la chevalerie et de la loyauté » (p. 95). Son sujet reste toutefois l’histoire du village de Haybes. Dès lors, ce style, ses envolées lyriques (lire à ce sujet le 2ème paragraphe, héroïco-mystique, de la page 116), destinées au lecteur à laquelle elle s’adresse (p. 110) et une certaine centralité omnipotente du personnage dans les faits qui se sont déroulés des 24 au 26 août éludés, l’ouvrage reste référentiel pour l’historiographie de la pointe de Givet et pour les secteurs d’Haybes, de Fumey et de la frontière avec les Ardennes belges. Le livre concourt bien entendu à la littérature martyrologe, mettant en avant les exactions allemandes, la pratique des otages, des boucliers humains, les balles explosives, jusqu’au viol, supposé toutefois (celui de Julie Dévosse p. 94). L’ouvrage s’ouvre en effet sur les 11 soldats tombés au champ d’honneur à la bataille d’Haybes, et sur quatre soldats tombés en formations sanitaires à Haybes (Ambulance de Moraypré) ou Fumay. Toutefois la vérification ponctuelle de quelques patronymes (par exemple Jean-Baptiste Urbain) ne confirme pas toujours les lieux et dates de décès sur les simples noms avancés par Marie-Louise Dromart et invite donc à la prudence et à une vérification plus poussée. Le cas de Jean Marie Ternynck, sous-lieutenant au 245e RI, décédé des suites de ses blessures le 13 septembre (p. 97) et dont elle témoigne de l’enterrement par l’ennemi est par contre conforme à la réalité.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
P. 2 : Enfants endimanchés pour l’exode : « on sauvait ce que l’on avait de mieux »
17 : Songe à suicider et à empoisonner sa famille
23 : Cadavre brûlé
30 : A perdu puis retrouvé sa mère et sa fille
33 : Evoque un roulement d’otages
35 : Balle explosive
40 : Croix d’ardoise pour un sépulture
75 : Dans les accusations des prêtres : « Vous avez prêché la revanche »
77 : Acte d’accusation et procès des prêtres puis Cour martiale pour l’abbé Hubert
80 : Allégations allemandes (population hostile, oreille coupée, enfant tirant sur les troupes ou mutilant les soldats, etc.), formulées par un général !
81 : Proclamation
84 : Trou du Diable
94 : Viol supposé de Julie Dévosse, figue johannique
: Allemands se ravitaillant sur le stock de nourriture du fort de Charlemont tombé le 29 août
97 : Mort en enterrement avec le respect de l’ennemi du sous-lieutenant Jean Ternynck
100 : Installation dans l’occupation
103 : Entend le canon du front sur la roche de l’Uf à Fumay (100 km du front)
104 : Soldats français toujours derrière les lignes allemandes plusieurs mois après les combats dans les Ardennes (noms cités) (vap 128 à 130 M. Dutil, parisien, prisonnier puis évadé retrouvé à Paris)
106 : Prix des denrées
108 : Tambour de Raffet, version napoléonienne du Debout les morts de Péricard
112 : Tableau surréaliste de la mort christique d’un soldat
133 : Histoire d’un homme fusillé enterré avec la sacoche postale (vap 154)
134 : Pièce d’or donnée comme Talisman d’un père à son fils
141 : Balle retournée (Dum-dum)
155 : Capitaine Evrard, natif de Fumay, aviateur espion qui a atterri à Bourseigne (Belgique) pour faire sauter le pont ferroviaire Saint-Joseph de Fumey
Table des chapitres
Les Boucliers vivants (p. 1) – Mon village en ruines (p. 55) – Devant la Cour Martiale (p. 61) – Les jours qui suivirent (p. 88) – Figures de désespoir (p. 111) – La dernière classe (p. 117) – La rencontre (p. 126) – La pièce d’or du Poilu (p. 131) – Jeanne Craque (p. 136) – Au temps des Cornouillers (p. 142) – Anniversaire (p. 148) – Appendices (p. 153) dont Rapport des atrocités commises à Haybes par les Allemands, du 24 août au 27 août 1914 (p. 158) et Citation parue au Journal Officiel du 24 octobre 1919 (p. 165)
Yann Prouillet, août 2024
Gaudy, Georges (1895-1987)
Résumé de l’ouvrage :
Sur la ligne d’un front indéterminé, un simple sergent anonyme, dans un régiment non désigné, se mue en témoin de la vie et d’épisodes de quelques compagnies, aux personnages pittoresques, dont le soldat Baris, venant des « Joyeux » (soldats issus du 5e bataillon de chasseurs d’Afrique). Celui-ci gagne héroïquement ses galons noirs, les deux ficelles de laine qui marquent maintenant son grade de caporal. Hélas, à la suite d’une bagarre déclenchée dans un débit de boissons, un lieutenant, sur la fausse déclaration d’un soldat, entraîne la cassation du grade de Baris. Ces deux derniers disparaissent ensuite dans les tourbillons d’une attaque qui disloque le petit monde décrit par l’auteur, qui retrouve quelques survivants après la guerre.
Commentaires sur l’ouvrage :
Comme pour Jérôme et Jean Tharaud, c’est Jean-Norton Cru qui, par son enquête sur la véracité du témoignage et le parcours des auteurs des grands ouvrages sur la Grande Guerre, nous donne les éléments biographiques utiles à retracer le parcours militaire de Georges Gaudy, complété par sa fiche wikipédienne (Georges Gaudy – Wikipédia (wikipedia.org)) et dont le « grand œuvre » est un triptyque de souvenirs intitulé « Souvenirs d’un poilu du 57e régiment d’infanterie ». Comme les frères Tharaud, auxquels est dédié ce livre en incipit, Georges Gaudy est né à Saint-Junien, en Haute-Vienne (87), le 18 février 1895, d’un père comptable. Georges Gaudy décède le 9 février 1987 à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Alors qu’il est encore étudiant en langue étrangère, il précède de quelques mois l’appel de sa classe et se porte volontaire. Il intègre alors le 57e RI à partir de septembre 1915, régiment dans lequel il fera toute la guerre. Il arrive au front le 19 février 1916, dans le secteur de Troyon (Aisne) puis fait Verdun (mai 1916) et attaque au Chemin des Dames en 1917. Le 25 mars 1918 il est engagé vers Noyon et participe au mois d’avril suivant à la défense du Mont-Renaud (Oise), en avant de Ribécourt. Il est nommé caporal en mai 1916 puis sergent en avril 1918, est blessé plusieurs fois, cité deux fois à l’ordre du régiment, bénéficiant d’excellentes notations. En février 1919, il est promu aspirant avant d’être démobilisé en septembre. Il sera plusieurs fois décoré. Il n’est donc pas étonnant de trouver ces trois grades dans cet ouvrage ; le narrateur anonyme qui se présente dès la première phrase est sergent (p. 7) ; le soldat Baris, dont le parcours donne le titre à cet ouvrage, est caporal (p. 90) et le dernier chapitre trouve le narrateur à Saint-Cyr, préparant le grade d’aspirant (p. 211). L’autre emprunt à l’œuvre des frères Tharaud vient de la construction de l’ouvrage, similaire dans sa composition à « Une relève », Tharaud, Jérôme (1874-1953) et Tharaud, Jean (1877-1952) – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org), suite de tableaux de courtes durées sur la période de la Grande Guerre. Toutefois, ces « Galons Noirs » n’en sont qu’une pâle copie sans réel intérêt de ce qui semble en effet basé sur les propres souvenirs de l’auteur, le livre étant écrit après 1925, et le parcours militaire de Gaudy. Aussi peu d’éléments sont à tirer de cet ouvrage imprécis, à l’apparence d’une pièce de théâtre, introduisant des tableaux mais traités de manière incomplète (le vol, la bagarre, l’attaque, la considération sur le soldat, le meurtre même) qui sont traités de manière incomplète et stylistiquement maladroite. De même, la vision d’une armée brutale (le premier chapitre est par exemple fortement teinté d’une frénésie de militarisme casernier) et martyrisante teinte le livre d’une couleur gauchement pacifiste. Dans Les galons noirs, Gaudy n’atteint donc pas la qualité des souvenirs composites qu’il a pu produire dans son œuvre précédente.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 46 : Sur la guerre révélant l’homme : « Dix jours de bataille dénudent mieux une âme que trente ans de vie commune dans une province morte »
53 : Sur la difficulté de comprendre la guerre : « Ceux qui n’ont pas vu la nuit descendre sur un champ de bataille ne peuvent me comprendre ».
57 : Hallucination collective du guetteur au créneau nocturne.
88 : Sur le devenir du héros après la guerre : « Dispersé par la paix, nous irions, chacun dans notre voie, poursuivre nos destinées. Les archives du régiment garderaient l’histoire des faits qui nous honorent plus que tout. Mais qui viendrait les feuilleter ? »
95 : Vue sommaire d’un artisan de tranchée
134 : Officier assassinant un soldat trouillard
Yann Prouillet, juin 2024
Tharaud, Jérôme (1874-1953) et Tharaud, Jean (1877-1952)
Une relève, Paris, Plon-Nourrit, 1924, 247 pages.
A l’occasion du déplacement du régiment pour une relève, un caporal dresse une succession de tableaux des paysages et des situations qui défilent sous ses yeux dans le secteur de Reims à une date inconnue de la Grande Guerre. Il s’agit en fait de tableaux littéralisés permettant l’évocation de lieux ou de situations glorifiant les hommes (de toutes nationalités), la Nature et les sentiments. Le premier de ses tableaux évoque la rumeur, les « canards du front » qui font voyager à l’estime, depuis les Flandres, le régiment dons toutes les directions possibles. Le second amène l’unité du narrateur sur « les pentes longuement inclinées de la montagne de Reims », à Verzenay, d’où « de ce haut belvédère, [il] regarde Reims qui brûle ». Relevant une brigade russe, il en profite dans son troisième tableau pour décrire quelque peu le « contraste entre deux humanités », dont « le grand troupeau moscovite » mêlant « mine enfantine et brutale à la fois ». Ce rapprochant de la première ligne, « derrière la berge d’un canal », la, description du paysage, martyrisé mais tranquille, même si « sans héroïsme » permet la réflexion et la contemplation de la nature et de sa faune abandonnée. La tranchée se conjugue avec « l’idée d’une menace prochaine [qui] agit sur l’âme un peu à la façon dont l’exalte l’amour (…) ; tout émeut à l’excès ». C’est le règne de l’obus qui pulvérise tout, homme comme village ». Le sixième tableau débute ainsi : « Ce soir, nous prenons la tranchée », un boyau qui mène à un « poste où [il] tombe ce soir est installé dans les sous-sols d’une ancienne ferme modèle », une cave qui mêle sépulcre et nid protecteur à ces quatre occupants qui doivent tenir le lieu et renseigner le commandement par le seul lien qui les relie au monde de l’extérieur, le téléphone. « Une prison sans portes sans verrous, sans barrières, mais plus strictement enfermés par les consignes idéales que par la plus rigide clôture, et vraiment séparés du monde par ces lignes de fer barbelé, ces hautes herbes non fauchées et l’inextricable dédale des boyaux et des tranchées ». Ce milieu particulier confine à l’introspection et à l’analyse du soi. Ce téléphone et le personnage du septième tableau, qui permet de décrire le rôle comme la vie de l’escouade désœuvrée, son rôle météorologique et tout compte-rendu insignifiant réalisé. Dès lors, « pour échapper à l’ennui, on se réfugie dans le sommeil ou bien dans la lecture, comme on monte dans un arbre pour fuir une inondation » ou « on écrit une lettre ; on attend celle qui se promène sur les routes », prétexte à s’épancher sur ce seul lien avec l’être aimé comme avec l’humanité. Mais « ce téléphone sans vie, que nous veillons comme un mort et qui n’annonce jamais rien » annonce un jour un jour « le Kaiser a démissionné ! », « folle invention » qui jette un émoi diviseur (d’une demi-heure seulement toutefois), au sein du petit groupe humain, « braves gens de chez nous ! honnête peuple de France ! » le 8ème tableau revient sur les compagnons de tombeau qui se catalyse autour du Capitaine Fracasse, prétextes aux bavardages dont le caporal se plaint finalement, y préférant un silence finalement la denrée la plus rare au front. Le neuvième tableau souligne le contraste entre la vie souterraine, « où chacun est emprisonné dans la terre » et l’extérieur, où existe encore fleurs et oiseaux dans le « miracle de la lumière ». Le 10e tableau est celui du calme quasi-mortuaire déchiré tout à coup par l’obus qui trouve son chemin vers le téléphone dont il ne parvient pas à briser la boîte toutefois et qui finalement ne change rien à la « platitude ordinaire » de la morne existence. Le 11e chapitre fait état du résultat du bombardement, qui laisse derrière lui poussière et gravats de ce que furent maisons, église et village. Le dernier chapitre finit en parabole. Le caporal quitte enfin cave et boyau ; c’est tout aussi enfin la permission, la maison bruyante et animée de la vie des femmes et des enfants, d’où le caporal écrit, évoquant à mots couverts la mort de Jean, absent de la table et pleuré par les enfants du lieu.
Commentaires sur l’ouvrage :
En fait, c’est Jean Norton Cru qui, par son enquête sur la véracité et le parcours des auteurs, décrypte la matérialité des souvenirs contenus dans les 12 tableaux du caporal Jean. Jérôme Tharaud (18 mars 1874, Saint-Junien (87) – 28 janvier 1953, Varangeville-sur-Mer (76)) et Jean Tharaud (né Pierre Marie Martial Charles, 9 mai 1877, Saint-Junien (87) – 8 avril 1952, Paris) furent bien mobilisés au 94e RIT d’Angoulême (178e brigade de la 89e division territoriale) dès le début d’août 1914. Ils font à plusieurs reprise référence à ces soldats de Charente et du Limousin. Le parcours du 94e RIT les amène bien pendant 6 mois (1914-1915) sur le canal de l’Yser puis sur l’Aisne (jusqu’au 5 mai 1915) puis pour faire des travaux dans les secteurs de Reims et de Fismes de mi-décembre 1915 à mi-février 1916. Du 16 février au 5 mai, le régiment occupe effectivement le secteur entre la ferme des Marquises (nord-est de Prunay) et le Fort de La Pompelle. C’est donc bien ce secteur et ce créneau temporel qui sont décrits dans les 12 chapitres d’Une Relève. On y retrouve également des éléments biographiques factuels contenus dans ces douze tableaux ; le narrateur est caporal téléphoniste, comme Jérôme, et l’autre est vaguemestre (cf. le 7e tableau Le Kaiser a démissionné). Ceci étant dit, il devient clair que les quelques données dégageables de ces quelques semaines décrites permettent de confirmer que le récit est basé sur une expérience de guerre, ce qui confirme par ailleurs le classement de Jean-Norton Cru dans la catégorie Souvenirs. Toutefois, le récit est très fortement littéralisé dans ce parcours, les quelques épisodes décrits dans ce parcours, dont la guerre n’est que le tableau de fond de scène, ne sont finalement que le prétexte à louanges à la nature (on trouve ici des similitudes avec Genevoix ou, dans la démarche stylistique, avec Pierre Jolly dans son 13 octobre Jolly, Pierre – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org)), les hommes ou les lieux, en une introspection sur le caporal dans son escouade dans la guerre. L’ensemble apparaît donc finalement superficiel et outre son style et quelques réflexions intéressantes n’apporte que peu, donnant à Une relève l’identité d’un roman plus que d’un livre de souvenirs. Cette impression est appuyée de surcroît par le dernier chapitre qui, plaçant le caporal en permission chez lui, donne l’impression que seul l’esprit du mort est revenu autour de la table familiale.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 12 : Sur la tranchée : « Les autres, préférant la tranchée, plus périlleuse assurément, mais où la discipline est plus souple et la ration de vin plus forte ».
Définition de la rumeur, semblable au moustique : « Et les fausses rumeurs de s’élever et de danser au-dessus du cantonnement, comme en été les moustiques au-dessus d’un marécage ».
50 : Vue de flamands, anglais, russes
65 : Réflexion sur le patrimoine vernaculaire de la guerre à conserver : « De l’autre côté du canal, en bordure d’un grand bois, on voit encore, clouées contre les peupliers, les niches de chapelle, où chaque soit les artilleurs plaçaient une lanterne pour guider leur tir dans la nuit. Elles sont aujourd’hui inutiles ces petites chapelles désaffectées, mais je pense que, la paix venue, il faudra garder pieusement ces fragiles abris de lumière qui nous ont protégés, comme on conserve dans les rues des vieilles villes, à l’angle de chaque muraille, ou bien dans les forêts, au creux d’un chêne vénérable, ces niches consacrées à la Vierge ou à quelque Saint rustique, longtemps après que la Vierge ou le Saint a délaissé son sanctuaire bocager ».
86 : Hypersensibilité à la Nature.
87 : Sur la protection du vivant confinant à la superstition : « … Je crois, ma parole, que j’aimerais mieux me fouler le pied que de détruire sous mon soulier une misérable fourmi, avec cet espoir inavoué qu’en ménageant une existence, si petit soit-elle, la mienne sera aussi épargnée ». (Vap p. 86 sur « la croyance aux présages »).
145 : Bruit « soyeux » des obus
159 : Sur les carnets et la pratique d’écriture du soldat. (Vap p. 162 sur la force du ressenti par rapport aux carnets de guerre).
174 : « La guerre a pris pour moi l’aspect d’un voyage en troisième classe, que je fais depuis trois ans, vers une destination inconnue ».
184 : Mort d’un pigeon, enterré par un sergent dans le cimetière des soldats
Yann Prouillet, juin 2024
Canoville, Henry (1898-1918)
C’est par hasard que le livre suivant m’est tombé entre les mains : Lettres d’un Bleuet, Henry Canoville, Aspirant d’Artillerie, Une année au front, 4 août 1917 – 29 août 1918, préface de Th. Mainage, O. P., professeur à l’Institut Catholique de Paris, Pierre Téqui, libraire-éditeur, Paris, 1922, XXXVI et 456 pages, 4 photos.
Un livre catholique
O. P. signifie ordinis praedicatorum et désigne un membre de l’ordre des frères prêcheurs (dominicains). Mon exemplaire du livre contient une carte de visite du Père de Condé, prêtre missionnaire de N. D. de Sion. Il a obtenu le nihil obstat et l’imprimatur. L’éditeur présente à la fin du volume un catalogue des auteurs par lui publiés : Mgr Dupanloup, Mgr Gibier, Mgr Tissier, Mgr Méric, chanoine Broussolle, révérend père Hugon, abbé Rimbault, etc. La longue préface (31 pages) du professeur à l’Institut catholique est une hagiographie du jeune soldat qui se destinait à devenir à son tour dominicain : « une âme, et quelle âme ! », « la vie d’un saint ». Un garçon qui savait « s’immoler » : « Tout petit, l’hiver, il promenait ses pieds dans les zones froides de sa couchette » [authentique : page XVII). La fin de la préface doit également être citée : « Les desseins de Dieu sont impénétrables. Mais, surtout, puissent les Français, par leur fidélité aux grâces de la Victoire, ne plus rendre nécessaire l’oblation de ces victimes innocentes qui, généreusement sans doute, mais douloureusement, ont payé de leur vie les déviations de la conscience nationale. »
Th. Mainage pourrait figurer comme témoin (involontaire) dans notre dictionnaire. Mais le vrai témoignage est constitué par les lettres adressées par Henry Canoville à sa famille.
Brève biographie de l’artilleur Canoville
Henry Jean Eugène Canoville est né le 2 octobre 1898 à Nogent-sur-Marne. Un indice dans le livre laisse penser que son père était médecin. La famille était à coup sûr bourgeoise et s’est installée à Cherbourg. Henry a fait sa scolarité au collège Saint-Paul de cette ville et a obtenu le bac en juillet 1916. Il avait trois sœurs dont deux sont devenues religieuses à Paris. Henry voulait entrer chez les dominicains, mais la guerre était là. En décembre 1916 il s’engage dans l’artillerie lourde et arrive sur le front de l’Aisne en août 1917 (110e RAL, canons de 155). Il vit « à sept kilomètres des boches » qu’il traite de canailles. Le séjour se passe principalement en corvées de pansage des chevaux, tâche fastidieuse qu’il n’aime pas.
En février 1918, il part à l’école de Fontainebleau pour devenir aspirant, et se réjouit à l’idée d’y passer quatre mois. De nombreuses courtes permissions sont passées à Paris auprès de ses sœurs. Il obtient le « grade » d’aspirant.
Fin juin, il repart pour le front comme aspirant au 130e RAL doté aussi de canons de 155 qu’il juge « terribles ». Et c’est au cours de cette période qu’il découvre vraiment la guerre : « Oui, j’ai vu aujourd’hui de près la grande détresse de la guerre » (28 juillet). Il décrit les destructions, les cadavres. Il a du mal à s’accoutumer « aux horreurs puantes de la guerre » (29 juillet). C’est la poursuite. À Dormans, le 19 août, il note : « Les murs crevés ont des déchirures toutes neuves ; les cendres semblent encore fumer dans le vent. On sent que toutes ces douleurs sont d’hier. »
Sa dernière lettre est datée du 28 août. Il est tué le lendemain, près d’Epagny.
Choses (bien) vues
Avant de découvrir les horreurs de la guerre, Henry Canoville avait envoyé à ses parents quelques informations, peu originales, mais toujours intéressantes :
– quelques descriptions de cagnas (p. 5, 39, 80, 99)
– le crépitement du « brave petit 75 » (p. 12, petit par rapport au 155)
– les combats aériens (p. 29)
– les rats dégoûtants et les « hideux totos » (p. 41, 45)
– l’arrivée du vaguemestre (p. 130)
– « les efforts crispés des chevaux sur la glace » (p.198)
– un entrainement pour résister aux gaz (p. 344)
– un tir de concentration (p. 397)
Un catholique forcené
Se considérant comme un dominicain avant l’heure, Henry Canoville va à la messe, se confesse, communie, prie, dit le chapelet, distribue des « médailles miraculeuses » (p. 231). Il fréquente de préférence prêtres et séminaristes ; il visite églises et chapelles. Il arbore l’insigne du Sacré-Cœur.
La plupart des lettres à sa famille sont précédées d’une « méditation », d’une « invocation », d’une « oraison ». Il s’adresse au Bon Dieu, au Christ, à l’Enfant-Jésus, à Jésus-Hostie, à Marie et à plusieurs saints. Le 14 décembre 1917, il parle directement au Christ ; le lendemain, il parle au Saint-Esprit : « J’ai dit à l’Esprit-Saint… » (p. 164 et 165). Tout en annonçant qu’il se pliera toujours aux volontés divines, sa pratique ressemble à du donnant-donnant. Les prières doivent être exaucées : « Je demande au Bon Dieu un petit coup de main » pour soulever un obus de 43 kilos (p. 128). « J’appelle à mon aide les saints du Paradis » (p. 197) et ça marche. Sa nomination du brigadier est due à l’intervention de l’Enfant-Jésus (p. 175).
Quelques pas de côté
En lisant attentivement le livre, on découvre cependant quelques contradictions. Le gamin, qui plaçait ses petits pieds à l’endroit le plus froid du lit, apprécie l’envoi de nombreux colis de nourriture ; de retour au régiment après une permission, il écrit : « Où sont donc vos bonnes gâteries ? » Pire, il profite du vol de volailles d’un de ses hommes pour améliorer l’ordinaire, et l’avoue ainsi à ses parents (le 31 décembre 1917) : « Gros cas de conscience ! Qu’auriez-vous fait ? Oui, qu’auriez-vous fait, consciences scrupuleuses… et repues ? »
Il signale (p. 269, 19 février 1918) que des prêtres en soutane se sont fait jeter des pierres par des ouvriers de la région parisienne. Le 12 juillet 1918, Henry rapporte cette phrase d’un téléphoniste : « Comment Dieu permet-il qu’on s’égorge avec tant de joie ? » (La réponse d’un vieux poilu, sur un autre registre, mérite aussi d’être citée : « Laisse faire à Dieu, c’est une personne d’âge. »)
Le 12 août 1918, l’aspirant d’artillerie lourde se moque d’une artillerie plus lourde encore : « l’ALGP (artillerie lourde grande puissance, que d’aucuns traduisent : Artillerie de luxe pour gens pistonnés) ».
Et nous voilà revenus à l’engagement d’Henry Canoville. Alors que sa classe allait être appelée par anticipation à cause des hécatombes et qu’il aurait vraisemblablement dû rejoindre un régiment d’infanterie, il a devancé l’appel ce qui lui a permis de choisir l’artillerie lourde où les risques de mort étaient bien moindres. Ensuite il a été candidat aspirant et a passé quatre mois à Fontainebleau. Oui, il a été tué lors de la contre-offensive alliée de l’été 1918, mais la stratégie d’évitement de la famille ne peut être niée. Les travaux de Jules Maurin sur les centres de recrutement de Béziers et de Mende avaient découvert cette réalité. Ceux de Philippe Boulanger au plan national l’ont confirmée. La connaissance du différentiel de risque entre les diverses armes a abouti à la statistique suivante : entre 1914 et 1916, le nombre d’engagés volontaires dans l’infanterie est passé de 5101 à 1119 ; dans l’artillerie, de 2298 à 6309 (et on ne précise pas s’il s’agit de la lourde ou de l’artillerie de campagne).
Conclusion
Si un tel livre était publié aujourd’hui, il passerait pour une caricature ou un pastiche réussi. Mais le livre est un bon exemple de ce que pouvait oser le milieu catholique il y a cent ans, précisément en 1922. J’ignore son audience ; elle fut vraisemblablement limitée ; Jean Norton Cru n’a pas connu ce témoin.
Rémy Cazals, mai 2024
Lebrun, Mathilde (1879 – )
Le témoignage
Mathilde Lebrun (1879, Nantes – ?) habitante de Pont-à-Mousson, où elle tient un commerce, est en 1914 veuve d’un militaire (adjudant) décédé en 1908, avec lequel elle a eu trois enfants. La guerre déclarée, et ayant eu une culture militaire qui l’a habitué à côtoyer ce milieu (elle a habité plusieurs années dans des forts, dont à Toul, et a été élevée par un oncle, ancien combattant de 1870), elle monte un débit de boissons ambulant au plus près des troupes, activité qu’elle poursuit alors que la ville est envahie pendant quelques jours entre le 4 et le 10 septembre 1914. Sur sa répugnance à côtoyer « les boches », elle se justifie et dit : « Je domptai mon instinctive répugnance, en songeant que j’avais tout intérêt à approcher ces gens, à les étudier, à les connaître » (p. 39). Elle profite de ce côtoiement pour visiter les organisations de l’ennemi et collecter tout renseignement qui lui semble utile. Le recul allemand et la cristallisation du front font qu’elle pense pouvoir être utile aux français ; elle veut « jouer un rôle », non en s’engageant comme vivandière ou infirmière, mais comme espionne, destination qu’elle se fixe possiblement après avoir désigné un espion présumé en pleine bataille pour défendre la ville, mais peut-être aussi en ayant été désignée elle-même comme telle après la réoccupation de la ville. Le 1er décembre suivant, elle est approchée puis finalement, le 13, recrutée à Nancy par le Service des Renseignements de l’Armée de Lorraine. Son « agent recruteur » la missionne de se rendre à Metz, toute proche, afin d’y collecter tout information utile. Elle dit sur son nouveau « métier » : « On m’apprit mon rôle et je compris que j’étais un peu dans la situation de quelqu’un qu’on jette à l’eau pour lui apprendre à nager ». Laissant à la garde de tiers ses enfants qu’elle a éloignés du front à Contrexéville, et devient alors Simonne autrement surnommée « Tout-Fou ». Sa première mission, le 23 décembre 1914, consiste à passer la ligne de front (à Norroy-lès-Pont-à-Mousson) ce qu’elle fait avec une étonnante facilité. Après plusieurs jours d’enquête, elle est finalement approchée par le capitaine Reibel, puis plus tard le lieutenant von Gebsattel, autrement appelé monsieur de Bouillon. Pour les Allemands, elle devient R2, ou madame Blum, autrement surnommée également « Faim-et-Soif ». Le 4 janvier 1915, elle revient en France par la Suisse, fait son compte-rendu au capitaine de B… sur ce qu’elle a vu et entendu durant les 15 jours en territoire allemand qu’a duré sa mission : « Je pus révéler l’emplacement des batteries de Norroy et les dépôts de munitions, la profondeur des lignes de tranchées, le numéro des régiments. Je signalai l’importance des envois de troupes sur la Belgique. Je ne manquai pas non plus de parler des espions que j’avais rencontrés, travaillant pour l’Allemagne » (p. 99). A partir de cette première mission réussi, Simonne, pendant toute l’année 1915, fait des allers et retours entre Nancy et l’Allemagne, en passant par la Suisse (elle cite successivement Metz, Montmédy, Luxembourg, Mondorf, Trêves, Mayence, Coblentz, Cologne, Francfort et même Berlin, passant par Offenburg, Saverne, Appenweiher, Strasbourg et Sarrebourg dans une liste certainement non exhaustive). En tout, elle réalise 13 voyages entre lesquels, missionnée par l’ennemi, elle se rend dans le sud de la France (Marseille et Nice) afin de contacter des agents doubles françaises dont elle sera à l’origine des arrestations. Ce sont Félicie Pfaadt (agent R17), exécutée le 22 octobre (elle dit août) 1916 à Marseille [voir dans ce dictionnaire la fiche de Jauffret, Wulfran (1860-1942) – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org) qui décrit l’exécution de l’espionne le 22 août, qu’il avait défendue vainement devant le conseil de guerre en mai et dont il témoigne de sa réprobation] et Marie Liebendall, épouse Gimeno-Sanches, également condamnée à mort et emprisonnée dans la même ville. Côté allemand, elle distille des informations fournies par le Service de Renseignements qui, apparemment savamment construits, lui valent même en novembre 1915 la Croix de Fer ! Elle reçoit de côté-là des missions dont l’une des dernières confiées est rien moins que de récupérer la formule des gaz de combat français. Risquant, par ces deux principaux « faits d’armes » d’être « brûlée », c’est-à-dire découverte en Allemagne, elle est « mutée » quelques jours à Tours, revient à Nancy avant de participer aux enquêtes et aux procès Pfaadt et Liebendall puis d’être convoquée, le 16 août 1917 à Marseille pour témoigner dans l’enquête sur le député C[eccaldi], mentionné dans ses rapports, accusé lui aussi d’intelligence avec l’ennemi. C’est très possiblement ce qui lui vaut d’être « rayée du service », teintant son dernier chapitre comme une conclusion amère qu’elle a été mal utilisée et oubliée, tant dans l’honneur que dans la récompense nationale.
Mathilde Lebrun, Mes treize missions, préfacé par Léon Daudet (Député de Paris) Paris, Arthème Fayard, sans date, ca 1920, 285 p.
Commentaires sur l’ouvrage
Ecrit en 1919 et les années suivantes, apparemment publié plusieurs années plus tard (1934), ce récit simple, chronologié, sans réel talent d’écriture et descriptif, mais manifestement sincère peut apparaître comme une curiosité littéraire voire fictionnelle. Pourtant, le livre de Mathilde Lebrun est bien la narration testimoniale d’un parcours d’espionne agent double comme les Services de Renseignements français en ont utilisé de nombreuses pendant la Grande Guerre. Le parcours et les actions de Mathilde, manifestement à la personnalité évidente, se construit et évolue en territoire ennemi avec une apparente facilité et légèreté malgré les risques énormissimes pris par ces femmes particulières qui exercèrent leur patriotisme par des voies aussi dangereuses que volontaires. L’ouvrage n’est pas iconographié et contient quelques erreurs topographique (Noviant pour Novéant) ou points tendancieux qui mériteraient des vérifications plus approfondies pour en confirmer la véracité ou la plausibilité. Par exemple, son premier parcours débute en pleines fêtes de Noël et du réveillon dans la Lorraine envahie de l’hiver 1914 et elle n’en décrit pas une ligne. De même par exemple, elle attribue à ses renseignements l’origine d’une contre-offensive sur le Hartmannswillerkopf (entre le 8 et le 15 mars 1915) qui ne semblent pas correspondre à une telle activité sur le massif. Enfin, sa narration est aussi le prétexte à des tableaux, le plus souvent grotesques voire injurieux des personnages qu’elle croise et qu’elle caricature à l’envi (cf. la famille Rihn à Metz dont elle garde les enfants et dont elle dit par que le père à « une bonne tête… d’abruti »), celui lui permettant d’appuyer sur son patriotisme exacerbé.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Liste des missions effectuées en Allemagne par Mathilde Lebrun
1re mission : Du 23 décembre 1914 au 4 janvier 1915
2e mission : Du 11 au 17 janvier 1915 (avec une erreur de date page 112)
3e mission : Du 27 janvier au 1er février 1915
4e mission : Du 15 au 21 février 1915
5e mission : Du 08 au 15 mars 1915
6e mission : Du 26 mars au 2 avril 1915
7e mission : Du 19 avril au (jour non précisé) avril 1915
8e mission : Du 04 au 22 juin 1915 (dont voyage à Berlin)
9e mission : Entre le 26 juin et le 18 juillet 1915, d’une durée de 18 jours
10e mission : Du 18 au 23 juillet 1915
11e mission : Du 11 au 23 août 1915
12e mission : Du 07 au 09 septembre 1915
13e et dernière mission en Allemagne : Du 3 au 11 novembre 1915
Page 22 : Vue tonitruante et sonore de la mobilisation à Pont-à-Mousson
33 : Distribue des bouteilles de vins en pleine attaque allemande
34 : Décrit Pont-à-Mousson sous attaque
176 : 2 canons de 75 français et 6 belges en trophée à Berlin
: Taux de change 100 pour 87,50 marks
178 : Croix de fer en bois plantée de clous d’or et d’argent achetés (elle en plante un)
219 : Obtient (mais trop tard) un sauf-conduit pour toute l’Allemagne
227 : Manque d’être arrêtée en Allemagne à cause de la Gazette des Ardennes (pas logique)
230 : Doit récupérer la formule des gaz de combat français
233 : Obtient la Croix de fer
Yann Prouillet, juillet 2023
Mussolini, Benito (1883-1945)
Une biographie complète du militant socialiste ultra gauche devenu interventionniste (partisan de l’entrée en guerre de l’Italie en 1915), directeur du journal Il Popolo d’Italia, chef du parti fasciste et dictateur de l’Italie ne peut trouver ici sa place. On peut renvoyer aux 985 pages du livre de Pierre Milza, Mussolini, Paris, Fayard, 1999.
Qu’en est-il du témoignage de Mussolini sur la guerre de 1915-1918 ? Dans sa biographie du Duce, Pierre Milza donne cette information : « Selon sa fille Edda qui en fera la révélation en 1950, il [son père] aurait tenu un journal intime, non destiné à la publication et par conséquent non soumis à la censure, que la comtesse Ciano remit au docteur Ramiola avant de se réfugier en Suisse et qui disparut après l’arrestation de celui-ci. ». Ce document étant perdu, on doit donc se contenter de Mon Journal de guerre, dont les pages ont d’abord paru en feuilleton dans Il Popolo d’Italia, puis ont été réunies dans le premier volume des œuvres du Duce, traduit en français chez Flammarion dès 1923. Le texte est clairement travaillé pour servir à une propagande patriotique (puisque c’est le nouveau choix politique de Mussolini) et personnelle (puisque Mussolini a des ambitions). Si un « journal intime » a existé, cela renforce l’idée qu’il faut prendre le témoignage officiel avec quelque précaution.
La partie la plus fiable concerne la dureté de la guerre dans les Alpes. « Quelle autre armée tiendrait dans une guerre comme la nôtre ? » demande Mussolini qui fait dans ce texte très peu de remarques négatives sur l’organisation militaire et les chefs. Au contraire il signale à plusieurs reprises des contacts familiers entre gradés et simples soldats ; il insiste sur le bon moral des troupes italiennes. Juste avant de mourir, les bersagliers prennent le temps de crier « Vive l’Italie ! » et Mussolini lui-même termine ses pages sur la guerre par la victoire et la phrase : « Qu’un cri immense s’élève des places et des rues, des Alpes à la Sicile : Vive, Vive, Vive l’Italie ! »
En lisant ce journal de guerre, j’ai été frappé par le très grand nombre de noms de soldats italiens cités. Comme s’il s’agissait de faire appel à des témoins. Si Mussolini peut désigner Tommei, Failla, Pinna, Petrella, Barnini, Simoni, Parisi, di Pasquale, Bottero, Pecere, Bocconi, Strada, Corradini, Bascialla et des dizaines d’autres, ils pourraient témoigner de sa présence dans les tranchées. Je remarque aussi que Mussolini mentionne la ville ou la province de presque tous ces soldats, une façon de montrer l’engagement des Italiens de toute origine géographique, y compris ceux revenus d’Amérique pour défendre la Mère-Patrie.
Tous les historiens ont montré l’évolution remarquable de l’antimilitariste ayant manifesté violemment contre la guerre de Libye puis ayant poussé à l’intervention dans la guerre européenne en 1915. Et l’antimonarchiste s’est présenté au roi, après la marche sur Rome (lui-même étant venu de Milan en train à l’appel de Victor-Emmanuel) en prononçant la phrase : « Maestà, vi porto l’Italia di Vittorio Veneto. Majesté, je vous apporte l’Italie de Vittorio Veneto. » Le régime fasciste s’est présenté comme l’héritier unique de l’expérience de guerre et de l’héroïsme, en particulier dans l’enseignement, comme l’a montré la communication de Stéfanie Prezioso au colloque de Sorèze, Enseigner la Grande Guerre qui a réuni en 2017 plusieurs membres du CRID 14-18 et de la Mission du Centenaire.
Sarrail, Maurice Paul (1856-1929)
Né à Carcassonne le 6 avril 1856, mort à Paris le 23 mars 1929.
Carrière militaire. Général de division en 1911. Lors de la bataille de la Marne, il refuse d’obéir aux ordres de Joffre d’abandonner le secteur de Verdun presque encerclé et le conserve dans les lignes françaises.
Un des rares généraux marqués à gauche, franc-maçon, Sarrail, que Joffre a voulu marginaliser en l’envoyant commander à Salonique une trop faible troupe, s’est défendu en publiant en 1920 chez Flammarion son témoignage sous le titre Mon commandement en Orient (1916-1918). Il y justifie sa stratégie dans des conditions rendues très difficiles par la mésentente des Alliés, la duplicité du gouvernement grec, et surtout les ordres contradictoires venant du Grand Quartier Général en France. Un seul exemple de l’opinion exprimée par Sarrail sur le GQG, page 188 : « Travailler à faux dans un bureau, sur des idées générales préconçues, ne pouvait qu’entraîner fautes sur fautes ; le GQG n’y manquait pas. » Les pièces justificatives en annexe occupent 120 pages sur un total de 424. Le livre du général Sarrail a eu un bon succès. Mon exemplaire figure dans le vingtième mille. Rémy Porte l’a réédité en 2012.
La biographie de Sarrail dans Wikipedia est résolument hostile et peu fiable. Elle rapporte que Sarrail aurait participé aux intrigues entrainant la chute de Joffre en décembre 1917 (consulté le 25 août 2021) alors que, à cette date, depuis le limogeage de Joffre en 1916, deux autres généraux en chef ont occupé le poste à la tête de l’armée française, Nivelle et Pétain. Inversement, l’opinion d’Albert Londres, grand reporter à Salonique, est dithyrambique : « Il n’y a qu’une chose au milieu de cette ville tourbillonnante, paradoxale, sournoise et peut-être bientôt sanglante, il n’y a qu’une chose qui nous remette l’esprit en place, c’est lorsque, le soir, vers sept heures, sur le quai, vous voyez passer une automobile éclairée, et que dans cette automobile, vous reconnaissez un homme dont le regard devant les événements les plus sombres est toujours droit, limpide et puissant. Cet homme, c’est un général, ce général, c’est Sarrail. »
Je n’ai pas étudié personnellement la question des compétences de Sarrail. Je ne peux me prononcer que sur un point : pendant la guerre, les généraux ont employé une partie de leur énergie à se dénigrer (même chose côté allemand). Cela aussi fait partie du témoignage. Complément : on trouve une photo du mariage du général Sarrail avec Mlle de Joannis dans le livre du pasteur Freddy Durrleman, Lettres d’un aumônier sur un navire-hôpital, Armée d’Orient (1915-1918), page 145 (voir ce nom dans notre dictionnaire).
Rémy Cazals, août 2021
(Voir aussi le riche fonds iconographique sur le général Sarrail disponible sur Wikimedia Commons)