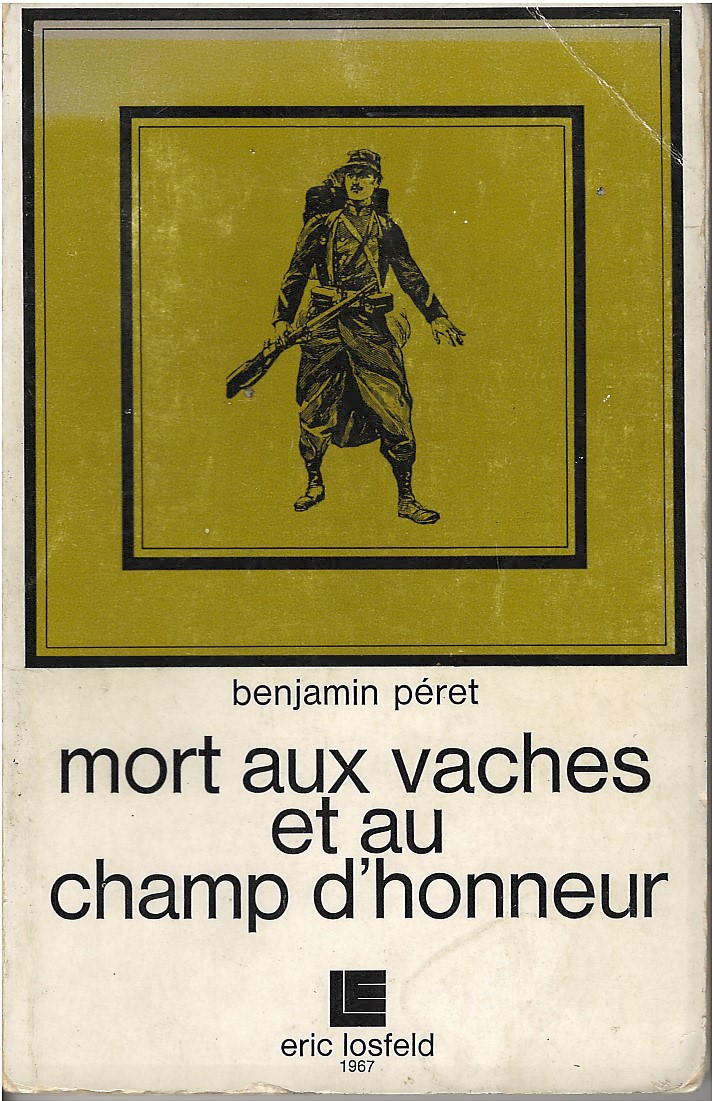Résumé de l’ouvrage :
Emile Pagès, La grande étape. Ceux de la « Sans-Fil », Paris, Tallandier, 1931, 221 pages.
En août 1918, le caporal Pagès, se « trouvant inapte à tous les fronts par suite d’une blessure à la jambe gauche » (page 10), ronge son frein à La Courade (commune de La Couronne, à peu de kilomètres au sud d’Angoulême), dépôt des éclopés du 8ème régiment du Génie. Un matin, à la lecture du rapport, un gradé « demande des volontaires, aux fins de constituer le poste radio-télégraphique de la Mission militaire française en Sibérie » (page 11). Désœuvré, il décide de s’engager immédiatement comme huit autres comparses : Battesti, hâbleur qui se propose comme le futur mécano du poste, Fendlevent, un classe 17 éleveur d’escargots montmartrois, Lenoir, grippe-sous, Larchaud, sème-fortune, Robert, la belle gueule, Ramon, le sauvé du front, Bollec, racolé de la dernière heure et Fléau, le taciturne. Pour Pagès, un problème se fait jour ; le poste de chef est dévolu à minimum un sergent or il n’est que caporal. Qu’à cela ne tienne, il est alors immédiatement nommé sergent, Battesti devient derechef caporal. Dès lors, il prend la tête de cette petite troupe hétéroclite pour une marche vers l’ouest, avec pour but de convoyer une « caravane » de 120 caisses de matériels de transmission et de téléphones. Le petit noyau fait partie intégrante d’un « échelon », composé d’une dizaine d’officiers, commandée par un colonel. Parti de Paris le 8 octobre, la troupe de ces « Sibériens » embarque à Brest sur le Léviathan, ancien paquebot allemand capturé par les Américains à leur entrée en guerre. Le détachement débarque à New-York après une traversée sans rencontre sous-marine funeste. C’est l’occasion d’une découverte de la grande cité outre-Atlantique où les Français bénéficient d’un crédit patriotique confinant au triomphal. Embarqué dans un train, il faut maintenant au détachement traverser le Nouveau Monde. Le 7 novembre, arrivé à San-Francisco, Pagès embarque sur le Thomas pour traverser maintenant le Pacifique. C’est sur les flots que l’escouade apprend que « la guerre est finie » ; c’est la Victoire ! Et de s’interroger sur celle-ci : « La Victoire ? elle est faite de toutes les tombes qui, pour l’éternité, vont monter la garde au long de la ligne rouge. Un peu de nous-mêmes, les rescapés, se trouve enseveli sous ces croix. Nous ne sommes pas morts, mais quatre ans de la vie, quatre ans d’ardente jeunesse reposent, scellés dans les bières de ceux qui furent fauchés à nos côtés. La guerre est en nous pour toujours, comme un épouvantable virus » (page 124). C’est aussi l’occasion de se remémorer, sur la base du « Boum ! Voilà ! », journal de tranchée du 402ème RI que l’auteur a contribué à fonder , de quelques épisodes de la guerre passée. Le détachement débarque enfin à Vladivostock. Pagès dit alors : « En somme, nous abordons la Sibérie sans en rien connaître. Les rouges, les blancs, l’épopée tchèque, la révolution forment un puzzle nébuleux parfaitement incompréhensible pour des cervelles simples comme les nôtres ; et, au surplus, nous estimons que toutes ces querelles ne nous regardent pas. Il fallait des volontaires pour dresser une antenne, monter un poste-radio en Sibérie ; nous nous sommes proposés, un point c’est tout. La politique n’a rien à voir là dedans » (pp. 151-152). Débute alors la dernière partie du voyage, épique et Vernienne, dans un train qui permet d’appréhender le peuple russe, conglomérat cosmopolite, miséreux à l’extrême et bien entendu alcoolisé. Il voit ainsi « des loques, de la vermine, de la faim – une faim rouge, enragé – des agonisants, des enfants, des vieillards, des femmes, toute une humanité blême, cadavérique… » (page 155). Il voit aussi des combattants, ceux qu’il appelle « les Loups de la Steppe » de tous oblasts ; « Kalmouks au nez écrasés, Mongols aux petits yeux bridés, Tartares, Mandchous aux moustaches grêles, Lakoutes aux faces bestiales, des blancs aussi, Cosaques, aventuriers de nationalités mal définies » (page 200). Le but ultime de ce voyage sans fin, au cours duquel il apprend les rudiments du russe, est Omsk, la zone d’affrontement entre les Russes rouges et les blancs. Il dit, « nous ne sommes pas sans savoir que cent milles Tchèques, aidés de Serbes, de Polonais, de Roumains, de tous les prisonniers enfin du front oriental, luttent eux aussi, dans ce combat titanesque. Ils forment même l’ossature véritable de l’armée opposée aux bolchéviks » (pages 205-206). Mais Pagès, pas dupe, complète : « D’ailleurs, tous ces étranges ne peuvent-ils pas disparaître en moins d’un mois. Qu’on laisse à tous ces brave le libre passage, qu’on leur permette de rejoindre leurs foyers, et la Sibérie n’en gardera pas un seul. S’ils se battent en ce moment, c’est qu’ils entendent prouver par la force de leurs coups que le plus sage est de les laisser retourner dans leur patrie, leur présence étant nécessaire dans la république naissante » (page 206). Après de multiples péripéties, dont le vol de l’ensemble de la cargaison du détachement, le train arrive enfin à Omsk et l’escouade de constater que les trois couleurs nationales flottent au-dessus de la ville et qu’une antenne est déjà dressée sur une cheminée, qui sera bientôt complétée par le mât de « l’équipe » du caporal Pagès. « L’odyssée est terminée. Partis du dépôt sur un coup de tête, traversant l’Amérique en délire, voguant sur le Pacifique, apprenant dans une dure expérience les multiples dangers de l’Aventure, nous avons vécu » (page 220).
Commentaires sur l’ouvrage :
Manifestement basé sur ses souvenirs d’Emile Pagès (30 juin 1893, Saint-Maurice (Val-de-Marne) – 9 mars 1963, Paris), cet écrivain français et auteur de romans populaires livre dans La Grande étape, ceux de la Sans-fil » un Road Movie qui naît de la Grande Guerre. En effet, cette relation très personnelle distille au sein du livre, çà et là, quelques souvenirs et éléments de sa carrière militaire, notamment son rôle de créateur du journal de tranchée du 402ème RI, le « Boum Voilà », à l’occasion de son apprentissage de l’Armistice, dans les flancs du Thomas, le bateau qui approche des côtes de Vladivostok (page 125). L’ensemble de l’ouvrage est en vérité un véritable carnet de voyage d’un détachement du 8ème régiment du Génie en secours des Russes blancs qui, après la Révolution, combattent au centre de la Russie contre le péril rouge bolchévik. Cet ouvrage, qui emprunte tant de Jack London que de Boris Pasternak, s’étale ainsi d’août 1918 à janvier 1919. L’intérêt principal de cette relation réside donc dans la vision anthropologique de deux continents traversés de part en part, les Etats-Unis peu avant l’Armistice et la Russie pas encore soviétique peu après. Enchaînant les tableaux d’une Amérique très francophile, Pagès, devenu pour les Amec’s le sergent Pig’s, note que, « depuis la visite des chasseurs alpins, en 16, New-York n’a pas revu de poilus dans ses murs, et ceci explique la chaleur d’un tel accueil » (page 58). Il précise encore : « Quand, en 18, un Yankee prononce religieusement : Verdun ! tout est dit » (Page 65). Il voit des scènes pittoresques, comme la collecte effrénée des Liberty Bounds et décrit à cette occasion : « … à une fenêtre de sa maison, un petit drapeau bleu sert de rideau ; ce drapeau est piqué de deux étoiles d’argent. Deux fils au front. » (page 65). A la veille de la Victoire, il continue : « Oui, j’admire un New-York enfiévré qu’on ne retrouvera pas de sitôt. Songez que tous ces gens-là, sportifs et joueurs enragés, considèrent la guerre comme un match dans lequel ils ont engagé des paris » (page 65). A San-Francisco, « le port du masque est obligatoire » (page 105) du fait de la grippe espagnole. De même qu’il a décrit New-York et le trajet en Pullman de la Pacific and Co, Pagès décrit la terre russe, la Vladivostok pendant l’hiver, ses moyens de lutte contre le froid, la population, ville dont il s’extasie que « oui, voilà bien le seuil d’un pays d’aventures » (page 162). Et il n’en manque pas ; attaque du train, parcours chaotique et surréaliste, vol de l’ensemble d’un chargement si difficilement convoyé jusque-là (page 196), mais incident dont on n’entend toutefois étonnamment plus parler à l’arrivée. Un petit doute est toutefois relevé (page 106) quand il dit à peu de jours de l’Armistice : « J’ai vingt ans, je suis heureux de me sentir vivre » alors qu’Emile Pagès est sensé avoir à 25 ans à cette date.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 20 : Description d’un képi de chef de gare, à trois galons et à bande blanche
30 : Fourré à l’ours : être puni
42 : Vue du Léviathan, ancien Vaterland, « le plus grand bateau du monde », (vap p. 44)
77 : Sabre Z (sabre-baïonnette Chassepot) pour les GVC
125 : 321ème RI cité, qui fait bien brigade, la 133ème, avec le 402ème R.I. à la création, en Alsace, dans le secteur de Dannemarie, du journal de tranchée « Boum ! Voilà !« .
Yann Prouillet, juillet 2024