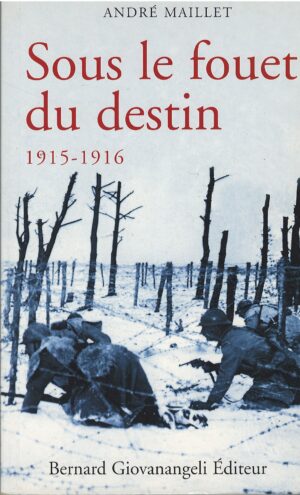Maillet, André, Sous le fouet du destin. 1915-1916, Paris, Bernard Giovanangeli, 2008, 157 p.
Résumé de l’ouvrage :
Le jurassien et intellectuel André Maillet est soldat au 23e RI de Bourg-en-Bresse, qui tient La Fontenelle, dans les Vosges, à la mi-décembre 1915. Son régiment est alors appelé à renforcer le 15-2 qui doit attaquer sur le Hartmannswillerkopf le 21. Racontant par étapes ce qu’il considère comme une montée au Golgotha, il relate cinq jours épiques et sanglants dans les « Régions infernales » dont il échappe, blessé, les pieds gelés, sauvé par miracle par des brancardiers.
Eléments biographiques :
André Maillet est né le 30 novembre 1889 à Le Vaudioux, canton de Champagnolle, dans le Jura, d’un père scieur. Volontiers poète, il est instituteur à son recrutement et professeur au collège de Nantua à la déclaration de guerre. Il dit : « Je voulais former des jeunes gens, mes élèves, pour la lutte qui les attendaient… » (p. 46). Bernard Giovanangeli, qui introduit cette réédition, évoque le cercle intellectuel dans lequel, jeune, il évolue avant la guerre, écrivant poèmes et « pièces de sa composition ». Il publie chez Jouve en 1918 un premier livre de poèmes, écrits avant la guerre (1909-1912), sous le titre L’Angoisse éternelle, puis chez Perrin en 1919 Sous le fouet du destin. D’autres livres suivent, dont le dernier paraît en 1965. Son parcours militaire est ténu, très vraisemblablement du fait de sa faible constitution. Il est d’abord réformé pour « faiblesse générale et imminence » le 26 octobre 1911, puis reconnu apte au service armé par le Conseil de Révision de Nantua le 26 novembre 1914. Il est d’abord incorporé au 60e RI à compter du 16 février 1915, puis passe au 23e RI le 14 août suivant. [Il n’a donc pas participé aux combats sur La Fontenelle de juin et juillet, particulièrement âpres pour son régiment]. La gelure de ses pieds à la fin de la bataille du HWK entraîne une inaptitude temporaire d’un mois, avant qu’il soit classé au service auxiliaire le 27 novembre 1916 pour « amaigrissement et dyspepsie ». Il est finalement reconnu définitivement inapte à faire campagne pour faiblesse générale, gastro-entérite, anémie et amaigrissement par la commission de réforme de Dôle du 26 novembre 1917. Il ne retournera finalement jamais au front et sera démobilisé le 10 mai 1919. Jean Norton Cru, qui lui consacre une longue notice analytique dans Témoins (p. 363 à 366), indique qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité en 1919 et qu’il exerce les métiers de professeur au lycée d’Alais (aujourd’hui Alès) puis inspecteur primaire à Montceau-les-Mines. Il est également recensé à Aurillac et Nîmes (1921) ou Villefranche (1933). André Maillet meurt le 16 avril 1968 à Lyon.
Commentaires sur l’ouvrage :
Licencié en philosophie, sa formation littéraire transpire à chaque ligne de son impressionnant témoignage uniquement vosgien, sombre et très intellectualisé, qu’il circonscrit à l’attaque du HWK le 21 décembre 1915. Lancinant d’abord, à partir du moment où il apprend que le régiment doit quitter La Fontenelle pour aider à l’attaque de la « Mangeuse d’hommes » avec le 15-2, régiment vosgien qui l’occupe, Maillet multiplie les références bibliques, évoquant alors une longue montée au Calvaire. Puis l’ouvrage tourne au terrible et horrifique l’apocalypse déclenché. On sent la formation classique rien qu’à l’énoncé de son chapitrage, en forme de d’une pièce de théâtre en 15 tableaux empruntant au registre dramatique :
Premier tableau – Le sort en est jeté : La méditation du factionnaire – Dans la grange du corps de garde – La proclamation aux guerriers
Deuxième tableau – Sous le fouet du festin : La traversée de l’oasis – Le rêve des guerriers – Vers l’Alsace – L’étape – L’ascension du Golgotha
Troisième tableau – Les régions infernales : L’assaut – Le tir de barrage – En patrouille – En contre-attaque – En attendant la mort – La fête des damnés – Des profondeurs de l’abîme.
Peu des camarades qu’il cite et côtoie survivent à la boucherie dans un style dramatique impressionnant dont il ne se fait aucune illusion sur l’issue, s’abandonnant à l’idée de la mort : « C’est vrai… je me résigne. La mort n’est pour moi ni un châtiment, ni une promesse » (p. 119). Très tôt dans l’ouvrage, il évoque en effet la certitude de sa mort prochaine, comme de celle des autres d’ailleurs ! Il dit « Celui-là ne reviendra pas » ! » (p. 43) et plus loin « Lesquels laisseront sur la terre encore inconnue leur dépouille aujourd’hui frémissante ? » (p. 44). Il se révolte à l’idée de sa propre mort sacrificielle mais dit qu’elle ne l’effraie pas : « J’ai passé de trop longues nuits de méditation avec les sages et les poètes, mes amis, pour craindre son coup définitif et brutal » (p. 44). Et plus loin : « … je regarde ce sang, et je cherche les âmes de ceux qui ne sont plus » (page 80). Oscillant entre mythologie et christianisme, il avance un parallèle christique : « Et je comprends le bonheur divin du Christ, agonisant sur le promontoire tragique du Golgotha, pour délivrer le monde » (p. 74).
Il incarne quelque peu aussi le Hartmannswillerkopf, parlant du « râle immense de la montagne » (p. 90).
Patriote, le passage de la frontière (au col de Bussang) révèle sa souffrance traumatique de 1871 : « Voici enfin la réalisation du rêve de mon enfance » (page 51) alors qu’il participe à récupérer la province perdue. Ayant pourtant une vision très poétique des allemands, il en affirme aussi une haine certaine, marquant l’opposition irréconciliable des deux races. Il affirme que « la vie nationale est supérieure à la vie individuelle » (p. 117).
Comme Eugène Lemercier, dont le statut intellectuel et la psychologie sont similaires, André Maillet a une haute opinion de sa classe, tendant parfois à la condescendance. Il dit, à la vue de territoriaux transformés en cantonniers : « Ils se relèvent, lourdement, brisés, à notre passage, et, de l’air placide et calme des ruminants, nous regardent défiler » (p. 56). Plus, il avance : « Le penseur a même ici moins de valeur que le rustique, car il réfléchit trop, il raisonne trop, et une machine à tuer ne doit pas penser » (p. 76).
Il intériorise en permanence son « expérience » de combattant et cherche à analyser, dans un mélange d’utopie et de pacifisme, les sentiments et les rouages qui le poussent à agir contre sa volonté. Il dit : « Quelle est donc la force qui nous pousse à la mort ? Quelle est donc la force qui nous attire aux enfers ? Quel nom donner à la mystérieuse puissance des Ténèbres qui nous conduit au sacrifice ? », l’expliquant, réaliste, par le simple consentement (p. 70), ajoutant plus loin : « L’aiguillon de la nécessité fait des prodiges » (p. 87). Aussi, il se révolte en vain contre l’obligation d’ôter la vie : « Tuer des hommes ! quelle horreur ! Est-ce possible ? Tout ce que j’ai d’humain se dresse contre ces crimes » (p. 93). Et il appréhende ce moment : « … Je redoute l’instant où je devrai tuer. Et pourtant, je sens, je sais que, au premier signal je lâcherai mon coup de feu, et que ma balle portera juste, terriblement meurtrière… Je le sais. Je sais que je tuerai parce qu’il y va de la sécurité de mes camarades qui comptent sur moi, parce qu’il y va de leur vie…. Je tuerai parce que j’y suis obligé, parce que c’est le devoir ! » (p.111). Pour la liberté, il accepte et justifie alors la notion de meurtre : « C’est pour la défendre et la conserver que nous avons accepté ces meurtres et ces tueries que nous n’avons, en particulier, pas voulus » (p. 118). Il revient plus loin sur ce terme : « Notre tuerie se passe en champ clos. Nous sommes seuls admis à franchir le seuil des régions infernales ». Et il se confie alors sur l’indicible horreur, comme celle, la guerre suivante, des camps de la Shoah, que l’on ne croira pas : « Quand tu narreras tes aventures, on ne te croira pas. On sourira avec une légère pointe de pitié condescendante en pensant : « Il chevauche son dada » (p. 141), s’interrogeant page suivante sur la difficulté de trouver les mots, voire d’autres vecteurs, convoquant ainsi musiciens, peintres ou poètes du futur, pour évoquer la réalité de la sauvagerie à laquelle les poilus ont survécu. Ainsi « Seuls devraient avoir le droit d’en causer ceux qui l’ont vécue, ceux qui ont souffert » (p. 143). Et sa conclusion est formelle : « Si les hommes connaissaient toutes ces tortures, s’ils pouvaient souffrir tous, par la pensée, ce que nous avons réellement souffert, c’en serait à jamais fait des guerres » (p. 142). Hélas, il n’est pas optimiste sur l’oubli prévisible des générations futures et sur la certitude formelle et désabusée que « La guerre ne disparaîtra qu’avec le dernier soupir du dernier des mourants » (p. 144).
Le témoignage de Maillet, soldat du 23e RI, qui n’est sur le Hartmannswillerkopf qu’en renfort temporaire pour l’attaque du 21 décembre 1915, est à rapprocher de celui d’Auguste Chapatte (Souvenirs d’un poilu du 15-2), qu’il pourrait même avoir vu lors de sa blessure de ce dernier, voyant, p.86, « les bombardiers se glissent vers les fortins, en les attaquant à la grenade ; font sauter les derniers centres de résistance et les derniers repaires de mitrailleuses » ; même lieu, même temporalité mais unités différentes, sans que l’un cite l’autre et réciproquement le régiment frère de circonstance d’ailleurs !
Au sortir de la bataille, après son récit épique et impressionnant, André Maillet dresse un bilan surréaliste et très lucide : « Je n’ai plus que mon fusil… J’ai perdu mes musettes, mon masque à gaz, ma couverture, ma toile de tente, ma pelle-bêche, mes guêtres, mon masque et ma cravate… Je n’ai plus rien. J’ai perdu toutes mes forces et ma santé. Je ne suis plus qu’une loque, qu’une épave exsangue, qu’un squelette, qui se traine mû par ce qui me reste de puissance de volonté. J’ai laissé là-bas tout ce que j’avais encore de possibilités de bonheur, tout ce que nourrissaient d’espoirs mon cœur et mon cerveau. (…) Je ne suis plus un homme » (p. 136). Et quand même les survivants retrouvent leur sac, celui-ci a été pillé pendant leur absence au cœur de la bataille ! (p. 137).
Au final, l’ensemble de l’ouvrage est ainsi celui d’un intellectuel idéaliste et fataliste mais résigné à donner sa vie à la France. L’ouvrage est très riche psychologiquement et assez pauvre quant à certaines précisions (toponymes, souvent oubliés, dates ou unités ; il ne cite par exemple jamais le 15-2 alors que son régiment, prélevé de La Fontenelle, à 80 kilomètres au nord, soutient l’attaque principale par cette unité), circonscrivant le témoignage à une seule période comprise entre la mi-décembre 1915 et le 1er janvier 1916. Maillet apporte ainsi à la littérature de guerre un récit intellectualisé plus qu’un témoignage « technique », voire journalistique, de soldat.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 48 : Vue de Bussang
56 : Surnomme le front « le toboggan »
57 : Sentiments anti-alsaciens, pris pour des espions
60 : Défilé du régiment à Saint-Amarin, « pour l’image », puis effondrement dans l’épuisement !
64 : Achète une carte d’état-major pour suivre ses déplacements
66 : Homme faisant son testament avant l’attaque, et toilette de condamnés à mort
83 : Pancarte allemande demandant quand aura lieu l’attaque française !
89 : Perçoit un couteau de tranchée (qui lui servira à creuser son trou sur le champ de bataille, qu’il appellera sa tombe)
90 : Prisonniers allemands enviés car ils quittent le champ de mort
99 : « … le principal effet du bombardement est de nous endormir »
110 : Décide de ne plus faire de prisonniers
126 : Bruit des éclats d’obus : « grand bruit d’étoffes froissées et de râles désespérés »
131 : Veut bombarder Mulhouse insolemment éclairée
132 : Aide des brancardiers allemands à franchir une tranchée, tués juste après
136 : Ferme les yeux pour ne pas voir la montagne devenue cimetière à ciel ouvert
141 : Sur les lettres : « Les lettres sont douces. On nous parle comme si nous étions encore du monde des humains… »
Yann Prouillet, février 2026
Lemercier, Eugène-Emmanuel (1886-1915)
Lettres d’un soldat. Août 1914 – avril 1915, Paris, Bernard Giovanangeli, 2005, 191 p.
Résumé de l’ouvrage :
Eugène-Emmanuel Lemercier, né le 7 novembre 1886 à Paris, est d’abord engagé volontaire en 1905 avant d’être rappelé au 106e RI de Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne aujourd’hui), qu’il rejoint dès le 3 août 1914. Il arrive au front dans la Meuse après la bataille de La Marne. Promu caporal le 1er janvier 1915 (page 89, qui lui donne un « devoir social » (p. 108 et 189) puis sergent le 13 mars suivant (p. 146, qui faillit être cité (p. 187 et 189), il disparaît aux Eparges le 6 avril 1915. L’ouvrage publie 140 lettres écrites du front du 6 août 1914 au 21 mars 1915, principalement à sa mère et à sa grand-mère.
Eléments biographiques :
L’auteur naît à Paris le 7 novembre 1886, de Louis-Eugène et de Marguerite Harriet O’Hagan, une famille protestante, dont la branche féminine est d’origine irlandaise. Après la mort de son père alors qu’il n’a pas un an, il est élevé par sa mère et sa grand-mère maternelle, qui créent un lien profond, qui transpire dans la correspondance avec le jeune homme lorsqu’il est au front. Initié au dessin et à la peinture par ces dernières, il a pour mentor le peintre Fernand Cormon (1845-1924) qui lui présente dès ses 11 ans ½ Jacques Humbert (1842-1934). Ce dernier va lui prodiguer une formation artistique qui aboutira à son entrée aux Beaux-Arts dans sa 15e année. Malgré une faiblesse de constitution, il devance l’appel et rejoint le 106e RI de Châlons-sur-Marne en 1905, qu’il quitte l’année suivante, revenant à ses études artistiques. Nombre de ses toiles sont primées mais sa santé s’épuise et il est contraint d’aller se soigner en Suisse. À la déclaration de guerre, il rejoint tout naturellement son régiment, dès le 3 août, et sa première lettre, dès le 6, témoigne de la vie mouvementée et fatigante des premiers jours sous l’uniforme d’un intellectuel plongé dans la guerre. Il arrive en ligne le 12 septembre et est porté disparu, sans que son corps ne soit jamais retrouvé, au combat du 6 avril 1915 aux Eparges, dans la Meuse.
Commentaires sur l’ouvrage :
Artiste et intellectuel, Eugène-Emmanuel Lemercier tient un carnet de guerre et échange surtout une correspondance avec sa mère, adulée, et sa grand-mère. Il dit très peu de la guerre mais intériorise ou philosophe abondamment, ayant conscience de sa classe et de son intellectualisme (volontiers supérieur). Quelques apports toutefois, mais assez peu sur le 106e RI, celui du panthéonisé Genevoix, avec lequel il partage parfois la contemplation de la nature, et des autres témoins que sont André Fribourg, Robert Porchon et Joseph Vincent. Bernard Giovanangeli rappelle dans un avertissement que Lettres d’un soldat est paru sans nom d’auteur chez Chapelot en 1916 puis chez Berger-Levrault en 1924, et Jean Norton Cru, qui lui consacre une longue analyse critique pages 530 à 535 dans Témoins, ajoute à ces références éditoriales une publication partielle préliminaire dans la Revue de Paris les 1er et 15 août 1915.
Il n’est pas étonnant que Jean Norton Cru classe Eugène-Emmanuel Lemercier dans les 27 témoins qu’il place dans la 1re catégorie de son classement tant Lettres d’un soldat est résolument un témoignage intellectualisant son parcours de guerre, même si ténu puisqu’il concerne seulement les 8 premiers mois de guerre. Il s’épanche souvent sur sa condition et, le 1er décembre 1914, il dit : « Et voici qu’à vingt-huit ans, je suis replongé en pleine armée, loin de mes travaux, de mes soucis, de mes ambitions, et jamais la vie ne m’apporta une telle abondance d’émotions nobles ; jamais, peut-être, je n’eus, à les enregistrer, une telle fraîcheur de sensibilité, une telle sécurité de conscience », et il semble jouer quelque peu de ce statut comme il l’avance un peu plus loin : « Mon petit emploi me dispense de la pioche » (p. 83), lui que la guerre ne lui fait pas « renoncer à être artiste » (page 84). Il dit d’ailleurs à ce sujet : « Sans doute, après cette guerre, un art fleurira-t-il de nouveau, mais nous aurons à l’apprendre entièrement » (p. 110). Sa haute condition, qui lui fait se différencier de la plèbe qui l’entoure, lui fait dire de ses camarades : « Leur courage, pour être infiniment moins littéraire que le mien, n’en est que plus pratique, adapté à tout… » (p. 87). Plus loin, il avance même : « … je mène une existence d’enfant au milieu de gens si simples que, même très rudimentaire, mon existence est encore bien compliquée pour mon entourage » (p. 102). Il est de temps en temps descriptif et volontiers poète ; « Tu ne saurais croire ce que les forêts ont souffert par ici : ce n’est pas tant la mitraille que les effroyables coupes nécessaires à nos constructions d’abris et à notre chauffage. En bien ! parmi cette dévastation, il me disait qu’il y aurait toujours de la beauté pour l’arbre et pour l’homme » (page 93). Plus loin, il dit : « Il est de heures de telle beauté où celui qui les embrasse ne saurait mourir alors. J’étais bien en avant des premières lignes, et jamais je ne me sentis plus protégé », vantant les beautés de la nature meusienne (p. 130 et 131). S’il dit qu’il a parfois conscience de se répéter, il ajoute : « Il faut s’adapter à cette existence particulière, à la fois indigente en activités intellectuelles et merveilleusement opulente en émotions spontanées », comparant son métier au moine-soldat (p. 94). Il a peur page suivante de perdre « sa main » de dessinateur. Toujours observateur de son environnement, il a quelques phrases analytiques plus profondes : « Ils blaguent, mais leur blague est l’épiderme d’un magnifique courage profond » (p. 100). Il s’étonne que la vie continue : « Ce qui nous dépasse (mais qui pourtant est bien naturel) c’est que les civils puissent continuer une existence normale alors que nous sommes dans la tourmente » (p. 117). Philosophe, convoquant parfois Spinoza ou Saint-Augustin, il s’interroge sur l’ordre et la violence ; il dit : « L’ordre conduit au repos éternel. La violence fait circuler la vie. Nous avons comme objectifs l’ordre et le repos éternel, mais, sans la violence qui déchaîne les réserves d’énergie utilisable, nous serions trop enclins à considérer l’ordre comme obtenu : un ordre anticipé qui ne serai qu’une léthargie retardant l’avènement de l’ordre définitif » (p. 118). Il teinte le plus souvent ses réflexions de la présence de Dieu. Il se révolte à l’idée de sa mort (la pressent-il ?) ; il dit : « Pourquoi suis-je ainsi sacrifié, quand tant d’autres qui ne me valent pas sont conservés ? (p. 146). Ses analyses sont parfois plus singulières. N’avoue-t-il pas à sa mère : « …pour revenir à ces moments extraordinaires de fin février, je te redirai encore que j’en conserve le souvenir comme d’une expérience scientifique » (p.152). Dès lors, le sous-titre d’une telle œuvre testimoniale aurait pu être « introspection d’un intellectuel à la guerre ».
Car la guerre il la décrit finalement assez peu. Des fois, il dit quand même, sans s’étaler : « Nous sommes en cantonnement après la grande bataille. Cette fois-ci, j’ai tout vu. J’ai fait mon devoir, et la sympathie de tous me l’a prouvé. Mais les meilleurs sont morts. Pertes cruelles. Régiment héroïque. But atteint. Ecrirai mieux » (p. 142). La description plus diserte qui suit fait état d’un tableau épique d’horreur. Il dit : « Voici cinq jours que mes souliers sont gras de cervelles humaines, que j’écrase des thorax, que je rencontre des entrailles » (p.143) et c’est après un temps plus ou moins long qu’il donne ses impressions au spectacle réel de la bataille (voir p. 185 le 14 mars, peu avant sa mort). L’édition de 2005 permet de rétablir les passages censurés dans l’édition de 1916 et notamment celui-ci : « Car on a l’impression que tout le monde y passera. Chaque mètre de terrain coûte trois cadavres » (p. 158). Il a en effet la certitude de sa mort ; quelques jours avant celle-ci, il dit : « Ils m’ont raté, mais malheureusement ce n’est que partie remise, car il ne doit rien rester de notre régiment » (p. 186). Dès lors il ne faut pas rechercher dans le témoignage de Lemercier un réel ouvrage testimonial, bien qu’épistolaire, mais un livre de réflexion. Au final, c’est plus une correspondance dans la guerre qu’une correspondance de guerre. En fait il donne le plus souvent l’impression de n’avoir jamais avoir été soldat ; il semble confondre cagna et casemate (p.165) et avoue même : le « plaisir que j’éprouve de n’avoir pas tiré un coup de fusil » (page 186). Il avance même étonnamment « … avoir rencontré des Allemands nez à nez, mais (…), ces gens-là ont dû pressentir en moi quelque chose de mieux et en tous cas très différent d’un soldat, car ils se sont constitués prisonniers de façon courtoise, ce qui, d’ailleurs leur était dictée par ma façon polie de les aborder » (p.186). Il a pourtant, à la veille de sa mort, été envoyé suivre un cours d’élèves sous-officiers, ce dont il se faisait un certain orgueil. Las, ses derniers morts, qu’il écrit à un ami, sont prémonitoires : « Pense à moi et aie de l’espoir pour moi qui n’ose pas en avoir » (. 187).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 100 : Douille de 75 utilisée comme pot à eau
: « 115 obus pour blesser un homme au poignet »
101 : Noël 1915, ténor allemand dans sa tranchée (rappelle Joyeux Noël de Carion), français répondant par La Marseillaise
108 : Garde sape pour protéger les sapeurs
114 : Nous n’avons plu aucune vision d’une issue quelconque
117 : Apprend le 17 janvier 1915 la mort de Péguy
146 : Proposé sergent et pour une citation (p. 187), non obtenue à cause de la mort de son capitaine
155 : Retour des grues
Yann Prouillet, janvier 2026
Gargadennec Eugène (1896 – 1982)
Ma vie telle que je me souviens
1. Le témoin
Eugène Gargadennec est né dans une famille de pêcheurs de sardines à Tréboul (Douarnenez – Finistère). La famille est pauvre, la pêche irrégulière, mais avec sa mère ouvrière en conserverie, il dit ne pas avoir pas connu la faim dans son enfance. Mousse à 11 ans, il est pêcheur jusqu’à sa mobilisation en avril 1915. Il passe le conflit avec des affectations variées, essentiellement comme matelot canonnier. Après sa démobilisation, il multiplie les emplois à terre (ouvrier en région parisienne, travaux publics d’entretien des ports) et en mer (pêche), il terminera sa carrière comme patron de vedette de tourisme (île d’Yeu).
2. Le témoignage
Les Éditions Le Télégramme ont publié en 2003 Ma vie telle que je me souviens, les Mémoires d’Eugène Gargadennec, (148 pages). Les notes qui composent le manuscrit ont été rédigées entre 1965 et 1978. La période de la Grande Guerre va de la page 46 à la page 104.
3. Analyse
Le témoignage de notre marin se caractérise par la diversité des expériences vécues pendant le conflit. Classe 16, l’auteur est convoqué à Brest en avril 1915, « et le voilà marin de l’État». Il ne fait pas l’intégralité de ses classes, car à cause du nombre important de navires arrivant dans la rade, il est employé comme docker (p. 47, avec autorisation de citation): «On nous envoyait par équipe de jour et de nuit décharger les cargos. Blé, charbons, divers, de ce fait, je n’ai eu qu’une connaissance très sommaire sur le maniement du fusil. »
À bord du cuirassé Marseillaise
Il embarque en août 1915 comme apprenti-canonnier sur la Marseillaise. En arrivant, on lui montre dans un pont inférieur « les deux crocs où on devra crocher son hamac le soir et la case où on devait ramasser notre sac. » Lors du branle-bas (6 h 30, p. 49), « il y en avait toujours qui tiraient leur flemme, les quartiers-maîtres passaient sous les hamacs, et d’un coup d’épaule le flemmard était vite sur la cuirasse. » Il raconte la vie à bord, le charbonnage éreintant, toute une journée en équipe à la file, avec des briquettes de 12 kg, les difficultés à se laver ensuite. Les sorties à Brest sont possibles, mais les matelots sont désargentés : « quand on avait fait une petite tournée dans la rue de Siam et une petite bifurcation dans la rue Guyot, la paye du mois passait comme un feu de paille. » Ils appareillent en janvier 1916, faisant route à l’ouest par gros temps, et l’auteur signale que les malades sont majoritaires. À la recherche d’hypothétiques navires allemands, ils font escale aux Antilles, charbonnent en Jamaïque, puis vont mouiller à Saint-Domingue : une révolte est en cours dans la capitale, et des familles françaises viennent se réfugier quelques jours à bord. Le calme revenu, la Marseillaise revient à Brest en octobre 1916. Il est débarqué, étant en excédent à l’effectif, malgré le capitaine canonnier qui lui demande de rester, « je trouvais que je n’aurais eu de l’avancement de sitôt. »
Paquebot mixte Niagara
Le canonnier nouvellement breveté est embarqué sur le paquebot mixte Niagara, il s’agit de servir une des deux pièces de 90 mm du navire. Il y navigue de mars à juillet 1917; la paye n’est pas « bien forte », dit-il, mais hors la veille dans les zones dangereuse, il leur est « interdit de travailler. » Le Niagara va jusqu’au Venezuela où il commence à embarquer viande et café, puis refait la route des Antilles en chargeant des bananes. Il décrit une virée à terre à Colon (Panama) où il se taille un grand succès en interprétant une goualante célèbre (L’étoile d’amour) (p. 60) : « J’avais récolté 12 dollars, en ce temps-là, un dollar valait 5 francs. Nous étions en pompon rouge, cela faisait de l’effet. On avait vite fait des douze dollars pour les dépenser. Si les deux Nantaises nous ont fait monter le copain et moi gratuitement par commisération pour nous, les deux autres copains, les dollars en communauté, ils en ont profité. ». En mer, le danger est modéré, sauf à proximité des côtes françaises (p.62) : « Venant de dépasser l’île d’Oléron, nous étions arrivés par le travers de la Courbre, deux torpilles ont passé de justesse derrière nous, on les voyait venir de loin.» Ils sont plus tard canonnés par un sous-marin à trois jours de mer de l’embouchure de la Gironde, mais ils réussissent à le distancer.
Embarquements divers
Passé quartier-maître, il est mis à disposition de l’A.M.B.C. (armement des bateaux de commerce) à Calais. Il navigue sur le charbonnier Ville de Dunkerque, avec des rotations Cardiff et Hull, et le service est exigeant « ce n’était pas la bonne vie du Niagara ». Volontaire pour une place de chef de section pour la protection de la grande pêche (morutier), il relie en train Calais à Brest, improvisant une permission à Paris (sanction : 4 jours de prison et 8 points rouges sur son carnet), « Les petites midinettes m’ont apporté probablement beaucoup de chance par la suite, car mon pompon les attirait, et toutes voulaient le toucher. » Le soir, à Montparnasse, il rencontre une petite bonne bretonne (p. 68) : « Loin du pays où l’on se retrouve, on ose prendre plus de liberté. (…) On se quitte le matin, en jurant de ne rien dire au pays de la nuit mémorable. » Arrivé à ce moment du récit, E. Gargadennec signale que les dates commencent à s’estomper dans sa mémoire, son récit ne s’appuyant pas sur des carnets.
New-York – Savannah – Charleston
On déduit du récit que l’auteur est envoyé avec d’autres marins aux États-Unis pour former les équipages de grands voiliers qui reviendront en France avec des cargaisons de charbon. « L’ordre nous est venu d’embarquer le 23 mars 1918 sur un grand paquebot qui venait de débarquer 10 000 hommes de troupe à Brest. » Il commence par passer deux mois à Brooklyn en attendant que son voilier soit prêt à Savannah ; ils sont logés sur un bateau à deux étages à quai, c’est un dépôt de marins US où il découvre le self-service, où l’on mange debout ; il signale sa bonne vie (p. 72) « il arrivait tous les jours à bord plus d’invitations qu’on était de marins français. Les Américains faisaient un point d’honneur d’avoir deux, trois et plus de marins français quand ils avaient des invités en soirée. » Il a la chance d’être assez bon danseur (fox trot), « la danse, ça rentrait assez vite » Durant ces deux mois, c’est du manque de sommeil qu’il a le plus souffert, le réveil à bord étant fixé impérativement à 6 h 30. Il a un peu honte, au moment où il consigne ces aventures festives à New-York, en pensant aux malheureux soldats dans la tranchée, mais il ne se sent pas responsable (p. 71) : « J’ai demandé à être volontaire, j’ignorais alors comment je me serai trouvé par la suite. (…) j’ai passé deux mois de la sorte. Une chose que je n’oublierai pas. Nous étions demandés par les grands théâtres pour chanter La Marseillaise aux entractes, j’avais de la voix alors. »
L’ambiance change radicalement lorsqu’ils prennent en main à Savannah leur quatre-mâts goélette Ypres (équipage 22 hommes), il devient alors gabier et doit vaincre le vertige. Le voyage inaugural vers la France tourne rapidement à la catastrophe car, chargé de charbon, dans une mer très forte, « un mât libéré de ses haubans tribord se casse au ras du pont entraînant avec lui l’étai de tangage, et le mât d’artimon qui se casse à moitié. » L’ambiance n’est plus au fox-trot : « Le commandant fait monter l’équipage sur la dunette arrière et me dit de me préparer à tirer avec le canon sur l’étai de tangage pour faire tomber le troisième mât. [les coups de roulis menaçant la structure du bateau] ; 4 coups de canon sont tirés et finissent par atteindre leur but, puis il faut ensuite mettre de l’ordre dans l’enchevêtrement des espars et des débris sur le pont. Après quelques heures d’un travail dangereux (des barils ayant rompu leurs amarres passent et repassent rapidement…), le bateau n’est plus qu’une épave flottante. La TSF permet de prévenir un remorqueur, qui ramène le Ypres à Charleston. Ils y restent deux mois jusqu’en octobre 1918, le temps pour les charpentiers américains de réparer les mâts. On désigne l’auteur comme « quartier de commission » : se débrouillant en américain, il va faire les courses, et, invité par les fournisseurs, il fréquente les cinémas ; il mentionne également la ségrégation raciale. Le Ypres appareille enfin, et le 11 novembre 1918 le trouve dans la rade de Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada).
Police de la pêche
Revenu à Brest, notre marin est affecté sur un chalutier pris aux Russes (le T 35 qui devient le Commandant Vergognan), et le 1er janvier 1919, il appareille avec deux autres chalutiers armés pour Terre-Neuve, en mission de surveillance et de police des pêches. Son commandant qui l’apprécie essaie de le convaincre de rester dans la Marine : « à 33 ans, vous aurez 15 ans [de service] et je vous prédis que vous serez alors maître, vous pourrez si vous voulez prendre votre retraite et vous trouveriez dans le civil les meilleures places. » E. Guargadennec confie « qu’il a beaucoup regretté de n’avoir pas suivi ces conseils », car son itinéraire professionnel entre-deux guerres a été très difficile. Démobilisé le 21 novembre 1919, il conclut son évocation de la guerre en disant qu’il n’a jamais eu ni faim ni soif et que contrairement à la majorité des soldats, il n’a jamais été beaucoup en danger.
Voici donc un témoignage intéressant, bien qu’assez atypique, certes parce que les marins ne représentent qu’une minorité de l’ensemble des mobilisés, mais surtout en raison de l’originalité du parcours de l’auteur, au gré de ses aventures variées.
Vincent Suard, décembre 2025
Zeyssolff, Ferdinand (1899-1997)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Ferdinand Zeyssolff concerne les pages 185 à 194 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Ferdinand Zeyssolff naît à Gertwiller (Bas-Rhin) le 12 mai 1899. Incorporé dans l’artillerie lourde allemande en 1917, il dit avoir refusé d’être affecté sur le front de France. Il est affecté en Roumanie, occupée depuis 1916, puis est envoyé en Palestine pour combattre les anglais du général Allenby devant Jérusalem. Affecté à la mission militaire allemande auprès de l’armée turque de Liman von Sanders, il dit : « Une bonne entente régnait avec les Turcs. Ils se sentaient en sécurité en compagnie des soldats allemands » (p. 187). Mais, dans les vicissitudes de la Grande Guerre dans cette partie du monde, il décide, après le 28 février 1918, de déserter. Par chance, il est signalé comme prisonnier. Commence alors pour lui un incroyable voyage dans un monde en guerre, passant du front de Palestine, dans la région de Jéricho, dans le désert de Syrie, accompagné de mulets, dans lequel l’errance est aussi dure que dangereuse, assuré d’être fusillé s’il est repris. Le 19 septembre 1918, le front germano-turc s’effondre dans ce secteur. Chacun tente de rentrer par ses propres moyens par la Turquie, le sud de la Russie et la Roumanie. C’est la chance de Ferdinand Zeyssolff. En train, il arrive à Constantinople, prend un navire vers Odessa, qui prend feu, heureusement éteint par des marins expérimentés, le sauvant in extremis, et arrive sur les côtes russes en Ukraine, où la guerre entre les rouges et les blancs fait rage. Là il apprend la signature de l’Armistice. Il retrouve alors la Roumanie et finit enfin par gagner l’Alsace, par l’Allemagne du sud, achevant une épopée qui a tout d’une succession sans fin de miracles. Vigneron après-guerre, il meurt le 11 novembre 1997 à 98 ans.
Yann Prouillet, 28 juin 2025
Schwintner, Joseph (1897-1998)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Joseph Schwintner concerne les pages 25 à 36 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Joseph Schwintner est né à Wackenbach, hameau de la commune de Schirmeck (Bas-Rhin), le 8 février 1897. Comme Léon Nonnenmacher, il est incorporé dans l’infanterie allemande le 8 septembre 1915 à l’âge de 17 ans, dans un bataillon de travailleurs. De fait il n’est pas encore militaire mais porte l’uniforme d’auxiliaire de l’armée. Il arrive dans la zone du front à Thorn, alors en Pologne prussienne. Il y découvre les Jakobsbaraken. Sa tâche consiste à étayer les tranchées creusées par les « polaks » en Russie, puis en France. Rapidement, au bout de 15 jours, il est affecté au 402e IR. Il vit en mars 1917 l’ordre n°1, promulgué par le Soviet et décrit l’anarchie russe qui s’en suit. L’armistice de Brest-Litovsk le ramène en France, à Metz, avant sa montée sur le front au Chemin des Dames puis en Flandre. Il est alors rapidement transféré à Ypres, en Belgique avant d’être redirigé sur Arras. Il est désigné pour servir d’ordonnance, « brosseur du lieutenant », qu’il assimile à un travail de domestique. Cet officier, par chance, parle le français couramment. Ce poste ne le libère pas complètement des attaques et il se retrouve servant de mitrailleuse. C’est à ce poste qu’il vit ses heures les plus dangereuses. Miraculeusement, il parvient à échapper à la mort (« la guerre, une absurde histoire de hasard » (p. 31)) et met en place une stratégie d’évitement. Il dit n’avoir pas « songé sérieusement à déserter » car « avec les Sénégalais [présents en face de son secteur] nous pensions que c’était risqué » (p. 32), même si beaucoup de camarades alsaciens l’ont fait quant à eux. Il finit par arriver « sans casse » jusqu’aux derniers jours de la guerre, dont il voit le délitement de l‘armée et la dégradation des officiers. Il se démobilise lui-même et rentre enfin dans la vallée de la Bruche retrouver son foyer. Bûcheron et scieur, il reprend son métier et décède à Schirmeck (Bas-Rhin) le 14 mars 1998 à l’âge de 101 ans.
Yann Prouillet, 28 juin 2025
Nonnenmacher, Léon (1896-1998)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Léon Nonnenmacher concerne les pages 63 à 69 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Léon Nonnenmacher est né à Lixheim en Moselle le 3 janvier 1896. Posté dans le grenier de la maison familiale à Sarrebourg pour guetter l’arrivée des français, il a 18 ans quand il assiste à l’offensive en Moselle le 18 août 1914, qui lui laisse une forte impression. Il dit : « Au bout de quelques heures, des milliers de corps jonchent la campagne. Massacrés à la mitrailleuse ou au canon de 75 ou de 77, ces jeunes gens enthousiastes on perdu la vie sans même s’en rendre compte, tombés pour cette terre de Lorraine que la plupart ne connaissaient que par les leçons des instituteurs » (p. 64) avant d’aller ramasser les blessés et enterrer les morts sur le champ de bataille. Ses parents sont emmenés comme otages ; sa mère est emprisonnée puis rendue à la Moselle un an plus tard, passée par la Suisse, alors que son père est interné toute la guerre, travaillant dans un port de près de Nice. Orphelin, seul avec son frère dans la famille à Sarrebourg, il est incorporé dans l’infanterie allemande en Russie. Brest-Litvosk survenu, il apprend qu’il va être transféré sur le front Ouest, en France. Il dit sur la désertion des Alsaciens : « La perspective de tomber entre les mains des Français leur paraît bien plus réjouissante que celle de croupir dans un camp sibérien » mais le commandement est clair : « Si on en prend un qui essaie de se débiner, il sera immédiatement fusillé » (p. 67-68). Sa présence au front français correspond à des secteurs calmes, jusqu’à l’Armistice, jusqu’à son retour en Moselle, redevenue française. Exerçant la profession de tailleur, il meurt à Sarrebourg le 29 octobre 1998.
Yann Prouillet, 28 juin 2025
Némery, Léon (1899-1995)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Léon Némery concerne les pages 123 à 131 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Léon Némery naît à Sedan (Ardennes) le 7 mai 1899 dans une famille de cinq enfants. Son père et son frère tiennent un petit magasin de coiffure. Il est un enfant moyen, qui ira à l’école jusqu’à 13 ans. Il vit rapidement l’occupation de sa ville. Sans s’étaler sur le moyen d’y parvenir, il raconte avoir passé en zone française pour finir par s’engager en juillet 1915; il a alors 16 ans, en mentant sur son âge, avec la volonté de « tuer des boches » (p. 126). Il est alors incorporé au 54e RI en juillet 1915. Manifestement de constitution frêle, il dit : « On m’a classé comme élève caporal ; pourtant, je n’étais pas bon en gymnastique, ni en tir. J’étais un type ordinaire, tout simple » (p. 127). D’abord affecté dans un secteur calme, il fait l’Yser et le Chemin des Dames. Mais c’est dans l’Oise qu’il reçoit une grave blessure, en 1918, par balle à la cuisse. Etant originaire des « pays envahis », il dit avoir bénéficié d’un traitement de faveur. Il est assez sobre sur la réalité de sa campagne. Après l’Armistice, son régiment entre Alsace et a la fierté d’avoir été choisi pour défiler à Paris le 14 juillet 1919, ce car il mesure 1,74 mètres, les candidats retenus devant faire entre 170 et 174 cm. Manifestement impressionné par cet épisode, il en dit : « Sur les Champs-Elysées, les gens étaient partout : dans les arbres, aux balcons… A certains endroits, on nous a lancé de l’argent. Nous n’avons pas eu le droit de le ramasser, mais les officiers avaient des pièces qui s’étaient logées dans leurs manches, qu’ils ont partagées avec nous. » (p. 130). Epicier puis ouvrier après-guerre, il raconte enfin avoir été fait prisonnier en juin 1940, mais qu’il est parvenu à s’évader en sautant d’un train en marche pour éviter la captivité. Il décède à Andlau, dans le Bas-Rhin, le 23 décembre 1995.
Yann Prouillet, 28 juin 2025
Mater, Gabriel (1897-1998)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Gabriel Mater concerne les pages 107 à 122 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Gabriel Mater naît à Anthelupt en Meurthe-et-Moselle le 6 juin 1897. Il apprend la mobilisation générale dans l’Impartial de l’Est, il a 17 ans. Il enfourche son vélo et fonce à la frontière pour « voir ce qu’il se passait. Il ne s’y passe rien, puisque le gouvernement français a ordonné à ses troupes de reculer de dix kilomètres pour bien montrer au monde qu’il ne serait pas l’agresseur » (p. 109). Les Allemands arrivent dans le village le 22 août 1914, entraînant la fuite de la famille. Mais il est dépassé par la vague du front mouvant et retourne chez lui en plein combat. « Pour gagner de l’argent, je me suis mis à ramasser les douilles, celles de nos canons de 75 et des 77 allemands (celles de 75 m’étaient rachetées 2 francs pièce, c’était beaucoup pour l’époque) » (p. 112). Il parvient ainsi à se faire 2 000 francs de cuivre. A 18 ans, en juin 1915 , il passe le conseil de révision et est déclaré apte pour l’infanterie mais il choisit finalement de s’engager en Afrique, dans l’artillerie. Il passe un an à « regarder les saisons » ! (p. 113) à Hussein-Dey, près d‘Alger. Là il y retrouve des jeunes de son âge, déportés là à la suite de l’offensive allemande en Lorraine de 1914, et qui comme lui se sont engagés dans l’artillerie. Il rappelle à cette occasion : « Pour leur éviter le sort des traitres et des déserteurs, et leur garantir le statut de prisonnier de guerre en cas de capture par les Allemands, leur état-civil est modifié. « Sur leur livret, on inscrivait « natif de… (quelque part en France) » mais on les versait seulement dans l’artillerie. Là, il n’y avait pas beaucoup de risque d’être fait prisonnier » (p. 114). En janvier 1917, il passe au 54e RA où il est occupé à dresser des chevaux canadiens. Il est nommé brigadier et rejoint le front des Vosges, à Pierre-Percée (Meurthe-et-Moselle) où il découvre sans la comprendre la « Reboursite », accord tacite de limitation de l’emploi de l’artillerie hors des zones de front effectif et donc épargnant les localités (p. 115). En novembre, il est déplacé sur le front de la Somme puis presqu’aussitôt en Italie, à l’issue de la défaite de Caporetto. Il y tombe malade et connait là-bas l’Armistice du 4 novembre. Il part alors pour Salonique, au 140e RI, pour liquider les biens de la cuisine et les stocks. Il est enfin démobilisé à l’été 1919 et reprend sa vie à la ferme. Il décède à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) le 16 février 1998 à l’âge de 99 ans.
Yann Prouillet, 28 juin 2025
Masson, Edmond (1894-1999)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Edmond Masson concerne les pages 93 à 105 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Edmond Masson est né à Neuchâtel en Suisse le 11 janvier 1894 mais il conserve la nationalité française. Il est issu d’une famille de huit enfants, dont un frère cadet disparait à Verdun le 24 juin 1916 et habite rue des Remparts à Pontarlier, en Franche-Comté. Sa préparation militaire lui fait acquérir les grades de caporal puis de sergent et la guerre vient le chercher alors qu’il est ouvrier dans une usine automobile. Sergent au 171e RI incorporé en septembre 1914. Il arrive en janvier 1915 dans les tranchées de la Woëvre, près de Verdun. Il est blessé par éclatement de grenade le 6 mai 1916 à la ferme de Navarin, en Champagne, en posant des défenses accessoires en avant d’un petit-poste. Il est cité à l’ordre de la brigade pour cet acte. Il participe à l’offensive du Chemin des Dames où il est blessé une seconde fois, par éclat d’obus, puis par une grenade lancée par l’allemand qui le fait prisonnier. Miraculé des combats, il manque d’être assassiné par un soldat par un soldat brutal. Il dit que sa captivité, dans deux camps, près de la frontière belge et le long de la mer du Nord, ne l’a pas traumatisé. Il y a même appris l’allemand, initiative qui lui permet de devenir interprète. Le soldat Masson est toujours en Allemagne aux derniers de novembre, quand éclate la Révolution ; il dit sur ces jours surréalistes : « Les Allemands sont des organisateurs. Ils organisent même la révolution ! » (p. 104). Edmond Masson revient à Pontarlier en janvier 1919 via un port d’Allemagne du Nord puis Cherbourg. Cheminot après-guerre, membre de plusieurs associations d’anciens combattants, il décède à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne le 28 août 1999 à l’âge de 105 ans.
Yann Prouillet, 28 juin 2025
Masson, Albert (1897-1999)
Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Albert Masson concerne les pages 79 à 93 de l’ouvrage.
Eléments biographiques :
Albert Masson, né à Hagéville en (Meurthe-et-Moselle) le 18 février 1897, est incorporé dans les chasseurs alpins sur le front ouest et en Orient. Il est ouvrier boulanger près de Verdun en 1913 et patron par intérim à la déclaration de guerre, poursuivant son métier jusqu’à son incorporation, le 12 janvier 1916 au 19e BCP, comme chasseur de 2e classe. Il monte en ligne près de Châlons-sur-Marne puis participe à l’offensive de la Somme, où il est blessé. Il revient au front pour la terrible offensive Nivelle sur le Chemin-des-Dames. Son frère y est tué et lui blessé à la main le même jour. Revenu sur le front dans le Nord, il répond positivement à un appel à volontaire pour Salonique, qu’il rejoint finalement, au camp de Zeitenlik. En avril 1918, son bataillon traverse la Grèce pour monter en ligne à Monastir, en Macédoine, face aux Allemands et aux Bulgares, dont il dit qu’ils « étaient des assassins (…) ils achevaient les blessés » (p. 86). Le 6 août 1918, il reçoit une balle dans la tête, deuxième blessure, finalement peu grave, qui le tient éloigné du front pendant quelque semaines. Il rejoint son bataillon en septembre et constate la déliquescence du front alentour alors que, blessé de la tête, il est quelque peu « préservé » par ses supérieurs. La guerre terminée, il est employé à la boulangerie militaire de Zagreb et finit par rentrer en France en août 1919 ; « Cela faisait cinq ans que je n’avais pas vu ma mère » (p. 91). Gardant sa profession de boulanger après-guerre, il décède à Metz (Moselle) le 18 février 1999 à l’âge de 102 ans.
Yann Prouillet, 28 juin 2025