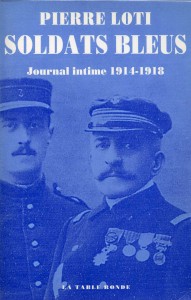Le témoignage
Le général René Agis Pichot-Duclos (9 mai 1874 – Fort d’Aubervillers (93) – 18 janvier 1968 – Biviers (38)), d’un père officier, présente dans ce fort volume les souvenirs des deux grands temps forts de sa vie militaire, de sa formation (enfance, écoles, premier régiment, Ecole de Guerre, états-majors et temps de commandements) à son affectation au 3e Bureau du GQG de Joffre, ce jusqu’à la fin de l’année 1915. Il y rapporte et dépeint son action comme les dessous du commandement des grandes unités au cours des différentes phases de la guerre jusqu’à son affectation, à la toute fin de 1915, au commandement du 11e BCA (qu’il commandera effectivement du 10 février au 26 octobre 1916). Par ses yeux et son esprit incisif, on entre dans l’intimité des états-majors et il n’élude rien des personnalités, innombrables, qu’il côtoie, parfois juge et critique ou encense avec une liberté de ton indéniable et directe. Très en lien avec les états-majors des grandes unités qui combattent à l’Est sur la ligne de feu, il renseigne très largement sur les actions de commandement et d’organisation des secteurs dirigés par le général Dubail et ses subordonnés dont on retrouve la liste dans une imposante table des noms cités (près de 700 noms) qui témoigne à elle seule de l’intérêt documentaire des souvenirs de ce lien entre le haut commandement et la guerre appliquée sur les différents théâtres d’opérations. L’ouvrage regorge ainsi d’anecdotes ou de chapitres qui partent dans une infinité de directions tant sur la formation militaire que sur différents aspects qu’il touche au fur et à mesure des activités d’analyse et de lien avec l’état-major de Joffre, fournissant ainsi un regard précieux du début de la guerre à toute l’année 1915. Ainsi, il évoque pêlemêle sa genèse d’une vocation aéronautique, les analyses des offensives de 1914 (La Marne et ensuite), l’adaptation à une guerre longue après le rétablissement de septembre, le GAE et les grandes attaques sur les Vosges, les études, recherches, travaux et réalisations, comme ses réflexions, sur de nombreux sujets divers, y compris sur certains fronts extérieurs.
Général Pichot-Duclos, Réflexions sur ma vie militaire. Au G.Q.G. de Joffre. Souvenirs, Paris, Arthaud, 1947, 399 pages.
Commentaires sur l’ouvrage :
Très autocentré bien entendu et donnant le plus souvent la part analytique la plus profonde et effective à ses actions et analyses, ce témoignage, qui allie en effet souvenirs (dont il dit, page 99 « les présents souvenirs sont écrits sans consultation d’une seule note pour l’excellente raison que je n’en ai pris au cours de ma vie que pendant les dix-huit mois vécus au GQG. ») et réflexions, en forme d’autobiographie sur le temps long de sa formation, écrit après la 2e Guerre mondiale, dont il fait parfois, voire souvent référence, est précieux car profond et précis. Eludant peu de noms, y compris sur l’ensemble de sa période très observatrice et rédactionnelle au GQG, il s’érige en témoignage incontournable pour toute étude concernant le haut commandement, son fonctionnement, les hommes qui le composent, concourant à la petite comme à la grande Histoire. Ce fort volume est un livre de souvenirs très documenté et le plus souvent très opportun pour qui veut connaître le « dessous des cartes » de l’Etat-Major de Joffre pour toute la période 1914 et 1915, surtout à l’Est. Il est en effet plus spécialement affecté à la liaison avec la 1ère armée de Dubail, abondamment cité, et dont on peut facilement dégager un portrait. Il y démontre l’extraordinaire complexité de la gestion d’une guerre moderne, avec son infinité d’hommes et de paramètres à prendre en compte. Le livre est également référentiel sur le haut commandement du front des Vosges pour la période du 6 septembre 1914 à décembre 1915. Il l’est aussi en filigrane sur l’aviation de la période 1913-1915, l’auteur ayant occupé une position en lien avec l’organisation de l’arme aérienne militaire et ayant profité de sa fonction à l’entrée de guerre pour tenter de passer le brevet de pilote. Il serait intéressant d’en dégager l’ensemble des passages et de les comparer avec son ouvrage.
L’ouvrage n’est pas iconographié mais comporte quelques cartes, contient très peu d’erreurs et est agrémenté d’une table patronymique et toponymique.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Plusieurs tableaux intéressants dans de nombreux emplois divers dans lequel l’auteur a eu une action, soit en formation, soit comme « observateur », soit dans les prises de décision de commandement ou de critique de celui-ci.
Extrait utile de la table des matières :
Formation : Enfance et écoles, mon premier régiment : Sous-lieutenant (76e RI) à Paris, lieutenant à Orléans, l’Ecole de guerre : chefs, professeurs, choix d’un Etat-major, Etats-majors et temps de commandement : Lyon, ; Grenoble, crises et troubles (dont vinicole), commandant de compagnie alpine (5e Cie du 158e à Lyon), grandes manœuvres (1909).
La Grande Guerre vue du GQG : Avant-guerre et début de l’aviation militaire, à Nancy (garnisons de Nancy et Toul), Genèse d’une vocation aérienne et section d’aéronautique du ministère, direction, organisation à la veille de la guerre
Entrée en campagne : certitude et préparatifs, couverture, appel du 3e bureau et ses conséquences, son rôle avant et après La Marne, exécution du Plan XVII à la 1re Armée, réhabilitation de l’offensive, Dubail et son Etat-major, contrôle parlementaire, l’épreuve de la 2e armée, plans consécutifs à La Marne.
Stabilisation progressive du Groupes des armées de l’Est
Front de Woëvre, officiers de liaison, coup d’œil sur la 4e armée, front mouvant des Vosges en 1914, déplacement présidentiel, front de Lorraine, Rocques et Dubail ; reconstitution et emploi des réserves, opérations sous bois, note du 16 avril 1915 et ses applications, second déplacement présidentiel, offensives des Vosges, Maud’huy, assauts du Linge, Hartmannswillerkopf, mort de Serret, « les cas » Sarrail et Schérer, mutations des grands chefs.
Pendant la stabilisation, études, recherches, travaux et réalisations : unités au repos, reconstitution et instruction, utilisation des ressources et places, recherche et expérimentation de matériels nouveaux, guerre des mines et des gaz, questions de 2e Bureau, rédaction de règlements et codification des enseignements tactiques, enseignements et réflexions tirés de la bataille de Champagne, mesures prises en vue de l’hiver, nuages sur Verdun, conduite progressive de la guerre, un match au sujet d’Alexandrette, l’intervention bulgare, les Dardanelles et Salonique et ses difficulté de commandement, velléités roumaines et plan d’opérations, mainmise de Joffre sur le théâtre balkanique, conférences interalliées et leur préparation, choix d’un adjoint, les distractions de Chantilly et Départ.
Annexe : Voyage dans les Vosges les 10 (Gérardmer), 11 (Epinal, Saint-Amarin, Moosch) et 12 février (Belfort) 1915.
Notes de lecture
Page 14 : Général (non cité) enterré avec son épée
32 : Galon d’Anspessoir (1re classe) donné aux 75 premiers au classement fait à Pâques
33 : Chien vert : dans l’argot de Saint-Cyr, nom donné au Sergent-major
56 : Les premiers 75 distribués en unités circulant en ville recouvert d’une housse sombre pour dissimuler son frein et sa hausse indépendante
83 : Vue des Gros Frères, les Cuirassiers
89 : Sur le système de fortification d’Epinal, réponse à la question
106 : Sur la guerre en montagne
122 : Bruit de la balle, « méthode de calcul des distances basée sur le phénomène de claquement que produisent les balles pendant qu’elles parcourent certaines parties de leur trajectoire »
140 : Sur Andlauer (vap 318)
: Réquisition des véhicules
141 : Lit du général Bailloud placé face à l’Est à Nancy
: Plan des mots de passe à Nancy
153 : Mort d’Edouard de Niéport, dit Nieuport par accident d’avion à Verdun
154 : Ecrit (en 1912 alors qu’il était capitaine) Les Reconnaissances en aéroplane, publié par Imhaus et Chapelot, éléments et chiffres de tirage et de ventes.
173 : Epuration du commandement (vap 206 et 334)
177 : Nombre d’escadrilles en août 14 ; 22 + 3 récupérables
178 : GQG restreint : Pichot-Duclos, Lt-col Buat, Brecard, col Paquette
181 : Habite 7 rue Valentin Haüy le 4 août 14
: Sur le retrait des 10 km
: Foch, 20e Corps (Nancy), Legrand-Girarde, 21e Corps (Rambervillers), leur personnalité dans leur bureau, trajet, temps et conducteurs (Boileau et Rigal, pilotes de course Paris-Belfort)
183 : Sur la rumeur de tranchées allemandes creuses dès le temps de paix en Lorraine
184 : Joffre dit : « J’aime mieux faire commander des divisions par des capitaines que de les laisser aux mains de gens incapables de les conduire ».
: Les stratèges sont les officiers qui ont fait une troisième année à l’Ecole de Guerre
: Veut profiter de sa position pour passer le brevet de pilote ; il dit « le mauvais départ de notre organisation d’aviation, la peine qu’elle avait à se militariser ».
187 : De Goÿs, chargé d’organiser l’aviation turque (en fait avril 1914 par Hirschauer, inspecteur de l’aéronautique militaire)
: Il précise son poste et sa réaffectation après La Marne
189 : Comment l’EM fonctionne à Vitry-le-François
190 : Opinion de Joffre le 6 septembre 1914 dans une école de Bar-sur-Aube : « … dans huit jours nous serons à genoux ! »
: Colonel Pont, chef du 3e Bureau
: Recul prévu un temps jusqu’au… Morvan, opiné par le Général Belin
194 : La Woëvre est censée envahie par la boue (colonel Poindron), mais les Allemands arrivent jusqu’à Saint-Mihiel
196 : (Note) Sur les inconvénients de la carte au 200 000e en deux couleurs, sans nivellement ni zone boisée
199 : Général Bastidon a fait une étude sur la bataille de Sarrebourg à Domptail
201 : Sur le rôle majeur mais sous-évalué de la forêt de Haye (vap 202)
202 : Dubail amputé (d’un pied en mars 1896 à la suite d’une chute de cheval)
203 : Son action sur les conseils de guerre spéciaux (vap 206 son Etat-major) et leur devenir
207 : Sur Saconney qui adapte le Drachen, de meilleure stabilité
22 : Raison du débarquement de Messimy (affaire du 15ème Corps) et devenir (fin 213)
216 : Renseignement récupéré à Coinches sur le moral allemand
226 : Nombre de coups par pièces et par calibres (155 et 120)
: Incident d’Apremont
228 : Sur les officiers de liaison, rôle, contact avec Joffre
233 : Général Gérard menteur, enquête de Pichot-Duclos (mais résultat non dit)
238 : « Le goût de la pioche n’était pas assez répandu dans l’infanterie qui avait en général trop compté sur le génie pour faire les travaux ; seul le colonel Barrard du 91ème s’était constitué une section de pionniers ; exemple à suivre ».
: Organisation du front d’Argonne chiffrée par compagnies d’une division
239 : Garibaldiens, valeur
241 : Front des Vosges
242 : Général Bolgert insuffisant pour « une région où le commandement à la fois compartimenté et distendu par le terrain devait être entre les mains de chefs susceptibles d’autonomie »
243 : Secteur du HWK et Serret
245 : Description du front des Vosges par Dubail : « Les Vosges ne sont pas un pays de montagne, mais un pays coupé et couverte. Sauf exceptions motivées par des vues particulièrement étendues ou intéressantes, les postes n’y sont pas faits pour garder du terrain, mais pour garder des gros »
: Belfort et le Général Thévenet
246 : Voyage de Poincaré dans les Vosges et en Alsace (vap annexe p. 376 à 380)
247 : Tardieu puis de Pierrefeu historiographes officiels des 3 premiers mois de guerre
249 : Poincaré ostensiblement non reconnu par une infirmière alsacienne
: Comment on choisit une infirmière religieuse alsacienne à décorer
251 : Front de Lorraine
258 : Utilise Minenwerfer au lieu de crapouillot
264 : « La crainte de Limoges » influe sur les chefs, et le pourquoi
: Observatoires dans les arbres
268 : Difficulté du combat sous bois et le pourquoi
: Sur les formules creuses des jusqu’auboutistes et qui ils sont
271 : Visite de Poincaré, donner l’illusion de la 1ère ligne et visite dans les Vosges, organisation en partie par Pichot-Duclos
273 : Sur la bataille des Hautes-Vosges de Pouydraguin
274 : Sur l’intervention du pouvoir civil
275 : Sur la mystique
286 : Sur ce qu’est la guerre dans les Vosges, concept de la guerre de montagne
: Sur la mort de Serret, utilisée de manière propagandiste par les Allemands
292 : Sur les chicanes dans les réseaux de fils de fer barbelés
297 : Territoriaux tarés
298 : « On gaspille les projectiles allongés de 90 et de 155 qui sont très précieux pour l’artillerie, en les faisant jeter par les avions ; les aviateurs ne veulent pas les lâcher parce qu’ils se sont entraînés au tir avec ces projectiles ».
: Sur les fusées
: Sur les sections de réparation auto de Lunéville « mal dirigée »
304 : « Je n’admet pas qu’un chef considère que son supérieur n’a pas le droit de lui faire une observation » dit le général Dubail
: Liquidation des places fortes, décret du 5 août 1915
306 : 730 infirmiers à Verdun
307 : Sur le Chauchat, l’histoire de sa mise au point et signification de CSRG (page 309) : Chauchat (colonel d’artillerie), Sutter (officier d’artillerie), Rybeyrol (ingénieur civil), Gladiator (du nom d’une fabrique de bicyclette).
310 : La boue et les armes
: Obus D, portée
313 : Sur le carnet d’explosion de la guerre des mines
314 : Klaksons + clairon + feux puis sirènes électriques pour l’alerte aux gaz et inconvénients divers de son audition
316 : Sur la méconnaissance de l’anglais chez les officiers
318 : Sur les Alsaciens, leur mentalité, leur surveillance
323 : Bruit du canon et compétence des troupes à les identifier
330 : Attaque et calendrier, l’amiral Amet dit : « Avant de fixer la date de vos attaques, que vous faites tomber aux équinoxes, regardez donc que diable votre calendrier ».
331 : Batterie de catapultes vosgiennes à deux pièces et description
332 : Bombes Save utilisée en forêt d’Apremont, à la « Tête de vache », à raison de 175 par jour, arrêtant des travaux de mines allemands (photo existante par aiilleurs)
333 : Charbon de bois fabriqué en forêt de Commercy par les Morvandiaux, utilisé en 1re ligne
: Mort du général Benzino, attribué aux renseignements des Services Spéciaux écoutant les communications allemands
334 : « Nettoyage des cadres »
: Sur les aménagements de tranchées et cantonnements par les généraux (cf. Lebocq pour le Bois-le-Prêtre)
336 : Eléments recueillis sur la préparation de Verdun par les Allemands d’après un renseignement fourni par des … religieuses + destructions de clochers
337 : 2 000 F. donnés pour monter une fanfare par le général Renouard
: Sur l’abus de vin distribué… aux habitants ; 720 litres par familles, qui les revendent aux militaires « pour le plus grand dam de l’hygiène ; de la discipline et de la bourse de ces derniers »
345 : Sur l’échec du débarquement en baie de Suwla (Dardanelles) « qui n’échoua que par l’inconscience tactique absolue des exécutants » (par des troupes) « plus sportives que militaires (qui) prirent d’abord des bains de mer et ne se mirent en marche pour occuper les hauteurs dominantes qu’après avoir laissé aux Turcs le temps de s’y incruster, de recevoir de l’aide et enfin d’ouvrir un feu suffisamment ajusté pour nécessiter l’organisation d’une attaque en règle, de sorte que l’insuccès de cette dernière entraîna l’échec définitif de l’opération »
346 : Sur l’enseigne de Vaisseau Simon, rescapé du Bouvet (coulé par une mine le 18 mars 1915) et qui échappa à Mers-el-Kébir comme capitaine de Frégate, commandant en Second du Dunkerque en 1940
351 : Atlas Stieler et Vidal-Lablache
362 : Idée de déposer par avion des troupes derrières les lignes ennemies
: Sur Saconney et cerfs-volants
: Sur la même invasion en cheminant par les mines s’étendant sous les lignes allemandes, « plan de termites » abandonné car jugé impossible à réaliser
: Sur un débarquement par les côtes par les canaux par bateaux à fond plat
363 : Sur l’invasion par la Suisse (dossier H) et troupes concentrées à Belfort en lien avec ce plan
372 : Comment on décide d’une décoration belge
373 : Sur l’idée d’instaurer la polygamie pour pallier au manque d’hommes
374 : Il passe au 11e BCP (en fait BCA) (il commandera aussi le 363ème RI (cité p. 255)
376 : Vue de Gérardmer, la Schlucht, l’Altenberg avec Poincaré, échanges sur la prospérité des Vosges et plans pour elles, l’Alsace et la Lorraine après la guerre le 10 février 1915
377 : Visite d’Epinal
378 : Hansi présenté au général Mauger
: Vue de Bussang (11 février 1915)
379 : Méthode Berlitz à l’école alsacienne
: Enfants allemands invités à garder leur langue aussi après la guerre
380 : Pains K et KK
Yann Prouillet, juillet 2023