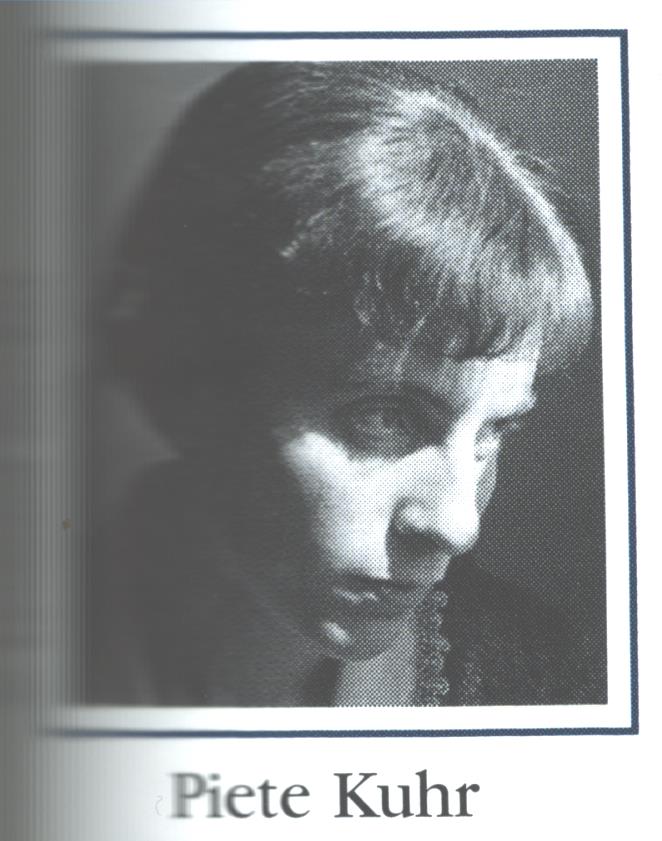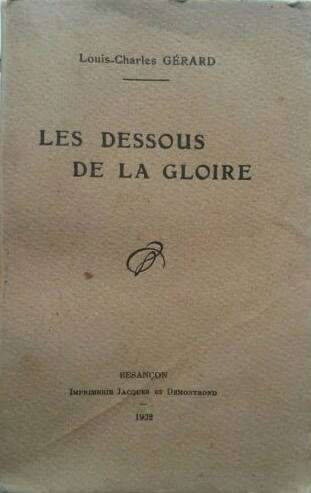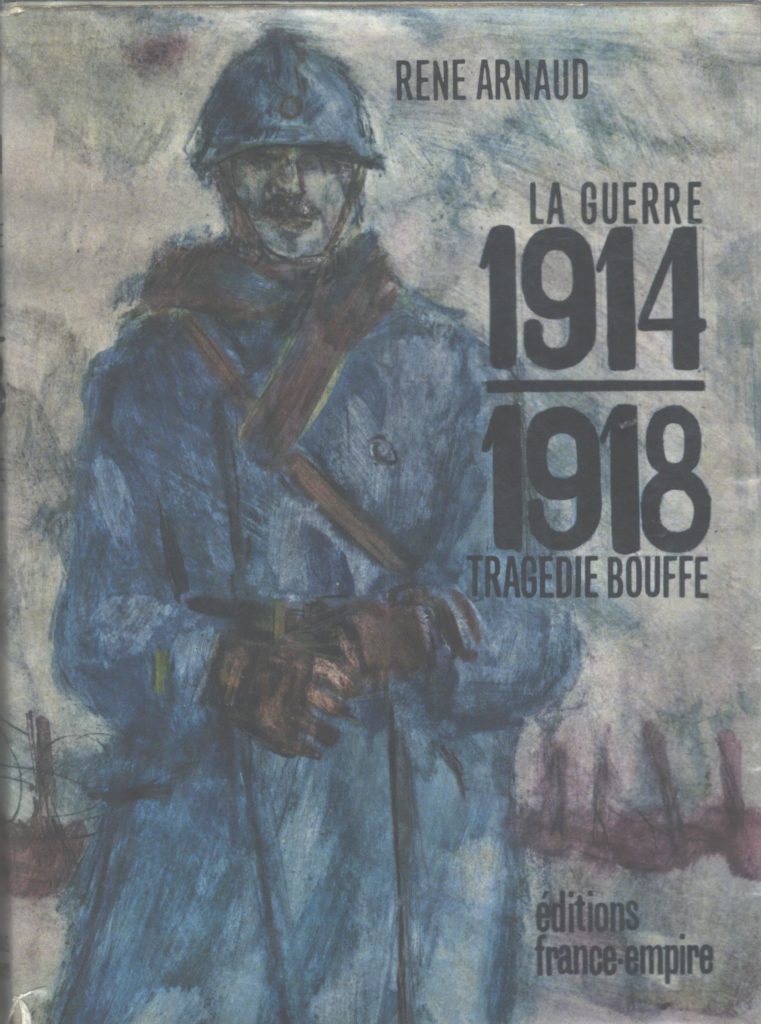1. Le témoin
Né le 1er février 1882 à Taugon (Charente inférieure) dans une famille de cultivateurs propriétaires. François Hippolyte Benéteau réside en 1914 dans ce même village charentais où il reprend l’activité d’agriculteur. Il effectue ses classes au 18e RI en tant que tambour en novembre 1903, puis mis à la disponibilité du 123e RI de La Rochelle où il effectue deux périodes d’exercices en 1909 et 1913. Il entame une correspondance avec sa famille très fournie dès les premiers jours de la mobilisation générale en août 1914. Agé de 32 ans, 4 enfants, il incorpore le 138e RIT de La Rochelle avant d’être désigné quelques mois plus tard pour rejoindre le 167e RI. Ce témoignage permet de suivre son parcours de territorial puis dans l’active. Parcours qui le conduira jusqu’au front dans le secteur du Bois Le Prêtre.
2. Le témoignage
La correspondance entre François Hippolyte Benéteau et sa famille est regroupée dans livre ce épistolaire de 152 pages paru aux éditions Edhisto en avril 2022. Les 90 lettres du poilu couvrent la période d’août 1914 à avril 1915 et s’articule autour de 5 axes : l’attente, le casernement, les premières tranchées, les derniers jours, les recherches post mortem.
3. Analyse
Le 16 août 1914, les trois bataillons du 138e Régiment d’Infanterie Territoriale) quittent La Rochelle. Le régiment cantonne du 17 août au 13 septembre à Marigny-les-Usages, dans le Loiret, pour sécuriser les villes, porter assistance aux blessés, surveiller les gares. François Hippolyte Benéteau est spectateur indirect de la première bataille de la Marne quand il rend compte à sa femme de ce qu’il voit, ce qu’il entend. En effet, devant l’avancée allemande, la population parisienne, traumatisée par le siège de 1870, fuit la capitale par centaines de milliers. « Il y avait des femmes, des enfants de tous âges qui ne marchaient pas encore. Seuls, ils ont couché dehors et le matin ils tremblaient. Aucun endroit pour les loger, il faut le voir pour le croire » (p. 18).
Le 13 septembre, son bataillon quitte le cantonnement Loirétain pour rejoindre la caserne Excelmans de Bar-le-Duc (Meuse), garnison du 94ème RI mais qui participe à la première bataille de la Marne. François Hippolyte Benéteau exprime sa confiance en l’avenir ; il pense que la guerre sera courte et que la victoire sera proche. Il est affecté le plus souvent à la surveillance de la gare, des hôpitaux et parfois à l’assainissement du champ de bataille sur les communes de Laimont et de Villers-aux-Vents. Tenant à être mis au courant de l’avancée des travaux de la ferme, il questionne régulièrement son épouse à ce sujet. Il souhaite également être averti des blessés, des morts qui sont annoncés dans le village de Taugon. La vie de cantonnement se prolonge, occasionnant parfois un sentiment de lassitude ; il va régulièrement à la messe, dont celle que Mgr Charles Ginisty organise le 19 novembre 1914 à l’église Notre-Dame à Bar-le-Duc.
Le 21 novembre 1914, le bataillon de François Hippolyte Benéteau fournit un contingent de trois cents hommes au dépôt du 167e régiment d’infanterie. Il part le jour même pour Toul et y intègre la 5ème compagnie, 2ème bataillon. Sa confiance s’amenuise et n’imagine pas rentrer pour la naissance de son cinquième enfant fin décembre ; « il faut s’attendre que ce soit très long. Et au moment où tu me parles, c’est presque sûr que je ne serai pas présent » (p. 58). Son entrainement a repris, plus intense avec des manœuvres, des exercices. Il continu a jouer son rôle de territorial dans les gares, décharger les péniches qui arrivent par le canal et qui transportent les cailloux de consolidation des voies de chemin de fer pour le front. Plus proche de la zone de combats, il entend le canon, voit affluer plus de blessés, de malades. Fin décembre, il pense être protégé par la naissance de son cinquième enfant, et ne pense pas être désigné pour partir dans les tranchées. Il y échappe une première fois mais le 12 février 1915, il est informé de son départ imminent : « J’étais parti à mon ouvrage comme d’habitude ce matin. Mais l’on est venu me chercher en disant que je partais avec ceux qui étaient désignés. » (p. 92).
Le 15 février 1915, après avoir reçu son écusson du 167e RI d’active et habillé de neuf, il rejoint Jezainville au sein de sa section à trois kilomètres de la zone de combats du Bois Le Prêtre. Il exprime dans ses lettres la peur de mourir mais aussi l’espoir de revenir. « Chère femme, si par malheur Dieu voulait nous séparer pour toujours, souviens-toi de moi » (p. 93). Le courrier à des difficultés à parvenir ce qui ajoute à ses craintes. Il prie, se donne force et courage pour affronter ce qui lui semble inéluctable. Du 8 au 17 mars 1915, le bataillon de François Hippolyte Benéteau quitte Jezainville pour relever le 5ème bataillon du 346e au Bois Le Prêtre. Ce sera pour lui sa première expérience de tranchées. Il décrit les scènes de combats, avec la neige, le froid, qui surprennent les soldats. A chaque attaque, il entend les coups de fusils, les obus qui passent sur sa tête, la terre qui vole partout, les blessés à côté de lui. Il raconte notamment la journée du 15 mars : « A huit heures du matin, les Allemands ont fait sauter plusieurs tranchées et aussitôt la fusillade a commencé. Toute la journée sans desserrer ; il y avait du danger partout en première ligne comme en deuxième ou en troisième. C’était tout pareil. Les balles, les obus, les grenades et les torpilles pleuvaient. Les arbres sont d’une bonne épaisseur dans ce bois là et bien souvent les obus Allemands tombaient en plein dedans. D’une grosseur d’une brassée, ça les coupait en deux ». De retour en cantonnement le 18 mars 1915, il continu a écrire, rendant compte a son épouse des combats. Il rend grâce à Dieu, participe aux messes et se rend sur la tombe de ses compagnons. La peur de mourir est là. Dans sa dernière lettre datée du 30 mars 1915, François Hippolyte Benéteau est de nouveau dans le Bois-le-Prêtre aux abords de la tranchée de Fey. Il sera mortellement blessé au combat du 30 mars ou du 1er avril. Identifié par les soins de l’officier gestionnaire de l’ambulance 3/64 (ambulance 64 du 13e corps rattaché provisoirement à Avrainville). Il est inhumé fosse numéro sept au Gros-Chêne le 20 avril 1915 et le 20 novembre 1920, son corps sera transféré à la nécropole nationale du Pétant près de Montauville.
William Benéteau – Yann Prouillet
Mirabaud-Thorens, Henriette (1881-1943)
Fille du médecin Henri Thorens. Famille protestante des Vosges. Mariée en 1903 avec le banquier Robert Mirabaud. Après la guerre de 14-18, elle préside avec son mari la Société de secours fraternel de Gérardmer qui vient en aide aux familles vosgiennes éprouvées par la guerre. Traductrice de divers auteurs, notamment Emerson et Rabîndramâth Tagore, prix Nobel de littérature. Elle a publié deux volumes de témoignages sur la guerre : Journal d’une civile, en 1917, et En marge de la guerre en 1920, les deux chez le même éditeur, Émile-Paul frères à Paris. Une réédition des deux est envisagée par Edhisto. Je ne peux faire ici que l’analyse du premier titre, acheté chez un bouquiniste. Il est publié avec seulement pour nom d’auteur les initiales H. R. M. La présentation dit que le livre a été victime « des mutilations de la censure, qui ont fait disparaitre d’intéressantes critiques ». Espérons qu’elles pourront être rétablies.
Milieu social
Le texte se présente comme un journal tenu régulièrement du dimanche 26 juillet 1914 (« dans les Vosges ») au vendredi 2 juillet 1915. Le témoignage est sincère (en tenant compte de la crédulité de la narratrice) et de lecture facile. Bien entendu il est marqué par le milieu social d’Henriette : ses fréquentations (des officiers, une marquise, une princesse qui trouve que « le service est plus que défectueux, en ce temps où il n’y a plus de domestiques nulle part », p. 85), ses loisirs (« un bridge de guerre, dont nous étions un peu honteux », p. 87). Même sentiment pour évoquer une « journée mondaine » qui suit l’enterrement de deux soldats (p. 249). Phrase intéressante, p. 70 : « Les enfants, le peuple, ont besoin d’être trompés pour avoir du courage. Pour nous, nous devons en avoir en regardant les réalités en face ! »
Patriotisme
Le 1er août, jour de l’annonce de la mobilisation générale, Henriette écrit : « Si l’on frissonne en pensant aux deuils prochains, on vibre aussi, en imaginant la joie de tant de cœurs alsaciens, quand nos trois couleurs passeront les Vosges… » Elle se réjouit à l’annonce du ralliement des socialistes à l’Union sacrée (« Hervé voulait s’engager », p. 13). Le 9 août, elle décrit des scènes d’enthousiasme et évoque Déroulède (mais elle a aussi noté le ridicule de Hansi « se baladant en pioupiou français », p. 13). Des lettres reçues disent la vaillance du peuple de Paris (p. 27). Les Allemands sont lâches et repoussants ; des Bavarois ont été fusillés par des Prussiens ; « on ne dit que la moitié des atrocités allemandes » (p. 100). Le portrait des Allemands est cependant nuancé ; des actes de bonté sont signalés (p. 103 et autres). Mais « le pauvre curé de la Bourgonce avait mille deux cents bouteilles dans sa cave : il n’en reste plus ! » (p. 108). Quant au pape, il est accusé (p. 330) de soutenir l’Autriche et l’Allemagne.
Rumeurs
« Des bruits divers circulent : Metz et Strasbourg brûleraient. La révolution agiterait l’Allemagne » (2 août). Ce sont les Allemands qui ont fait assassiner Jaurès (p. 13). Une femme aurait raconté à un officier français que « son fils, âgé de sept ans, n’ayant pas voulu donner sa tartine, fut tué d’un coup de sabre » (30 août). Sur plusieurs pages (250, 253, 257, 264, 326, 335) des témoins prétendent avoir vu des enfants aux mains coupées et autres atrocités. Dès les premiers jours, les Français auraient remporté des succès écrasants ; les Russes marcheraient sur Berlin. Parfois elle précise (p. 67) : « Je répète ce que j’entends ! » Un caporal de chasseurs alpins décrit des massacres à la baïonnette (p. 113). En secteur tenu par les Anglais, « à l’heure du thé, les tranchées restent vides » (p. 182) ; comique involontaire ici, mais que Goscinny a repris dans Astérix chez les Bretons ! Quant au commandant F., il a chargé à la baïonnette à la tête de ses hommes et tué de sa main huit Allemands (p. 222).
Espionnite
Dès le 4 août il est question d’espions allemands. Le 30 août, Henriette retranscrit une information venant d’un ami officier : les Allemands sont « renseignés par un espionnage admirable fonctionnant dans nos lignes mêmes, au moyen de téléphones souterrains ». Le 25 septembre, il s’agit d’espions « déguisés en prêtres et en ambulanciers ». Le 27, on aurait fusillé trois espions dont une femme. Le 25 octobre, c’est une femme qui a installé un téléphone dans les W.C. et « un autre truc d’espionnage consiste à faire varier la couleur d’une fumée de ferme : grise, bleue, jaunâtre, blanche. Chaque teinte a une signification. » D’autres espionnes encore le 6 mars 1915.
Opinions politiques et autres
La comtesse de P. lui a décrit « nos gouvernants [qui] actuellement font la fête à Bordeaux où ils ont fait venir leurs maitresses » (p. 104). Antiparlementarisme (« la retraite des quinze mille », allusion au chiffre de l’indemnité des députés, p. 105), mais pas antisémitisme (les Juifs aussi donnent leur vie pour la patrie, p. 102). Henriette pense que le féminisme a fait fausse route (p. 70) : « Nous nous sommes occupés d’antialcoolisme, de socialisme, de féminisme, de syndicalisme, de coopératisme, etc.. Nous cherchions l’esprit de justice. C’était bien, mais ce n’était pas l’essentiel. Il fallait faire du patriotisme. » Et plus loin (p. 260) : « Mes sentiments féministes reçoivent de rudes atteintes ! » Et les « grands précurseurs du pacifisme » nous ont fait beaucoup de mal (p. 209).
Une certaine évolution
Dans sa sincérité spontanée, Henriette est bien obligée de tenir compte aussi de notes discordantes. Elle a des doutes sur l’avance des Russes (28 octobre). Un ami officier signale l’état d’esprit déplorable dans les dépôts où « chacun cherche à exagérer ses incapacités » pour ne pas partir (17 novembre). Le 10 janvier 1915, elle nous dit qu’elle demeure patriote mais que la guerre est une chose « effroyable », tandis que certains industriels « gagnent beaucoup sur la fourniture des munitions ». À Annonay, il y a des Alsaciens qui se comportent mal et qui refusent de s’engager et même de travailler (p. 276 et 289). Des femmes d’Aubenas, « de petite condition », sont heureuses d’avoir leur mari sur le front car, en indemnité, « elles touchent une somme rondelette », tandis que « le mari ne va pas boire au cabaret » (p. 286).
Le Midi
Le 9 novembre 1914, Henriette a déjà évoqué les Méridionaux en citant une lettre d’un ami officier : « Les populations du Midi qu’épargne la guerre auraient grand besoin d’être éduquées par la souffrance. On les sent molles et égoïstes. » À partir de mai 1915, elle entreprend un voyage vers le Sud pour rendre visite aux Alsaciens réfugiés : Lyon, Annonay, Tournon, Privas, Aubenas, Alès… Elle n’aime pas Nîmes (16 mai) : « Beaucoup de monde dans les rues. Du monde prétentieux, et vêtu à la mode d’il y a cent ans. Les voix sont criardes, les robes de couleurs voyantes. Beaucoup de soldats errent par les rues. Visiblement, ils ne sont pas allés au feu […] Ils semblent très satisfaits d’eux-mêmes. » Les réfugiés sont plus ou moins bien accueillis. Ils font baisser les salaires (p. 300). Si Nîmes est laide, Montpellier est pire (p. 303) ; l’hôtel est « de goût fort boche » ; « les cafés pullulent de soldats ». Si Béziers a bien traité les réfugiés, Narbonne est si laide que mieux vaut n’en point parler. Perpignan est bien, mais Madame E. affirme qu’on y voit « quatre ou cinq duels au couteau par semaine ». Henriette aperçoit le Canigou, elle passe à Prades, Carcassonne, Villefranche-de-Lauragais, et retourne à Paris.
Finalement, si sa crédulité est compréhensible – qui rappelle celle de François Blayac, voir ce nom – que dire des bobards contenus dans les lettres qu’elle reçoit de ses amis officiers ?
Dans En marge de la guerre, Henriette Mirabaud-Thorens, bourgeoise parisienne, protestante, féministe d’origine alsacienne possédant une villa à Gérardmer dans les Vosges poursuit ses souvenirs (la période du 26 juillet 1914 au 2 juillet 1915 a été publiée dans l’ouvrage Journal d’une civile, publié aux mêmes éditions en 1917) couvrant la période du 5 juillet 1915 au 30 décembre 1917. L’auteure, très active dans l’aide médicale et philanthropique des poilus poursuit son journal après avoir quitté la cité vosgienne depuis la Suisse puis Paris, où elle côtoie le monde artistique et mondain, puis en faisant quelques retours dans les Vosges. Elle y poursuit sa description d’une petite ville d’arrière-front avec sa sensibilité alsacienne protestante.
Analyse
Deuxième volume du plus important témoin publié de la cité géromoise, ce témoignage d’une bourgeoise active – elle a 5 filleuls de guerre (p. 105) et fait de la photo (p. 295) -, idéalement placée dans l’intelligentsia locale et connectée largement avec les milieux militaires, médicaux et philanthropiques, – elle a également des envolées politiques (p. 228) – en fait un témoin de première importance, notamment sur le paradigme des Alsaciens. Bien entendu, elle rapporte, parfois en toute connaissance de fausseté, les ragots et rumeurs de la guerre mais ceux-ci ne lui sont pas servis par les journaux, mais par son entourage, hétéroclite. De très nombreux éléments sont à dégager et de différents ordres. Un témoignage (presque) complet (il manque l’année 1918) qui mériterait une réédition.
Renseignements tirés de l’ouvrage
Page 12 : Succès de la Fontenelle appris le 27 juillet
13 : Lits démontable des ambulances alpines
14 : Suisse entendant le canon de Verdun
22 : Sur un foyer du soldat refusé à Wesserling par Serret
23 : Sur la guerre manquant au soldat permissionnaire : « Assis pensivement sur les bancs, ils semblaient… s’ennuyer un peu, bien que poliment, sans vouloir le montrer. On sentait que leur âme était ailleurs. La guerre, cela excite, cela agite ; c’est l’imprévu, c’est l’inconnu… Je comprends mieux, depuis que je les ai vus, leurs joyeux retours au front. »
24 : Colis non reçus par les prisonniers
: Marquise conduisant des véhicules à la Croix rouge (fin 28)
25 : Extrait d’un carnet d’un soldat de la Chipotte, abbé Collé ?
28 : Tirs sur des cigognes !
: Lutte contre les alambics par Ribot
32 : Vue de Paris, où le noir est à la mode
33 : Vue du dépôt des éclopés des Champs-Elysées
34 : Retour à Gérardmer, le 10 septembre 1915, trajet, voyage avec Hansi : « … toujours le même, avec son allure de bon géant, taciturne et dégingandé. Mais le pioupiou de 1914 est aujourd’hui sous-lieutenant et décoré. »
35 : « Cela « sent le front » Ceux qui n’y ont jamais été ne peuvent comprendre ce que c’est : mélange d’attente d’angoisse, de vie intense et de mort ». Description de sa villa.
36 : Aviatik descendu au Saut des Cuves
: Rumeur que les Alpins ne font plus de prisonniers
: « Lorrain, vilain ; traître à Dieu et à son prochain » !
37 : Spectacle de la guerre
39 : Général Maud’huy, aimé de ses hommes et le pourquoi
: Promesse de récompense de 20 francs pour l’arrivée au sommet du HWK, qui coûte à un officier 1600 francs
41 : Pouydraguin (vap 79)
42 : « Le pessimisme pour un civil, c’est la désertion pour le militaire »
45 : Orphelines fabriquant des masques à gaz
46 : Rencontre une survivante du Lusitania
49 : Foyer du Gaschney fermé à cause d’un Suisse
54 : Gâchis au front
57 : Artistes camoufleurs, dont Flameng, faux ?
58 : Prophétie d’avant-guerre
62 : Visite de Polybe, Barrès, Rostand, Haraucourt et Daudet.
63 : Mauvais traitement des civils alsaciens (vap 269, 66 le contraire)
: Maquette au cimetière d’un monument aux morts
64 : Anecdote sur un filleul de guerre
70 : Voyant un fumiste mutilé de guerre (borgne), réflexion sur le changement social de la guerre
71 : Joffre à Gérardmer « incognito » !
: Pathéphone
74 : Accident de tramway au Hohneck
75 : Soldat regardant sa femme et sa fille en zone envahie près de Cirey
77 : Grand froid
: Exécution d’un espion
79 : Description de Villaret, Pouydraguin
80 : Anecdote sur l’occupation de Saint-Dié
: Anecdote sur l’alcool
84 : Tardival, couteau de tranchée donné aux Alpins
: Sur les soldats à Paris « trop gâtés »
85 : Sur la capture du 152ème au HWK
86 : Sur les prisonniers de l’ile de Croix, allemands et alsaciens
87 : « J’aurai ou la médaille militaire ou un petit jardin sur le ventre »
89 : Explosion d’un train de munition à Dollwiller
: Espionnite, homme badigeonné de citron pour révéler de l’encre sympathique sur son corps
94 : Récit de la bataille du HWK
97 : Sur les lumières de Paris
101 : Livres français envoyés dans les camps par la société Franklin
102 : Zeppelins sur Paris, ambiance
: Prix pour la capture d’un espion, 3 000 F.
103 : Vue de Jérôme Tharaud, mariage, sa femme
104 : Vue de Barrès et madame
105 : Espionnite à Paris et à Nancy
112 : « Rencontré trois permissionnaires, probablement fraîchement débarqués du train, qui regardaient… on aurait pu croire des magasins d’articles de Paris, des fleurs, etc., non, ils étaient en contemplation devant… des couronnes mortuaires. Ces hommes qui vivent en face de la mort, sont attirés par ce qui la rappelle ».
114 : Phrase attribuée au Kayser : « Si jamais vous reprenez l’Alsace, vous la reprendrez chauve. »
115 : Bruits de Révolution en Suisse, affaire des colonels (vap 116)
116 : Rumeur d’achat d’enfants par les Allemands
117 : Problème médical après le HWK
122 : « Marie me damne », code pour Dannemarie
: Chiffres et statistiques sur les prisonniers
123 : Cite Altiar (une femme, vap 130, 176, 261)
125 : Victime (à Paris) de l’explosion de l’usine de grenades de La Courneuve
129 : Drame populaire intitulé « La Défense de Schirmeck » de Bruno, maire du XVIème arrondissement et professeur à La Sorbonne
130 : Poincaré, nouveaux obus au cyanure de potassium « pouvant tuer instantanément des milliers d’hommes à la fois »
134 : Vue de Mme Péguy, Ferry
135 : Vue de Mme Jules Ferry
138 : « A Mulhouse, on va embrasser les éclats d’obus français qui y tombent !»
: « Je voudrais être une punaise écrasée par les glorieuses bottes de nos poilus »
141 : Vue de Gide
145 : Sur Pétain, qui « saute à la corde tous les matins » (vap 216)
146 : 3 femmes, 3 lumières, espionnite !
150 : Anecdote de la capture de l’ambulance de Perrin en août 14, mais inexactitude (fin 151)
151 : Coterie bourgeoise, princesses, comtesse, etc. et Colette ex-Willy
152 : Usine de brome
: Vue de Mme Brandès aidant des aveugles
154 : Sur la censure touchant la citation d’un fils d’Alfred Dreyfus, infamie ! (vap 265, anecdote)
156 : Boy scouts défilants
177 : Surnoms de tanks anglais, qu’elle appelle « automobiles anglaises blindées qui sautent, sans roues, par-dessus tout », appelées « baleine, requin, limace ». Commentaires sur.
182 : Ambiance et description sociales de Paris, militaires et ouvriers, état d’esprit, mode
184 : « On dit que les Allemands ont choisi pour le rapatriement des prisonniers en Suisse des repris de justice et autres échantillons de ce genre afin que les Français fassent mauvaise impression chez les neutres ».
188 : A son petit musée à la villa, abondé par des militaires en visite
189 : Sur l’assassinat de prisonniers
195 : « Pour le 1er janvier on offrira aux amis un sac de charbon, si l’on en trouve, en guise de sacs de chocolat »
200 : Sur l’alcool au front
204 : Sur les 5 coups de canon de Belfort annonçant la guerre
206 : Subterfuge pour envoyer de la poudre de chocolat à Mulhouse
208 : Œuf dito ?
211 : L’internationalisation de la guerre par l’uniforme
212 : Sarrail épouse Oki (pour Octavie) de Joannis, qui fut infirmière à Gérardmer : « Cette alliance du protestantisme le plus sévère avec l’agnosticisme le plus complet me trouble. Trente printemps alliés à soixante-quatre hivers, c’est amusant. »
217 : Description au 2ème degré de l’horreur des grenades incendiaires
219 : Rumeur d’évacuation de Mulhouse
220 : Barrès à Verdun… pour aller chercher une poupée d’une orpheline de guerre
221 : Sur la TSF et la Tour Eiffel
223 : Sur les champs magnétiques déviant les balles !
227 : Lassitude d’écriture
232 : Long récit sur la fuite de Serbie par les montagnes (fin 255)
249 : Le devenir des Serbes, sont étudiants en France
250 : Colonie pénitentiaire de La Grande Chartreuse pour les délinquants serbes
261 : Indiscipline (mutinerie) à Laveline-devant-Bruyères en juin 1917 : « A Laveline, des officiers ont été sifflés et obligés de se cacher »
: Contact, Allemands bien renseignés, messages lancés par arbalète
263 : Sur sa 1ère parution
264 : Pierres jetées sur un cercueil protestant
267 : Prévision de fin de guerre par un abbé
271 : Contrefeu à l’indiscipline
272 : Consommation d’alcool (vap 279)
275 : Nancy ville morte
276 : Avion français descendu par des Français
: Sur les surintendantes d’usine, femmes à poigne pour gérer les ouvrières femmes
281 : Joute sportive sur le terrain de Ramberchamp (qui leur appartient ?) (vap 295)
283 : Traitement des Kabyles
286 : Vue intéressante d’une scierie canadienne à Martimprey (vap 292, 302, 307)
288 : Vue de Dieterlen (vap 301, 309, 318)
: Vue d’une mission chinoise
289 : Allemands déserteurs
291 : Pétition d’Alsaciens
293 : Visite de Poincaré, Pétain, le roi d’Italie (vap 301)
295 : Faux prisonniers allemands jouant une attaque
296 : Madelon
299 : Pourquoi on met les Américains dans les Vosges, pour les éloigner des Anglais !
306 : Vue du cimetière de Gérardmer
307 : Ambrine contre les brûlures
308 : Vue de l’ouverture du foyer du soldat de La Poste
312 : Tonkinois et Cochinchinois
313 : Epopée d’un Alsacien déserteur
317 : Récriminations contre les grévistes
322 : Noël 17, distribution chaotique de cadeaux aux poilus, contenus des colis. Puis arbre de Noël aux enfants
Rémy Cazals et Yann Prouillet, mai 2021
Lanois, Lucien (1891-1980)
Né le 14 août 1891 à Villeroy-sur-Méholle (Meuse). Sa famille tient un café-tabac-épicerie dans le village. Il fait de bonnes études primaires et, au « certif », il est classé 1er du canton, comme Louis Barthas. Comme lui encore, Lucien Lanois reste artisan, menuisier, puis cultivateur. Il passe toute sa vie à Villeroy, en dehors de son long service militaire. En effet, entré au 155e RI à Commercy en 1911, dans le cadre de la loi des 2 ans votée en 1905 à l’initiative de Jaurès, il doit effectuer une année de plus à cause de la loi des 3 ans. Le 30 juillet 1914, il écrit à ses parents : « Malgré tout la classe vient et dans une cinquantaine de jours je serai de retour avec vous. » Ce sera dans une cinquantaine de mois. Il est donc resté plus de sept ans sous les drapeaux.
Baptême du feu le 21 août, il s’en tire « sans une écorchure », mais il est blessé au pied le 6 septembre 1914 ; la balle de shrapnel n’est extraite que le 20 octobre. Dans la deuxième quinzaine de novembre, sa famille reçoit des autorités militaires l’annonce de son décès. Heureusement, Lucien n’avait pas cessé d’écrire depuis l’hôpital de Moulins. Suit une période de soins, de convalescences. En septembre 1915, il est classé inapte à retourner au front et remplit diverses tâches à l’arrière, par exemple matelassier ou gardien de prisonniers. En avril 1916, il est « récupéré » comme ravitailleur au 25e d’artillerie et participe à l’offensive de la Somme. Dans l’Aisne en avril 1917, puis en Meurthe-et-Moselle. Il connaît également une longue période dans les Vosges de juin 17 à février 18 avant d’être à nouveau hospitalisé en août.
Le témoignage qu’il a laissé est énorme, un « hyper-témoignage » dit Yann Prouillet, comme celui de Gaston Mourlot que sa maison d’édition, Edhisto, a déjà publié en 2012 : La Grande Guerre d’un « récupéré », Journal et correspondances de Lucien Lanois de 1914 à 1918, présentés par Gisèle Lanois, Senones, Edhisto, 2020, 635 pages, 362 illustrations, 2 millions de signes. La correspondance occupe les pages 14 à 466. Elle comprend 317 lettres de Lucien et 257 cartes postales marquées de la date de son passage et de sa signature, parfois plus précisément personnalisées par une croix de situation ou par un bref commentaire. Sur certaines légendes de cartes, la censure avait noirci les noms des villages ; Lucien les a rajoutés de sa main. Le livre compte aussi 163 lettres reçues par le soldat. Celui-ci, en 1976, âgé de 85 ans, a rédigé un récit à partir de ses carnets de guerre (qu’il a ensuite détruits) et de sa correspondance. Le texte des cahiers occupe les pages 469 à 621 du livre.
L’appareil critique comprend une présentation par sa petite-fille Gisèle qui explique comment elle a rassemblé les documents que Lucien avait distribués à ses enfants et petits-enfants ; une chronologie précise de la guerre de Lucien ; un index des noms de lieux ; un glossaire iconographique. Comment Yann Prouillet réussit-il à abattre une telle besogne de recherche, composition, relecture, diffusion ? Je pense que l’expression sportive « mouiller le maillot » doit être ici retenue. Comment réussit-il à vendre un tel monument au prix unitaire de seulement 29 euros ?
Une suggestion : achetez et faites acheter ce livre par les bibliothèques.
Rémy Cazals, mars 2021.
Kuhr, Piete (1902-1989)
1. Le témoin
Elfriede Alice « Piete » Kuhr est née le 25 avril 1902 à Schneidemühl, ancienne capitale de la Prusse-Occidentale, aujourd’hui Piła en Pologne. Sa mère, qu’elle vénère, dirigeant une école de chant à Berlin, distante de près de 300 kilomètres, Piete vit chez sa grand-mère avec Willi-Gunther, qu’elle surnomme Gil, son grand frère de 15 ans, qui deviendra apparemment aviateur en 1918. Rien n’est dit d’un père. De son témoignage transpire son statut social, manifestement aisé. Grandissant, en 1918, elle travaille dans un foyer pour enfants de sa ville où elle deviendra soignante. En 1920, elle rejoint sa mère à Berlin puis devient danseuse. En 1927, elle épouse un célèbre acteur juif, Léonard Steckel, avec lequel elle aura une fille, Anja. Après l’accession au pouvoir d’Hitler, un officier SS lui conseille de quitter le pays. Elle abandonne le « Quartier rouge » de Berlin pour la Suisse où, fidèle aux propensions qu’elle a nourri dans son adolescence, et qui transpirent de son journal de guerre, elle consacre son temps aux réfugiés. Une pathologie cardiaque met fin à sa carrière de danseuse ; elle se consacre à l’écriture jusqu’à sa mort le 29 mars 1989 à Seehaupt en Bavière.
2. Le témoignage
Le journal de guerre de Piete Kuhr est publié, pages 19 à 68, dans Filipovic, Zlata et Challenger Mélanie, Paroles d’enfants dans la guerre, Paris, XO éditions, 2006, 455 pages.
Piete débute son journal de guerre le 1er août 1914 sur les conseils de sa mère : « Elle pense que çà m’intéressera quand je serai grande. C’est vrai » (p. 23). Elle y décrit tout à la fois son environnement, la vie de la petite ville de Schneidemühl en y ajoutant son état d’esprit, volontiers frondeur, et ses sentiments quant à la vie qu’elle mène, maintenant profondément bouleversée par la guerre. Pourtant, celle-ci dure et pèse sur le moral de l’adolescente à tel point qu’elle déclare, le 1er septembre 1916 : « J’arrête mon journal de guerre. Je ne peux plus continuer. Cette guerre ne finira jamais. Je ne vais pas continuer à écrire jusqu’à ce que mes cheveux aient blanchi » (p. 57). Heureusement, malgré un cafard grandissant, elle le poursuit toutefois mais de façon plus épisodique ; en effet, on trouve 20 dates pour 1914, 4 pour 1915, 6 pour 1916, 5 pour 1917 et 5 pour 1918. Pourtant, malgré la ténuité de son écriture, de nombreux renseignements d’ambiance et psychologiques peuvent être dégagés de son journal d’une adolescente en Prusse-Occidentale.
3. Analyse
Piete décrit d’emblée une ville pavoisée de « drapeaux à toutes les fenêtres » (p. 24) alors même que l’Allemagne n’a pas encore déclaré la guerre. Elle tente de comprendre les raisons de cette folie qui gronde et fait montre d’un bon sens enfantin. Très vite, elle affiche une adhésion militariste ; elle dit : « J’étais furieuse de n’avoir que douze ans et de ne pas être un homme. A quoi sert un enfant, pendant une guerre ? A rien. Il faut être soldat. La plupart des hommes s’engagent volontairement » (p. 26). Elle y revient à plusieurs reprises dans un premier temps. Alors qu’elle ravitaille des soldats en partance pour le front, elle dit : « Je me prenais pour un soldat dont on s’occupait bien, et j’étais très heureuse » (p. 31) souhaitant abandonner l’insouciance de son enfance : « … je ne joue plus à la poupée. C’est si petit des poupées… Elles n’ont rien à faire dans une guerre. – Tu voudrais jouer à quoi, alors ? – Aux soldats, j’ai répondu » [à Greta, sa bonne] (p. 49). Le 4 août elle décrit longuement le départ du régiment de la ville (le 149. I.R.), avec ses hommes décorés. Elle dit : « Tous les soldats portaient des guirlandes de fleurs des champs autour du cou ou sur la poitrine. D’immenses bouquets de marguerites, comme s’ils pensaient abattre leurs ennemis avec des fleurs » mais immédiatement, elle note que « Leurs visages étaient graves. Je m’attendais à les voir rire et plaisanter » (p. 29). Plus loin, elle ajoute encore alors que les troupes venues de tous les horizons défilent dans la petite capitale : « Les soldats et les réservistes rient et chantent. Ils saluent joyeusement en arrivant, puis en partant » (p. 31). Sus à l’ennemi ; un chant en démontre la différence de traitement : « Que chaque Prussien tue un Russe. Que chaque Allemand rosse un Français. Et les Serbes auront ce qu’ils méritent. Que les démons soient serbes ou russes, nous les écraserons » (p. 32). C’est bientôt (6 août) le temps des premiers bourrages de crânes sur les Russes, menés au front à coups de fouet et déjà en famine, ou les premières victoires, telle celle de Liège annoncée le 7 alors que le dernier fort de la ville ne tombera que 9 jours plus tard. Cette partie de la Prusse étant majoritairement composée de polonais, divisés entre Russie et Allemagne, l’armée les recrute par voie d’affiches : « Polonais, soulevez-vous et engagez-vous avec le respecté gouvernement allemand » (p. 35). Pourtant aux derniers jours d’août, Piete assiste à l’arrivée des premiers réfugiés venant de la Prusse orientale (p. 40). Elle y décrit aussi l’antisémitisme, exacerbé, et rapporte entendre « Profiteurs de guerre ! » dès le 7 septembre (p. 43). Hélas, les journaux publient les noms des premiers morts parmi les soldats qui appellent leurs soldbuch, (quelle désigne « carte d’identité militaire »), « ticket pour la mort ». Piete y a peur d’y trouver des noms connus et déjà elle dit : « La guerre aurait vraiment mieux fait de finir » (p. 36). Les premiers blessés affluent en effet dans la ville, qu’elle décrit. Puis, malgré la distance, elle dit : « Les combats font rage sur le front de l’Est, tout le long des quatre cents kilomètres de la ligne. En étant immobile, et très attentif, on sent la terre trembler légèrement sous nos pieds » (p. 40). Par les écoles, elle participe à l’effort de guerre par le tricotage (chaussettes, écharpes, bonnets, mitaines, gants et oreillettes) pour les soldats, plus tard, ce sera par d’incessantes quêtes et récoltes. Elle décrit : « Tous les jours, on nous répète : « Chaque pfennig pour les soldats ». Mamie dit que je vais la ruiner, avec les quêtes de l’école. Maintenant, il y a une grande Croix de fer en bois accrochée au mur de l’école et nous devons y planter mille clous en fer. Quand ils seront tous cloués, ce sera vraiment une Croix de fer. On peut en planter autant que l’on veut. Les clous valent cinq pfennigs pièce, ceux en argent dix. Jusqu’à maintenant, j’en ai planté deux en fer et un en argent. Ça fait une distraction. L’argent récolté est consacré à l’effort de guerre » (p. 47). Plus loin, à la demande de l’Etat, le 11 mars 1915, de collecter des métaux, cuivre, fer, plomb, zinc, bronze et vieux fer, elle pille à nouveau la maison grand-parentale pour participer à la compétition des classes. Elle fait un état des lieux : « J’ai retourné la vieille maison de fond en comble. (…) J’ai pris des vieux couverts, cuillers, fourchettes et couteaux, des brocs, des bouilloires, un plateau, une coupe en cuivre, deux lampes en bronze, de vieilles boucles de ceinture et plein d’autres choses », allant même jusqu’à fondre elle-même ses soldats de plomb (pp. 53-54). L’ambiance en ville, entre réfugiés et trains de combattants, amène des scènes de folies, civile comme militaire (pp. 41 et 42), puis les premiers morts prisonniers et espions exécutés (p. 44). D’ailleurs, un terrain appartenant à sa famille jouxtant le cimetière devient celui des prisonniers russes décédés. Suit maintenant la mort d’un ami, le premier qui tombe au front, fils d’une conseillère municipale, puis de l’un des élèves de sa mère, le ténor Dahlke, tué à Maubeuge. Ce décès affecte cette dernière qui, dès lors, reproche à la jeune diariste le contenu de son journal et lui prescrit : « … tu devrais considérer la guerre sous un jour plus héroïque. Une vision trop terre à terre brouille la grandeur des événements. Ne te laisse pas envahir par une sotte sentimentalité… » (p. 46) alors que ses écrits reflètent bien ce qu’elle constate et son chagrin, jusqu’au blasphème. Elle dit à ce sujet : « Mamie prie Dieu pour qu’il le protège [Paul Dreier]. Si Dieu exauçait toutes nos prières, aucun soldat ne mourrait. Mais il ne les entend même pas. Le tonnerre des fusils a dû le rendre sourd comme un pot » (p. 49). Lentement s’insinue le cafard et le 31 décembre 1914, elle dit : « Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec les soldats ? Pourquoi je ne suis pas morte ? Çà sert à quoi, que je vive encore cette vie ? Elle ne m’a jamais donné aucun plaisir ; d’abord l’école, et maintenant la guerre. Je le pense vraiment, je ne peux pas écrire autre chose ; je ne peux pas, maman, tu m’entends ? Et je ne le ferai pas. Elle est comme çà, notre vie et si je devais la raconter autrement, je dirai des mensonges. Je préfèrerais encore ne plus rien écrire du tout » (p. 52). Le 25 avril 1916, elle dit : « Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. J’ai quatorze ans ! Je ne sais toujours pas exactement ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, dans cette guerre. Je me réjouis de nos victoires et je suis hors de moi en pensant aux morts et aux blessés. Hier, j’ai entendu dire qu’il y a un hôpital caché dans la forêt, où vivent des soldats qui ont le visage arraché. Ils doivent être si effrayants que les gens normaux ne peuvent pas les regarder. Des choses comme çà me plongent dans le désespoir » (p. 56). Le 29 novembre 1918, elle termine son journal allégoriquement en rendant visite au cimetière des prisonniers du camp de Scheidemühl et dit enfin : « Dans la mort, on pourrait dire que tous les hommes ressemblent aux autres » (p. 67).
L’ouvrage se poursuit par la reproduction du journal de Nina Kosterina (Russie), Inge Polak, (Autriche et Royaume-Uni), Gunner W.-G. Wilson (Nouvelle-Zélande et Egypte), Hans Stauder (Allemagne), Sheila Allan (Australie et Singapour), Stanley Hayami (Etats-Unis), Yitskhok Rudashevski (Lituanie) et Clara Schwarz (Pologne) pour la Seconde Guerre mondiale. Ed Blanco (Etats-Unis) pour la guerre du Vietnam. Zlata Filipovic (Bosnie-Herzégovine) pour la guerre des Balkans. Shiran Zelikovitch (Israël) et Mary Masrieh Hazboun (Palestine) pour la deuxième Intifada. Et enfin Hoda Thamir Jehad (Irak) pour la guerre d’Irak.
Un cahier photographique central illustre ces témoins, dont Piete Kuhr.
Son témoignage a été utilisé dans une série dramatique diffusée en 2014 : 14 – Des armes et des mots — Wikipédia (wikipedia.org)
Renseignements complémentaires relevés dans l’ouvrage :
(Vap signifie « voir aussi page »)
Page 27 : Proscription à l’école et dans la famille, des mots étrangers ; « adieu » ou « journal », trop français. Chaque manquement entraîne une amende de 5 pfennigs
33 : Elle fait une croix en cire pour célébrer la première victoire
48 : Évoque Verdun en novembre 1914
50 : Vue de Noël 1914 (vap p. 55 pour Noël 1915 et 58 Noël 1916)
54 : Voit un zeppelin, le LZ 35
55 : Offre pommes et fleurs aux soldats de l’hôpital
56 : Fait une tombe pour son chat, tué à coup de fusil par un voisin
58 : 25 décembre 1916 : « On fait la queue pour une malheureuse miche de pain »
61 : Elle vole une pâtisserie avec une amie
66 : A peur de la grippe espagnole
Yann Prouillet, février 2021
Gérard, Louis-Charles (18..-19..)
1. Le témoin
Nous n’avons pas recueilli d’information biographique à propos de Louis-Charles Gérard qui indique à la fin de son œuvre l’avoir rédigée à Roches-les-Blamont, dans le Doubs, en 1932. Il annonce également un autre récit en préparation intitulé L’épave, lequel ne semble pas toutefois avoir été publié.
2. Le témoignage
Gérard, Louis-Charles, Les dessous de la gloire, Besançon, imprimerie Jacques et Demontrond, 1932, 248 pages.
Léon Giraud est incorporé pour sa période militaire le 9 octobre – semble-t-il – 1912 au 81e bataillon de chasseurs à pied de Montabélard. Il va y apprendre le métier au cours d’une longue vie de caserne, faite de services et de menus tracas ; un milieu où il va gagner le respect de ses camarades ainsi que le galon de caporal. Les bruits de guerre rapprochant le bataillon de la frontière, c’est dans les Vosges qu’il prend sa place « assignée sur la ligne Messimy » (p. 202). Après le baptême du feu en Alsace, le caporal Giraud est lui-aussi fauché par l’implacable destinée de chair à canon quelque part dans la Champagne Pouilleuse, à proximité d’une ferme de la Folie.
3. Analyse
L’auteur place son héros dans le 81e BCP de Montabélard. Cette commune comme cette unité n’existent pas, les BCP à la mobilisation « s’arrêtant » au numéro 71. Son témoignage ne correspond pas non plus au 55e BCP de Montbéliard, dont le parcours n’est pas commun avec celui décrit dans l’ouvrage de Gérard. Car l’auteur a bien fait ses classes, et vraisemblablement la Grande Guerre, dans les chasseurs à pied. Son caporal Giraud y décrit fidèlement, et longuement, la vie de caserne, son microcosme et son jargon, son argot, y développant quelques scènes typiques d’intérêt pour l’historien. Il décrit la mobilisation en caserne (déroulement, vocabulaire, etc.) (p. 70) et glose sur la discipline : « Il est écrit dans le Règlement : Le supérieur doit obtenir de l’inférieur une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Tous les actes de la vie militaire tendent à asseoir cette opinion présentée sous forme d’axiome. Tous les esprits sont atteints de cette psychose particulière, d’où naît l’aveugle soumission » (p. 86). Il décrit une marche-manœuvre sous la pluie : « Aux fenêtres, des gens étonnés regardaient passer le morne défilé des soldats courbés sous la rafale, les fusils crosse en l’aire, comme on le fait aux enterrements. Et vraiment cela ressemblait à un enterrement : choses, bêtes et gens semblaient plongés dans un deuil cruel » (p. 89) ou une séance d’escrime à la baïonnette (p. 121). Son tableau (p. 195) de la lecture de la presse allemande par les officiers afin de galvaniser les soldats est certainement chose vue. Il est également opportun dans sa réflexion sur la guerre qui mélange les origines sociales : « Cela me fait plaisir de constater que, si la guerre arrive, nous y seront tous, sans distinction de fortune ». (p. 205). Il y revient plus loin (pp. 210-211), et dit, en septembre 1914 : « Tout d’abord, j’ai perdu encore là une autre illusion, j’avais cru à la sincérité de cet élan qui nous portait tous indistinctement à un commun sacrifice ; sous l’uniforme qui nous rendait frères égaux, j’avais conçu le fol espoir d’une mentalité nouvelle enfantée par le danger pressant ; je voyais dans ce généreux geste d’union sacrée, apparaître les bases d’une société meilleure, qui allait se tremper dans le creuset de la souffrance et cimenter dans le sang, l’éternel monument d’une fraternité effective ». Il découvre les PCDF et les embusqués.
Vient la guerre. L’épreuve du feu passée, il dit en septembre 1914 « Je me demande par quel miracle je suis encore en vie ! » (p. 210). Puis il décrit sa vision des soldats après quelques semaines de guerre : « Tous ces combattants n’offraient plus rien de la physionomie habituelle des soldats du temps de paix. Des uniformes salis et déchirés, des faces osseuses et tannées, sur lesquelles une barbe d’un mois appliquait un cachet crapuleux, des gestes brusques, des voix rauques, des yeux durs où brillait une flamme inquiétante, c’était, en quelques traits, ce qu’offrait la vue des survivants de ce premier mois de campagne ! » (p. 214). Il termine sa campagne quelques jours plus tard, adossé à la margelle d’un puits, une artère fémorale coupée, pleurant « sur sa jeunesse sacrifiée, sur ses deux dernières et inutiles années qu’on avait volées à son affection filiale, sur les petites méchanceté qu’il avait supportées, sur la cruauté criminelle des hommes qui déchaînent la guerre, sur la bêtise de ceux qui la font, sur le néant de ce qu’elle représente » (p. 243-244).
D’idéaliste, Gérard, dans un ultime chapitre appelé « Remords », adresse, la guerre terminée, un pamphlet pacifiste aux anciens combattants : « Il faut bien l’avouer, on ne nous a pas consultés pour rédiger les traités, moutons nous étions, moutons nous sommes restés, sous la houlette de nos bergers, nous n’avons pas eu le courage d’élever la voix. Nous nous sommes laissés canaliser dans nos foyers, par petites paquets, et, sitôt repris par l’égoïsme, nous nous sommes vautrés dans l’indifférence, dans la lâcheté ! On nous a jeté, comme à des enfants, des hochets, des rubans qui flattaient notre fatuité. Pour étouffer nos scrupules, on a agité sous nos yeux, les spectres d’un danger puéril. Nous n’avons pas su résister, « ô corruption de l’argent ! », à l’appât des misérables primes qu’on nous offrait…, que votre sang avait payées…, et comme des mercenaires, nous avons empoché nos trente deniers ! Nous avons fermé les yeux, nous n’avons pas voulu démasquer les gens de la coulisse « (p. 245-246).
Dès lors, malgré que la classification de cet ouvrage soit de l’ordre du roman, la guerre ne concernant que les pages 201 à 244, Les dessous de la gloire constitue un bon témoignage anonymisé du dressage d’un chasseur à pied.
Parcours de guerre : Août 1914, départ de la caserne (fictive) de Ban-sur-Meurthe (201) – Vallées de la Plaine et du Rabodeau (Vosges) (203) – début septembre : Mirecourt, Neufchâteau, Chaumont, Bologne, vallée de la Marne (214) – Saint-Dizier (219) – Montier-en-Der (220) – Champagne Pouilleuse (221) – début de la bataille de la Marne (227) – Ferme de la Folie (231).
Autres informations relevées
Page 13 : Hussards surnommés « trotte-secs »
15 : Il cire les sabots de son cheval pour l’occasion
22 : Essai des chaussures à l’incorporation
23 : Pliage du paquetage
90 : Bienfait du chant sur le cafard de la marche
101 : Cigarettes Maryland et Londrès et courses de rallye-paper : « Le jour de la course, deux cyclistes, chargés de musettes bourrées de papier déchiré menu, partaient de grand matin semer par monts et par vaux ces papillons marquant la piste que devaient suivre les coureurs… ».
128 : Pose de la bande molletière
129 : Vue du « triste camp de Valdahon »
132 : Recevoir l’ours = recevoir la solde
166 : Anciens cassant la visière des képis des bleus
168 : Affecté au 21e corps, parcours de Montabélard à Ban-sur-Meurthe
195 : Lecture de la presse allemande par les officiers afin de galvaniser les soldats : « N’oubliez pas que, s’il y a des Allemands intelligents, c’est que les Français ont occupé vingt ans l’Allemagne »
215 : terribles taureaux pour territoriaux
216 : Le brutal = le canon
229 : Description de la marche « en tiroir »
221 : Vision d’exode
231 : Stratagèmes pour étancher la soif : « … on ramassa des balles boches, dont la chemise de nickel éclatée permit d’extraire le plomb, espérant que le froid du métal parviendrait à ramener un peu de salive ; on mâcha des aiguilles de pin, mais le soulagement était de si courte durée qu’on y renonça bientôt. Des hommes souhaitèrent d’attraper la bienheureuse balle qui mettrait fin à leur supplice ».
Yann Prouillet, février 2021
Arnaud, René (1893-1981)
1. Le témoin
René Jacques André Arnaud est né le 2 juillet 1893 à La Rochelle (Charente-Maritime). Il dit être entré au lycée de Rochefort en sixième à l’âge de dix ans. C’est son père qui choisit pour lui la langue anglaise : « Ce jour-là, sans s’en douter, mon père avait orienté toute ma destinée », ce qui précipitera la fin heureuse de sa guerre. Il aura certainement une scolarité brillante puisqu’il est normalien et entre en guerre en septembre 1914 à Vannes, obtenant le grade de sous-lieutenant en trois mois. Dans son témoignage, peu avant le Chemin des Dames, il se classe comme « homme de gauche ». Il meurt à Paris le 15 janvier 1981.
2. Le témoignage et analyse
René Arnaud annonce dès le titre l’angle sous lequel il va délivrer son témoignage. Son récit, écrit au début des années 60, est alors un mélange de souvenirs et de réflexions, souvent opportunes, avec pour fil conducteur la démonstration de l’absurdité de la guerre et de ceux qui la font, des militaires de carrière ou des civils sous l’uniforme, y compris réservistes. Ce biais rend son témoignage réfléchi, en forme de récit chronologique mais surtout concentré sur des grandes phases vécues dans trois régiments ; le 337e, 6e bataillon (Fontenay-le-Comte), (janvier 1915 – juin 1916), le 293e (La Roche-sur-Yon) (juin 1917 – novembre 1917) et quelques mois au 208e RI (Saint-Omer) (décembre 1917 à son changement d’affectation, en juillet 1918).
Avec son ami Guiganton, ils entrent en guerre « pleins d’ardeur et d’enthousiasme. Notre seule crainte avait été que la guerre se finît trop vite, avant même notre arrivée au front : quelle humiliation eût été la nôtre, de rester en dehors de la grande aventure de notre génération ! Et puis la flamme de la guerre attirera toujours les gars qui ont 20 ans » (p. 8). Il reviendra d’ailleurs mi-1916 avec plus de lucidité sur ces premiers sentiments : « Bien qu’une grosse marmite allemande vînt toutes les deux minutes s’écraser à droite dans les bois, j’eus quelque envie pour ces « embusqués » – qu’en même temps je méprisais -, et qui faisaient la guerre avec un minimum de risques, alors que l’enchaînement des causes et des effets avait fait de moi, petit intellectuel chétif d’avant-guerre, un lieutenant d’infanterie, c’est-à-dire pratiquement un homme condamné à mort, sauf grâce exceptionnelle. Et je ricanai en me rappelant qu’en 1914 je n’avais qu’une peur : que la guerre ne finît trop vite et que je n’eusse pas le temps d’y prendre part » (p. 88). Il reviendra page 204 sur cette expression en disant : « Un condamné à mort en sursis célèbre-t-il son anniversaire ? » Sa rencontre avec celui qu’il qualifie de « mon premier colonel » est lucide : « Si le colonel prenait son absinthe biquotidienne, si, coiffé d’un képi à manchon bleu, il évoquait les grandes manœuvres, c’est que la guerre n’était au fond pour lui qu’une continuation de la vie de garnison, à peine modifiée. Qu’il y eût cette fois de vraies balles dans les fusils et de vrais obus dans les canons, il n’en avait cure : car il ne mettait jamais les pieds en première ligne et ne dépassait guère vers l’avant son poste de commandement » (p. 13). Poursuivant ses tableaux, s’affranchissant parfois de la chronologie, en janvier 1916, assez familier avec son capitaine, qui le surnomme « Noisette », il relate comment il obtient sa première décoration : « Vous chercherez avec mon secrétaire dans le Bulletin des Armées un motif de citation à l’ordre du régiment ! C’est ainsi que je reçus la Croix de guerre et ma première étoile. Après avoir rêvé d’être décoré sur le front des troupes, quelle dérision ! J’eus du moins la pudeur, en rédigeant moi-même mon motif inspiré du Bulletin, d’éviter la grandiloquence ordinaire, les « N’a pas hésité… » ou les « N’a pas craint… » et de me référer simplement à mon baptême du feu où j’avais le sentiment d’avoir fait honnêtement mon métier » (p. 19). Baptême du feu qu’il avoue d’ailleurs avoir reçu tardivement, précisant : « Ce n’est qu’un mois et demi après mon arrivée au front, le 28 février, que je reçus en première ligne le baptême du feu ». Il n’est pas très ému de son premier mort (P. 34) mais dit plus loin (p. 36) sur son inhumation, cérémonialisée « Mais on n’enfouit pas ce corps comme celui d’un chien » : « Bien que la religion me fût devenue assez étrangère, je fus profondément remué par ce modeste effort de spiritualité au milieu des brutales réalités de la guerre ». En effet, cette mort le renvoie à la sienne : « Et j’étais si plein de vie qu’il m’était impossible de m’imaginer comme lui, couché sur un brancard, avec cet air distant qu’ont les morts. D’ailleurs n’était-il pas inscrit que j’en reviendrais ? ». (Il revient plus tard sur ce sentiment d’en sortir, alors qu’il subit un pilonnage à Verdun « Alors que la mort me frôlait à chaque minute, je sentais en moi la volonté, la certitude de vivre » (p. 117) (…) « Je vis donc emporter ce cadavre sans y voir pour moi aucun présage » mais il est bien plus ambigu quand il poursuit : « Ces images éveillaient alors en moi obscurément je ne savais quel plaisir : c’est beaucoup plus tard que je devais découvrir que ce plaisir était d’ordre sensuel et qu’il y a un lien mystérieux entre la mort et la volupté » (pp. 34-35). Il revient la page suivante à cette notion dans un tout autre domaine : « Nous couchions dans les caves, dont les murs étaient abondamment illustrés de pages découpées dans la Vie Parisienne, sarabande de petites femmes montrant leurs cuisses demi gainées de soie : nous n’avions pas attendu les Américains pour orner nos chambres de « pin-up »» (p. 36).
Sur la notion de héros, il en a une définition réaliste : « Le héros véritable à la guerre, ce n’est pas l’officier à qui il est facile d’oublier le danger qu’il a la volonté de faire son métier, ce n’est pas le technicien – mitrailleur, artilleur, signaleur – qui lui aussi peut ignorer les périls s’il se concentre sur le fonctionnement de sa technique ; le héros, c’est le simple soldat sans spécialité qui n’a qu’un fusil en main pour se distraire de l’idée de la mort ». (pp. 39 et 40).
Afin d’attester du surréalisme et du tragique de la guerre, René Arnaud multiplie les anecdotes telle celle de ces guetteurs tirant sur des oiseaux migrateurs pour s’amuser, entrainant un effet domino de fusillade, puis d’artillerie et causant finalement 7 morts dus à cette fausse alerte, ou ce lieutenant d’artillerie chauffé par l’alcool qui fait tirer au canon sans motif, entraînant lui aussi une riposte mortelle (p. 44).
Il n’est pas toutefois hermétique au bourrage de crâne, notamment sur le ramassage des blessés, n’y voyant qu’espionnage et traîtrise, tel en juin 16, ce : « Souvent, à ce que l’on nous avait dit, des combattants ennemis s’approchaient sous le couvert de la Croix-Rouge, dissimulant dans leur brancard une mitrailleuse » (p. 135). Mais il fait côtoyer ce sentiment avec l’horreur des corps en décomposition, qu’« il nous fallait pourtant regarder en face » et de conclure ; « Et nous n’avions qu’une pensée fugitive pour les proches de ces « disparus », qui fussent devenus fous à voir ce que la guerre avait fait de leur fils, de leur mari ou de leur amant » (p. 49). Il poursuit encore : « Et puis, en rentrant de la ronde, on secouait ces funèbres pensées, on se jetait sur la mangeaille avec un appétit de jeune loup comme dans ces repas de famille qui suivent les enterrements à la campagne. La vie reprenait le dessus, on bâfrait, on buvait, on savourait un verre de fine, on fumait un cigare et on ne pensait plus à nos cadavres jusqu’à ce que la prochaine ronde remît sous nos yeux ce « je ne sais quoi qui n’a de nom dans aucune langue » (pp. 49, 50).
Le 6e chapitre est un tableau de sa vision de l’armée anglaise, bien équipée, et à l’ « odeur de merisier et de tabac sucré ».
Près de cent pages sont consacrées au front de Verdun. Elles montrent, par l’ambiance et l’anecdote, l’homérique de cette phase. Sur l’abnégation du soldat qui « y tient », il dit : « On nous disait de tenir : y avait-il tant de mérite à ne pas bouger de sa tranchée où on était bloqué, et à y attendre passivement la fin du pilonnage, dans l’incapacité physique d’agir ? » (p. 117) Devant cette débauche d’obus, dont il dit : « tous les obus ne tuent pas – il y en a même fort peu qui tuent. Mais il en tombait tellement cette fois-ci que quelques-uns frappaient juste », il se révolte pourtant : « A la fin, c’en était trop. Le spectacle de ces paquets de chair fragile qui attendaient la mort sous un déluge de fer et de feu me révolta. En cette minute je ne pensai à la Providence que pour la nier ou la maudire. Morand, mon ordonnance, l’avait dit dans son simple langage : « Est-ce que le Bon Dieu devrait tolérer des choses pareilles ? I doit pu guère s’occuper de nous à c’t’heure ! ». Oui, le ciel était vide. Il n’y avait point de dogme du péché qui pût donner un sens à un pareil massacre ». Devant tant de mort et de souffrance ; « Cette longue série d’émotions excessives avait fini par tuer en moi l’émotion elle-même » (pp. 118-119). Car la mort tombe du ciel, impersonnelle, anonyme : « Je remarque tout à coup un grand corps qui marche là, vers la droite, je vise, j’ai l’intuition du tireur qui tient là son but, j’appuie sur la détente et, tandis que le recul me secoue l’épaule, le grand corps disparaît. Je me demanderai plus tard si c’est ma balle ou la balle d’un autre qui l’a atteint ou s’il s’est simplement jeté à terre devant la fusillade trop intense. C’est en tout cas le seul Allemand que je crus avoir « descendu » en trois ans et demi de campagne, et sans en être sûr » (pp. 122-123). La relève arrive : « tous les survivants eurent un sursaut de joie ; ils allaient en sortir ». Mais le capitaine envisage de laisser les morts à leur sort. Suit un tableau saisissant d’assainissement du champ de bataille (p. 140). A Verdun, revenu dans la sécurité relative de la ville, succédant à 10 jours d’enfer dans le secteur de Thiaumont, il constate qu’une trentaine d’hommes sur 130 sont redescendus ; il les décrit : « La plupart n’ont ni sac, ni ceinturon, certains n’ont même plus leur fusil. Ils s’en vont furtifs, en désordre, comme s’ils avaient fui la bataille. Leurs yeux sont encore fiévreux dans leur visage noirci par la barbe, le hâle et la crasse. Ces héros ne font guère figure de héros » (p. 143). Il en tire un bilan décalé devant le communiqué : « Y n’parlent pas d’nos pertes », grommelle un homme. Mais il est le seul à grogner. Les autres ont aux yeux une petite flemme d’orgueil : « Ça, c’est nous ! » L’être humain tire sa fierté de ses pires souffrances » (p. 144). Les pertes au 237e RI ont été si importantes qu’il est fondu avec le 293e « que nous n’aimions point » dit-il, bouleversant totalement l’unité, et de fait sa cohésion (p. 147). Après quelques jours de repos, le régiment reconstitué est renvoyé dans l’enfer avec la mission de reprendre Thiaumont. Il dit : « Chacun pensait : « On en revient une fois, pas deux ! » » (p. 148). Et Arnaud de constater la recrudescence des consultants du médecin aide-major, soldats comme officiers qui en font autant ! (p. 150). Dans ceux qui y retournent, il décrit les blessés légers filant vers l’arrière après s’être lestement déséquipés et dit : « On eût dit qu’ils avaient étudié le manuel du parfait évacué » ! (p. 156). Plus loin, il fait le calcul lucide et surréaliste « que pour faire un prisonnier on dépensait 300 000 francs (…) [79 829 927,88 € ndlr] pour un prisonnier, « cela mettait cher le gramme de Boche » ! (p. 170).
Il participe ensuite au 16 avril 1917, et est témoin des mutineries ; « nous n’en croyions pas nos oreilles » (p. 175) en avançant qu’elles n’ont pas concerné son régiment, expliquant que « par tempérament et par tradition le Vendéen est docile et respectueux de ses chefs » (p. 176). Il en impute la cause aux officiers cultivant l’inégalité et, arguant qu’il connait ses hommes, caviarde auprès de ses troupes la « littérature » ampoulée émanant du GQG, mais pas celle venant de Pétain. Il rapporte ensuite l’épisode de La Marseillaise chantée par Marie Delna le 19 juillet suivant qui tempéra un peu pour le général Des Vallières la loyauté de sa division (151e).
Au début de décembre 1917, René Arnaud, qui a été promu capitaine à 24 ans au mois d’aout précédent, se trouve affecté à un nouveau régiment suite à la dissolution, en novembre, du 293, mais sans citer celui, « de réserve du Nord » qui l’accueille. Il intègre une unité qui porte la fourragère aux couleurs verte et rouge de la Croix de guerre. Au passage, il dit ce qu’il pense de ces fourragères, notamment en les rapportant à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale ! Mais il avance : « Un régiment dissous, c’était un régiment suspect : si on nous avait supprimés, c’est sans doute que nous ne valions pas grand-chose, peut-être même que nous avions mis la crosse en l’air » (p. 182). S’il ne cite pas son nouveau et ultime régiment, c’est qu’il n’a pas digéré cette affectation. Mal reçu par ce qui apparaît être le 208e RI de Saint-Omer, il dit : « En outre, je tombais dans un régiment où l’atmosphère était assez déplaisante » et « était ce qu’on appelle vulgairement un panier de crabes » tel qu’il acquiert un manifold pour se garantir contre les mauvais coups ! (pp. 184-185). En mars ou avril suivant, ayant répondu à une demande d’officiers connaissant l’anglais, il est affecté au début de juillet 1918 à l’armée américaine comme « officier informateur ». Il en déduit : « Je fus comme ébloui par cette nouvelle. En une seconde, j’eus le sentiment que la guerre était finie pour moi, que je survivrais, et je fus d’un coup délivré de cette sourde angoisse qui pesait sur moi depuis trois ans et demi, de cette hantise de la mort qui m’avait obsédé comme elle obsède les vieillards en bouchant leur avenir ». Plus loin, il ajoute : « J’avais le sentiment d’être invulnérable » mais sans que cela gomme son impression d’abandonner ses hommes (pp. 204 à 206). Son témoignage s’arrête sur sa « profonde reconnaissance à ceux qui sont ainsi venus in extremis faire pencher en notre faveur le plateau de la balance ». (p. 208). S’ensuit un appendice final de 73 pages, inutile et comportant quelques erreurs, intitulé « petite histoire de la Grande Guerre »
Est-il un bon témoin ? Fin mai 1916, alors qu’il monte à Verdun, il se souvient avoir vu au bord de la route, entre Vaubécourt et Rembercourt-aux-Pots, « des tombes de deux soldats tués ici même le 8 septembre 1914 : Rémy Bourleux, soldat au 37e de ligne ; Constant Thomas, soldat au 79e de ligne » (p. 83). Recherches effectuées, ces deux soldats n’ont pas été identifiés et les deux régiments cités ne combattaient pas à cet endroit à la date précisée mais en Meurthe-et-Moselle. Mais il est plus précis quand il évoque la mort de l’Etreusien René Breucq BREUCQ René, 05-10-1884 – Visionneuse – Mémoire des Hommes (defense.gouv.fr), effectivement tué le 20 juillet 1918 au combat de Neuilly-Saint-Front (p. 207).
Renseignements complémentaires relevés dans l’ouvrage :
(Vap signifie « voir aussi page »)
Page 93 : L’absinthe et comment on la consomme
Vue de volontaires américains conduisant des ambulances Ford de la Croix Rouge « qui s’étaient jetés dans la guerre dès 1915 comme dans une gigantesque partie de base-ball »
19 : Comment il reçoit sa Croix de guerre en se l’attribuant lui-même.
25 : Colonel reprenant théâtralement son poste juché sur un lorry
28 : Vue d’un déserteur allemand polonais
29 : Général enfreignant la consigne de l’interdiction de porter le passe-montagne
33 : Bruit de l’obus (vap 63, 97, 104, 105 et 116)
34 : Poêles « empruntés » au village voisin
35 : Vue du château de Bécourt, près de La Boisselle
34 : Pas ému de son premier mort, mais ému plus loin (p. 36) de la spiritualité
37 : Reçois tardivement son baptême du feu, le 28 février
: Hallucination du guetteur
38 : Odeur poivrée de la poudre
44 : Coup de foudre d’amitié entre deux hommes « sans qu’aucun élément trouble vienne s’y mêler »
48 : Cigarette, seul recours contre l’odeur des cadavres
51 : Bruit du train
53 : « Le vin est pour eux chose plus sacrée que le pain »
55 : « Heureux le bœuf qui ne sait pas qu’on le même à l’abattoir »
59 : « Sentiers « canadiens » faits de petit rondins joints où couraient deux rails de bois qui fixaient le tout »
Rats et odeurs de rat crevé
Vue « pittoresque » d’un capitaine de marsouins « à l’allure d’alcoolique »
61 : Touche l’Adrian, « que nous essayâmes en nous esclaffant, comme si c’eut été une coiffure de carnaval »
66 : Propos défaitistes de Vendéens parlant de la défense de la Champagne pouilleuse : « Si tieu fi d’garce de Boches veulent garder ce fi d’putain d’pays, y a qu’à l’leur laisser : ça sera pas une perte ! Ollé pas la peine de s’faire tuer pour ça ! ». (vap 80 sur le 15ème Corps)
67 : Poêle improvisé fait d’un vieux bidon de lait et de tuyaux de gouttière
68 : Jambe momifiée par le gel
: Différence entre active et réserve : « je suis un réserviste, un soldat d’occasion ! » (vap 94)
71 : Interrogatoire comique de prisonnier allemand qui pense retourner dans sa tranchée après
73 : Sur le 17e RI, le régiment du midi crosse en l’air et la chanson révolutionnaire de Montéhus
76 : Ce qu’on trouve dans un bazar militaire
82 : 10 minutes de pause toutes les 50 mn de marche
: Mai 1916, vue de deux tombes du 8 septembre 14 mais non confirmées par les recherches
84 : Vue de la Voie Sacrée interdite aux colonnes d’infanterie, ordre contourné par coterie
85 : Rumeur des gendarmes pendus à Verdun
86 : Haine, mépris et envie contre les officiers d’état-major
: Camions ornés de la Semeuse
: Sur les Vendéens et les Midis
87 : « « Embusqué » s’écrivait désormais avec un A, l’A cousu au col des automobilistes »
90 : « Le vrai front commence au dernier gendarme »
: Vue de la citadelle de Verdun, son ambiance, son aspect d’« entrepont d’un paquebot plein d’émigrants » (vap 95 comment on en sort)
94 : Sur le drapeau et son utilisation : « le drapeau était un embusqué et la guerre était sans panache »
: Odeur de sueur et de vinasse flottant dans les casemates
96 : Sur la veulerie d’un homme qui a peur, son sentiment devant cet homme
105 : Sur la mort survenue aux feuillées, accident qu’une citation aurait heureusement transformé en mort glorieuse
111 : Allègue que « le « système D » n’est pas traduisible en allemand »
112 : Couleur des fusées françaises et allemandes
116 : Bruit des obus
122 : Stahlhelm « en forme de cloche à melon »
: Odeur alliacée (de l’ail) de la poudre
123 : Reçoit une balle dans son casque, lui ayant fait sauter le cimier
124 : Accident de grenade F1 à douille en carton (vap 129 et 136)
133 : Regarde passer les « bouteilles noires », des obus
134 : Capitaine déprimé, « l’alcool ne le soutenait plus »
135 : Grenade grésillante
136 : Sentiment d’être sourd et pense à la « fine blessure »
137 : Blessés dont il remarque « leur soumission passive au destin »
140 : Odeur fétide d’une corvée montante
145 : Officier de l’arrière, escadron divisionnaire, semblant sortir d’une première page de La Vie Parisienne
146 : Pense avoir perdu sa jeunesse à Verdun
155 : Vider sa vessie en cas de balle au ventre
173 : Pillage d’une cave de Champagne
174 : Notion du bien et du mal floutée par la guerre
: Sur le vin : « Chacun sait que le soldat français croit avoir des droits sur toute bouteille de vin qui est à sa portée »
182 : Fourragère rouge et verte (Croix de guerre), citée à l’ordre de l’Armée deux fois, Jaune (Médaille militaire) citée 4 fois, Rouge (Légion d’Honneur) citée 6 fois
189 : Vue d’une fête sportive
212 : Affiche de la mobilisation générale toujours présente sur un mur parisien en 1964.
Yann Prouillet – février 2021
Ricadat, Paul (1893-1987)
1. Le témoin
Paul Ambroise Edmond Ricadat est né le 14 octobre 1893 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) dans une famille originaire des Ardennes, à Sedan. Après des études supérieures dans la capitale, il fait une carrière à la Bourse de Paris où il termine chef du service des opérations à terme. Il fait son service militaire à Sedan en 1913 et termine la guerre comme aspirant, achevant finalement sa longue période militaire de 6 ans lieutenant de réserve. Blessé deux fois et plusieurs fois médaillé, il sera fait chevalier de la Légion d’Honneur. Il décède le 27 février 1987 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
2. Le témoignage
Ricadat, Paul, Petits récits d’un grand drame. (1914-1918). Histoire de mes vingt ans. Paris, La Bruyère, 1986, 233 pages.
Sur sa démarche d’écriture, réalisée en différentes étapes, Paul Ricadat indique lui-même : « J’avais eu l’occasion de lire dans la presse, au début de 1966, une appréciation qui estimait que, pour les Anciens qui l’avaient vécue, la guerre de 1914-18 c’était le bon temps… Je décidai, sur-le-champ, de relever le gant et j’écrivis un récit intitulé : « Le bon temps », qui fut publié par le journal la Voix du Sancerrois. Ce récit fut retenu par un jury, présidé par Jules Romains de l’Académie française dans un livre, les Camarades, de Roger Boutefeu. Il y eut dix lauréats de ce prix Verdun : six lauréats français, dont je fis partie, et quatre lauréats allemands. Voilà l’origine de ce titre, qui ne devait pas être ignorée du lecteur » (p. 207). Ces récits forment la base de ce livre, Paul Ricadat dédiant ses pages à ses enfants, petits-enfants et à son arrière-petit-fils « en sa 93e année ». Il précise encore sur la rédaction de ses « vieux souvenirs », débuté à sa retraite, en 1956 : « Pour 1916 et 1917, je pus confronter ma mémoire avec les deux petits agendas de poche que j’avais tenus alors au jour le jour. (…) Quant à 1914, époque à laquelle toute note écrite était interdite, je n’avais besoin d’aucune aide. Je me souviens de chaque jour, sinon de chaque heure, comme s’ils dataient d’hier » (pp. 230 à 232). Sur les conditions de son écriture, il nous renseigne un peu plus loin : « Il me faut dire ici que j’eus une chance inouïe. C’est grâce à ma blessure et à mes pieds gelés que je dois la vie sauve. Les longs mois d’hôpitaux, suivis de séjours prolongés au dépôt de mon régiment, me maintinrent à l’abri au cours des années 1915 et 1918. Mais aussi et surtout, cette survie, je la dois à la protection efficace du Ciel, à cette intervention continue, que je qualifie de miraculeuse, de la Divine Providence, écartant sans cesse le danger au moment où il semblait devoir me frapper. J’aurais dû mourir cent fois plutôt qu’une, mais, en, chaque circonstance, le « coup de pouce » était donné qui faisait dévier la balle ou l’éclat d’obus. Ma vie, depuis un demi-siècle, est une action de grâce continue pour tant de bienfaits ». Poursuivant dans un ultime chapitre en forme de « conclusion (au soir de ma vie) », il pense prophétiser : « Les années ont passé. La génération de « Ceux de 14 » ainsi que l’a défini Maurice Genevoix, achève de disparaître. Bientôt le linceul de l’oubli ensevelira les événements, les acteurs du drame et leurs souvenirs. Et les livres d’Histoire ne mentionneront plus qu’il y eut en 14-18 un conflit pas comme les autres » ! » (p. 232).
Paul Ricadat débute ses souvenirs en juin 1914 à la caserne Macdonald du 147ème RI à Sedan (il avait été incorporé le 27 novembre 1913) alors que « les classes des contingents 1912 et 1913 étaient enfin terminées. Elles venaient d’être couronnées par les marches d’épreuve dont la dernière était l’itinéraire Sedan-Charleville, aller et retour, avec le chargement de guerre. Au total 55 km, sous un soleil torride. L’Etat-major local était parait-il satisfait, l’entraînement intensif que nous avions subi avait porté ses fruits » (p. 20). Suit la narration de sa guerre sous la forme de 20 tableaux commentés de sa guerre, tour à tour réaliste et terrible, à laquelle il finit par échapper pour cause de pieds gelés, à la fin de 1917, alors qu’il est passé au 33ème RI d’Arras.
3. Analyse
Son récit est alors un mélange de souvenirs et de réflexions, souvent opportunes, le poilu réfléchissant sur son environnement comme sur son rôle au fur et à mesure de ses fonctions. Il dit de l’Armée : « j’ai eu la possibilité de bien la connaître parce que j’ai souffert de toutes ses contradictions » (p. 94) ce qui rend son témoignage réflexif selon les tableaux qui résument les grands chapitres de sa guerre, en forme de récit chronologique.
Le premier tableau, Leçon d’histoire, fait un rapide tour d’horizon du ressenti de sa vie militaire. En guise de préliminaire, il pose la question : « Comment avez-vous pu tenir ? », ce à quoi il répond : « Nous n’avons pas eu à nous interroger sur ces questions du moins pendant les trois premières années de guerre. La raison est que notre génération avait été élevée sous le signe du devoir ». Il attribue au pangermanisme une autre réponse à cette question. Il fustige ensuite ce qu’il qualifie comme étant les mensonges de son époque, « journalistes partisans [écrivant] l’Histoire à leur façon » et de dire « qu’ils attendent au moins que les acteurs du drame de 14-18 soient tous disparu » ! (p. 14). Il y rappelle l’état d’esprit de la jeunesse d’alors : « Non, les jeunes de 14 ne voulaient pas la guerre, tout au contraire, ils la redoutaient, sachant qu’ils en seraient les premières victimes. Personnellement, j’avais visité, dès que j’eus l’âge de raison et plusieurs fois par la suite, l’ossuaire de Bazeilles et ces pauvres restes de combattants de 1870 me laissaient une impression de terreur que rien que le mot « guerre » me faisait trembler ». Poursuivant ses questionnements, il dit : « On nous reproche aujourd’hui d’être partis en chantant (…) et, qui plus est, avec la fleur au fusil, ce qui prouve soi-disant notre volonté de guerre. Pauvres ignorants qui méconnaissent jusqu’à l’A B C de la psychologie des foules. Puisque le sort en était jeté et que nous ne pouvions rien contre lui, nous considérions qu’il valait mieux partir en chantant plutôt que les larmes aux yeux » (p. 16).
Dans Avant la bataille, il décrit son départ pour le front et la montée dans les wagons à bestiaux « aménagés de bancs à dossier et même de râteliers pour les fusils » (p. 24), les heures de marche qui agonisent les pieds. Sur ce point, il décrit : « Ordre est donné de se déchausser, de se laver les pieds avec un linge humide et de les exposer toute la journée. Ce fut un excellent cicatrisant, au point que le lundi 3 août, nous pûmes remettre nos chaussures, les plaies étaient presque refermées et la souffrance devenue supportable » (p. 26). A Marville, dans la Meuse, Ricadat dit : « Ce que nous ne savions pas, c’est que notre départ de Marville signifierait pour nous un point de rupture dans notre vie. C’en était fini de notre jeunesse, de notre insouciance, de notre sérénité. Une période commençait qui durerait plus de quatre ans et pendant laquelle nous serions confrontés perpétuellement avec la Mort. Les trois mille hommes qui pendant huit mois avaient vécu une vie commune, allaient tomber les uns après les autres, ne laissant subsister qu’une poignée de rescapés. Pauvres gars ! » (pp. 28-29). Son régiment, qui a quitté Sedan le 1er août, reste stationné dans cette commun jusqu’au 18 avant de se diriger vers le nord où il franchit la frontière belge : « Traversant les villages, nous trouvons devant les maisons, sur le bord de la route, de vastes récipients ou des baquets remplis de vin et d’eau. Nous plongeons notre quart sans nous arrêter et buvons en marchant. Les quarts suivants que nous pouvons remplir sont destinés au bidon. Des enfants nous donnent leur tablette de chocolat, d’autres nous mettent en main des paquets de cigarettes. Quelle fraternité ! » (p. 37). A « Robelmont, village belge évacué par tous ses habitants. Pour éviter des dégâts, ils ont laissé les portes ouvertes. Nous sommes autorisés à entrer à condition de tout respecter » (p. 38). C’est dans ses environs qu’il reçoit le baptême du feu, sous les ordres d’un adjudant (Simon) qui tient sa troupe, apeurée, en distribuant des cigares ! (p. 40) alors qu’heureusement « il fut admis que dans les premiers jours des hostilités, les Allemands tiraient trop haut » (p. 41) ! Très descriptif et pédagogue, l’auteur continue de décrire ses premières heures de combat : « Enveloppez les baïonnettes dans le pan de la capte pour en amortir le cliquetis et marchez sur la pointe des pieds » (p. 42). Il décrit aussi les affres de la bataille des frontières, telle cette femme accouchant sur un chariot d’exode (p. 44) ou ce soldat en sentinelle devenu fou en tuant son frère par erreur (p. 46). Il dit devant cette phase des combats d’août 14 : « Nous ne comprenons rien à la situation. Au fond, n’est-il pas préférable pour nous de ne rien comprendre » (p. 48). Ses descriptions virent parfois au cocasse près de Stenay, quand il fait un plat-ventre dans une de ces « servitudes de notre frère le corps » en rappelant que « chacun sait ce que l’on trouve souvent le long des haies ! » (p. 49), ou quand, faute de ravitaillement, chacun se rue sur des pommes, mêmes vertes, et qu’ensuite, « il faut avoir vu ces milliers d’hommes s’égailler dans les champs et poser culotte à perte de vue pour imaginer cette souffrance » de la dysenterie (p. 54). Cette retraite précédant le sursaut de La Marne occasionne également de la fraternité, certains portant le sac de ceux qui s’apprêtent à flancher (p. 56). Le 21 septembre, devant le bois de la Gruerie, il s’horrifie de la guerre en forêt : « Je considère ces hautes futaies, ces arbres de vingt-cinq mètres de haut, ils m’écrasent et leur masse, qui se referme sur nous sans nous laisser voir le ciel, m’étouffe. Petit à petit, j’en prends conscience, c’est la peur qui m’étreint. Je lutte contre elle, je voudrai pouvoir fuir, je n’en ai pas le droit » (p. 65). Après un accrochage ayant causé une vingtaine de morts dans le camp d’en face, il fait cet étonnant bilan : « Mais, faut-il l’avouer, c’est moins le nombre qui nous intéressait que les provisions que nous pouvions trouver dans leurs sacs. Ils avaient en effet, ce que nous n’avions plus depuis longtemps, des vivres de réserve, biscuits et conserves, et nous avions faim. Ces récupérations furent les bienvenues » (p. 69). Le 24 septembre, il rapporte l’exécution d’un soldat du 147 et, fait rare, il fait partie du peloton d’exécution. Toutefois, la base Guerre 1914-1918 ~ Les fusillés de la Première Guerre mondiale — Geneawiki ne relève pas d’exécution ce jour là mais le même jour un mois plus tard. A-t-il exécuté Maurice David Séverin ce jour-là ? (pp. 70 et 71). Le lendemain Paul Ricadat est blessé à la tempe : « Je prends conscience que je vais mourir » (p. 74) ; il quitte la tranchée pour un poste de secours. Là, il tombe alors sur un major fou (Guelton) qui menace d’abord de le faire fusiller pour désertion, avant de le faire effectivement évacuer devant la gravité de sa blessure dont il finit pas prendre conscience ! Sa vision de la cave d’ambulance où il passe la nuit en attendant son évacuation est « apocalyptique », même si elle est atténuée par les « gestes maternels » que se prodiguent les blesses entre eux. Toutefois, devant la désorganisation du service de santé, et devant la, finalement, faible gravité de sa blessure, il finit par s’évacuer lui-même et prendre un train sanitaire qui mettra 19 heures pour faire Sainte-Menehould/Dijon (pp. 78-79). Il passe 4 mois à l’hôpital de cette ville puis rejoint le dépôt du 147ème RI à Saint-Nazaire. Il y apprend alors avec stupéfaction qu’il a été cité à l’ordre de la Division « qui me donnait le droit au port de l’étoile d’argent sur ma croix de guerre » (p. 84). Dans le chapitre Le baiser, il indique que « ce n’est pas le récit d’un combat, mais celui d’une émotion, associée à la souffrance et provoqué par la bonté ». Il décrit l’état des soldats après la retraite de La Marne ; « nous n’étions plus des hommes, mais des loques » (p. 89). Retapé, son changement de régiment lui donne le cafard et lui rappelle ses copains déjà morts, dont Eugène Pasquet qui avait le pressentiment funeste qu’il « ne sortirai pas vivant de ce métier », l’invitant, lui, très pieux, à se pencher sur ce sentiment. Le 18 mars 1916, il quitte la cité portuaire pour revenir dans la Meuse, à Longeville. Il est donc versé à la 8ème escouade de la 2ème section de la 4ème compagnie du 33ème RI. Sur la route pour rejoindre le Chemin des Dames, au cours d’une étape, sa compagnie est rassemblée par son capitaine qui déclare : « Je vous ai rassemblé afin de prendre contact avec les nouveaux venus. Je tiens à ce qu’ils sachent à qui ils ont affaire et ce qui les attend. Nous sommes ici pour faire la guerre, c’est dire qu’il ne faut pas que vous conserviez le moindre espoir de rentrer un jour dans vos foyers ! Rompez les rangs et rentrez dans vos cantonnements » (p. 110). Le lendemain, il est au Village nègre de Bourg-et-Comin et, prenant la ligne de feu sur le plateau, il relève : « Les gradés se passent les consignes, les hommes chuchotent à voix basse. Nous apprenons qu’il y a une entente tacite existe depuis des mois avec l’ennemi. Aucune dépense de munitions, pas de pertes d’un côté comme de l’autre, c’est le secteur idéal. Oui, mais ce n’est pas la guerre, et, à ce train, elle pourrait durer cent ans. L’état-major du corps d’Armée est, parai-il, scandalisé par un tel abandon de responsabilités et projette d’y mettre fin » (p. 11). Le 2 mai, ayant appris que son père est mourant, il obtient in extremis une permission pour assister à ses derniers instants, à Fismes. Il quitte le Chemin le 17 juillet 1916 pour la Somme où, jusqu’au 7 août, « nous connûmes cette vie de camp pour laquelle nous n’avions plus beaucoup d’affinités » (p. 126). Celle-ci lui donne toutefois le temps de voir griller des Saucisses et leur observateur par un orage ou tirer un 380 de marine sur voie ferrée. « Le 1er septembre marque notre entrée dans la bataille de La Somme », sur un autre plateau, celui de Maricourt (p. 128). Il y subit de terribles épreuves : « Nous restons ainsi quatre jours sans nourriture, souffrant encore plus de la soif que de la faim. Avec notre couteau nous arrachons des fibres de bois aux matériaux que nous trouvons et nous les mâchons pendant des heures pour tromper la faim » (pp. 135 et 136). Très pieux, il est aux anges quand, sorti un temps de l’enfer, « l’abbé Vitel décide une journée complète de spiritualité. Nous en avions besoin après ces trois semaines de vie purement bestiale » (p. 137). Après la Somme, on le retrouve en Champagne, sur la butte du Mesnil ; il y connaît l’angoisse d’entendre sous ses pieds des bruits de creusement, qu’il nous fait vivre heure par heure. La mine explose en même temps qu’il est attaqué et il s’en sort miraculeusement. Il conclut ce chapitre, Agonie, en revenant sur sa blessure à la tempe en septembre 1914, « la mort subite », et sur son expérience de la guerre souterraine, « la mort lente » : « Ah ! qu’il est donc facile de mourir à vingt ans ». Le 12ème chapitre, Espions vrais et faux, revient ce qu’il qualifie de « véritable épidémie » : « l’espionnite ». Il en fait une analyse correcte en alléguant : « Ce fut le début d’une suite d’aventures et d’erreurs qui, parfois, tournèrent au comique, mais, trop souvent aussi, hélas, eurent une conclusion tragique » (p. 152). Toutefois, il rapporte cette anecdote d’un vacher dénonçant aux allemands l’arrivée du 33ème RI en faisant bouger ses bêtes dans le secteur de Vendresse-et-Troyon en avril 1916. Il dit également avoir rencontré un artilleur-espion dans la tranchée le 22 mars suivant non loin de la ferme du Temple puis un autre encore plus tard, faux cette fois-ci. Et de conclure : « … je dois avouer que j’ai joué de malchance dans mes démêlés avec des espions. J’ai laissé filer le vrai et j’ai arrêté le faux » ! (p. 159). Son 14ème chapitre est consacré aux mutineries. Sur ce point, il dit : « J’eus la chance d’appartenir à un corps d’armée, le 1er Corps, qui ne se laissa pas gagner par la contagion » (p. 171). Il est désigné pour tenter, à plusieurs reprises, de contenir les mouvements des hommes, isolés manquant de pinard ou de permissionnaires excités, tâches dont il s’acquitte brillamment évidement. Il gardera de cette époque une haute estime à Pétain qu’il qualifie de magicien.
Est-il un témoin fiable ? L’épisode qu’il rapporte, le 27 juillet 1917 semble le confirmer. Ce jour-là, il assiste effectivement à la mort « accidentelle non imputable au service » dans le canal des Glaises à Wahrem (Nord) du soldat Camille Xavier Derrouch (cf. DERROUCH Camille Xavier, 02-02-1896 – Visionneuse – Mémoire des Hommes (defense.gouv.fr)). Il en décrit ensuite l’inhumation (pp. 188-189). On pense donc pouvoir le croire quand quelques jours tard, il atteste qu’un soldat a abattu un avion à coup de fusil (p. 195). La guerre avançant renforce sa religiosité… ou sa superstition. Pris dans un bombardement en octobre 1917, il dit : « La main dans la poche de ma capote, je récite mon chapelet, arme suprême quand les autres sont impuissantes » ou sur ce qu’il qualifie de miracle du fait de la prière d’un de ses soldats, pourtant athée (pp. 201 et 202). Mais rien n’atténue l’horreur croissante de ses conditions en première ligne sur l’Yser. Il dit, « Depuis notre arrivée ici, nous urinons sur place, sans bouger, augmentant ainsi la puanteur de ce cloaque » (p. 210). En novembre, après quatre jours d’enfer au fond d’une tranchée, il est relevé mais, comme les deux tiers du bataillon en ligne, il a les pieds gelés. Hospitalisé à l’hôpital d’Abbeville, sa guerre est terminée.
20 octobre 1918, on retrouve Paul Ricadat à Champigny-sur-Yonne (Yonne), à la veille d’être inscrit à suivre à Issoudun un cours d’élève-aspirant. C’est dans cette ville qu’il vit le 11 novembre en une longue minute de silence avant qu’« alors, c’est une clameur, une ruée, un déchaînement comme je n’en ai jamais connu ». Réflexion faite, il dit : « J’ai toujours regretté de n’avoir pas assisté au « Cessez-le-feu », au front, en première ligne, minute inoubliable pour ceux qui l’ont vécue ». Et de conclure : « Qu’étions-nous, en fait, à cette heure ? Des condamnés à mort qui, depuis quatre ans, attendaient chaque jours leur exécution et à qui on venait dire : « Vous êtes graciés, partez, vous êtes libres » (p. 224). « L’armistice n’est pas la paix ». En mars 1919, son stage se termine, complété par quinze jours à l’école d’artillerie de Poitiers à l’issue desquels il devient instructeur à Tours. Il est enfin démobilisé le 1er septembre 1919, achevant sa vie militaire commencée le 27 novembre 1913.
Bibliographie complémentaire à consulter : Boutefeu, Roger, Les camarades. Soldats français et allemands au combat. 1914-1918. Paris, Fayard, 1966, 457 pages.
Yann Prouillet, février 2021
Jacques, Pierre (1879-1948)
1. Le témoin
Pierre Jacques est né le 9 avril 1879 à Halstroff, village de Moselle situé dans le Pays des Trois frontières (France-Allemagne-Luxembourg). Il est issu d’une famille modeste ; sa mère a travaillé comme femme de chambre au Grand Hôtel de Metz et son père est cocher. Après leur mariage en 1872, ils retournent s’installer à Halstroff et ouvrent une auberge-épicerie. Ils ont plusieurs enfants dont Pierre qui fait des études et cultive de hautes valeurs morales. Formé à la Lehrerausbildunganstalt, centre de formation des maîtres de Phalsbourg, il est nommé instituteur à Coin-sur-Seille puis Moyeuvre-Petite, deux villages mosellans francophones. En 1913, il passe professeur à la Handelsschule, l’Ecole de Commerce, de Metz. En février 1915, il est envoyé à Neuss en Rhénanie pour sa formation militaire mais il est jugé inapte en août et rejoint alors son poste d’enseignant. De fait, il ne fera pas l’expérience des combats et de la tranchée. Il décide toutefois d’écrire un « récit symbolique et didactique », une « fiction allégorique » dans laquelle il mêle ses sentiments et son « expérience ». Il l’attribue à Paul Lorrain, avatar combattant d’un professeur pédagogue qui ne combat pas mais souhaite dénoncer la guerre, seul « ennemi haïssable » à ses yeux, et soucieux de faire comprendre l’arbitraire des frontières et la tragédie des guerres. Il fréquente les milieux catholiques messins et est ami de Robert Schuman. S’il est un « produit du système d’éducation [allemand] de l’époque », il est sensible aux valeurs humaines et chrétiennes et ne se départira jamais de son esprit pédagogue. Pierre ne se mariera jamais et Chantal Kontzler et Véronique Stoffel, parentes de l’auteur, présentatrices de cette édition, indiquent que « sa jeune sœur, Lisa, l’accompagnera dans chacun de ses postes ». Resté à Metz pendant l’autre guerre, il revient un temps dans son village au printemps 1945 et meurt dans la métropole lorraine le 2 octobre 1948. Il est enterré dans son village natal.
2. Analyse
Jacques, Pierre, Prussien malgré lui. Récit de guerre d’un lorrain. 1914-1918, coédition Metz, Les Paraiges – Nancy, Le Polémarque, 2013, 127 pages.
Jean-Noël Grandhomme, préfacier de ce singulier ouvrage nous éclaire très opportunément sur celui-ci. En effet, d’abord, il indique que l’auteur « a maintenu intégralement le texte déjà paru du 21 janvier au 8 février 1922 sous le titre Paul Lorrain. Novelle aus dem Kriegsleben eines Lothringers d’un certain Pierre du Conroy (…) dans la Lothringer Volkszeitung, journal des catholiques germanophones de Metz et de l’Est mosellan, dont le groupe « la Libre Lorraine » publie Muss-Preusse en 1931. » Dès lors, il s’agit bien ici d’une fiction à très fort message politique, revendicateur de la notion de Muss-Preusse, « Malgré-nous », dans la lignée de l’association éponyme créée à Metz le 20 mai 1920 par le Sarthois André Bellard. Prussien malgré lui se veut un plaidoyer pacifiste du paradigme. Pour ce faire, l’auteur donne à son épopée l’apparence d’un récit de guerre, mixant réflexion identitaire et histoire d’amour corrompue par le tiraillement des nations, ce sur fond du drame des populations du Reichsland : « tantôt assujetties et délivrées par l’un puis par l’autre, les provinces sœurs Alsatia et Lotharingia subissent le sort des enfants du divorce qui ne peuvent trouver la tranquillité et la paix que si les parents se réconcilient » (p. 23) ! De fait, à l’étude, l’ouvrage vaut certes pour ses informations opportunes sur l’ambiance mosellane et une analyse plus ou moins directe de la question des Alsaciens-lorrains, de leur âme et des grandes questions qui en font la spécificité plutôt que sur la réalité d’une éventuelle part testimoniale à tenter de retrouver dans le récit. On peut toutefois retenir des éléments sur le Gott Strafe England d’Ernest Lissauer (1882-1937) (p. 74), la germanisation des territoires conquis, cf. la défrancisation des noms et des enseignes (p. 79), des exemples nombreux de bourrage de crâne ou le mot Alboche (p. 105).
Yann Prouillet, février 2021
Bier, Charles (1898-1977)
1. Le témoin
Charles Bier, 19 ans, domicilié à Saint-Epvre, au sud-ouest de Metz en Moselle est boulanger quand sa classe (1918), est appelée à rejoindre le front. Il doit revêtir l’uniforme feldgrau et désormais se prénommer Karl. Au foyer, sa mère et son beau-père (il est orphelin de père) semblent l’avoir élevé dans un milieu francophile. Il parle français couramment, a une culture littéraire (il cite Barrès ou Déroulède), politique et évoque à plusieurs reprises les stratégies des lorrains de cœur pour maintenir la culture française, y compris en célébrant les anciennes fêtes à Nancy, restée française. Il a une sœur et deux frères, Gaston, qui mourra dans ses bras le 1er décembre 1918 de maladie contractée en forteresse suite à une tentative de désertion, et Antoine, qui reviendra également du front après avoir été « porté disparu en service commandé sur le front anglais ». Il fait ses classes au 137e IR d’Haguenau et au 166e IR de Bitche mais c’est au sein du 462e qu’il est enrégimenté avec la fonction de mitrailleur. Après-guerre, il reprend son métier de boulanger-pâtissier à Metz, se marie en 1931 et de cette union naitront trois enfants.
2. Le témoignage
Amoros, Nadine, Entre les lignes. & En quête d’Isabelle. Charles, alsacien-lorrain, 1914-1918, chez l’auteure, 2019, 189 pages.
Au seuil d’octobre 1917, Karl rejoint le front dans le secteur de Cheppy en Argonne. Il est mis en réserve un peu plus au nord, dans le secteur Saint-Juvin, Champigneulles, Grandpré, mais, n’ayant pu empêcher un vol de cochon alors qu’il est de garde, se retrouve dans une section disciplinaire qui le renvoie au front dans le secteur de Verdun. « Et là, commença la vraie guerre avec toutes ses cruautés. En mettant cette fois, fin à mes rêves de jeunesse par la vision du spectacle qui s’offrait à mes yeux. Ce grouillement de soldats, entrant et sortant de ces casemates souterraines, attendant avec impatience la relève dans un désordre inextricable, avec leur visage ravagé et leur uniforme saccagé. Une vision douloureuse de cadavres non identifiés, ou d’autres, debout comme des mannequins en vitrine ; barricadés pour l’éternité dans ces barbelés infranchissables. Ces sentinelles accroupies, grelottant de froid avec tout leur fourbi sur l’épaule, les pieds dans la boue, momifiés de stupeur » (p. 26). Devant Verdun, à Noël 1917, sous le feu, il subit la violence et le surréalisme du front, son stahlhelm traversé par un éclat, le commotionnant légèrement. Puis dans la même page, il rapporte la pancarte française écrite en allemand demandant une trêve de Noël : « La surprise fut bien accueillie par les Allemands » dit-il, avant de décrire rapidement son application : « Les ordres durent donnés afin de se replier sur les arrières-tranchées pour mieux participer à ces évènements. Des petits feux furent allumés pour bien spécifier l’accord. Il y eut dans certains endroits des échanges amicaux, des ramassages de blessés de part et d’autre et pas un seul coup de fusil ne fut tiré » (p. 29). Il fait preuve de bravoure, sauvant un temps son lieutenant sous le feu, parvenant également à livrer un message au commandement. Mi-février 18, il est blessé légèrement et intoxiqué par des gaz. Renvoyé du front pour une infirmerie à Laon, il est nommé ordonnance de l’oberleutnant puis capitaine Langberger, un Lorrain. Il est alors embusqué dans les troupes d’occupation (terme cité à deux reprises pages 79 et 94). Il va s’évertuer alors à atténuer le sort de la population, dont il cherche le contact en mettant en avant sa qualité de soldat lorrain arguant volontiers de son pacifisme. Il dit de la perception des envahis à son égard : « Disons que cette population me réservait un bon accueil quand je me permettais de lui dévoiler mon tempérament avec l’accent de chez nous. (…) C’est parmi ces villageois que se développèrent mes capacités de soldat pacifique… » (p. 22). Il va d’ailleurs jusqu’à détourner de la nourriture à leur profit. A Laon, rencontre houleusement (elle le soufflette !) Isabelle, jeune veuve de guerre avec laquelle il va nouer une amitié croissante. La majeure partie de son récit se situant à Laon, il en décrit quelque peu la vie quotidienne. Fin février 18, il est pris dans le bombardement par avions de la gare qui coûte à l’armée allemande « au moins 25 tués, des disparus, un grand nombre de blessés et deux trains avec leur contenu, c’est un désastre » (p. 88). Au cours d’une permission d’ailleurs, il subit à quelques kilomètres de Sedan un mitraillage dans un autre train qui le ramène à Metz, opération occasionnant des morts et des blessés ; « … une fois de plus, je parvins à passer entre les mailles de la mort » (p. 97). Le 28 mars 1918, les Allemands ayant déclenché l’opération Michael, et raclant les fonds de tiroir comme il le lit dans un communiqué « affiché aux pancartes de la Kommandantur », Karl pense retourner au feu mais Landberger parvient à nouveau à l’embusquer en lui confiant une mission d’accompagnement sanitaire « au fin fond de la Prusse », dans un camp de prisonnier de Gros-Strehlitz en Silésie. Au retour, il retrouve toutefois un temps le front d’Argonne (avril-mai) puis participe à la bataille du Bois de Belleau (juin) dans laquelle il est fait prisonnier par les soldats français, puis immédiatement libéré par une contre-attaque. A l’issue d’une seconde permission, il revient à Laon dans un train « entre toutes sortes de soldats allemands qui, eux aussi, ne chantaient plus de belles chansons patriotiques » (p. 160 et 161). Il y retrouve Isabelle qui le travestit en civil, change son identité et lui fait même rouvrir une boulangerie laonnaise en déshérence. Craignant toutefois d’être démasqué, il reprend toutefois l’uniforme vert-de-gris et quitte Laon le 8 octobre 1918, 5 jours avant sa libération par les troupes françaises. Retourné au front, il assiste à la confusion d’une fin de guerre délitante et décrit « à quelques lieues de Chauny » : « Ce fut catastrophique par là. Des soldats allemands disparurent, d’autres firent sauter leurs mitrailleuses à coups de pioches et de grenades à main. Un jour, des soldats de ma section se décidèrent à se rendre, mais n’y parviendront pas, car nous fumes bombardés. Sous ces bombardements nous ferons même plusieurs prisonniers français, sans le vouloir pendant que les murs s’écroulaient sur nous, à nous faire perdre la raison. Français et Allemands finirent par s’enfuir après un véritable adieu amical, où chacun retrouvera sa tranchée. » (pp. 153 et 154).
Insérant quelques chapitres dans les souvenirs de Charles, Nadine Amoros, sa petite-fille, fait état de ses recherches en 2019 pour identifier Isabelle, avec laquelle le musketier semble « avoir continué à échanger par correspondance tout au long de leur vie ». Elle est morte deux années après lui.
3. Analyse
L’auteur, Mosellan « Malgré-nous » de la Grande Guerre nous donne à lire un livre de souvenirs simplement écrit et relativement singulier. Enrôlé tardivement dans ce qu’il qualifie « d’armée d’invasion » (p. 139), il décrit une année d’un conflit qu’il tente d’éviter sans parvenir, comme son compatriote Eugène Lambert, à s’éloigner du front qui le rattrapera épisodiquement. Il parvient tant bien que mal à faire son devoir entre le marteau de la suspicion du commandement, qui enquête sur ses sentiments patriotiques du fait des évasions tentées ou réussies de ses frères (voir son interrogatoire pages 36 à 40), et l’enclume d’une guerre contre les français dont il dit à plusieurs reprises s’être retenu de tuer. Plus encore, au cours de sa bataille du bois de Belleau, il décrit dans le chaos : « … il nous fallut à nouveau partir pour rejoindre une vaste grotte à proximité du lieu. Durant trois jours, un sorte de vision de terreur nous accabla sans distinction, où il ne put être question de boire ou de manger quoi que ce soit ». Suit une vision dantesque des conditions de vie souterraine d’une « garnison » surchargée, narration à l’issue de laquelle il conclut : « La positon n’étant plus tenable il fallait sortir. Alors, durant une courte interruption des combats, je laissai nos prisonniers français prendre le large vers l’arrière » pp. 143 et 144). Dans ce parcours contraint, il parvient à s’embusquer à Laon et noue avec la population civile des relations occupants/occupés qu’il tempère en permanence par sa qualité d’alsacien-lorrain. Et, cas relativement rare dans la littérature testimoniale de ces Reichlander sous l’uniforme allemand, il met en avant l’amitié profonde qu’il noue avec Isabelle, jeune veuve de 2 ans son aînée. C’est cette histoire intime qui nourrit la quête de sa petite-fille pour parvenir à identifier la jeune femme, qu’elle maintiendra toutefois anonyme. C’est également le cas pour Charles dont le patronyme n’est pas révélé et nous remercions l’auteure pour nous avoir permis d’attribuer ce témoignage écrit par Charles quelques décennies plus tard. Il délivre sa démarche d’écriture, située entre 1965 et 1970, en incipit : « J’ai voulu transmettre ma version de cette période telle que je l’ai vécue. Tout particulièrement en pensant à tous ces militaires incorporés par le destin dans les rangs germaniques, disons « malgré eux » (…) Je raconte à la fois, les étapes de cette guerre, notre quotidien de soldat, et aussi des secrets plus personnels ». Il revient d’ailleurs sur cette initiative à la fin de son récit en disant : « Il faudra que mes nombreux amis me pardonnent d’aborder de telles révélations qui touchent tant de secrets personnels. J’ai pris mes responsabilités dans ce que j’ai cité en détail et dont j’atteste la valeur d’authentique réalité ». Il est évident que les souvenirs de Charles ont un double but politique ; démontrer son pacifisme et s’inscrire dans le paradigme des enrôlés de force alsaciens-lorrains qui ont gardé leurs sentiments francophiles malgré 44 ans d’annexion. Charles s’en explique ouvertement ou de manière plus subliminale. Lors de sa visite à la femme de son capitaine protecteur, le messin Landberger, celle-ci lui demande : « Mon mari est-il bien vu par la population ? ». Plus loin, il décrit Metz où les habitants « parlaient en sourdine le français ou le patois régional ». Il fera toutefois une concession au militarisme à l’issue de la cérémonie funèbre des victimes du bombardement de la gare de Laon : « Le garde à vous et la présentation des armes furent si impeccables que cela me réconcilia avec la discipline » (p. 88).
L’ouvrage est bien publié et seules quelques imprécisions dans la transcription du récit ou la toponymie ont été relevées.
Yann Prouillet, février 2021
Marie, reine de Roumanie (1875-1938)
1. Le témoin
La reine Marie de Roumanie est née en Angleterre, petite-fille de la reine Victoria (1837-1901). Son père, Alfred Ernest Albert, duc de Saxe-Cobourg et de Gotha, était le deuxième fils de la reine Victoria, et sa mère, Maria Alexandrovna, était la fille du tsar de Russie Alexandre II. Marie est arrivée en Roumanie en 1892 après son mariage avec Ferdinand de Habsbourg, prince héritier de la couronne de Roumanie. Six enfants naîtront de ce mariage. La reine Marie avait, semble-t-il, une vie amoureuse parallèle ; il y a une série de témoignages sur ses liens avec le prince Barbu Stirbei ou avec l’officier canadien Joe Boyle. En septembre 1914, après la mort du roi Carol Ier, Marie et Ferdinand furent couronnés rois de Roumanie.
Bien que la Roumanie ait secrètement adhéré à l’alliance des Puissances Centrales en 1883 (pour deux raisons : la peur de la politique agressive de l’Empire russe et la parenté du roi Carol Ier avec les Hohenzollern), la Roumanie est restée neutre pendant les deux premières années de la Première Guerre mondiale, et la reine Marie a été un acteur clé dans la décision de 1916 de faire entrer la Roumanie dans la guerre avec l’Entente.
Pendant la guerre, la reine Marie s’affirme par sa foi inébranlable dans la victoire de l’Entente, par ses gestes et ses campagnes caritatives dans les hôpitaux, les orphelinats et les asiles, et par ses nombreuses visites sur la ligne de front où elle encourage constamment les soldats. Grâce à ces faits, sa popularité et celle de la monarchie ont atteint un sommet en Roumanie. En 1919, la reine Marie s’est révélée être la meilleure ambassadrice du pays, visitant Paris et Londres pour obtenir la reconnaissance des frontières de la Roumanie et la volonté des Roumains de Bessarabie, Transylvanie et Bucovine de faire partie de la Roumanie.
Après la guerre, Marie a initié le culte des héros tombés au combat dans les années 1916-1919, encourageant l’érection de monuments dans tous les villages du pays. Son rôle dans la vie publique diminue avec la mort de son mari en 1927. Dans les dernières années, son fils, le roi Carol II, la réprouve parce qu’il l’a toujours blâmée pour sa vie scandaleuse. La reine Marie passe ses dernières années dans les châteaux de Balchik (en Bulgarie aujourd’hui), Bran ou Sinaia.
Elle eut des funérailles nationales à la nécropole royale de Curtea de Arges. Après la chute du communisme, elle est devenue l’une des personnalités les plus populaires de l’histoire roumaine du 20e siècle, et le centenaire de la Première Guerre mondiale et de la Grande Union a été un vecteur important de cette popularité. Beaucoup de monographies ont été écrites, des romans, des films ont été réalisés avec elle comme personnage principal.
2. Le témoignage : « L’histoire de ma vie »
Les années 1914-1919 représentent des parties importantes du journal de la reine Marie écrit tout au long de sa vie. Bien sûr, comme son récit a paru pendant la vie de la reine, quand de nombreux personnages des événements étaient encore vivants, l’auteur a atténué et édulcoré certains des faits. L’histoire de ma vie a été publiée en anglais à Londres et à New York en 1934, donc pendant la vie de la reine, et le texte du manuscrit est écrit dans la langue maternelle de la reine – l’anglais. Il a été traduit par Margarita Miller-Verghy et publié en Roumanie avant que le régime communiste ne soit établi, puis il a été mis à l’index et interdit. Après 1989, il y a eu une série de rééditions, la première en 1991 et la plus récente en 2011 (3 volumes publiés par la maison d’édition RAO que nous avons utilisés dans cette présentation). En 2014, sous l’impulsion du centenaire, la maison d’édition Humanitas a publié en deux volumes l’édition intégrale des manuscrits de la reine conservés sous forme de carnets aux Archives Nationales de Roumanie dans le fonds de la Maison Royale. La traduction à partir de l’anglais a été faite par Anca Barbulescu, et celui qui a pris soin de cette édition était l’historien Lucian Boia.
3. Analyse du livre
L’édition utilisée par nous (L’histoire de ma vie, RAO, 2011) touche à travers les volumes II et III la période la plus difficile, en même temps ridicule et sublime de l’histoire de la participation de la Roumanie à la Première Guerre mondiale. C’est une histoire racontée par une personnalité ayant accès à des informations de premier rang et, évidemment, fait intéressant, c’est une histoire féminine de la guerre. Il faut aussi préciser que le style de l’œuvre est en quelque sorte sirupeux, héroïque et mythique, car il a été la « marque » de la personnalité de la Reine, tant dans sa vie que dans sa postérité.
Du point de vue chronologique, la reine Marie a raconté ses impressions d’août 1916 à mai 1918, et le lecteur est frappé par l’optimisme constant de la reine, qui se glisse à travers tant de tragédies, personnelle (mort de son dernier-né, le prince Mircea le 2 novembre 1916), et nationale qui a culminé avec l’entrée victorieuse à Bucarest des troupes allemandes menées par le maréchal Mackensen le 6 décembre 1916 et le refuge de l’armée, de la maison royale, du gouvernement et de l’administration en Moldavie. La reine est établie à Iasi, la capitale historique de la Moldavie, devenu capitale de l’espoir national et de la renaissance de la Roumanie.
« Je suis entrée dans l’inconnu. Où vais-je ? Combien de temps ? Et pourquoi ? » se demande la reine, mais bientôt les réalités quotidiennes du refuge prennent le dessus. Elle prend des notes brièvement dans la soirée, après une journée épuisante au cours de laquelle elle est prise d’assaut par toutes sortes de demandes de réfugiés qui ont besoin d’aide. Le jour de Noël 1916 est un jour triste dans la ville où les gens n’ont pas de nourriture, et l’épidémie de typhus exanthématique fait des centaines de morts par jour. Chaque jour, la reine tient des audiences, puis appelle les autorités au pays ou à l’étranger à collecter de la nourriture et des vêtements pour les soldats ou les civils. Puis commencent les visites sans fin dans les hôpitaux où, avec les soldats blessés, il y a des civils et des soldats malades du typhus. « L’un des spectacles les plus terribles que j’aie jamais vus est le triage dans la station. C’était une sorte de caserne transformée en hôpital. Dante n’a jamais inventé un enfer plus terrible… », écrit la reine dans son journal.
Bientôt, son nom devient un slogan, celui de la solidarité, du courage et de la résistance. « Je la trouve trop difficile, trop dure, trop lourde, écrit-elle, accablée, mais je vais tout endurer, je me suis juré d’endurer leur amertume jusqu’à la fin. Je crois toujours au fond de mon cœur que cette fin sera brillante, bien que je doive admettre que rien en ce moment ne justifie cet optimisme. »
Le récit de la reine Marie est rare car il montre au lecteur l’histoire d’une tête couronnée qui se manifeste sur plusieurs niveaux. Diplomatiquement : elle entretient des relations avec les membres de la Mission Militaire Française, avec celles des Britanniques et des Américains, et puis avec ses proches à la cour impériale russe. Politiquement : elle soutient et conseille le gouvernement dans ses décisions. Sans oublier le domaine charitable parce qu’elle a visité tous les hôpitaux du pays, aidé les pauvres. Elle est une mère à la fois pour ses enfants et pour les soldats qu’elle encourage en leur rendant visite sur le front. Même si le journal de la reine est subjectif, son attitude au cours de la Première Guerre mondiale reste remarquable, et ce fait a été enregistré par le commentateur et le mémorialiste le plus incisif et malveillant de la vie roumaine dans la première moitié du XXe siècle, Constantin Argetoianu qui a écrit à ce sujet : « Peu importe combien d’erreurs la reine Marie peut avoir commises, avant et après la guerre, la guerre reste sa page, la page qui la caractérise, et la page qui sera placée dans l’histoire comme un lieu d’honneur. On la trouve dans les tranchées parmi les combattants dans les rangs avancés, on la trouve dans les hôpitaux et dans tous les établissements de santé parmi les blessés et les malades. Nous l’avons trouvée dans toutes les réunions qui essayaient de faire un peu de bien. Elle ne connaissait pas la peur des balles et des bombes, car elle ne connaissait ni la peur ni l’absence de douceur ni l’impatience pour des efforts si souvent inutiles, causée par son désir de mieux faire. La reine Marie a accompli son devoir sur tous les fronts de ses activités, mais surtout celui d’encourager et de relever le moral de ceux qui l’entouraient et qui devaient décider, dans les moments les plus tragiques, du sort du pays et de son peuple. On peut dire que, au temps de notre résistance en Moldavie, la reine Marie a incarné les plus hautes aspirations de la conscience roumaine. »
Dorin Stanescu, janvier 2021