Le témoin
Aloyse Stauder naît le 30 septembre 1891 à Gros-Réderching, en Lorraine annexée. Second fils d’une famille de dix enfants, il se destine à une carrière ecclésiastique. Vers 1903, il entre au petit séminaire de Montigny-lès-Metz, avant d’intégrer le grand séminaire de Metz en 1910. Il entame son noviciat chez les jésuites en Belgique en octobre 1913. En septembre 1914, il fait partie d’un groupe de religieux engagés par les chevaliers de Malte à l’arrière du front (du côté de Thionville) comme infirmiers. Il poursuit ensuite ses études en Hollande jusqu’en juillet 1915, quand il doit partir à Jülich (Juliers) en Rhénanie afin d’effectuer sa période d’instruction. A la fin du mois de juillet 1917 – il commence ici son récit –, il est envoyé sur le front russe. Il passe par Cologne, Dortmund, Berlin et Thorn avant d’arriver à Wilna (Vilnius) le 29 juillet, où il intègre la 9e compagnie du 425e régiment d’infanterie de réserve. Il demeure quelque temps à l’arrière. Déjà sergent, il bénéficie d’abord d’une formation pour officiers, puis participe aux travaux auxquels sa compagnie est employée à proximité du front. En novembre, cette dernière est envoyée en première ligne. Il y connaît son baptême du feu et découvre la vie dans les tranchées, mais n’y reste pas longtemps car il reçoit l’ordre de rejoindre le front français le 19 novembre. Il transite par le camp de Beverloo et y reste sept semaines, jusqu’au milieu du mois de janvier 1918, puis arrive au dépôt de la 16e division de réserve à Cagnoncles (à proximité de Cambrai). Il y stationne jusqu’à la fin de février puis intègre la 7e compagnie du 29e régiment de réserve et rejoint le front du côté de Marcoing, au sud de Cambrai, face aux positions anglaises. Les conditions de vie sont éprouvantes et les combats meurtriers. Avec l’unité de mitrailleurs qu’il commande, il participe à l’offensive sur la Somme en mars et avril. Après la relève et un séjour en repos à l’arrière du 28 avril au 11 mai, sa compagnie regagne le front le 12 mai. Le 25, il profite d’une opportunité pour déserter et se rendre aux Anglais. Passé les premiers interrogatoires, il transite dans différents camps de prisonniers avant d’être dirigé vers le camp spécial pour Alsaciens-Lorrains de Saint-Rambert-sur-Loire, où il arrive le 11 juin. Après une semaine de repos, il est détaché dans une ferme pour aider aux travaux agricoles jusqu’au 16 juillet, quand il obtient d’en être relevé. Il est alors employé au camp en tant qu’interprète pour interroger et identifier les nouveaux arrivants. Cette fonction l’enthousiasme et donne lieu à d’heureuses retrouvailles. Le 1er octobre, il décide de s’engager dans la marine française. Cette expérience, dont il sait dès le début qu’elle sera brève, est encore écourtée en raison de la grippe espagnole qui sévit dans les ports mis en quarantaine, et qu’il contracte lui-même. Impatient de rentrer chez lui, il est finalement démobilisé le 23 janvier 1919. De retour à la vie civile, il reprend ses études théologiques en Belgique, est ordonné prêtre en 1922 puis part comme missionnaire jésuite à Madagascar en 1925. Hormis un bref intermède en Lorraine entre 1947 et 1949, il y passe le reste de sa vie et y décède le 24 décembre 1954.
Le témoignage
Aloyse Stauder, Un Lorrain dans la tourmente, 1914-1918, éditions du Belvédère, Pontarlier, 2012, 287 p.
Au cours de ses années au front (à partir de 1917), Stauder tient un journal, rendu par précaution illisible pour autrui grâce à l’utilisation de la méthode de sténographie Gabelsberger. Après la guerre (on ne sait pas quand), il rédige ses mémoires en français (« Mémoires de guerre d’après mon journal ») dans les deux carnets qui sont ici retranscrits. Le journal original a quant à lui disparu. Si le contenu a sans doute été remodelé, ces carnets en héritent une certaine précision dans la chronologie des évènements relatés.
La première partie de l’ouvrage est constituée de l’étude menée par Pauline Guidemann sur les carnets de Stauder dans le cadre de son travail de Maîtrise. Elle y présente l’auteur puis nous offre une analyse thématique déroulée autour de deux axes, la vie de soldat puis « les forces spirituelles et intellectuelles dans la guerre ». L’ensemble est préfacé par Jean-Noël Grandhomme et agrémenté d’un cahier central d’illustrations ainsi que de quelques annexes (chronologies, carte, bibliographie).
Analyse
Ce témoignage offre un tableau assez complet de la vie au front, et se montre volontiers critique à l’égard de l’armée allemande, notamment pour ce qui concerne le ravitaillement et les pillages, relevant selon l’auteur d’une « mentalité générale » (p.170). Stauder dénonce les officiers « planqués » et ne manque pas de relever les exemples d’indiscipline, individuels ou collectifs. Il porte un regard curieux sur les contrées qu’il traverse et les localités qu’il ne manque jamais de visiter, avec une attention particulière pour les lieux de cultes et les pratiques religieuses des populations rencontrées. Nous ne nous attardons pas sur ces aspects, largement mis en valeur par Pauline Guidemann dans son analyse. La principale particularité de ces carnets réside en l’expérience atypique de leur auteur, séminariste originaire de la partie germanophone de la Lorraine annexée (les deux tiers nord-est de la partie de la Lorraine annexée avec l’Alsace en 1871 appartiennent à l’aire linguistique alémanique). S’il semble être, à bien des égards, correctement intégré au sein de l’armée allemande (ses rapports cordiaux voire amicaux avec la plupart de ses pairs le prouvent), il n’en proclame pas moins souvent son attachement à la France. Le culte de la France lui a vraisemblablement été transmis par sa famille qui, d’ailleurs, approuve son projet de désertion. Si celui-ci n’est mis à exécution qu’à la fin de mai 1918, Stauder dit y songer dès le début de sa mobilisation : alors qu’il est encore en garnison à la caserne et qu’on demande des volontaires pour le front français, il se propose avec déjà l’espoir d’être « plus ou moins volontairement prisonnier à la première occasion ». A deux reprises, il voit sa demande rejetée au motif suivant : « Alsaciens-Lorrains exceptés » (p.99). Par la suite, il ne manque pas de se présenter comme Lorrain francophile à chaque rencontre propice, par exemple avec des prisonniers français (p.101), d’autres soldats alsaciens-lorrains (p.106), ou encore des civils polonais (p.113) ou français (p.195, 197). Lorrain et volontiers revendicateur, il est suspect aux yeux de sa hiérarchie, qui le met à l’écart des préparatifs de l’offensive de mars 1918 : « Le seul qui ne fut pas appelé, qui ne s’aperçut de la chose que quand tous les autres étaient partis, c’était moi… » (p.169). Appliquant les prescriptions de plusieurs circulaires de l’Etat-major à propos des Alsaciens-Lorrains suspects, ses officiers semblent éviter soigneusement de l’employer à des postes stratégiques. C’est à nouveau le cas quand on l’écarte d’une patrouille de reconnaissance en avant des lignes (p.207). En plus de ses sentiments francophiles, cette suspicion ne manque pas de le rapprocher de sa patrie de cœur.
Raphaël Georges, février 2015
Pénin, Pierre (1890-1972)
Le témoin
Pierre Pénin naît en 1890 à Moyenvic, canton francophone de Vic en Lorraine allemande, frontalier avec la France, au sein d’une petite exploitation familiale. Il y grandit et s’y marie en janvier 1913. Mobilisé dès le 2 août 1914, il passe successivement quelques jours à la caserne de Forbach, puis à Graffenstaden (banlieue de Strasbourg), où il participe à des travaux de fortification, et enfin à Detmold (Westphalie), avant d’être provisoirement libéré vers le milieu du mois de septembre. Il retourne ainsi à Moyenvic où il demeure jusqu’au 20 mars 1915. Il est alors appelé à rejoindre le dépôt du 17e RI à Coblence. Le 29 juin, avec un contingent de quelque cinq cents Lorrains, il part en direction du front russe. Il y découvre la vie dans les tranchées du 7 au 30 juillet, et connaît par la même occasion son baptême du feu. Les mois suivants sont rythmés par les combats, les repos, les longues marches et les travaux d’aménagement des tranchées. Sortant sain et sauf de nombreux combats meurtriers, il se blesse accidentellement à la cheville le 8 décembre. Cela lui vaut un long séjour à l’hôpital, qu’il achève, rétabli, en y étant chargé de travaux comme la construction d’une station d’épouillage. Il retourne au front vers le milieu du mois de mars 1916, se trouve du côté de Trabechz le 20 avril, puis dans une position devant Postavy, ville occupée par les Russes, à partir de juillet 1916. Il y demeure jusqu’en mars 1917, puis est détaché à la réserve de la 10e armée, avant d’embarquer en gare de Soly le 10 juillet, pour prêter main forte aux troupes autrichiennes en Galicie. L’offensive russe est alors contenue et repoussée par la contre-offensive à laquelle il participe. Le 26 août, son régiment rejoint la Lettonie afin de participer successivement à l’offensive en Courlande (Lettonie), puis à celles menées sur les îles d’Ösel et de Dagö jusqu’en novembre 1917. Le 13 novembre, il repart pour la Galicie, aux environs de Kowel, et est décoré de la Croix de fer le 26. Peu de temps après, au début du mois de décembre, sa division signe l’armistice avec les Russes et, le 20 décembre il embarque à destination du Nord de la France, à Néchin. Après une courte hospitalisation du 23 janvier au 2 février 1918, il retrouve sa compagnie dans les tranchées devant Armentières. Entre le 19 mars et le 9 avril, il séjourne au dépôt de recrues de Lambersart, puis participe à l’offensive sur Armentières, au cours de laquelle il est blessé à la cuisse par un éclat de shrapnel. Evacué en ambulance vers un hôpital de campagne, il est ensuite transféré dans un hôpital à Westerholl, en Westphalie, où il demeure jusqu’au 20 avril, puis dans un dépôt de blessés. Après une permission, il rejoint finalement sa compagnie le 1er juin 1918. Il est détaché pendant un mois dans un village avec un Alsacien afin d’y participer aux moissons, puis retourne dans les tranchées en septembre. Devinant une fin de guerre proche, il décide de gagner du temps en se faisant porter malade pour maux de dents – il s’en fait arracher huit. Il bénéficie ensuite d’une nouvelle permission en octobre, puis note sobrement dans ses carnets, sans plus de détails : « En novembre, la guerre est terminée ». Après guerre, il retrouve sa famille (il aura quatre enfants), son exploitation et travaille en tant que commis agricole dans les exploitations alentour.
Le témoignage
Pierre Pénin, Le carnet de Guerre d’un soldat lorrain. Le périple d’un jeune Moyenvicois de 1914 à 1918, du front russe aux champs de bataille du Nord de la France, publié par l’association Chemins faisant, 2013, 154 p.
Il ne s’agit pas de l’édition d’un carnet de guerre original, comme le titre pourrait le faire croire, mais celle de la transcription a posteriori – et en français – de notes prises pendant le conflit. Le document d’origine, disparu, a donc été retravaillé après la guerre, visiblement complété de souvenirs, et sans doute aussi élagué de certains passages, le tout pour un usage privé. La présente édition est due à l’initiative du petit-fils de l’auteur.
Les façons de rédiger un journal de guerre sont aussi variées qu’évolutives, le témoin n’accordant pas la même importance à des éléments similaires à mesure que le temps passe. Le présent témoignage nous le rappelle. Ainsi, tandis que la chronologie des évènements est peu précise au début de son récit (il a sans doute commencé à écrire quelque temps après le début de sa guerre), elle devient assez minutieuse par la suite, tout autant que les indications de lieux, avant d’être négligée à partir du printemps 1916. Il n’écrit quasiment rien entre la mi-juillet 1916 et mars 1917 et, en dehors de son évocation, il demeure silencieux sur les raisons de son hospitalisation en janvier 1918.
Il s’agit d’une écriture pour soi, contenue dans une sorte de carnet de route et destinée à pouvoir se rappeler plus tard des éléments qui sans cela risquent d’être oubliés. Les quelques mots couchés sur le papier ont une force d’évocation jugée suffisante pour empêcher les souvenirs de disparaître dans les arcanes de la mémoire. Ainsi, l’écriture est factuelle et laisse peu de place aux émotions, pudiquement réservées à la seule mémoire de l’auteur. Quand des surnoms suffisent ainsi à se remémorer des personnes familières rencontrées en cours de route, certaines lignes fournissent une matière suffisante pour se souvenir des combats vécus. Il évoque alors en quelques mots ce dont il est témoin, par exemple les circonstances de blessure ou de mort d’un camarade (« Mon voisin reçoit une balle dans la tête, il s’était un peu montré », p.37 ; « Notre lieutenant tombe à côté de moi d’une balle dans la tête. Il s’appelait Gaquemann », p.38). Ailleurs, il laisse parfois des impressions plus personnelles quand il s’agit de moments éprouvants : « les mitrailleuses crachent et nous fauchent comme du blé, c’est épouvantable » (p.29) ; « A 10 mètres de nous, une jambe, un peu plus loin, une tête, sur les barbelés les cadavres sont restés accrochés et suspendus. C’est terrible à voir et dire qu’il faut passer la nuit à les voir toujours sous les yeux » (p.47).
Le témoignage de Pénin est agrémenté d’annexes utiles, parmi lesquelles on trouve des cartes, des lettres d’un autre jeune de Moyenvic, exécuté par les Allemands après une tentative de désertion, des informations sur la 42e division et sur les batailles de Riga et de la Düna, et aussi une mise en perspective par l’historien Jean-Claude Fombaron – également auteur de la préface – sur les mesures d’exception prises à l’encontre des Alsaciens-Lorrains dans l’armée allemande.
Analyse
Ce témoignage est surtout intéressant pour ce qu’il nous renseigne sur la minorité que constituent les Lorrains francophones dans l’armée allemande. Lors de la mobilisation, tout semble visiblement prêt pour faire passer les appelés de sa contrée de l’autre côté de la frontière (p.12), mais le plan est empêché par la présence de Uhlans envoyés justement pour encadrer la mobilisation. Contraint de se battre pour défendre des couleurs auxquelles il ne s’identifie pas, il adopte volontiers un comportement réfractaire. Ainsi, au cours d’une longue marche sur le front est, au début d’août 1915, lui et quelques-uns de ses camarades s’égarent, apparemment volontairement, et mettent ainsi plusieurs jours avant de retrouver leur compagnie. Il ne mentionne pas de sanction, contrairement à un autre épisode au cours duquel il est puni pour avoir jeté des cartouches dans un ruisseau (p.25).
L’éloignement de sa contrée occasionne des moments de cafard, notamment au moment des fêtes familiales ou patronales. Aussi, il lui est important d’entretenir une grande proximité avec les Lorrains de sa compagnie, et chaque rencontre fortuite avec des connaissances d’avant-guerre, et notamment avec le curé Hennequin – francophile notoire – lui procure un grand plaisir. A l’inverse, l’hostilité est palpable à l’égard de la plupart des « boches » (p.62, 73, 111) de sa compagnie, officiers comme soldats. Le 12 octobre 1917, lors du débarquement sur l’île d’Ösel, il se réjouit de cette situation : « Les chefs n’ont pas encore de chevaux, il faut aussi qu’ils marchent à pied dans la merde jusqu’en haut des bottes » (p.95).
Après un an sur le front russe, il note, en juillet 1916 : « Dans notre abri, nous sommes quinze hommes. Ce sont presque tous de sales boches. On ne s’arrange pas très bien ensemble. Je suis copain avec un Alsacien et un Westphalien. Les autres voudraient me faire partir et ils me font tout le mal qu’ils peuvent. » (p.49). Son identité de Lorrain francophone le rend suspect de francophilie et lui vaut des soucis mais, l’amitié nouée avec ce Westphalien en témoigne, sans pour autant l’isoler complètement. De surcroît, à la manière de poupées russes, cette identité s’emboîte dans celles à dimension régionale regroupant les Lorrains annexés ou plus largement l’ensemble des Alsaciens-Lorrains. Tous partagent les bons comme les mauvais côtés des mesures d’exception prises à leur égard. Ainsi, alors que plusieurs Lorrains désertent en direction des Français dans les tranchées d’Armentières en février 1918, tous les Alsaciens-Lorrains sont retirés du front et envoyés le 19 mars dans un dépôt de recrues à Lambersart. La mesure est plutôt bien accueillie : « Nous faisons des exercices tous les jours mais nous sommes mieux que dans les tranchées. La nuit, on dort tranquille. C’est la belle vie pour nous Lorrains » (p.113)
Cette altérité face à l’Allemand ne doit pas être comprise comme étant exclusive mais plutôt à géométrie variable, ce que tendent à prouver les impressions laissées par les batailles, qui révèlent l’esprit de camaraderie qui le lie à son camp : «ça fait mal au cœur de voir nos renforts couchés derrière un petit talus (…) Les obus tombent au milieu d’eux et les shrapnels retombent sans arrêter. Je me dis pour sûr, il n’en restera plus » (p.38).
Un autre intérêt du témoignage est de nous livrer l’exemple d’un soldat connaissant l’expérience des tranchées sur les fronts est et ouest, avec tout ce qu’elle comporte en malheurs : pilonnages d’artillerie, attaques au fusil et à la baïonnette, les gaz, mais aussi les marches épuisantes, le froid, la boue, la fatigue ou encore la faim. Ce dernier point constitue d’ailleurs une préoccupation récurrente dans son témoignage, tant le ravitaillement est irrégulier. Le système D est souvent de mise, si bien que la maraude (p.66) et le glanage dans les affaires des soldats tombés à proximité apparaissent comme des pratiques de première nécessité (« nous rôdons autour des cadavres pour les dépouiller », p.80 ; et dans un village évacué des environs de Riga : « on leur vole ce que l’on peut : lard, graisse et savon », p.87).
Au front, le temps de la bataille constitue un autre monde, dépourvu de toutes les règles ordinaires, et dans lequel Pénin semble avoir trouvé sa place. Ainsi, lors d’attaques russes au cours desquelles « tout le monde est devenu sauvage » (p.82), il se prend au jeu sans scrupules : « On prend plaisir à tirer tellement la cible est belle » (p. 39). Les moments de repos ou de toilette n’en demeure pas moins des interruptions salutaires (« on revient un peu au monde », p.34 et 41).
D’une manière générale, le témoignage de Pénin renvoie l’image d’un soldat combatif et courageux, une attitude revendiquée d’ailleurs comme une réponse aux suspicions et discriminations éprouvées. Plutôt que par la résignation ou l’évitement, il semble davantage inspiré par le dépassement de soi afin de faire valoir ses qualités guerrières. Ainsi, alors qu’il sort indemne d’effroyables bombardements vers juin 1917, et qu’on cherche des volontaires pour garder les avant-postes, il note : « personne ne veut aller aux avant-postes alors je vais le premier en avant pour leur montrer que les Lorrains ont plus de courage qu’eux » (p.64). A nouveau, le 5 septembre de la même année, le lieutenant réveille son groupe : « Il veut quatre hommes de notre groupe avec lui. Il ne me dit pas pourquoi. J’y vais le fusil au dos » (88). Indubitablement, son expérience de guerre est marquée de son empreinte identitaire de Lorrain francophone.
Raphaël Georges, février 2015
Lorette, Robert, et Fizaine, Fernand
Nous donnons ici ce compte rendu de roman par Raphaël Georges. Les auteurs du livre recensé ont voulu « témoigner » de cette façon de leur guerre.
Lorette (Robert) et Fizaine (Fernand), Frontière, Paris, Firmin-Didot, 1930, 210 p.
Robert Lorette semble originaire de la région de Château-Salins. Fernand Fizaine est quant à lui né le 25 juin 1900 à Moyeuvre et décédé à Paris le 29 avril 1966. Il est l’auteur de deux autres ouvrages plus tardifs . Les deux auteurs sont des amis d’enfance ; ils ont fréquenté le même collège à Metz avant d’être séparés par la guerre. Leur ouvrage est un roman à tendance autobiographique, un genre qui permet de s’arranger avec la réalité : « Si certains épisodes furent personnellement vécus, d’autres seulement observés, qu’importe ! », note une journaliste du Figaro, car leur ambition est de « tracer une synthèse de tous les combattants dans leur situation » . Ainsi, dans le roman, Robert Lorette devient Roland Lorquin, tandis que Fernand Fizaine prête ses traits au personnage de Firmin Margaine. Basé vraisemblablement sur leurs souvenirs de guerre, le récit contient peu de repères chronologiques. Pour les dialogues, l’écriture emprunte largement à la langue parlée et à l’argot.
Originaires de Château-Salins (Roland) et de Moyeuvre (Firmin), puis scolarisés ensemble au collège Saint-Clément de Metz, les deux personnages principaux ont grandi dans la partie traditionnellement francophone de la Lorraine annexée, où le souvenir de la France est encore largement entretenu dans les familles. Ainsi, en 1914 encore, Roland assiste avec son père au défilé militaire du 14 Juillet à Nancy. Ces deux jeunes Lorrains francophiles font donc le choix de la France dès le début des hostilités : après avoir assisté de loin à la défaite française de Morhange, Roland quitte sa famille en août 1914, à l’âge de 17 ans, décidé à rejoindre Nancy pour s’engager dans l’armée française. De son côté, Firmin tentera plus tard de mettre son plan de désertion à exécution, quelques jours avant son conseil de révision, mais devra l’abandonner au dernier moment et se résoudre à endosser « l’uniforme abhorré » allemand. Pour sa part, Roland se montre tout à la fois fier d’intégrer l’armée française idéalisée et impatient de monter au front pour en défendre les couleurs. Il n’a pas trop de mal à s’intégrer dans son régiment du Midi. Dès ses classes à la caserne de Toulouse, il tisse de forts liens d’amitié avec son camarade Brissac originaire de Haute-Garonne. Au front, il bénéficie de la sollicitude de ses camarades qui étouffent leur joie devant lui au moment de la distribution du courrier car, coupé de sa famille restée en Lorraine, soumise d’ailleurs à une surveillance étroite de la part des autorités allemandes depuis sa disparition suspecte, il est le seul à être privé de toute correspondance. Son baptême du feu, à proximité d’Arras, est très violent et lui occasionne d’emblée l’expérience de donner la mort. La dureté des combats, en particulier en 1916 dans le secteur de Verdun (bois d’Avocourt), ainsi que les rudes conditions de vie au front atténuent son enthousiasme initial et il attend bientôt les repos à l’arrière avec autant d’impatience que ses pairs. La dizaine de jours qu’il passe en permission à Marseille constitue un moment de répit particulièrement apprécié, loin des images de la guerre. Au cours d’une âpre bataille, se trouvant seul dans un trou d’obus avec un de ses proches camarades touché mortellement, il éprouve un bouleversement total lorsqu’il entend des soldats parler le patois lorrain dans la tranchée adverse. Il se produit un véritable choc identitaire : « Il pensa soudain qu’il se battait non seulement contre des ennemis, mais aussi contre des amis et peut-être même contre des frères » (p.111). Cette idée qui l’obsède le rend désormais incapable de participer activement au combat : « Dans le doute, je ne tuerai plus ». Puis une nouvelle lui parvient et renforce son trouble : il apprend que son père, volontaire dans la Croix-Rouge, a été arrêté par une patrouille française et qu’il est depuis détenu comme espion à Tours. Roland parvient à le faire libérer, grâce à l’intervention de son capitaine, mais n’en est pas moins éprouvé : cette armée, pour laquelle il était prêt à sacrifier sa vie, a emprisonné son père comme un traître. Enfin, un dernier évènement achève de le pousser dans un accès de fureur, quand il se voit traiter de « boche » par un adjudant. Complètement bouleversé par ces épreuves, il obtient de son colonel de quitter le front pour rejoindre l’Algérie, une alternative réservée aux Alsaciens-Lorrains. Il prend donc le large avec soulagement, et rejoint la caserne d’Orléans à Alger. Il y profite de meilleures conditions de vie, mais demande bientôt à pouvoir rejoindre son régiment à l’automne 1918, pour éviter de participer aux combats dans le sud-tunisien : « J’aime encore mieux crever en France ». Ainsi, il retrouve dans la joie Brissac et ses anciens camarades le 9 novembre 1918 à Pont-à-Mousson.
Le parcours militaire de Firmin est moins bien renseigné. Mobilisé plus tard, les premiers chapitres qui lui sont consacrés permettent d’entrevoir les conditions de vie des civils en Lorraine, soumis à la dictature militaire imposée dans toute l’Alsace-Lorraine. En 1916, après sa tentative avortée pour éviter l’enrôlement dans l’armée allemande en passant en Suisse, il est mobilisé dans la 2e compagnie du IXe régiment d’infanterie basé en Prusse orientale. Il vit mal sa période d’instruction, dénonçant la grossièreté et la brutalité de ses camarades et des gradés. Les Lorrains font l’objet de nombreuses tracasseries, notamment quand on les surprend à converser en français. Firmin est un jour pris à partie par plusieurs Allemands bien décidés à le passer à tabac, et ne doit son salut qu’à l’intervention de son camarade lorrain Petitmangin, lamineur dans le civil et doté d’une force incomparable. Dans une bagarre majestueuse, les deux arrivent finalement à bout des assaillants. Peu de temps après cependant, ils sont envoyés sur le front russe. Là, les auteurs brossent un tableau très noir de la situation, teinté d’une critique du militarisme prussien : « serfs des temps modernes », les soldats « ne sont rien, rien que du matériel humain (…) : Menschenmaterial ! » Ils sont soumis à des conditions de vie très difficiles (froid, faim, vermine) et une grande lassitude les gagne. Par ailleurs, Firmin ne se remet pas d’avoir asséné un coup de poignard mortel au soldat russe qui venait de tuer Petimangin, au moment même où les deux amis avaient prévu de se rendre aux Russes. Pour ce qui est pris comme un acte de bravoure, il est décoré de la Croix de fer, un insigne honteux pour lui et qu’il cache à sa famille (son père a été emprisonné pour ses sympathies à l’égard de la France). De retour sur le front français en avril 1918, il n’attend plus que la mort pour se sentir libéré de ses tourments ; c’est finalement une blessure par éclat d’obus qui le conduit à l’hôpital pour le restant de la guerre. Lorsqu’il retrouve sa caserne, celle-ci est en proie aux troubles révolutionnaires qui agitent toute l’Allemagne. Il en profite pour décrocher une fausse permission ainsi qu’un titre de transport qui lui permettent de rentrer à Moyeuvre vers le début du mois de novembre 1918. Il peut alors participer aux préparatifs pour l’arrivée des troupes françaises. Le 19 novembre, en assistant au défilé des Poilus à Metz, il reconnaît dans leurs rangs son ancien ami Roland. Les retrouvailles sont chaleureuses et offrent l’occasion à ce dernier, pourtant auréolé du prestige de l’armée française victorieuse, de dire son dégoût de la guerre et de conclure : « Notre cœur, à nous autres de la frontière, est trop grand pour une, et trop petit pour deux patries… ».
Bien que publié sous la forme d’un roman, ce qui empêche d’en démêler le vrai du faux, ce témoignage n’en est pas moins intéressant car il s’inscrit dans la courte liste de la littérature de guerre dédiée aux Alsaciens-Lorrains. A ce titre, ce roman, adapté ensuite en pièce de théâtre, participe à la construction et à la fixation dans la mémoire collective de la figure du soldat alsacien-lorrain de la Grande Guerre : un homme résolument francophile, contraint d’endosser à contrecœur l’uniforme allemand. Longtemps admise, correspondant à l’image véhiculée en France des habitants des provinces recouvrées, cette figure réductrice est aujourd’hui à nuancer. Dans cet ouvrage, les auteurs expriment leurs sentiments pro-français au moment de la guerre en les projetant sur les deux personnages principaux. Les rares allusions aux Alsaciens confortent leur idée (par exemple p.140 : « Dans un autre régiment de la garnison, des Alsaciens avaient tué à coups d’escabeau un sous-officier qui s’était montré particulièrement odieux. »). Celle-ci est en outre renforcée par la vision manichéenne opposant une armée française valorisée à une armée allemande accusée de tous les maux. Or, si l’attachement à la France perdure dans certaines familles d’Alsace-Lorraine depuis l’Annexion de 1871, les soldats alsaciens-lorrains faisant acte de rébellion ou de désertion n’en sont pas moins minoritaires. En réalité, si l’on peut admettre la véracité des sentiments des auteurs, et du coup leur description partiale des évènements, c’est en partie lié à leur origine, puisqu’ils sont tous deux nés dans la marge occidentale traditionnellement francophone de la Lorraine annexée. Cette précision, qui n’apparaît à aucun moment dans le récit, explique à elle seule qu’il ne soit pas possible de généraliser leur identité propre au reste de la population de l’Alsace-Lorraine.
Raphaël GEORGES, mars 2013
Lambert, Eugène (1876-1956)
1. Le témoin
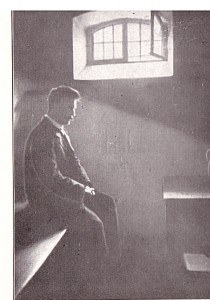 L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein
L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein
Eugène Lambert naît à Mainvilliers (Moselle) en 1876. Marié à Marie, il a trois enfants ; une fille, un fils, Rémi et Suzanne, qui naît en 1914 alors qu’il est en captivité. A la déclaration de guerre, il travaille au journal francophone le Lorrain à Metz. Francophile, secrétaire du comité du Souvenir Français de Noisseville (Moselle), il deviendra après-guerre publiciste, président du Syndicat d’initiative et à ce titre membre fondateur de la Foire d’automne de Metz, ville dans laquelle il est socialement très actif. Conseiller municipal messin, vice-président de l’Amicale des anciens incarcérés politiques d’Ehrenbreitstein, il reçoit le 12 juillet 1935 la médaille d’honneur (vermeil) de la Reconnaissance française pour ses actions de propagande francophile alors qu’il était sous l’uniforme allemand. Il décède à Metz le 7 mai 1956.
2. Le témoignage
Lambert, Eugène, De la prison à la Caserne ! Journal d’un incarcéré politique d’Ehrenbreitstein. 1914-1918. Metz, imprimerie Paul Even, 1934, 234
pages, (tirage limité à 250 exemplaires).
Eugène Lambert, se sachant recherché, est arrêté dans les bureaux du journal Le Lorrain le matin du 1er août 1914 et conduit à la prison militaire de la Place Mazelle, rue Haute Seille à Metz. Il en est extrait dès le lendemain pour être acheminé à la forteresse d’Ehrenbreitstein à Coblence, au bord du Rhin. Il reste incarcéré dans les fameuses casemates comme prisonnier politique, sans jamais connaître la raison de son arrestation. Le 24 septembre 1914, il fonde au sein de la forteresse, avec quelques détenus, « L’Union », « société des détenus politiques d’Ehrenbreitstein » (page 79).
Ayant la confiance des détenus, il est même mandaté pour tenir leurs comptes (page 83). Mobilisable dans l’armée allemande, il est transféré le 25 février 1915 de la prison à la caserne Ravensberg du 66e régiment d’infanterie allemand de Magdebourg (Saxe-Anhalt). Sous-officier, il occupe plusieurs fonctions et est muté dans un régiment territorial (à Quedlinbourg) le 15 mai 1915, suite à sa simulation d’un problème au cœur. Usant, comme beaucoup (voir page 229), de tous les subterfuges pour paraître malade, y compris en perdant anormalement du poids, sa crainte ultime est d’être muté sur le front russe dans un régiment combattant. Il sera d’ailleurs l’un des rares sous-officiers lorrains à ne pas y être affecté. A Magdebourg, affecté au 1er territorial, il est notamment affecté comme geôlier – lui qui a été détenu 7 mois en forteresse – à la garde de prisonniers belges. Surpris à leur parler français, alors qu’il leur fournit des informations, il est déplacé le 15 juin 1915 à Altenbourg (Thuringe) au 153ème régiment d’infanterie d’active. Considéré comme suspect, il y est particulièrement surveillé mais échappe à plusieurs commissions médicales qui veulent l’affecter en Russie. Il a en effet une certitude : « (…) on veut se débarrasser de moi, j’en ai la ferme conviction. Je n’arriverai jamais au front, me dis-je, ou si j’y arrive, je n’y serai pas longtemps. Sans doute, quelque gradé aura mission de me nettoyer de propre façon » (page 139).
Reclus dans son régiment, dans lequel il va rester jusqu’à l’Armistice. Il finit par obtenir enfin une permission en mai 1918 et retourne à Metz où, le
17, chez lui, il déclare paradoxalement : « Pour la première fois depuis la guerre, j’ai entendu le canon » (page 203). A Altenbourg, au fil des mois, il débute une propagande zélée de « doctrines antimilitaristes, antiprussiennes et francophiles [dans une] Saxe (…) foncièrement socialiste » (page 153) et va même jusqu’à fonder le 19 mai 1917 « l’Espérance », « journal manuscrit clandestin à l’image des compagnons d’exil. Paraissant en Barbarie ». Hebdomadaire écrit en français, et destiné à donner des nouvelles aux prisonniers des environs, il paraîtra jusqu’à la fin. Eugène Lambert vit ainsi le lent mais inexorable enfoncement de l’Allemagne dans la crise morale et alimentaire qui va amener à la situation révolutionnaire de l’automne 1918. « Singulier spectacle que ce peuple victorieux et mendiant » dit-il le 18 juillet 1915. Le 11 novembre, « cette fois, c’était bien la délivrance » (page 212) et le seul but qui maintenant le préoccupe est le retour en homme libre dans une Lorraine redevenue française. Il quitte Altenbourg le 17 novembre et, après avoir traversé une Allemagne où « l’anarchie règne en maîtresse » (page 215), Eugène Lambert arrive à Metz le 25 novembre 1918 et retrouve enfin sa famille.
3. Analyse
Deux ouvrages de volumes sensiblement égaux composent ce journal d’un « Malgré nous »[1] ; le journal d’un incarcéré et les souvenirs d’un Lorrain sous l’uniforme allemand. Francophile propagandiste, le témoignage d’Eugène Lambert est forcément partial mais nombre d’informations subsistent sur la vie en prison (pages 17 à 34), en forteresse (pages 35 à 117) comme sur l’ambiance de la caserne de l’armée allemande, la vie à l’intérieur dans le régime de blocus qui ronge le pays et qui va l’amener à la révolution (pages 137 à 214). Débutant son journal le 27 juillet 1914, il nous permet d’appréhender les heures intenses précédant la déclaration de guerre à Metz et son arrestation, le 1er août. Ces quelques pages sont ainsi à rapprocher du journal de guerre de René Mercier qui décrit des scènes semblables à Nancy[2]. Très psychologiquement touché par son incarcération, Eugène Lambert témoignage des affres de sa vie d’interné, craignant d’être fusillé pour ses activités francophiles. Il balance entre obéissance et évasion mais se soumets sous la menace des représailles à sa famille (page 9). L’ouvrage témoigne aussi des difficultés d’une écriture de la claustration tant le confinement et l’absence quasi-totale de nouvelles provenant de l’extérieur ne permettent pas l’enrichissement du témoignage. Il y parvient toutefois, nous parlant des ruses pour obtenir de l’argent par sa famille (pages 55 et 80), et pour le cacher dans des boutons de caleçon (page 80), pour tromper la censure, en écrivant « sous les timbres, dans les doublures d’enveloppes ou avec du jus d’oignon comme encre sympathique » (page 80), sachant que toute correspondance doit obligatoirement être écrite en allemand (pages 63 et 79). Il évoque aussi les mouchards (page 80), la collaboration (page 104) ou les fraternisations avec les gardes (page 97), qu’il appliquera lui-même quand il sera geôlier. Il craint la folie, notamment quand il ne peut plus sortir de sa casemate à cause de la neige : « Nous filons toutes voiles déployées vers la neurasthénie, la folie ! » (page 105) et évoque même le suicide le 27 janvier 1915 (page 106). Libéré pour être encaserné, il fait un court retour sur la sociologie des prisonniers, de tous statuts et de toutes nationalités (page 115).
Vêtu de force de l’uniforme feldgrau, arrivé à la caserne, son témoignage change d’aspect, passant de l’écriture journalière à des souvenirs reconstruits, épisodiques, vraisemblablement basés sur un carnet. Affecté à une unité de réserve (son fusil est russe), il atteste de l’impréparation du soldat allemand au combat : « J’en ai vu partir qui ne savaient pas se servir de l’arme à feu, qui n’avaient jamais tiré un coup de fusil » (page 180) et de la violence du dressage des hommes (page 152), « matériel humain »[3] (…) en voie de s’épuiser (page 177). Observateur privilégié, il assiste à la double déchéance des sociétés allemandes ; la disette de la société civile et « un esprit de lassitude et de défaitisme » (page 164) de la société militaire, dont les conditions de vie matérielles se dégradent inexorablement : « Un ordre prescrit aux soldats de livrer leurs chaussettes pour être conservées dans les dépôts jusqu’au jour où ils partiront en campagne » (page 165). D’ailleurs, Lambert témoignage à partir de 1916 d’une recrudescence des suicides militaires comme civils (pages 168, 169, 171, 178). Il est témoin de la dégradation d’un militaire suite à une automutilation (page 189). La crise économique est telle que « des permissions sont offertes aux Alsaciens-Lorrains qui promettent de rapporter de l’or » (page 179), « les tissus sont tellement rares que les uniformes militaires ne sont plus en drap, mais en une sorte de feutre pressé. Dans les magasins, on vend du linge de corps en papier, la toile et le fil ayant disparu du marché » (page 180) en janvier 1917, « on recommande dans les journaux, de chasser les corbeaux qui s’abattent par nuées sur la région » (page 182). Le pain est « une composition dans laquelle la pomme de terre, la sciure de bois et le son entrent pour une grande part » (page 183) et des troubles éclatent à Leipzig et Altenbourg suite aux pénuries alimentaires. De retour de la seule permission qu’il parvient à obtenir en mai 1918, il constate « les ravages de l’idée révolutionnaire dans les casernes » et que « des incidents très suggestifs se produisent qui révèlent l’état d’esprit de la troupe » (page 208). Ils se traduisent par les premières marques d’irrespect envers les officiers qui dès lors « n’en mènent pas large » (page 208) ; certains « ont même été frappés par les hommes à la moindre observation » (page 209). L’anarchie monte à l’été 1918, « les hommes que l’on envoie au front refusent carrément de marcher (…) arrêtent le train, détruisent les fils télégraphiques et se dispersent dans la campagne » (p.209). C’est le début de la fin qui amène à la « paix de raison (Vernunftsfrieden) »
(page 212) et les jours de novembre, vécus à Altenbourg, sont surréalistes (pages 230 à 233). Son retour à Metz et le défilé des soldats français devant
Raymond Poincaré le 28 novembre 1918 lui suggèrent ces mots en forme de conclusion : « Je défie la plume la plus experte de décrire ce que nous autres Messins avons ressenti ce jour là » (page 220).
Yann Prouillet, février 2013
[1] Terme employé par Eugène Lambert dans sa préface, écrite en juillet 1934, mais non présent dans ses écrits rédigés avant Noël 1918.
[2] Voir sa notice dans le présent dictionnaire ou sur http://www.crid1418.org/temoins/2012/03/28/mercier-rene-1867-1945/.
[3] Cette notion de « Mensch material » ne saurait ici être comparée ou rapprochée de l’application concentrationnaire de l’autre guerre.