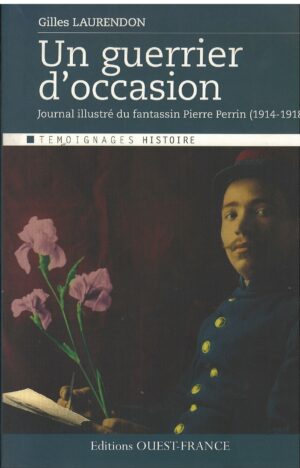Mouton, Auguste, Rosée sanglante. Journal d’un soldat de la Grande Guerre, CSV éditions, 2017, 257 p.
1. Le témoin
Auguste Mouton est né le 30 avril 1891 à Bourges, dans le Cher. En 1904, il entre au petit séminaire Saint-Célestin, aujourd’hui lycée Jacques Cœur, dans cette même ville. Il y acquiert manifestement de solides éduction et connaissance générale. Il parle anglais, ce qui lui servira à la fin de la guerre, avec 3 sergents noirs américains en Argonne (p. 211) ou se fera même un temps interprète auprès des anglais (p. 229). Il joue de l’harmonium, mais il ne sait toutefois pas nager. À sa sortie, il est employé de banque et demeure à Paris. En 1912, il fait sa période militaire au 51e RI de Beauvais, caserne Watrin, d’abord comme élève caporal puis occupant des fonctions de secrétaire. Il termine sa période peu avant la déclaration de guerre qui le rappelle le 2 août à la 20e compagnie. Il quitte la caserne le 14. Il perd sa belle-mère le 6 juin 1916, nouvelle qui l’attriste, puis épouse en pleine guerre Elise, qu’il appelle Lily, en l’église de La Madeleine à Paris, où il demeure, rue Victor Massé, le 15 septembre 1917. Il fait d’ailleurs à plusieurs reprises, en fonction de ses fonctions ou de ses stations à l’arrière du front, venir sa femme « en douce » à chaque fois que possible. Il ne sera démobilisé que le 16 août 1919. Il reprend d’ailleurs, au cours d’une permission, quelques jours, son travail à la banque parisienne Société Générale avant même d’être démobilisé. Dans les années 30, il s’installe dans l’Eure, à Nassandres. Du couple naîtront André, né le 19 septembre 1919, (mort le 15 février 1942), Monique, née le 25 juin 1930 (décédée le 21 mars 1948) et Eliane, née le 21 février 1935. Auguste décède à Evreux le 3 décembre 1972 à l’âge de 81 ans. C’est Véronique Normand, arrière-petite-fille d’Auguste qui publie les souvenirs de guerre du témoin.
Son parcours dans la guerre étant divers, le sont aussi ses différentes affectations relevées de son récit : 51e RI (20e puis 30e Cie) jusqu’au 30 avril 1915 où il passe à la vaguemestre du 3e compagnie hors rang du 3e bataillon du 402e bataillon de marche, à l’existence éphémère puisqu’il est dissous début avril 1916. Il est donc muté au 111e d’Antibes, régiment qui sera lui-même dissous début juillet 1917. Il passe alors dans différentes compagnies du 298e RI, changements multiples qui s’accompagnent le plus souvent d’une phase de cafard. Après-guerre, ce dernier régiment est à son tour dissous, lui occasionnant à nouveau la charge d’en liquider la comptabilité, rendant ses comptes à l’officier de Détails (p. 239 et 240). Il est alors affecté aux 5ème puis 7ème compagnies du 120e RI où il occupe diverses tâches, dont celle de repérer les obus non éclatés pour les signaler aux artilleurs pour le désobusage.
Il apprend le 23 novembre 1916 qu’il est proposé pour la croix de guerre avec une belle citation pour sa conduite au fort de Vaux (p. 160), qui lui sera remise dans la tranchée-même début mars 1917 (p.e 168). Il en obtient une seconde en août 1918. Paradoxalement il gardera toute la guerre son grade de sergent, expliquant « que mon poste de sergent-vaguemestre était plus enviable que les galons de sous-lieutenant » (p. 101). La guerre terminée et avant sa démobilisation, il occupe un temps la fonction de sergent-major, redevenant fourrier après la dissolution de son dernier régiment (298e). A noter que sa fonction de vaguemestre, rarement documentée, rapproche cette partie du témoignage de celui de Félix Braud in Les carnets de guerre du sergent vaguemestre Félix Braud, (1914-1917) (Senones, Edhisto, 2002, 191 p.).
C’est lui qui donne la conclusion de son récit, aussi encyclopédique que pédagogique, lorsqu’il est enfin libéré de ses 8 années de vie militaire : « Adieu donc à ce passé où la souffrance a eu la plus large place, où la mort m’a survolé tant de fois. Adieu aussi aux inepties du métier ! Adieu enfin aux heures si rares de franche gaieté que j’ai pu y trouver, car l’esprit français est ainsi fait qu’il oublie facilement le danger pour ne penser qu’aux joies connues ». Il ressortira toutefois du conflit avec un profond sentiment antiallemand, n’étant pas sorti de la guerre pacifiste : « Pour ma part, étant revenu indemne de cette longue guerre, je ne peux que remercier Dieu, mais toute ma vie je me souviendrai du mal que l’Allemand m’a causé ; je ne lui pardonnerai jamais d’avoir brisé ma jeunesse pour satisfaire son ambitieuse folie des grandeurs. L’ayant vu à l’œuvre, je sais qu’il est plus barbare que nous, plus cruel et indigne de la moindre pitié. Je ne lui connais aucun acte loyal à son actif et j’enseignerai à mon petit André la haine nécessaire pour un tel adversaire à jamais conciliable. Car malgré la défaite, il va travailler comme par le passé pour la Revanche » (page 250).
2. Le témoignage :
Recomposé après-guerre sous forme de synthèse construite et enrichie, Auguste Mouton nous renseigne dans une émouvante dédicace sur ses conditions et le pourquoi de son écriture, manifestement basée sur un scrupuleux journal de guerre : « Pour toi mon petit André chéri [son premier fils], j’ai réuni dans ce cahier les heures les plus douloureuses de mon existence avec les impressions que j’en ai ressenties au jour le jour. Ce recueil, dont le premier chapitre avait déjà été dédié et offert à ta petite maman avant que tu ne fusses de ce monde est la reproduction exacte et fidèle de celui que je traçais quotidiennement soit pendant les heures de répit que me laissait la mitraille soit au repos ou à l’abri des obus. C’est le résumé de mes 5 années passées sous les armes alors que je finissais à peine mes deux ans de service obligatoire au 51e régiment d’infanterie à Beauvais. Quand tu seras en âge de le lire et que certains passages te forceront à me questionner tellement les horribles détails de ce monstrueux carnage te paraîtront effrayants, ce sera ma joie d’être près de toi et de fournir les explications nécessaires à ta jeune imagination. (…) Tu pourras grandir dans la paix et le bonheur mon petit André, aux côtés de ton papa et de ta maman, après avoir eu la chance inouïe de se retrouver malgré le plus effroyable cataclysme que la terre ait jamais vu, n’ont eu qu’un désir : te connaître pour t’aimer et être aimé de toi » (p. 11). Mais Auguste Mouton nous renseigne également sur son processus d’écriture en insérant quelques informations architecturales de son récit pour le lecteur. P. 45, il prévient : « Là s’arrête la première partie de mon récit ». Il tient donc un journal et écrit également sa correspondance, qui n’est pas publiée ici. Il dit : « J’écris encore pour que les êtres qui me sont chers aient de mes nouvelles, car je sais que nos lettres arrivent paisiblement et lentement à leurs destinataires » (p. 53), lettres qu’il fait passer parfois en dehors du circuit militaire (p. 105). Poursuivant la pédagogie de sa narration à l’endroit du lecteur, à l’issue de son transfert à l’arrière après sa blessure, il avise : « Les pages qui vont suivre ne seront pas aussi riches en détails pour les deux raisons suivantes. La première c’est que du jour où j’ai quitté la zone dangereuse, j’avais moins d’intérêt à faire un journal vulgaire de ma vie que je considérais définitivement sauvée à ce moment-là. La deuxième raison c’est que le jour où, à mon grand désappointement, je rejoignis la ligne meurtrière, il était interdit de conserver sur nous des carnets de guerre ou autres feuilles similaires. Les événements nous avaient appris en effet que les Allemand avaient su tirer par de ces renseignements divers trouvés sur des prisonniers. Ils connaissaient ainsi le moral des officiers et des soldats, nos habitudes de relèves dans certains secteurs et même nos projets d’attaque qui ne se produisaient pas toujours ». Il ajoute enfin : « Malgré l’absence de ces notes, les chapitres suivants n’en contiendront pas moins des dates et des faits rigoureusement exacts puisqu’ils ont été reconstitués à l’aide de la correspondance quotidienne échangée entre ma chère Lily et moi et grâce à laquelle j’ai pu tirer d’aussi justes renseignements que d’un carnet de route » (p. 69 à 70). Dès lors, le récit d’Auguste est bien un journal de guerre recomposé mais seule son honnêteté intellectuelle permet de le déceler tant l’écriture est précise et continue sur l’ensemble des six années de guerre.
L’avant-propos de Véronique Normand nous renseigne sur l’explication du titre de l’ouvrage. Elle précise : « Rosée sanglante » est le titre d’un encart inséré dans le livre relatant le soir du 26 septembre 1914 où un combat sanglant eut lieu près de La Neuville, hameau du secteur de Commercy dans la Meuse » (p. 7 et 52). C’est Auguste Mouton lui-même qui fait ressortir par encarts quelques épisodes marquants de sa guerre. Ainsi : Le rempart humain (p. 21 – 23 août 1914) – Rosée sanglante (p. 52-53) – Une visite médicale aux armées, Le Sourrriat – 20 avril 1918 (p. 208 à 210).
Par sa précision et son extrême diversité d’expérience, le récit d’Auguste Mouton se classe parmi les tout meilleurs témoignages émanant d’un soldat d’infanterie ayant, miraculé de nombreuses fois, fait l‘ensemble de la campagne sur divers fronts, souvent les plus dangereux, sur l’ensemble du conflit, période d’hôpital non comprise puisqu’il a été blessé plusieurs fois. Un nombre considérable d’éléments utiles à l’historien sont ainsi à dégager de ces pages denses et précises. Sa formation de jeunesse au Petit Séminaire fait comprendre la grande piété toujours manifestée d’Auguste Mouton, qui se tourne fréquemment vers Dieu, notamment aux périodes les plus menaçantes, pendant lesquelles il l’implore même parfois (7 décembre 1917 lors d’un nouveau séjour à Verdun (p. 192)). Dès lors il se pense protégé par ses prières (p. 44 et 51) et le fait qu’il se fie souvent à sa « bonne étoile » l’est à juste raison finalement (p. 153). Il le dit ouvertement le 16 octobre 1918 : « …mais comme toujours j’ai confiance en ma bonne étoile et je suis persuadé que je vais m’en tirer » (p. 230). Il quitte par exemple son gourbi quelques minutes à cause d’un bombardement, pour le retrouver complètement défoncé. Il dit alors : « Probablement que si j’étais resté dans mon gourbi, j’aurai été aplati comme une galette » (page 189). Malgré ce sentiment de protection, il est lucide et dit, le 17 octobre : « Nous sentons une terrible appréhension en approchant de la fin de la lutte. Fatalement on devient égoïste et ce n’est pas une lâcheté après cinquante mois de guerre. Je ne réclame que mon droit, celui de vivre après tant d’épreuves et de souffrances ce qui ne serait que justice » (p. 230).
3. Analyse
Un formidable témoignage, issu d’un homme lettré, réflexif, à la profonde culture religieuse, et avec un vrai talent narratif. Noms et lieux sont décrits précisément, de même que mille données et anecdotes qui rendent l’ouvrage particulièrement vivant et fourmillant d’informations, parfois successives à chaque page, ce jusqu’à la dernière.
Dès la mobilisation en masse, dont il participe à l’organisation comme sergent, il n’est pas dupe sur les heures terribles qui l’attendent. Il dit, le 12 août : « j’éprouve l’impression que nous sommes des bestiaux qu’on embarque vers un lointain abattoir » (p. 16). Comme nombre de soldat, il aspire à combattre. Le 14 août, montant sans frein vers le nord, il confie : « Le temps est radieux, nous vivons presque tranquilles. C’est à croire que la guerre va se terminer sans notre intervention » (p. 17). Mais il commence bientôt à entendre le bruit du canon au loin, qui génère les premières angoisses.
Le témoignage est honnête et sincère, assez peu teinté par l’exagération et le bourrage de crâne, même s’il n’en est très ponctuellement pas universellement exempt. Comme ce rempart de cadavres allemands, qu’il rapporte toutefois, ne l’ayant pas constaté lui-même : « D’après leur récit, ils ont plutôt fait l’œuvre de fossoyeurs car, pendant un recul momentané des Allemands, ils ont ramassé un nombre considérable de cadavres au point de s’en faire une ligne de rempart toute grise derrière laquelle ils attendaient le retour offensif de l’ennemi » (p.20). De même ces allemands brûlant 800 corps de leurs camarades debout dos à dos, témoignage par procuration des civils (p. 38). Les pages qui suivent témoignent de la pression qui fait redescendre population en exode et tout le régiment vers le sud, l’armée perdant la bataille des frontières, il constate : « Partout c’est la misère qui passe et de voir pleurer tant d’innocents, nous maudissons la guerre et nous leur promettons en passant d’être impitoyables avec les Boches » (p. 24). Le doute général s’installe alors et il note : « …nous voyons bien que nos officiers sont indifférents et qu’ils en savent plus long qu’ils ne veulent en dire » (p. 24). Dès lors, son état physique, alignant sans fin les kilomètres de la retraite, témoigne du moment : « Ah ! Mes jambes, comme elles sont faibles ! Et mes épaules je ne les sens plus ; j’ai la sensation d’une brûlure dans les reins, tellement les courroies de mon sac deviennent insupportables. Je marche donc comme un automate, comme un bête folle sans plus d’espoir que d’atteindre le lieu de la grande halte ou du cantonnement suivant » (p. 24). Il en vient alors à envier les blessés : « Quelques blessés s’en vont plus loin à l’arrière. Heureux veinards dont nous envions le sort avant de savoir l’étendue de leur mal ! » (p. 28). Une phrase semble écrite après-guerre lorsqu’il dit : « Nous longeons la fameuse tranchée des baïonnettes où des visages noircis nous regardent d’une fixité effrayante, l’arme à la main » (p. 156).
Son récit, s’il ne fait pas état d’un pacifisme revendiqué, rapporte, certainement comme il le constate, l’état d’esprit des soldats. Par exemple, la bataille de La Marne à peine gagnée, il décrit : « Trempés, malades, les hommes se révoltent et veulent se porter d’eux-mêmes dans le village. Des réflexions venimeuses à l’adresse des officiers commencent à circuler hautement. Ceux-ci parlent de brûler la cervelle au premier qui bronche. Aussitôt des coups de sifflets et des jurons répondent à cette menace. Alors les officiers deviennent plus doux essayent de calmer leurs hommes, mais la patience de chacun est à bout et passant outre la colonne se rue dans le village » (p. 41-42). Il use le plus souvent possible de stratégies d’évitement (par exemple former la classe 1916 pour prolonger de 3 mois son retrait du front à l’issue de sa convalescence bretonne (p. 90) ou pour éviter une piqûre paratyphoïdique (p. 148 et 183), jusqu’à envier ceux qui parviennent à s’extraire du front, même pour quelques mois seulement, pour participer à des stages par exemple). Lors de la période des mutineries, qu’il vit dans les Vosges, il confie toutefois sa lassitude, allant jusqu’à dire, en septembre 1917, n’obtenant pas une permission pour se marier : « Je deviens anarchiste », assertion qu’il renouvelle le 4 avril suivant devant la fatigue des mouvements inutiles (page 205). Mais son mariage à cette date remonte un peu son moral. Il dit : « Il me semble que j’attendrai mieux la fin de la guerre et j’aurai une famille légale en cas d’accident » (p. 184). Car la guerre est longue, bien trop. Alors qu’il participe à un stage obligatoire, fin janvier 1918, et dit, désabusé : « … je n’ai plus rien à attendre de l’armée, sauf la Croix de Bois » (…) De plus, les jeunes classes sont mieux considérées pour aspirer aux grades supérieurs car le gouvernement les paie moins chers que ceux qui ont quatre ans de service et plus » (p. 199). Mais en fonction des circonstances, il confesse toutefois, comme au combat de Soupir, devant l’attaque allemande, avoir pris plaisir à tirer « sur cette fourmilière », prenant « plaisir pendant 10 minutes à viser sur cette ligne grisâtre aplatie dont les survivants n’osent plus avancer »… « grisés par la poudre, les cris, les commandement de toutes sortes » (. 67). Il rapporte également les épisodes, repartis à plusieurs moments de la guerre des incidents, mouvements voire mutineries qui s’allument de temps en temps dans les unités. À Brest, où se situe le dépôt des 51e et 251e RI, il égrène les morts sur les fronts de ces régiments.
Son témoignage est aussi une longue suite de miracles tant il est au feu à de nombreuses phases violentes de sa guerre, mais aussi de blessures, plus ou moins graves. Le 29 août, « je sens un obus passer si près de nous que j’ai une sensation de chaleur dans le dos ». C’est à cette occasion qu’il est très légèrement brûlé « à la main gauche, c’est un petit éclat qui vient de m’écorcher » (p. 25). Le 29 septembre, il s’empale le pied sans grande gravité dans une baïonnette allemande (p. 53). Sa plus grave blessure est une balle dans la tête reçue au combat de Soupir, le 2 novembre 1915, (p. 67) qui l’éloigne plusieurs mois de la première ligne, et dont il nous fait suivre la gravité (parcours de la balle et nerf coupé (p. 73)), l’évolution, l’évitement qu’il cherche à prolonger, avant de retourner, guéri et sans séquelle, autre miracle, en première ligne. Il en dit : « Il me semble que la guerre est finie pour moi et que je viens d’échapper définitivement à cet enfer maudit. Dans la sombre nuit, j’ai une pensée pour les pauvres compagnons de misère que j’ai laissés là-bas morts et vivants, et dans mon petit coin, l’œil à la vitre, je fouille l’horizon noir sans rien voir, mais sans pouvoir dormir » (p. 69). Mais il doit se résigner, retapé, à retourner au front. Parfois philosophe, il dit, le 4 mai 1915 : « Puisqu’il faut y retourner, puisque cette maudite guerre ne veut pas finir, il faut que je souffre et je m’en rapporte à Dieu pour mon destin » (p. 93). Devant le fort de Vaux, il est à nouveau blessé légèrement par un éclat d’obus au genou, sans qu’il soit évacué toutefois, préférant rester à l’abri de la tranchée que de risquer la mort sur le trajet du poste de secours (p. 156). Le 7 avril 1918, alors qu’il occupe une sape en Argonne, à La Fille-morte, il est brûlé aux yeux par l’ypérite et consent, devant son état de cécité, heureusement temporaire, à se faire évacuer (p 207). Il retourne à son unité le 14 mai suivant mais la longue liste de ses souffrances n’en est pas terminée pour autant. Il est à nouveau blessé le 30 juillet 1918 dans le secteur de Villeneuve-sur-Fère d’une balle traversante au bas du mollet (page 225) qui l’éloigne jusqu’à la fin de septembre suivant, date à laquelle il remonte encore en ligne (p. 228).
Parisien, il reprend vie dans sa ville et dit : « Là j’ai vu qu’on ignorait totalement la guerre et que c’était le véritable endroit où ceux qui comme moi la connaissaient si bien pouvaient venir guérir leur moral ébranlé » (…) Un mois sur le front paraît un an mais un mois à Paris, ce fut pour moi une bien courte permission » (p. 82 et 83). Il revient dans les mêmes termes sur l’ambiance parisienne plus loin en rapportant l’impression d’un ami, en décembre 1915 : « …on pourrait faire un corps d’armée avec les civils embusqués qui s’y promènent. La vie y est très normale et les meurs singulières. On y oublie complètement la guerre » (p. 122). Il parle souvent d’ailleurs de son moral, fluctuant en raison de ses multiples affectations régimentaires, de poste ou de front en fonction de leur dangerosité. Il dit par exemple, apprenant le 30 septembre 1917 qu’il quitte les Vosges pour Verdun et retourne au fort de Vaux : « À partir d’aujourd’hui, j’ai compris que j’avais mangé mon pain blanc » (p. 149).
Sensible, Auguste Mouton ne s’est finalement jamais habitué complètement à la mort et à l’horreur de ce qu’il traverse. Lors d’un énième séjour à Verdun, en janvier 1918, il dit, à la vue de « vieux » morts des deux belligérants réunis dans une sape : « Nous avons soin, malgré notre vieille habitude des morts comme compagnons, de détourner nos regards de ces yeux fixes et de ces bouches grimaçantes » (p. 197). Verdun sera d’ailleurs assurément le pire secteur qu’il ait jamais vécu à la guerre. Il dit, le 22 décembre 1917 : « Cette dernière journée a été l’une des plus terribles de ma vie de guerrier » (p. 194) et réitère cette funeste constatation dès le 16 janvier 1918 : « Ah ! Ces relèves à Verdun ! Je n’ai pas vu de moments plus tragiques et plus douloureux » (…) « c’est un spectacle digne d’émouvoir les cœurs les plus durs s’il était permis à ces profanes de nous voir une seule minute avec la souffrance reflétée sur nos visages » (p.197 et 198).
Humain toutefois, plongé tant dans un océan d’hommes que d’horreur et de misère, il récupère le 27 août un chien mascotte, Fure, qui subit également la violence des combats.
L’ouvrage, très bien présenté et architecturé, permettant un suivi facile, ne multiplie pas les notes inutiles et n’est entaché que de rare fautes (celle, traditionnelle, à cote (p. 30), ballade p. 162, Strausstruppen p. 166 ou west pocket (p. 211)) ou toponymiques (rivière incorrecte page 111, fort et tunnel de Lavannes p. 151 ou Côte du Pauvre (au lieu de Poivre, p. 198). Elles relèvent toutefois de l’ordre de la coquille sur une telle masse. Il est agrémenté de 24 photographies très intéressantes, la plupart de lui-même, de sa famille et des personnages, prises tout au long du conflit, soit en atelier, soit sur le front.
Le livre est de même enrichi de 19 croquis cartographiques des phases importantes de sa guerre : Combats d’Urvillers, 29 août 1914 – Bataille de Château-Thierry, 3 septembre 1914 – Bataille de La Marne (Courgivaux), 6 septembre 1914 – Combat de la cote 100 et position de la Neuville, du 15 septembre au 14 octobre 1914 – Combat de Rouvroye Parvillers (Somme), 8 octobre 1914 – Positions et attaque de Soupir, 2 novembre 1914 – Camp de la Valbonne, du 11 mai au 3 septembre 1915 – Offensive de Champagne, 7 septembre 1915 – Front d’Alsace (secteur est de Belfort), du 22 janvier au 22 mars 1916 – Prise du fort de Vaux ; novembre 1916 – Saint-Mihiel, du 25 novembre 1916 au 31 mars 1917 – La Halte et La Chapelotte. Vosges, du 19 mai au 18 juin 1917 – Mort Homme. Prise de la croix Fontenoy, 7 juillet 1917 – Château de Murauvaux, du 5 au 12 octobre 1917 – Les Eparges, du 5 au 8 novembre 1917 – Cote 344, du 1er décembre 1917 au 18 janvier 1918 – La Placardelle et La Harazée, 27 février au 6 mars 1918 – La Fille Morte et Livonnières, 5 avril et 27 mai 1918 – Les Maviaux, dernière offensive allemande, 14 juillet 1918.
Secteurs tenus – date :
Bataille de la Marne – 2 août – 15 septembre 1914
Guerre de tranchée – 16 septembre – 5 novembre 1914
Loin du canon (Saumur – Brest – Lyon) – 6 novembre 1914 – 3 septembre 1915
Offensive de Champagne – 4 septembre – 14 octobre 1915
Repos et reformation – 15 octobre 1915 – 25 janvier 1916
L’Alsace et les Vosges – 26 janvier – 30 septembre 1916
Verdun (fort de Vaux) – 1er octobre – 25 novembre 1916
Saint-Mihiel et les Vosges – 26 novembre 1916 – 28 juin 1917
Verdun (Mort Homme et Les Éparges) – 29 juin – 30 novembre 1917
Verdun (Cote 344) – 1er décembre 1917 – 5 février 1918
L’Argonne (La Harazée – la Fille morte) – 6 février – 16 juillet 1918
Offensive de la Victoire – 17 juillet – 11 novembre 1918
Après l’Armistice – 12 novembre 1918 – 16 août 1919
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Un volume considérable d’informations peut être dégagé de ces pages.
P. 14 : Pleureuse à la grille de la caserne, spectacle triste, ambiance au 3 août 1914
: Menaces de mort à l’adresse de Guillaume II
: « La cour ressemble à un marché juif où s’étalent pantalons rouges, capotes bleues, sacs et fusils »
: Pleurs au discours du commandant, le départ des 51ème, 251ème et 11ème R.I.T.
15 : Chiffres des unités, où elles vont
: Noircissage des gamelles
: Marches victorieuses, Waterloo et Liège, fausses nouvelles, ignorance de la réalité
: Retour de la foi
16 : « La moitié du régiment tombe d’insolation »
18 : 16 août, construction de tranchées
: 17 août, bruits lointains et angoisses, construction de barricades
19 : Tirs contre avions, 1ères émotions
: Prix d’un repas le 22 août 1914
: Exode belge (vap 22,23)
20 : Espionnite
: Baptême du feu du régiment
23 : Flegme anglais
: Frelons
: « Nos sentinelles voient des uhlans partout et tirent des coups de fusil à chaque instant »
: Pillage de cave et de maison pour ne rien laisser aux Allemands
25 : Trophées (vap 40)
: Bois planté en terre pour signaler une tombe
: Charge à la baïonnette de 800 mètres, « Pas une balle, pas un obus pendant ce trajet »
: Débandade prussienne
: Folle bravoure d’un capitaine (vap 85 un fanatique)
26 : Combat épique d’Urvillers
28 : « La sueur de la veille qui a séché avec la poussière a formé comme de noires cicatrices à chacun »
: Larges rations d’eau de vie distribuées
30 : Soupe renversée
32 : Destruction d’un canon abandonné
33 : Vue d’autobus
37 : Avion se posant près des batteries pour les renseigner
38 : Allemand brûlant 800 de leurs morts debout dos à dos « pour ne pas les laisser sur le terrain après leur fuite »
: « Les Allemands ont empoisonné tous les puits en jetant des bêtes mortes, des entrailles et des détritus de toutes sortes »
39 : Après la bataille de La Marne, maisons pillées, boîtes aux lettres défoncées, animaux dépecés, saleté
40 : Il pille une école et se ravitaille en papier
: Harangue du colonel sur les exactions de l’ennemi
: Million de cartouches allemandes abandonnées
41 : Faim
: Ferment de mutinerie, révolte due à la fatigue et la faim (vap 100)
47 : Brûle des meules de paille pour éclairer la plaine
49 : Drapeaux blancs pièges d’où abattage des allemands qui veulent se rendre
: Echappe à quelques centimètres à un éclat d’obus qui casse son fusil, chance
50 : Brosse d’arme utilisée comme blaireau
: Opium contre la cholérine
: Fausse tranchée
51 : Allemands commandant leurs feux en français
: Se blesse sur une baïonnette de mort allemand
52 : Soldats morts noyés dans un marais
54 : Espionnite, maison dans laquelle a été trouvé un uniforme d’officier allemand, tonneau de vin piégé par un obus
: Missionné pour chercher des égarés, 5 déserteurs fusillés au 254e RI
: Volets décrochés utilisés comme brancards
: Blague à tabac faite dans un sac allemand
: Bombardement surnommé l’angelus
55 : Vue pittoresque des cuisines de La Neuville « On dirait un pays lacustre habité par des indiens »
: Impressionnant combat aérien (victorieux)
: « J’ai abandonné ma toile de tente boche qui m’avait rendu de grands services depuis un mois » et ramasse et garde un revolver allemand
: Maisons pillées et inscription allemande sur une porte « maison pillée par les Français »
61 : Assainissement des lieux, enterrement des chevaux et des vaches, 200 kg de chaux
62 : Tranchée anglaise, bien faite, cuisine hygiénique avec filtration, surnom de cagnas
63 : Tireurs d’élite
: Guerre des mines (Aisne, 23 octobre) ?
: Comment on enterre un cheval dans le no man’s land
64 : Effet de grenade
65 : Machette de tirailleurs
: But de patrouille : Ramener un prisonnier, un casque, une patte d’épaule et reconnaître une nouvelle tranchée allemande (dimensions, contenu)
66 : Soldats agitant des mannequins
: Fume des feuilles de marronniers
67 : Grisé par l’attaque, fusil brûlant
68 : Fiche rouge d’évacuation
: Entend dire que les blessés prisonniers étaient achevés par les allemands
69 : Croit que sa balle dans la tête était une dum-dum
: « … sur toute la ligne [ferroviaire] les femmes françaises sont admirables et nous gâtent »
73 : Où sont les rescapés de Soupir
74 : Victuailles par la population
75 : Electroaimant pour tenter d’extraire la balle
78 : Subit une petit guerre des médecins sur le traitement à lui infliger
81 : Réveillon de 1914, menu
82 : Craint de retourner au front (vap 86 pour les camarades)
85 : Bretons ne parlant pas le français
: Tropine, gouttes dans l’œil et touche des lunettes noires
: Voit une escadre de guerre
: « En ce moment le Dépôt fabrique des pelotons de robusticité, d’enraidis, de convalescents, etc…, c’est-à-dire de quoi arriver à un résultat final : chasser tout le monde dans un bataillon de marche et l’expédier aussitôt formé »
86 : Vue de Brest : « Les rues de Brest sont très bruyantes et remplies d’ivrognes et de mauvaises femmes, c’est un peu écœurant »
87 : Touche 53,10 francs d’indemnité de convalescence
89 : Fraises de Plougastel-Daoulas générant 1 million de revenus
91 : Revoit un ancien blessé de 1914, déformé et vieilli
93 : Mutinerie au Dépôt (vap 100)
: Vaguemestre, il touche une bicyclette Aiglon
95 : Activité du vaguemestre (partie à rapprocher du sergent-vaguemestre Félix Braud)
96 : Signaux optiques
: Maison de Messimy à Pérouges
: Remise des drapeaux des 401ème et 402ème R.I. nouvellement créés
100 : Lutte contre les puces (vap 138)
: « Une infirmière suisse qui se trouvait dans un train de boches a lancé sur le quai une carte avec ces mots : « Salut aux Français, glorieux vaincus de la grande guerre »
101 : Accident de train à la gare de Valbonne, 3 tués et un blessé
: Tribune de Genève germanophile pour voir qualifié « 157ème Bon d’embusqués »
103 : Revient sur la durée de la guerre et rappelle, le 27 août 1915, qu’il avait écrit : « que la guerre ne peut pas durer encore un an car il n’y aurait plus de combattants vivants ». Plus lucide, il y revient page 114 : « Voilà plus de quatorze mois que la guerre dure et nous constatons chacun avec un sentiment mêlé de déception et d’étonnement que, contrairement à ce que nous espérions quelques mois avant, les événements ne laissent nullement prévoir une fin prochaine »
105 : Censure qui « fonctionne dur ; il est interdit d’écrire d’autres détails que ceux concernant la santé ». Fait passer ses lettres directement par un ami. Vaguemestre, armée cycliste de facteurs (vap 139)
: « Je trouve que les femmes ont un air bien gavroche et que la guerre ne les attriste pas toutes »
107 : Sur le sentiment d’être perdu dans un océan d’hommes : « On vit côte à côte sans se connaître »
: Envie les prisonniers : « Quelques prisonniers allemands reviennent par petits paquets et ils ont l’air joyeux d’en être quittes à si bon compte »
109 : Vaguemestre en première ligne : « À mon tour d’être témoin de cet horizon nouveau »
110 : 400 sur 600 lettres retournées avec la mention « disparu » ou « évacué » (vap 113 : « Nous avons rendu aux T. et P. pendant ces deux jours plus de trois mille lettres et environ douze sacs de colis »
111 : Noms « belliqueux » de canons de marine : « Revanche » et « Tonnerre de Brest »
112 : Vision surréaliste d’un cheval mort avec une pancarte Kamarad !
116 : Achète un rasoir pour 6,50 frs
118 : Comme vaguemestre ne veut plus annoncer les morts
119 : Gal, en fait colonel Gratier, très antipathique
121 : Noyé par accident
122 : Doit se raser, sinon 8 jours d’arrêt et suppression de permission : « Il paraît que la victoire dépend de notre coupe de cheveux »
123 : Chambre à gaz
125 : Philosophe
130 : En Alsace, le 6 février 1916 : « Pas un coup de canon, c‘est le pays rêvé pour faire la guerre »
133 : Incident avec des gendarmes au sujet de la lumière
135 : Mauvaise réputation du 111e RI d’Antibes, liée aux méditerranéens (« les gens du midi et les gens du nord ne s’accordent pas très bien ») et au comportement à Verdun (bois de Chippy et Malancourt) (vap 136, 140 et 141)
: Sur la durée de la guerre, Poincaré prédit le 11 avril 1916 « une guerre encore longue avec notre succès final »
136 : Durée de la guerre dans la Gazette des Ardennes, allemands résolus à la poursuivre encore 10 ans !
141 : Punition pour refus d’obéissance : « De mauvaises têtes se voient condamnées à la prison pour refus d’obéissance. L’ensemble est corrompu et, à un rassemblement où le Comt Bénier lit une circulaire qu’il veut faire terminer par le chant de la Marseillaise, ses hommes répondent par un chanson comique »
: Alsaciens qualifiés de boches car portrait du Kaiser, que Mouton a brûlé en partant !
143 : Écrit son courrier sur une borne frontière
: Voit la pierre gravée près de Petit-Croix sur le lieu de la chute de Pégoud
144 : Marchal survolant Berlin et lançant des proclamations
: Théâtre de verdure de Fraize (vap 145)
145 : Homme puni cassé de son grade par un général pour avoir fait monter une femme dans sa voiture pour lui rendre service
148 : Camp d’Arches
149 : « Verdun, c’est le crible géant de notre armée »
153 : Tenue d’attaque composée de « deux musettes garnies de biscuits, de boîtes de singe, de chocolat, de grenades, de pétards, de fusées éclairantes, de balles, deux bidons de deux litres plein de vin, mon fusil, mon tampons à gaz et un browning »
154 : « De là-haut [fort de Vaux] les blessés boches et français descendent en se donnant le bras »
157 : Victuailles souillées immangeables, état sanitaire des hommes
: Bruit du 420 comme un train de marchandises
: Fanion du Sacré-Cœur (vap 170)
158 : Essaye de réveiller… un mort
159 : Tonne à eau bienvenue sur le front
: Flacon de Ricqlès
161 : Bottes de tranchée
162 : Entend des chants allemands de Noël
163 : Cris d’animaux comme signes d’appels
: Méprise nocturne et tirs amis
164 : Allemands en draps blancs
168 : Groupes francs
169 : Tubes explosif allemands anti barbelés type Bangalores
170 : Rend les honneurs devant la maison de Jeanne d’Arc et subterfuge pour ne pas gêner les consciences : « En passant devant la maison de Jeanne d’Arc, notre colonel ayant fait placer le drapeau en face, tout le régiment défile en rendant les honneurs. De sorte que les consciences ne sont pas froissées puisque personne ne peut dire si nous avons présenté les armes au drapeau ou à la sainte »
172 : Vue de Moyenmoutier
173 : Construit des abris sous roche au-dessus de Moyenmoutier (mai-juin 1917)
174 : Chalet Zimm à La Halte
175 : Surréalisme de la guerre dans les Vosges : « C’est incroyable la guerre dans cette région et quand on a vu Verdun on croit rêver »
: Observateur ayant un tableau très détaillé des points dangereux à surveiller
176 : Vue de la guerre des mines à La Chapelotte
177 : Mouvement révolutionnaire dans le régiment, ambiance pacifiante, liste de pétitions, mutins, répression, rébellion avortée « Nous sommes redevenu doux comme des agneaux qu’on mène à la boucherie »
181 : Bataille + orage : « On croirait la fin du monde »
183 : Croup
184 : Mariage
190 : Déclaré inapte à une visite dentaire pour Salonique
192 : Compare la cote 344 (Verdun) à un plateau volcanique
195 : Cinéma de la Citadelle
196 : Soldat gazé en déféquant
: Horreur
: Section de discipline, difficulté du commandement
: Patrouille avec des draps blancs
: Homme à cheval sur son fusil dans un tranchée pleine d’eau
198 : Fonck
201 : Tranchée Clemenceau
202 : Condé, vrai village africain
203 : Arabes paresseux
206 : Aliments et boissons jetés à cause de la souillure de l’Ypérite
: Homme non atteint par les gaz car ivre
216 : Entend des cris de joie allemands à l’annonce des victoires du printemps 1918
217 : Match de foot
226 : 2ème citation qui lui vaut une étoile blanche et 2 jours de plus de convalescence
228 : Croix de guerre dessinée sur une statue au bras cassé à Château-Thierry
230 : Stout
231 : Grippe espagnole
: Humilie en paroles des prisonniers allemands
232 : 11 novembre, (vécu à Deinze en Belgique) joie calme et sage
234 : Famille belge flamande de 21 enfants, qui lui font penser aux mœurs bretonnes
235 : Paperasserie (vap 237, la maudit)
237 : Programme Deschamps pour la démobilisation des classes d’âge
: Homme ivre voulant « tuer un chinois »
: Evoque « trois jeunes filles d’ailleurs sérieuses et qui prennent part à nos discussion philosophiques sur la femme du siècle »
241 : Vue et désillusion sur le Manneken-Pis
: Pyramide de canons à Givet
242 : Longuyon, plaque tournante suite aux ponts coupés sur la Meuse
243 : Se réjouit de ne pas aller en Allemagne
247 : Incidents dus à la boisson (vap 249)
Yann Prouillet, février 2026
Tyl, Marie (1872-1949)
Journal de guerre Cherbourg 1914 – 1919
1. La témoin
Marie Tyl, née Dupont, appartient à une famille de militaires qui vit en Normandie depuis 1893. En 1914, elle est veuve avec trois enfants, son frère Hervé, officier de marine est mort des fièvres à Alger en 1903, et son mari Thaddée, capitaine d’infanterie coloniale, est mort de maladie à Fort-Lamy en 1906. Monarchiste, patriote et traditionaliste, elle s’intéresse à la politique et réaffirme souvent dans ses écrits sa détestation de la République. Elle élève ses enfants avec d’importantes difficultés matérielles : si elle a gardé la jolie maison « La Villa lointaine », sa pension de veuve grevée par la hausse des prix ne lui permet qu’une pauvreté digne.
2. Le témoignage
Les éditions Les Indes Savantes ont publié le Journal de guerre de Marie Tyl en 2015 (403 pages). L’autrice a tenu son journal à partir de 16 ans en 1888 jusqu’à sa mort en 1949, et Patrick Magnificat a rassemblé, présenté et annoté les passages concernant la Grande Guerre, vécue à Cherbourg.
3. Analyse
Marie Tyl a reçu une éducation très complète, elle lit beaucoup et malgré la guerre a encore son « jour » de visite : son journal est alimenté par les conversations et les nouvelles apportées par ses connaissances, qui sont pour la plupart des femmes ou des veuves d’officiers (Marine et Infanterie Coloniale). Son journal raconte la guerre vécue dans un important port militaire, avec les arrivées de navires, l’analyse de la situation militaire et les soucis matériels au quotidien.
Une vie quotidienne difficile
L’autrice consacre son temps à l’éducation de ses enfants, à la pratique religieuse et aux missions de bienfaisance : elle visite souvent les hôpitaux, distribue des fruits aux blessés, participe à des quêtes de charité, reçoit et rend des visites. Ses faibles revenus de veuve ne suivent pas l’inflation du coût des denrées, surtout à partir de 1916 (p. 168, avec autorisation de citation de l’éditeur) « L’existence devient plus ardue et mes petits revenus plus que réduits. Les impôts sont affreux et la vie suit une progression effrayante. » Elle mentionne des prix vertigineux, des économies forcées sur le charbon ou le pétrole, qu’on a de toute façon du mal à trouver. L’hiver 1917 est très froid (p. 289) « Nous, dans ma chambre où nous nous tenons, nous avons en nous éveillant, 3 degrés (chambre au midi, chauffée jusqu’à 11 h. du soir) et l’après-midi, à grand peine 6 ou 7 degrés (…) le gaz, mal épuré, est si bas qu’il ne chauffe pas. » À ce souci de vie chère s’ajoute ce qu’elle considère comme une injustice, c’est-à-dire le moratoire sur les loyers ; elle a hérité de trois petites maisons ouvrières, divisées en six appartements : un est vide et les 5 autres locataires, chefs de famille, ont tous été mobilisés. Dès le 20 août, elle déplore ce moratoire qui la réduit à sa seule pension, et ces plaintes reviennent à plusieurs reprises. Ses locataires dispensées de loyer ont souvent un emploi (p. 168) : «Elles peuvent se faire 9, 10, 11 fr. et plus par jour et être dispensés de payer leur terme, tandis que moi, ayant à ma charge trois enfants, il me reste, les impôts payés, à peu près 4 fr. 50 par jour. » Elle a lu dans un journal qu’en Allemagne on avait refusé le moratoire des loyers « Mais chez nous, c’était une trop belle occasion de porter atteinte à la propriété. Voilà une injustice spoliatrice d’où résultent de réelles souffrances pour moi. » Son mari est mort « en service et pour le service » dit-elle, mais pas à cette guerre, et elle n’a donc pas de droits particuliers. Sa rancœur alimente son hostilité envers les gouvernants, avec le sentiment d’être marginalisée au profit du « peuple » (p. 343) : « flagornerie à l’électeur-roi ! ».
S’informer
À Cherbourg, dans les familles de militaires, l’inquiétude règne d’abord sur le sort des nombreux disparus dont on reste sans nouvelles après le désastre du corps Colonial à Rossignol le 22 août 1914 (1er RIC de Cherbourg, par exemple). Les rumeurs circulent, on cherche à savoir. Les bruits sont transcrits en fonction de l’espoir qu’ils donnent : ces canards sont d’autant plus acceptés qu’ils correspondent aussi à une vision a priori de la guerre (anecdotes édifiantes et patriotiques, regain de la foi, entrain des pioupious). Ces sources « sûres » sont issues du milieu des officiers, qui relaie lui-même des rumeurs venues « d’en haut-lieu ». En visite à l’hôpital, elle rapporte les descriptions du front que lui font les blessés, et les propos fanfarons lui remontent le moral : pour employer un vocabulaire de l’époque, elle gobe assez les récits « à la rigolade » des loustics hospitalisés, par exemple un soldat (p. 151) qui « emmanchait des récits si drôlement qu’en effet, la guerre présente en semblait le sport le plus passionnant qui fut. »
Marie Tyl lit beaucoup la presse locale et parisienne et son titre favori est sans surprise l’Écho de Paris. Elle n’aime pas le Journal, critiquant (janvier 1915), ses contes qui sont la plupart du temps fort déplaisants et malsains (p 81) « mélangeant l’héroïsme de la guerre à des histoires d’adultères ou de fornication rendues attendrissantes. » Les feuilletons patriotiques du Petit Journal trouvent en revanche grâce à ses yeux (p. 101) : « Le feuilleton «Présent » touche à sa fin et les enfants en soupirent. Je leur en avais permis la lecture et celle-ci les passionnait et les exaltait. (…) Les enfants me prient de proclamer avec eux l’excellence de l’œuvre et je conviens que « Présent » est une œuvre de mérite empoignante et bien menée. (…) Une seule critique : on y oublie un peu trop le Bon Dieu. Ce laïcisme m’afflige et les petits se creusent la tête pour se souvenir si Dieu est totalement oublié dans leur récit préféré… ». L’autrice critique la presse et le bourrage de crâne, mais pas pour les raisons que l’on rencontre le plus souvent (juillet 1915, p.121) « Et puis que sait-on ? Les journaux sont plus vides que jamais. Nous avons l’impression d’attraper de-ci de-là, une bribe de renseignement et, en fait, de ne rien savoir ! Raison stratégique, certes, et aussi, et beaucoup, la volonté de nos dirigeants de noyer dans la grisaille toute beauté généreuse de la guerre trop enivrante pour nos cœurs français. »
Une détestation constante de la République et de ses acteurs
Marie Tyl est très politisée, et ce qui frappe dans ce journal, c’est la rancœur constante envers le pouvoir et les institutions de la République. Cette monarchiste exalte souvent le passé glorieux de l’Ancien Régime, les valeurs religieuses traditionnelles, avec la critique de l’émancipation des femmes, de la marginalisation des mères (p.43 « Et surtout pas trop d’enfants dans la famille !), et bien-sûr elle condamne la laïcité…. Cette détestation récurrente lui apporte une réponse univoque lorsqu’elle s’interroge sur les dysfonctionnements dans la conduite de la guerre: c’est de la faute des institutions, des parlementaires corrompus, des francs-maçons… Ainsi les mentions voient se succéder opinions d’extrême-droite, mais aussi racontars ou diffamations d’adversaires politiques honnis. On peut lister quelques domaines :
– en 1914, haine du pacifisme qui explique les défaites (p. 29)
– les francs-maçons sont responsables de la défaite de Rossignol (p. 40) : « plusieurs chefs qui ne devaient leurs grades qu’au Bloc et à la Maçonnerie, mirent la France à deux doigts de sa perte. »
– anglophobie, spécifique à la Marine (p. 67) « Ces braves Anglais ! On en fait un plat mirifique. » On risque de tomber « de la vassalité des Ya à celle des Yes ! »
– religion : hostilité à la séparation, heureusement la guerre change les mentalités (p. 77) ; «Un soldat, revenu blessé et jadis socialiste convaincu, disait à l’abbé Leclère : « il ne faut pas qu’ils viennent nous raconter leurs blagues anticléricales, ça ne prendrait plus. On change quand on a été là-bas. Dans nos tranchées, le dimanche, il y a des fois où on disait le chapelet presque toute la journée. », et elle dénonce en février 1917 (p. 303) : « Les pertes des meilleurs des Français sont lourdes : au moins deux mille prêtres tués déjà, tandis que la plupart des sans Dieu reste si sagement et si prudemment à l’abri. »
– hostilité au Midi, qui est aussi politique (p. 191). En visite à l’hôpital, elle relaie des propos hostiles de blessés convalescents qui tapent sur le Midi :
« « Tout le monde fait son devoir là-bas, excepté les ceusses du midi. »
Approbation de tous, retour sur les fautes passées : le 15e corps, le 17ème. Et puis, leurs officiers ne valent pas mieux, etc. (…) Voilà le Midi politicard ! Pauvre Midi, car il y a du bon. Madame Dujarric de la Rivière me disait que le régiment de Cahors était un des meilleurs et que les Cadurciens étaient navrés d’être englobés dans le mépris que le Midi s’est attiré. »
– calomnie des individus
On retrouvera ici sans surprise Joseph Caillaux (p. 21) « Il est absolument reconnu maintenant qu’il a touché de très nombreux millions pour la Cession du Congo et qu’il était l’homme-lige de Guillaume II. » L’amiral Louis Jaurès en prend pour son grade, il est surnommé le « Bolchevick » en septembre 1918 (p. 365), et est présenté comme un esprit dérangé, ne devant son poste qu’à son frère. Sarrail le républicain n’est pas épargné (p. 276) « Salonique est le dépotoir de l’Europe et de l’Asie (…) Sarrail, une canaille intelligente, arrive encore par le fait qu’il est canaille à gouverner sa barque dans ces eaux nauséabondes. » Le Garibaldi bashing (p. 87) est plus original (février 1915) mais tout aussi haineux « Les Garibaldi, s’écria Madame Lucas-Liais, mais on en a honte. En 70, on en rougissait : pas un honnête homme ne pouvait y songer sans dégoût.»
Le journal n’est-il qu’un défouloir personnel, ou ces détestations (que l’on trouve aussi chez Anne-Marie Platel par exemple, mais à un degré bien moindre) sont-elles formulées publiquement ? Il semble que ces propos sont partagés dans ses cercles féminins, et alimentés en nouvelles par des officiers de passage. Fort logiquement, notre diariste n’apprécie pas non plus le Feu d’Henri Barbusse (mai 1917, p. 331) : « Pourquoi te bats-tu ? » demande, paraît-il, ce mauvais livre « Le Feu » de ce Barbusse que n’a pas eu honte de couronner l’Académie Goncourt. Plus tard, il rend intéressant et pitoyable, et plus que cela, le soldat qui abandonne son poste. Madame de Pontaumont dit qu’il se lit énormément au front, étant bien écrit, bien fabriqué, mais comme sont fabriqués les portraits et les descriptions qui ne montrent que le laid, le mauvais, l’affligeant, et que l’effet est très nocif. »
Finalement, Marie Tyl produit-elle un bon témoignage ? Non, si on considère qu’elle ne reprend que les bruits et les rumeurs qui confirment ses haines préalables, et que son biais d’analyse univoque, tourné vers un passé mythifié, la France d’Ancien Régime, ne lui permet pas de comprendre la guerre de la majorité de ses contemporains. Non encore, car sa complaisance dans la détestation finit par décrédibiliser son jugement, même si par ailleurs elle mène une vie digne. Et pourtant oui, c’est un bon témoignage, si on considère que ces écrits sont représentatifs du milieu très conservateur des officiers de la Marine : ce groupe a longtemps formé la partie de l’Armée la plus hostile aux nouvelles institutions. Certes, à l’échelle du pays, cette sensibilité d’extrême droite monarchiste est très minoritaire, mais son influence sur la société, via L’Action française, est loin d’être négligeable. En outre, malgré son antiparlementarisme, quelques-uns de ses candidats furent élus à la Chambre des députés, parfois sur des listes de coalition hétéroclite du Bloc National, vainqueur des élections de 1919.
Vincent Suard février 2026
Arrouy, Éloi (1895 – 1968)
Journal de guerre 1914 – 1918
Miquèl Ruquet
1. Le témoin
Éloi Arrouy est né dans une famille d’agriculteurs à Fréchède (Hautes-Pyrénées). Classe 15, il est incorporé en décembre 1914 puis versé au 401e RI. Il arrive au front en septembre 1915, et combat, essentiellement en Champagne, à Verdun, au Chemin des Dames, en Flandre avec les Anglais à l’été 1917, puis pour contrer les offensives allemandes de 1918 : Somme (mars), Flandre (avril), puis dans l’Aisne et la Marne (mai 1918) ; il participe enfin aux combats de reconquête de la fin de l’été 1918. Après la guerre, il est ajusteur aux usines Hispano-Suiza de Séméac (Tarbes).
2. Le témoignage
Miquèl Ruquet a publié le « Journal de guerre d’Éloi Arrouy 1914 – 1918 » en 2016 aux Éditions Trabucaire (201 pages). C’est lors d’une conférence en Cerdagne sur les insoumis de la Grande Guerre qu’une famille lui a fait connaître ce document. Le transcripteur n’a modifié que l’orthographe, tout en cherchant à garder le plus possible le style du témoin. Il a accompagné le texte original de têtes de chapitres pour contextualiser les combats, avec des extraits du J.M.O. du 401e RI. Éloi Arrouy a quitté l’école à douze ans, mais il a le goût de l’écriture ; au front, le jeune soldat tient un journal qu’il rédige en cachette, seuls quelques camarades sont au courant. Il a retranscrit les carnets une première fois, puis a réalisé une nouvelle version « à peu près lisible » une fois arrivé à l’âge de la retraite. Sa fille Gabrielle signale en préface qu’il évoquait très souvent sa guerre, en famille ou avec des amis.
3. Analyse
Champagne 1915, Alsace et Verdun 1916
Éloi Arrouy découvre le front au milieu de l’offensive de Champagne (29-30 septembre 1915), mais sans effectuer d’attaque. Il est ensuite positionné en Alsace, où il devient ordonnance de son lieutenant. Il l’accompagne à un cours de grenadiers, et fait à cette occasion des conquêtes féminines. Il rejoint la bataille de Verdun assez tard, et s’estime favorisé comme ordonnance: «j’ai coupé à beaucoup de travaux et de corvées, la planque sert toujours.» Il refuse de monter en renfort avec la 11e cie (p. 49) « je n’y connais personne, c’est tout des gars du nord » et rejoint la 6e, vers Vaux-Chapitre, en novembre 1916. En décembre, le 401 est à l’arrière en manœuvres de division et il évoque (p. 51) des virées à Bar le Duc dans des « maisons dites hospitalières », avec parfois des démêlés avec les gendarmes. Son unité participe à l’attaque du 15 décembre 1916, et le récit du combat est de bonne qualité (p. 53, avec autorisation de citation) : «Ils [les Allemands] font camarades, ou résistent. La plus forte résistance se trouve aux abris de Lorient, nous eûmes bien du mal à en venir à bout, celui qui était pris les armes à la main était tué sans pitié. J’ai vu là un boche tirer sans relâche malgré qu’il soit entouré des soldats français qui lui sautaient dessus ; il a été criblé de balles et de coups de baïonnettes. » Ils font à cette occasion un grand nombre de prisonniers.
Verdun, Chemin des Dames 1917
Il retourne en ligne dans le secteur de Bezonvaux, le froid est terrible, et il essaie d’avoir les pieds gelés, mais il n’y réussit pas (p. 62) « Pas de chance, le major me dit que ce n’était rien et que je l’avais fait exprès (de cela il avait raison*) – avec note : *occitanisme « d’aquo avia rason » – . Remonté en ligne, il est cette fois évacué avec 40° de fièvre; à son retour, il dit avoir gardé à son domicile ou « liquidé au cours du voyage » les effets neufs qu’on lui avait donné à l’hôpital. De même au dépôt d’isolés de Saint-Dizier (p. 67) : « Une fois habillés, à quelques-uns, nous trouvons une porte de sortie et nous voilà dans la ville. Tant que l’on a eu de l’argent, cela a marché ; nous vendions ou échangions pour faire la bringue, mais le 26 [février], plus d’argent ; il faut rentrer. On dut nous rhabiller et équiper, sans compter une belle engueulade avec de belles promesses de punition. »
Le 10 avril 1917, désigné pour un stage de fusil-mitrailleur, il évite l’offensive du 16 avril, et rejoint ses camarades le 1er mai au tunnel de Vendresse. Le secteur est malsain, et il décrit la dure attaque du 5 mai à Vauclair, « la journée fut une des plus terribles que j’ai vue durant la guerre » (p. 77). La 6e cie atteint ses objectifs mais a fondu, et l’ordre de leur capitaine les révolte: ils ont interdiction de ramener les blessés, pour tenir prioritairement la position (p. 79) « c’est une honte et nous nous en souviendrons ».
Bataille de Flandre 1917
Le 401e est transférés en Belgique, et jusqu’au début de 1918 la 133e DI alterne entraînement (plage de Coxyde) et engagements aux côté de l’offensive anglaise de Passchendaele, dans un secteur noyé, risquant l’enlisement et la noyade en tombant des passerelles (Bixchoote). En dehors des combats très durs, il décrit des blagues idiotes dont il est semble-t-il coutumier, et que l’on retrouve souvent dans les récits de jeunes soldats comme Gaston Lefebvre par exemple (p. 86, à Coxyde) : « En moins de temps qu’il ne fallait pour le dire, il avait le plat sur la tête et de m’échapper dans la mer, derrière moi le copain et courir dans l’eau, les gendarmes qui criaient « venez ici » et finalement je fus rejoint derrière les dunes par les copains, j’encaissai une rouste et je dus me débrouiller auprès du chef cuistot pour avoir à manger pour l’escouade. Pourquoi aussi m’a t-il dit « chiche ? » Il fait une bonne description de bringue dans un café, sans assez d’argent, avec (p. 90) « des gâteaux avalés « à la Charlot », on en payait bien quelques-uns…». Lors de l’attaque d’octobre 1917, il vient d’avoir 22 ans, il évoque les fusils qui ne sont que des blocs de boue, et la mort du capitaine qui les avait empêché de ramener des blessés au Chemin des Dames : il indique que cet officier n’est pas regretté (p. 105) « il n’a eu que ce qu’il a mérité et c’est d’ailleurs ce qui fera dire à un copain quand on lui appris la mort du capitaine : « tant mieux, il ne nous fera plus chier ». Cela prouve dans quelle estime il était tenu par ses soldats. »
En défense successive lors des 4 offensives allemandes de 1918
Son unité est transférée en urgence dans la Somme à la fin mars 1918 pour aider les Anglais enfoncés, il évoque l’absence d’artillerie et de front tangible, la pitié pour les civils qui fuient avec en même temps le pillage systématique effectué par les soldats de tous bords (p. 116) « dans les premières maisons de Mézières, plus ou moins de lumière ; dans les caves, des soldats sont couchés, ivres, le pinard coule, les chambres, les meubles, tout est pillé : on dirait que l’ennemi est passé par là. Dire que c’est des Français qui font cela, c’est une honte. » Une scène curieuse a lieu alors qu’agent de liaison, il accompagne son lieutenant chez le colonel très en colère – enjolivement lors de la reprise de la transcription ? – : « il y a un peu de discussion ; à quel sujet, je ne le sais ? Toujours est-il que le colonel Bornèque fait mine de vouloir lui brûler la cervelle ; tout doucement je glisse mon mousqueton sous le bras et attention si jamais il a le malheur de tirer. Heureusement il ne tire pas et tous les deux, nous repartons ; le lieutenant est très pâle et il me dit que nous devons contre-attaquer. » Sans munitions, ils finissent par se replier après des combats très durs. Après relève le 2 avril et un peu de repos, les voilà embarqués en urgence pour les Flandres, mais ce ne sont pas eux qui prennent le choc le plus violent au Mont Kemmel ; la description insiste sur le pillage des maisons par les Anglais et les Français (p. 133, 17 avril 1918) « On en était arrivé à n’avoir plus de cœur. » Il évoque aussi l’attitude des plus jeunes de la classe 18 lors de leur dernier engagement avant relève (p. 136) : « On leur avait enseigné la haine des Allemands et de massacrer les boches qui se rendaient en nombre. Les boches se voyant foutus pour foutus se ruèrent à nouveau sur leurs armes et réussirent même à cerner certain contingent qu’ils exterminèrent à leur tour. Depuis ce jour, les jeunes de la classe 18 furent refroidis et ne voulaient plus rien savoir, pauvres gosses, car pour nous, ils l’étaient (…) Pour ma part, je n’ai jamais tiré sur un ennemi qui a levé les bras. » Lors de l’offensive allemande sur la Marne, le 401 est à nouveau en ligne, mais est trop éprouvé pour contre attaquer. Tenant des tranchées dans l’Oise lors de la 4e attaque allemande (Montdidier), ils fournissent en juillet des patrouilles, et notre soldat évoque des préparatifs de coup de main (p. 145) : « nous buvons tant qu’il y a de l’argent. Pourquoi le garderions-nous ? Nous devons crever ce soir dans les fils de fer barbelés. Et tandis que nous buvons, il vient au village de Coivrel un pauvre homme avec sa fille assez jolie et comme nous n’avons pas soif, à quatre, on projette de prendre la fille et d’enfermer le vieux ; hélas, un sous-officier nous a plus ou moins entendus ; il avertit le pauvre homme qui tout de suite prend le large, sans finir la visite de sa maison ; (…) quant à nous, nous avons eu droit à un savon par le sous-officier, mais cela n’alla pas plus loin. » En août et en septembre, E. Arrouy produit le récit intéressant du combat de poursuite, avec une progression heurtée et coûteuse, à cause des mitrailleuses allemandes très mobiles et de l’utilisation systématique des obus à gaz. En octobre, il participe aux combats dans les faubourgs de Saint-Quentin, sa fonction d’agent de liaison lui permettant de bien saisir les enjeux tactiques du combat à l’échelle du bataillon. Il évoque les prisonniers qu’ils font à Saint-Quentin le 5 octobre (p. 173) : «On les malmène un peu avant de les envoyer en arrière mais c’est drôle, aucun ne veut être Prussien. » (…) Et encore on sort des prisonniers les mains en l’air, Alsacien, Polonais, Autrichien, il y en a même un qui sort son chapelet : « Tu peux l’implorer ton bon Dieu et attrape celui-là. » En permission à la fin octobre, E. Éloi rejoint pour vivre l’Armistice puis après un long positionnement dans le département du Nord, il est démobilisé en septembre 1919.
Il y a donc plusieurs domaines d’intérêt dans ce témoignage de qualité, on peut évoquer par exemple :
– un soldat du rang qui dit sa vérité et son ressenti de la guerre, en cachant ses notes, et en prenant des précautions lorsqu’il les ramène chez lui ;
– mais aussi un texte retranscrit deux fois, dans lequel on sent apparaître des préoccupations mémorielles contemporaines ;
– les opérations d’un régiment « 400 » peu épargné, formé surtout de jeunes, une unité de choc ressemblant en ce sens à un BCP d’active ou à un régiment colonial ;
– l’habitus d’un soldat classe 15, avec une Grande Guerre vécue plutôt de 1916 à 1918, avec le comportement bien spécifique d’un « jeune », c’est-à-dire ici bon soldat en ligne, mais turbulent et farceur, voleur à l’occasion, pouvant être violent avec l’ennemi, etc…, mais qui acquiert une telle expérience du front qu’il devient à son tour en 1918 un véritable ancien pour ceux de la classe 18.
Vincent Suard, février 2026
Cailleau Jean (1882-1956) – Cailleau Pauline (1884-1963)
Cailleau Jean (1882-1956) – Cailleau Pauline (1884-1963)
« Puis crac ! C’est la guerre »
Alain Jacobzone – Louis Thareaut
1. Les témoins
En 1906 Jean Cailleau a épousé Pauline Chenois, et en 1914 ils ont trois enfants de 7, 5 et 2 ans. La famille habite Denée (Maine-et-Loire), et Jean travaille comme menuisier, le couple complétant ses revenus en tenant un café. Mobilisé dans l’artillerie au 3e Régiment d’artillerie lourde, il sert d’abord à l’échelon dans la Somme, en Artois, puis en Champagne. Passé au service d’une pièce, il combat dans l’Aisne, puis en 1918, avec le 111e RAL, dans les batailles de résistance à l’offensive allemande. Après les combats de reconquête de l’été, l’Armistice le trouve dans les Ardennes. Son âge et ses trois enfants lui permettent d’être démobilisé dès janvier 1919.
2. Le témoignage
Alain Jacobzone et Louis Thareaut ont publié en 2018 « Puis crac ! C’est la guerre », Échange épistolaire d’un couple Angevin durant la Première Guerre mondiale (Éditions du Petit Pavé, 312 pages). Louis Thareaut, petit-fils du couple Cailleau, a d’abord transcrit les 1542 lettres conservées, et des exemplaires des six volumes obtenus ont été distribués à la famille après 2000. Ce premier corpus, base de travail pour Puis crac ! C’est la guerre, contenait toutes les lettres quasi-quotidiennes des deux époux, car Jean Cailleau répondait au verso des envois de sa femme. Il existe aussi un carnet de guerre pour Jean, interrompu en 1915. Alain Jacobzone, un historien qui a bien étudié la Grande Guerre à l’échelon régional (« En Anjou, loin du front », 1988, réédité en 2015), a rédigé, en s’appuyant sur de nombreux extraits, une analyse thématique qui occupe l’essentiel du livre (p. 31 à 286). L. Thareaut le précède dans une présentation des sources et de ses grands-parents (p. 11 à 31), puis à la fin du volume (p. 287 à 297) évoque la vie de sa famille après 1918.
3. Analyse
Puis crac ! C’est la guerre n’est pas la publication des lettres des époux Cailleau, mais une mise en contexte et une analyse de leur correspondance, c’est à dire surtout une explication de la guerre qu’ils ont vécue. L’avertissement précise que l’édition des 1500 lettres était inenvisageable (p. 32), mais que le travail d’analyse repose rigoureusement sur ces documents: « le seul chapitre consacré au couple comporte 263 citations de quelques mots à plusieurs lignes et l’ensemble de l’ouvrage doit en comporter un bon millier. » Ce choix oriente donc plus le livre vers un travail d’historien, sur la guerre des époux Cailleau à travers leur correspondance, que vers une publication de source, c’est un choix assumé qui (p. 32) « pourrait gêner ceux qui ont le culte du document au point d’en faire un sanctuaire inviolable. » Appartenant effectivement plutôt à ce groupe (mais sans fanatisme), je regrette un peu ce sur-découpage en centaines de citations, qui empêche de se faire une vue d’ensemble par soi-même, mais le travail d’analyse est de bonne qualité, et le choix d’intituler les sous-parties avec des extraits significatifs (par exemple : chapitre IV. 4) « Tu dois trouver ça bien de ne plus m’entendre rouspéter…») ramène en permanence au texte et les propos des témoins sont replacés dans leurs contextes événementiels, économiques et familiaux, ce qui permet de déboucher sur une étude des mentalités ou de l’intime.
Une première partie présente les caractéristiques de la correspondance (p. 39 à 61), avec cette obligation quotidienne que les époux s’imposent. Le temps de cheminement est en moyenne de 4 ou 5 jours, et les lettres de Pauline sont plus longues que celles de son mari (A.J., p. 46) « elle semble s’imposer la norme exigeante de 4 pages quotidiennes qu’elle avoue parfois peiner à tenir. » L’analyse se poursuit en présentant la lettre-type de l’une ou de l’autre, avec l’ordre et les sujets abordés. Jean tient aussi un journal, mais il y renonce en mai 1915, car (A.J., p. 64) « il explique qu’il fait double-usage avec ses lettres qui relatent l’ensemble de sa vie de combattant. »
Le chapitre 2, intitulé Cailleau soldat, évoque la vie quotidienne, les conditions climatiques, l’alimentation et les événements du front. Alain Jacobzone parle d’un bilan décevant pour ce qu’on peut apprendre précisément du combat, notre artilleur ne disant par exemple presque rien de son arme, l’artillerie lourde. Il est un peu plus précis sur les opérations à l’été 1918, lorsque reprend la guerre de mouvement. Par ailleurs Jean atténue la description de la violence des combats, sans toutefois la faire disparaître complétement (classiques procédés d’euphémisation p.79). La partie la plus intéressante concerne l’évolution de l’engagement patriotique de Jean, avec un virage en 1915, que l’on peut caractériser avec cet extrait (p. 101, octobre 1915, avec autorisation de citation) : « Pour moi, je t’assure ma petite Pauline, que mes idées ont rudement changé au point de vue patriotisme. Au début j’aurais vraiment fait des actes de bravoure volontaires pour la patrie j’aurais donné ma vie. Aujourd’hui, après tout ce qu’on a vu et tout ce que l’on voit, je peux t’assurer que lorsque j’exposerai ma vie, c’est que j’y serai forcé. » Dès juillet 1915, il signale dans une lettre: « Si tu savais comme tout le monde en a assez», et ces moments d’exaspération reviennent régulièrement, en s’accentuant en 1917 (p. 103) « ce que je souhaite ardemment, c’est que tous les partisans de la guerre crèvent le plus tôt possible. » En sélectionnant un certain nombre de ces extraits, A. Jacobzone parle d’une forme de révolte de basse intensité (p. 106), constituée par exemple par la critique permanente des gradés et des officiers, ou des stratégies d’évitement : essayer de rester à l’échelon, moins exposé, écrire à son député pour obtenir un poste à l’arrière… Pauline relaie ces démarches, écrivant aussi au député, ou essayant sans succès l’intervention d’une relation familiale pour le faire muter à Lorient. À la fin du conflit, si le patriotisme, certes déclinant, reste un des moteurs de la résistance, c’est surtout l’attachement à la famille qui fait tenir Jean, et pas les grandes causes (p. 113, janvier 1918) : « On parle de plus en plus de paix. Mais la grande question c’est l’Alsace-Lorraine. Mon vœu le plus cher c’est que ceux qui la veulent viennent la chercher. »
Le chapitre 3, intitulé L’autre front de Pauline,donne une série d’éclairages sur la guerre vécue au bourg. Pauline s’intéresse aux opérations, essaie de jauger le danger pour son mari, croise les informations d’après le récit des permissionnaires. On constate ici aussi que l’année 1915 voit une baisse du moral ; elle avait décrit en novembre 1914 (p. 151) la scène affreuse de la douleur d’une mère à l’annonce du décès de son fils, et on peut citer le long extrait dont A. Jacobzone souligne la qualité d’évocation : (février 1915, p. 165) « Tu vois bien mon petit Jean que nous ne pouvons être gaies. Vous, ce n’est pas tout à fait la même chose, vous côtoyez la mort, vous voyez même tomber ces braves, et dans l’élan de votre patriotisme vous vous dites : « cette mort est belle », et vous passez en saluant leur dépouille. Vous vous riez des balles, vous narguez les obus, mais vous n’avez pas vu les figures pâles de ceux qui vous attendent quand un décès arrive, vous n’avez pas entendu ce bruit qui circule, ce bruit qui fait du mal, plus que vous ne pouvez le croire : « il y en a encore un ! »… Vous ne voyez pas comme je l’ai vu plusieurs fois hélas, la grande douleur, l’effroyable sensation de vide de ceux qui restent. Non mon petit Jean, nous ne pouvons être gaies, courageuses oui, vaillantes jusqu’au bout, mais c’est tout, nous les femmes, ce que nous pouvons vous promettre. » Sur le plan matériel, les lettres indiquent une fatigue physique et morale, liée au travail harassant – (p. 168) «Je ne m’assoie guère plus d’une heure par jour » – , et à la baisse des revenus malgré l’allocation : la menuiserie est arrêtée et le café marche mal ; Pauline redoute la misère, échafaude sans succès des projets d’entreprise, écrit au député pour que l’allocation soit revalorisée (juillet 1917, p.187) : « On nous a enlevé notre soutien, on se doit de pourvoir à nos besoins. » Le secours de la religion est pour elle vital, elle se pense protégée par sa pratique assidue, ses invocations à la Vierge (celle de Béhuard notamment) et plus encore à Sainte Thérèse de Lisieux.
Le dernier chapitre,Le couple et ses enfantsaborde la vie familiale, et on peut évoquer les thèmes suggérés par les titres de sous-parties qui sont extraits des lettres :
4.1.b « Tu sais combien les petites tiennent une grande place pour moi. »
Jean essaie malgré la distance de garder son rôle prescripteur de père, il dit son affection pour les enfants, mais essaie aussi de continuer d’imposer son autorité et ses directives, fait des remontrances à distance.
4.1.c « Mon Dieu que ceux qui ont des enfants solides ont de la chance ! »
Pauline détaille tous les soucis de santé des enfants, et l’épuisement qui découle des soins liés aux périodes de maladies infantiles.
4.1.d « Je crois qu’on laisse un peu la grammaire de côté. »
C’est l’aîné qui est investi comme l’héritier de la menuiserie, et son instruction doit être soignée (par exemple pour le calcul des mesures) ; la guerre entraîne une désorganisation avec une surcharge d’élèves chez les sœurs, dont l’enseignement laisse à désirer (p. 229) : [pour 1915] « Une année de fichue (…) Ils ont vacances sur vacances. Les demoiselles ont bien trop d’élèves et forcément les garçons sont négligés et ils n’apprennent rien de rien. » Et Pauline poursuit à propos du niveau de l’aîné en grammaire : « Si on ne s’en mêle pas, ce sera un âne. » Cet investissement de la mère dans le suivi pratique du travail scolaire des enfants est à noter, car il est rare, ou en tout cas peu mentionné dans les autres ménages ruraux.
L’analyse de la correspondance aborde l’intimité des deux époux : même si Jean est directif, il s’agit d’un vrai couple, et un passage intéressant rappelle les bilans que l’on trouve chez les territoriaux, quand ils regardent derrière eux en constatant l’effet la guerre sur leur trajectoire, familiale et matérielle. (décembre 1915, p. 253) « Tout n’a pas été rose loin s’en faut, il nous a fallu bûcher pour se créer une petite situation… la terrible maladie a été notre plus rude épreuve. Depuis ce moment, nous nous croyions à peu près sauvés, la santé revenant, le travail allant à merveille, nous commencions à faire quelques économies. Nous avions le grand bonheur de vivre pour nos trois chers petits qui nous délassaient de nos peines d’un jour par une caresse d’un instant. Puis crac, c’est la guerre, la terrible catastrophe, la dure séparation (…) On a ici une guerre pensée comme un aléa extérieur, non investi de sens ou d’engagement : la famille reste ici la première valeur.
Louis Thareaut ré-intervient en fin de volume (p. 289) : « Rien dans l’image du couple que donne l’historien ne me choque. Il laisse apparaître l’autorité de Jean et une Pauline courageuse qui tente de faire face à une situation à laquelle elle n’était pas préparée. » Et nous quittons l’Histoire pour la Mémoire, lorsque L. Thareaut évoque la publication des lettres (p. 295) « Je ne crois que grand-père Jean aurait sauté de joie de voir mise sur la place publique leur intimité épistolaire. » À son avis, Pauline n’aurait pas été du même avis, et lui pense de même : ce dépôt aux archives, tout comme la publication du livre (p. 297) « Non, ce n’est pas une trahison, ce n’est pas un sacrilège, ce n’est pas du voyeurisme. C’est un geste de reconnaissance. C’est un geste d’affection. »
Vincent Suard, février 2026
Martin, Henri (1892-1983)
Martin, Henri, Journal de guerre. Metzeral 1915, Munster, Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster, 2014, 168 p.
Résumé de l’ouvrage
Aspirant, Henri Martin relate, du 2 avril au 22 juin 1915, son action comme observateur et responsable d’une batterie de deux canons de 155 courts, Manon et Mignon, placés à proximité de la ferme Huss, sur la ligne de crête des Hautes-Vosges, entre Wildenstein et Mittlach (Haut-Rhin). Son témoignage renseigne sur « l’apprentissage » de la guerre d’artillerie lourde de montagne, tant sur le plan technique que sur sa mise en place stratégique lors des combats des crêtes jusqu’à la conquête de la Cote 830, au-dessus de Metzeral.
Le témoin
Henri Martin est né le 16 avril 1892 à Xertigny, dans les Vosges, d’un père instituteur. Pourtant « né sauvage et méditatif » (p. 87), il apprend en autodidacte le grec, le latin ainsi que la sténographie, avec laquelle il rédige son journal, puis obtient son brevet supérieur qui lui permettra de consacrer sa vie professionnelle entièrement à l’enseignement. D’abord instituteur à Bains-les-Bains, il devient directeur d’école à La Forêt (comme de La Chapelle-aux-Bois), où il termine sa carrière et prend sa retraite. Il se marie en 1919, union qui lui donnera deux fils. Vosgien, il connaît le massif (il confie être venu en touriste « sur les lieux » en 1911) sur lequel il va revenir pour y faire la guerre. Il y retourne d’ailleurs, en « pèlerinage » le 20 août 1960, retrouvant les endroits qu’il a occupés, et même les entonnoirs des obus qu’il a reçus ! Sa Première Guerre mondiale le voit ainsi à l’Hartmannswillerkopf, où il était déjà observateur, sur les sommets des Hautes-Vosges et à Verdun en 1916. En juin 1940, il commande l’ensemble des forts d’Epinal et les honneurs militaires lui sont rendus par les Allemands le 22 juin, au fort de Longchamp, lors de la reddition, la dernière, de la place. Il est ensuite fait prisonnier, envoyé en Silésie et renvoyé à ses foyers au bout de 14 mois au titre d’officier de réserve. Il publie de nombreux ouvrages de différents genres ; Histoire, dont trois sur la Grande Guerre, poésie, philosophie, etc. Il aura une abondante activité associative et sera lauréat du prix José Maria de Hérédia. Il décède à Epinal le 9 janvier 1983.
Le témoignage
Bien que court, le témoignage de l’artilleur Henri Martin, après celui qu’il a produit sur le Hartmannswillerkopf, est précis, diversifié et très descriptif de ses trois mois de présence sur les sommets des Vosges et dans différents postes d‘observations des hauteurs, éclairant ainsi la guerre des observatoires, indissociable de la guerre des artilleurs, et l’organisation militaire et guerrière des crêtes vosgiennes. Poète (il a envie d’envoyer ses œuvres aux Annales politiques et littéraires (p. 49), connaissant la botanique et technicien, son récit est l’un des tout meilleurs témoignages d’artilleurs dans les Vosges, ce sur tous les secteurs dans lesquels il officie. L’ouvrage rappelle d’abord la spécificité discontinue du front des Vosges : « Dans cette région, nos lignes, protégées par des réseaux, consistent surtout en petits postes tenus par le 5e BCT et par les skieurs, assez éloignés de ceux de l’ennemi, beaucoup moins agressif ici que vers l’Anlass » (p. 115).
Le corpus contenant le récit du témoin est composé de 13 cahiers comportant ses notes prises en sténo puis transcrites en français, repris dans un livre spécifique qui fait suite à Le Vieil Armand, 1915, édité à la librairie Payot en 1936 dans la prestigieuse collection des Mémoires, études et documents pour servir à l’Histoire de la Guerre Mondiale. Sur l’ensemble de la durée du témoignage, on découvre la mise en place d’un front d’artillerie en secteur de montagne qui ne dispose ni de la météo, dont la prédominance est évidente, ni des voies de communication adéquates ce, dans la première moitié de 1915. Outre l’ambiance et la description d’un poste de tir d’artillerie lourde, dont il nous avoue son propre apprentissage, il témoigne de l’affinage des techniques, intéressant sur les « astuces » pour les améliorer au fil du temps. En effet, avec l’accroissement de l’implantation de l’artillerie, notamment lourde, et ce avant la construction de la Route des Crêtes (qu’il voit d’ailleurs commencer à construire), naît un problème crucial de liaison avec l’infanterie pour la seconder au mieux dans les attaques. Il dit : « En cas d’attaque, la liaison immédiate entre l’artillerie et l’infanterie me parait très difficile à réaliser, surtout dans un terrain aussi accidenté et boisé que celui de cette région » (p. 69). Ainsi, pour pallier à l’absence du téléphone, qui deviendra systématique en juin, il dit, le 16 avril : « Le signal du tir d’efficacité sera donné par un feu de paille allumé sur le Schweisel, à 200 ou 300 mètres de notre observatoire. Les alpins du 5ème BCT ont entassé autour d’une perche quelques balles de paille comprimée qui ne brûleront pas facilement si on ne les délie. Ce tas intrigue l’ennemi qui, du Schnep, lui envoie quelques petits obus, sans résultat » (p. 40). Honnête, Martin évoque ses relations avec la hiérarchie, qui, alors qu’il n’est qu’aspirant au 8e régiment d’artillerie à pied, lui confie, le 10 avril, le commandement et la responsabilité du pointage de cette batterie de canons, révélant par là-même d’un côté la pression, l’impatience, qu’il subit de la part de ses supérieurs, et de l’autre côté le fait qu’il apprend et perfectionne son métier au fur et à mesure de son exercice. Il ne cache pas ses sentiments, et son manque d’assurance, devant une telle responsabilité. Il dit : « Le lieutenant Renaud, remonté de la vallée, m’apprend qu’on l’appelle à d’autres fonctions, et me remet le commandement du détachement et des deux pièces. Me voilà dans de beaux draps ! Moi qui suis encore un novice, comment m’en tirerai-je d’épaisseur ? Heureusement les hommes sont de braves types et les sous-officiers sont actifs et dévoués » (p. 29). Son premier tir intervient une semaine plus tard. L’affaire d’un coup court, tir ami dont il est accusé (p. 93), finalement à tort (p. 95), est intéressante sur ce point de la responsabilité d’action au front. Il s’étonnera d’ailleurs un peu plus tard (p. 66) de ne pas monter plus tôt dans les grades par ailleurs. Aussi, Henri Martin témoigne de l’adaptation nécessaire, en un grand nombre de sujets, afin de pratiquer cette lutte des sommets. Il donne de nombreux détails techniques propres à son arme (description, calibres, poids, caractéristiques des obus comme de ses canons, comment il pointe, les contraintes auxquelles il fait face, etc.). Il décrit même un crapouillot, arme nouvelle pour lui, et se fait expliquer le fonctionnement du canon de 65 (p. 87). Certains tableaux sont impressionnants de réalisme. Par exemple ce 7 mai 1915 : « Nous en sommes encore abrutis, les oreilles brisées et bourdonnantes, un peu enivrés par la fumée de la poudre. C’est un jeu brutal. La terre tremblait, les arbres remuaient en avant, comme secoués par la tempête. On voyait très bien les énormes projectiles sortir des tubes courts en ronflant et filer dans les nuages comme des oiseaux rapides. L’œil les suivant facilement pendant plusieurs kilomètres. Leurs formidables explosions soulevaient au loin, plus haut que les sapins, des colonnes de terre et de fumée grise et rousse » (p. 71).
Assez réflexif et direct, Henri Martin avoue à plusieurs reprises que, malgré l’intensité du lieu et la charge de son travail, il s’ennuie. Une impression de désert survient parfois, dans lequel Martin paraît tout petit dans l’immensité du front comme de la nature. « Il est curieux de remarquer que nous qui sommes presque sur les lieux ignorons une grande partie de ce qui s’y passe » (p. 73). Parfois, le cafard est plus profond. Le 27 mai, il s’épanche : « Je suis dégoûté de la guerre. Il n’est pas possible qu’on se détruise de la sorte ! Nous sommes tous des barbares ! » (p. 100).
Il ne manque cependant pas également d’un certain humour, et dit par exemple : « Il ne pleut pas dans notre cagna, recouverte de fortes tôles ondulées, apportées péniblement par les Boches du fond de la vallée jusque dans leurs tranchées de la crête ; ils n’ont jamais si bien travaillé » (p. 72).
L’ouvrage est également un hymne à la nature, qu’il dépeint grandiose (voir page 75), et dont il partage l’émerveillement. Il dit « Quel beau pays que l’Alsace » (p. 52) ou « Tristesse de se tuer dans un pareil décor » (page 60). Il magnifie ses écrits par la poésie. Il dit, le 23 avril : « Il a beaucoup neigé cette nuit et la montagne est de nouveau revêtue d’hermine » p. 51 ou « quelques 105 arrivent par paires, comme des colombes » (p. 92). Ses nombreuses observations botaniques (il connait Flore d’Alsace de Kirschleger, botaniste né à Munster (p. 61), et météorologiques témoignent du milieu somptueux et extrême dans lequel il évolue. Le 14 avril 1915, il dit : « À la nuit tombante, en rentrant à Schaffert, seul par les cimes, j’ai failli m’égarer dans la haute neige, quelque part au Sud du Schweisel. Fatigué je commençais à m’inquiéter, lorsque j’ai trouvé un câble téléphonique qui, nouveau fil d’Ariane, m’a conduit jusqu’à la ferme » (p. 34). Car le sujet ici est avant tout la nature, la géographie, la topographie et la météorologie de la montagne. La neige et le froid bien entendu, mais également, par exemple, la fragilité relative de la batterie par rapport à l’orage. Il dit, le 8 mai : « L’après-midi, violent orage et pluie sur nos cimes. Parfois le tonnerre est encore plus bruyant que le canon. Détonations épouvantables, pluie torrentielle. Nous avions débranchés les fils du téléphone, d’où jaillissaient, à chaque éclair, de grandes étincelles. Je dormais à moitié dans la nouvelle cagna quand un craquement terrible survint. La foudre venait de tomber sur un petit sapin, entre notre 2ème pièce et la 1re pièce d’Alliot, à quelques mètres d’un énorme tas d’obus de 220. Chance inouïe ! Nous aurions été pulvérisés par l’explosion à cinquante mètres à la ronde » (p. 73). Cette même scène se reproduit le 27 mai : « Vers midi, orage violent, pluie torrentielle qui nous trempe dans l’abri, sous les buissons. Des fils téléphoniques débranchés jaillissent en craquant des étincelles bleues. La plus longue, me passant entre les jambes, atteint à la cheville Alliot qui depuis marche en boîtant » (p. 99).
Il n’oublie pas non plus qu’il combat et occupe un pays reconquis, une Alsace qui comporte ses complications. Il dit : « Dîné avec mes sous-officiers chez une vieille dame de 71 ans qui n’a pas de nouvelles de son fils depuis le début de la guerre, pour l’excellente raison qu’il appartient au 11e d’infanterie prussienne. La pauvre vieille nous fait pitié. Nous lui avons donné à manger, fait boire du café et même du champagne » (p. 52). Il n’est parfois pas tendre sur les hommes qu’il rencontre, tels ces lieutenants désagréables ou ce colonel Boussat, manifestement craint (voir p. 95), qu’il met en opposition avec des officiers de chasseurs aimés de leurs hommes (p. 108). Dès lors, des informations utiles à l’historien, comme parfois à l’ethnologue, peuvent être relevées à chaque page. Il est enfin descriptif, y compris des grands officiers qu’il côtoie épisodiquement, tels d’Armaud de Pouydraguin, Serret ou Boussat.
L’ouvrage est très bien publié, comporte de rares erreurs (dont une seulement, traditionnelle et déjà maintes fois signalée chez les témoins, à cote). Il est agrémenté en annexes une courte biographie des officiers supérieurs évoqués dans le livre (général Marcel Serret, général Louis Marie Gaston d’Armau de Pouydraguin (décrit p. 60) et son fils Jean, ainsi que le colonel Joseph François Denis Boussat), un glossaire des abréviations et cotes altimétriques, précisant leur localisation sur le terrain, un lexique, une table des matières et une table du théâtre des opérations adossée à une opportune carte numérotée en couleurs.
Lieux évoqués dans l’ouvrage :
Ferme de Schaffert – Observatoire du Schweiselwasen – Schnepfenriethkopf – Kruth – Cote 1201 – Cote 1025 – Anlass-Wasen – Mittlach – Hohneck – 830
Renseignements utiles tirés de l’ouvrage :
Page 6 : Chiffres sur la vallée de Munster dans la guerre : Entre 30 000 et 40 000 soldats et 10 000 civils évacués
17 : Apprend à monter à cheval
18 : Sitomètre (calculateur d’angles)
21 : « La chaleur du poêle est le meilleur agent de liaison qu’on puisse rêver »
22 : Hôtel du Hohneck
: Le 65 de montagne envoie de « charmants obus rouges, coiffés de belles fusées de cuivre verni ».
: Leur bruit : « Ces petits obus éclataient en l’air comme des coups de pistolet »
25 : Organisation de la position et matériel de camp
26 : Vue, description et avis sur les méridionaux (vap 31, 33)
27 : Sur les lettres, il précise : « Dorénavant je ne leur dirai plus où je suis, même approximativement, afin qu’ils ne se tracassent plus quand ils entendront parler de batailles. Il peut arriver que je sois trop occupé ou fatigué pour avoir le temps de leur écrire, même brièvement »
28 : Utilise une carte allemande au 1/20 000e, considérée comme « très précise » (vap 83)
30 : Gibier, il donne une prime de 40 sous pour un chevreuil tué (vap 78, 85 sur le pillage des truites par détournement du ruisseau et la destruction des chevreuils)
32 : Décembre 1916, premier combat de skieurs entre une section d’éclaireurs français et des éléments du 1er bataillon alpin bavarois
33 : Tirs inopérants au fusil contre des avions
34 : Prix d’une baraque d’Épinal : 4 000 francs pièce
35 : Bataille… de boules de neige (vap 47, 48, 115)
: Lycopode appelée jalousie utilisé par les marquaires pour filtrer le lait (vap 50)
: Ennui
42 : Problèmes de réglage, impatience du commandement
44 : Obus passant au-dessus des avions !
45 : Voiture de Serret portée à bras pour la retourner dans la neige boueuse
: Tir vertical dit « Tir dans la lune »
: Bruit de l’obus « avec des froissements de soie »
47 : Différence entre la réalité et le communiqué
49 : Bêtise des journaux
: Poésie des noms allemands des lieux : Schnepfenriethkopf signifiant Tête de la prairie aux bécasses
52 : Allemand fusillé car « il portait des balles retournées dans ses cartouchières »
55 : Canons disparus sous la neige
56 : Mange sans peur des denrées (biscuits et potage) trouvées dans une cagna boche après conquête de la position : « S’il avait quitté moins précipitamment ces lieux nous n’aurions pas osé, de peur d’empoisonnement, utiliser ce qu’il a laissé ». Visite les tranchées ennemies faites dans la neige
57 : « Les Boches ont de l’excellent fil téléphonique, solide et souple »
61 : Voit la nuit les projecteurs des places fortes d’Épinal et de Belfort
66 : Fanions blancs pour signaler les tranchées
: Actes de sabotage témoignant d’une certaine résistance alsacienne ?
67 : Bruit de l’obus (froufrous)
: Comment il détruit l’usine de Steinabrück, avec combien d’obus
68 : La fonte des neiges révèle un corps enseveli
63 : Canon renversé
69 : Renversement du charriot transportant les obus : « Et dire qu’on nous recommandait de manipuler ces obus avec précaution ! »
70 : Ridicule de la peur des conducteurs
71 : Bruit assourdissant, l’artillerie, « c’est un jeu brutal », arbres secoués
72 : Accident de feu de cuisine, dû à une cartouche oubliée dans la paille
76 : Fosse commune de 12 soldats allemands
77 : Description des 74 allemands : « Ce sont des explosifs, bien peints, bien rangés dans des boîtes de tôle emboutie, il traîne aussi des outils servant à je ne sais quoi, car je ne connais pas bien le matériel allemand »
79 : Planchettes de tir au 1/20 000 et grosse monoculaire grossissant 25 fois
80 : Canons amarrés à des souches avec des piquets et des câbles
: Bruit et séquençage en secondes des tirs
82 : Soldat dormant avec un calot de chasseur à pied allemand enfoncé jusqu’aux oreilles
85 : Culot allemand : « Les Boches ont un culot phénoménal : ils font paître sur la montagne de l’Ilienkopf, à l’Est de Sondernach, un grand troupeau de vaches blanches et noires, peut-être pour nous montrer qu’ils n’ont point encore faim, comme on le prétend (…) Ils nous narguent aussi avec des drapeaux flottant sur une espèce de kiosque à l’Est de Metzeral sur une colline dénudée »
: Trophées : trouvé un sac tyrolien de solide toile bistre à plusieurs poches très commode et une patte d’épaule
86 : Grenades à tige dites « épis de maïs »
87 : Décrit un petit moulin hydraulique musical, jouet d’enfant posé sur un ruisseau
88 : Retombées aériennes de shrapnells
: Papier calque récupéré dans les caisses d’obus allemandes
: Sa barbe est censée le protéger des mouches
91 : Description d’un abri fait avec du matériel allemand
93 : Ambiance en ligne à la déclaration de guerre de l’Italie à l’Allemagne
99 : Civile toujours présente dans une ferme sous les obus, blessée
: Electrisation d’un soldat par l’orage
: Rumeur de train blindé
100 : Crise de cartouches de fusil, raclage de fonds de tiroirs
101 : Récupération de justaucorps de caoutchouc blanc allemands, imperméables à doublure rose avec des élastiques aux poignets et à la ceinture et la lettre S brodée en vert sur une manche
: Réutilisation de rondins allemands
: Odeur de cadavres mal enterrés
: Légende des mitrailleurs allemands enchaînés à leur pièce
102 : Tir ami dû à un problème de réglage de montre
: Chronomètre Lipp
103 : 13 attaques allemandes sur 955
105 : Odeur mélangée de résine, de terre remuée, de phosphore et de cadavre
: Téléphone modèle 1909 particulièrement solide
106 : Soldats morts embrochés
108 : Trouve que les artilleurs allemands « sont moins audacieux que nous dans leurs réglages en première ligne »
: Odeur des allemands
109 : Dissuadé par des soldats de tuer des allemands en corvée par peur de représailles par bombardements : « Ayant aperçu en lisière du bois, à cent mètres, trois Boches à calot rouge qui portent des rondins, je me dispose à en descendre au moins un ; mais les chasseurs m’en dissuadent, de peur de représailles par « épis de maïs » et torpilles, durant la relève prochaine »
115 : En promenade, découvre une jambe !
119 : Barres fixes et balançoires accrochées dans des hêtres pour amuser les poilus
120 : Eau phéniquée appliquée sur un tampon pour procéder à des exhumations
126 : Vue de Beaudrand, du 133e RI
132 : Usure de Manon
134 : Résonance sonore
: Couleur des fumées et signification
139 : Horreur de coups directs
: Bruit des obus : « Leurs obus miaulent comme des cordes de violon »
140 : Bombarde Metzeral
: Barberot
148 : Plaquette Malandrin et bruit qu’elle génère
150 : Lit en fougère pour les enfants qui font pipi au lit
: Appareil optique
156 : Suicide d’un lieutenant, flétri pour sa lâcheté par un général
161 : « Bancal » : son sabre
Yann Prouillet, février 2026
Viallet, Elie (1885-1915)
Gasqui, Jacques, Élie Viallet, capitaine de chasseurs alpins. Août 1914 – juin 1915, Paris, Bernard Giovanangeli éditions, 2014, 159 p.
Résumé de l’ouvrage :
Élie Joseph Viallet, né en 1885 dans l’Isère, fait avant-guerre une carrière militaire qui, en août 1914 le trouve lieutenant (depuis 1911) au 13e BCA de Chambéry. Après une courte période de garde à la frontière italienne, le 12 août, le bataillon arrive à Gérardmer, entre en Alsace et reçoit son baptême du feu à Soultzeren. Après la bataille des frontières, et une première blessure, il combat au terrible Hartmannswillerkopf puis est appelé en renfort lors de « l’affaire » de l’Hilsenfirst. C’est là qu’il trouve la mort sous les shrapnells allemands.
Éléments biographiques :
Élie Joseph Viallet naît le 8 juillet 1885 au Gua, dans le département de l’Isère. Son père, également prénommé Élie, est employé au Chemin de Fer Saint-Georges de La Mure (SGLM) qui achemine le charbon extrait des mines du secteur. Sa mère, Mélanie Euphrosine Samuel est lingère. La famille demeure au hameau de Saint-Pierre, dans le village de Saint-Georges-de-Commiers. Une sœur, Marie, rejoint le foyer en avril 1888 ; elle deviendra institutrice et il entretiendra toujours une correspondance avec elle, lui reprochant parfois la rareté de ses lettres (p. 87). Elle vivra dans le souvenir de son frère défunt. Il fait des études à l’école supérieure de Vizille, puis de La Mure à partir de 1901. Il s’engage pour trois ans au 52ème R.I. de Montélimar en octobre 1903 et est promu caporal l’année suivante, en octobre. Il passe sous-officier en juillet 1905, sergent-fourrier puis sergent en septembre 1906. Il est bien noté et désire alors embrasser la carrière d’officier. En 1908, il réussit simultanément les examens d’entrée à l’École d’administration de Vincennes et de l’École militaire d’infanterie de Saint-Maixent, intégrant cette dernière en octobre. Le 1er janvier 1909, il est incorporé élève officier et sort sous-lieutenant, 49e sur 163, le 1er octobre. Il est alors affecté au 13e BACP à Chambéry. Il passe lieutenant un an plus tard. On le retrouve chargé du casernement et des équipages, et remplit les fonctions d’officier d’approvisionnement pendant les manœuvres alpines et d’armée. Il quitte ces fonctions en juin 1913 pour reprendre le service de compagnie puis suit au premier semestre de 1914 les cours de l’École normale de gymnastique et d’escrime de Joinville. Son unité est en Haute-Maurienne pour les traditionnelles manœuvres d’été, en juillet 1914. Le premier courrier publié date du 27 juillet 1914 mais il tient également un journal de marche.
La guerre déclarée et après une courte garde à la frontière italienne, il connaît son baptême du feu le 15 août, participe aux combats de Mandray et de la Tête de la Behouille, dans les Vosges, avant d’être blessé légèrement à la jambe le 3 septembre. Il écrit à sa sœur le 11 qu’il a fait 7 jours d’hôpital et qu’il se remet très bien. Positionné ensuite en Alsace, il participe aux combats du Hartmannswillerkopf au premier trimestre de 1915, date à laquelle il est promu capitaine. Il sera à cette occasion cité deux fois à l’ordre de l’armée, étant l’un des premiers récipiendaires de la Croix de Guerre dans son bataillon (9 juin 1915). Élie Viallet meurt le 15 juin sur l’Hilsenfirst, dans les Hautes-Vosges (Haut-Rhin). Il sera cité une troisième fois et reçoit la Légion d’Honneur à titre posthume (dossier non découvert sur la base Léonore toutefois).
Commentaires sur l’ouvrage :
En page intérieure, l’ouvrage reçoit le sous-titre Élie Viallet, capitaine au 13e bataillon de chasseurs alpins : itinéraire d’un diable bleu.
Très représentative de la correspondance auto-censurée, destinée à rassurer en permanence les siens, les lettres de l’officier Viallet apprennent peu à l’Historien. Mais l’ouvrage trouve toutefois un intérêt dans la qualité de la contextualisation par Jacques Gasqui, présentateur du corpus du capitaine Vialle, qui précise avoir hérité des archives de l’officier, dans son bataillon, donnant à l’ouvrage l’aspect d’une biographie illustrée de correspondances. L’ouvrage est bien présenté et cite nombre d’autres personnages importants cités par le témoin (dont le docteur Boutle par exemple, qui a également témoigné dans l’ouvrage de Jean-Daniel Destemberg, Les Chemins de l’Histoire. L’Alsace, Verdun, La somme (Moulins, Desmars, 1999, 327 p.).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 23 : Durée de la guerre « bien vite réglée et que ce ne serait qu’une affaire de quelques semaines »
24 : Demande à sa sœur de conserver les journaux, « documents intéressants et que je reverrai avec plaisir »
48 : « À côté des amis qui assistaient à notre départ, on voyait des mamans et des sœurs qui pleuraient (elles ne sont pas plus raisonnables à Chambéry qu’ailleurs) ».
59 : Gants de pied supérieurs à la bande molletière pour les chasseurs
83 : Sur l’action de tireurs d’élite : « J’ai organisé depuis mes tranchées plusieurs stands et les bons tireurs les tirent au passage »
96 : Garde un fusil boche
107 : Demande à remplacer son fanion de compagnie, envoie le plan (description p. 108)
113 : Description du chasseur, « uniforme d’homme des bois » : « Béret bleu, peau de mouton, pantalon bleu de mécanicien en culotte de velours, gants de pieds, passe-montagne, cache-nez ; etc., et beaucoup de boue par-dessus tout ça »
114 : Sur l’enrichissement à la guerre : « Je vous envoie un mandat-poste de 300 francs. Je n’avais jamais trouvé autant d’argent dans ma poche en fin de mois. La guerre enrichit, le fait est concluant »
115 : « L’arrivée d’un nouveau galon est une chose dont on se réjouit en temps de paix ; à l’heure actuelle, malheureusement, elle est la conséquence de la disparition d’un camarade »
132 : Stylo Gold Starry
145 : Non-restitution des corps
Yann Prouillet, janvier 2026
Lasbleis, Eugène (1896-1982)
Les lettres de guerre d’Eugène Lasbleis (1915-1918), Senones, Edhisto, 2015, 386 p.
Résumé de l’ouvrage :
Eugène Lasbleis, jeune breton de Lamballe, à 19 ans lorsqu’il intègre, en avril 1915, le 6e régiment du génie d’Angers. Sa période d’instruction achevée, il rejoint le front, où il arrive en décembre, dans le Pas-de-Calais, puis dans l’Oise. Il bouge peu d’abord, occupé à l’organisation du front (défenses accessoires, bétonisation, génie infrastructurel, etc.). En mars 1917, il passe télégraphiste au 8e génie et stationne au terrible Chemin des Dames. Dès lors, les faits militaires s’accélèrent ; il manque d’être fait prisonnier lors des attaques allemandes du printemps 1918 et termine la guerre dans l’Aisne, avant sa démobilisation en 1919.
Eléments biographiques :
Eugène Lasbleis naît le 18 avril 1896 à Lamballe (Côte-du-Nord puis Côte d’Armor) de Florentin, professeur de mathématique et de sciences à l’Ecole Primaire Supérieure de la ville, et de Irma André, fille d’un Alsacien de Mulhouse, optant, mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, son épouse. Eugène est le cinquième enfant d’une famille de six. La famille est d’une tradition de marins hauturiers de l’île de Bréhat [son grand-père était capitaine cap-hornier] qui ont payés un lourd tribut à la mer. André Lasbleis, son fils, qui présente le témoignage, dit que son père a été élevé dans une famille très unie et d’éducation très positive, constructive et libre. Il obtient son brevet élémentaire en 1914 et entre au bureau de dessin de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest à Lamballe. La guerre se déclenche donc alors qu’Eugène a 18 ans. Le 10 février 1915, la classe 1916 passe au Conseil de Révision. Déclaré apte, il rejoint avec deux amis lamballais le 6e RG à Angers. Il décède le 16 décembre 1982 dans la commune qui l’a vu naître.
Commentaires sur l’ouvrage :
Entre avril 1915 et sa démobilisation, Eugène Lasbleis écrira près de 1 000 lettres à ses parents, conservées « avec une piété exceptionnelle » (p. 10) par la famille. C’est André, l’un de ses fils qui étudie et reporte ce corpus, dont il publie 526 lettres. Il est très précis sur le lien filial et le parcours de son père. Son introduction donne nombre d’éléments périphériques utiles à la compréhension de l’épistolier et à son parcours dans le siècle comme dans la guerre.
Eugène Lasbleis prend ainsi le train vers le front le 28 décembre 1915 et débarque à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il fait une période d’instruction au camp de Wailly-Beaucamps, à quelques kilomètres au sud de la ville, qu’il quitte le 8 mars 1916 pour l’Oise. Il arrive au hameau de Dizocourt, dans la commune de Jaux, sur la rive droite de l’Oise. Il quitte ce hameau le 6 mai 1916 et sa compagnie arrive au front dans le secteur Berneuil-sur-Aisne / Tracy-le-Mont le 15 juin suivant. Le 16 août, le 6ème Génie revient à Jaux et repars le 12 septembre pour Canny-sur-Matz, à 3 kilomètres à l’ouest de Lassigny, puis se déplace à Gury le 30 octobre. Le 13 mars 1917, Eugène quitte le 6e génie pour le 8e (Nogent-sur-Seine, dans l’Aube), affecté dès le 16 à la 10e armée du général Mangin. Il rejoint Fismes, dans la Marne le 31 suivant et change ainsi de fonction, passant téléphoniste-télégraphiste. Il participe à l’attaque du 16 avril 1917 sur le Chemin-des-Dames, dans le secteur de Craonnelle, en direction de Craonne, heures apocalyptiques dont il ne communique pas toute la réalité dans ses lettres. Le 23 juin, la compagnie télégraphiste du 8e génie dans laquelle se trouve Eugène est mutée dans les Flandres, à Woësten, au bord de l’Yser, en Belgique. Méritant par son comportement au feu, il reçoit la Croix de Guerre le 30 août avec cette citation : « … Sapeur au 8e régiment du génie. Plein de courage et d’entrain, du 29 juillet au 15 août il a assuré la réparation d’un réseau téléphonique constamment coupé par les obus. Est pour ses camarades, un exemple d’énergie et de dévouement » (page 26). En septembre et octobre, il est affecté un temps au front-arrière à un central téléphonique franco-anglais. Sa pratique de l’anglais n’est pas fameuse (il en parle p. 53 et 322) mais, comme la situation linguistique est similaire « en face », chacun parvient toutefois à se faire comprendre. Il est muté comme chef de poste téléphonique à Fismes et manque de se faire capturer lors de l‘attaque allemande sur l’Ailette, le 27 mai 1918. Parvenu a rejoindre son commandement, il est alors menacé de conseil de guerre pour panique devant l’ennemi. Il s’en sort car la retraite de son unité s’est faite dans l’ordre. Son unité se reconstitue vers Trilport puis, à l’été 1918, les armes se retournent. Fère-en-Tardenois le 11 septembre, puis Rethel, et Bergnicourt (Ardennes). Eugène apprend l’Armistice en permission dans une Lamballe où les cloches sonnent à toute volée. De retour dans les Ardennes, le soldat entre en Belgique par la vallée de la Semois et assiste aux cérémonies à Libramont, émaillées par la tonte de femmes « trop accueillantes » avec les Allemands. Le 19 novembre, il assiste à la débâcle d’une armée allemande abandonnant tout son matériel, « en pleine détresse par la faim. Hommes et chevaux tombent de faiblesse ! » (p. 367). Mi-décembre, il est de retour en France et cantonne à Verdun. Il attrape la grippe espagnole en permission, revient dans son régiment en Lorraine (Lunéville et Blainville), est nommé caporal (6 avril 1919) puis sergent (15 août). Le 19 septembre, il est rendu à la vie civile le 19 septembre. Mais, ne s’étant pas « démobilisé de la guerre » : « c’est parmi les ruines qu’il chercha et trouva vite du travail » (p. 34), engagé par l’administration des Régions Libérées au centre de Saint-Quentin dans l’Aisne. C’est là qu’il rencontre celle qui va devenir sa femme, institutrice à l’école du lieu, qu’il épouse à Pâques 1921. Il travaille ensuite au Service de la Navigation de Saint-Quentin. Le couple aura trois garçons (Jean en 1922, André en 1928 et Yves en 1930). Eugène Lableis prend sa retraite en 1957 et meurt le 16 décembre 1982 .
Jeune homme « brutalement » plongé dans la guerre, il bénéficie de toute l’affection et de l’aide matérielle (colis et argent, jusqu’à demander d’en recevoir moins !) de sa famille, très proche, composée de ses parents et de ses trois sœurs. Itératives ces lettres témoignent d’un quotidien parfois trop long et dont il se sort finalement sans trop de casse. Par sa jeunesse et son « apprentissage au feu de la guerre », l’ouvrage est à rapprocher de celui de Pierre Suberviolle ou celui d’Emmanuel Geisler.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 44 : Punition aux manquants à la mobilisation, faites au front (vap 98)
45 : Est confiant en « son étoile » (superstition)
46 : Ovations pendant le trajet en train
51 : Poux appelés « grenadiers »
53 : Anglophone (vap 322)
56 : Touche des épaulettes d’acier et le casque (vap 66, 76 mais d’« infanterie au lieu du Génie », 78, 79, 87)
59 : Changement d’écriture (pour tromper le contrôle ?)
61 : Salycilate contre les rhumatismes
63 : Touche des cas (ou poches) à grenades non cousus, il les fait coudre
Hameau de Dizocourt où « on ne voit que des vieillards »
70 : Reçoit des bêtises le 1er avril
71 : Permission accordée au numéro de matricule (vap 72 sur l’âge)
78 : Attrape des écureuils
80 : « Un sapeur a toujours la gorge en pente »
81 : Fait de la photo (vap 285)
82 : Pluie = « artillerie de Saint-Pierre » (vap 170 utilise « plume d’oie » pour l’orage)
: Cuistots tournants au régiment
85 : Punis expédiés aux « bat d’Af »
86 : Sénégalais « beaux vilains noirs ! » (vap 110)
94 : « Mocos », soldats du Midi
99 : Artilleurs ivres
: Animaux mascottes (151, adopte un chat errant, tué p. 156 par un ami, 268 une chèvre)
: « Monoplans » = paillasses
100 : « Forte ration » = 1 quart ½ de vin par jour, 5 cl d’eau de vie tous les soirs
104 : Espoir de victoire sur la Somme
109 : Menu
111 : Paye
114 : Se moque d’un prisonnier boche mais dit « C’était pourtant un type qui avait l’air très doux et qui n’avait pas l’ai d’un c… » (vap 209)
115 : « … nous couchons à côté des vaches. (…) Il paraît qu’il n’y a rien de plus sain que de coucher près de ces bêtes ! »
125 : Coupe militaire
126 : Mauvais résultat des zouaves
130 : Ce qu’il pense d’une séance de cinéma aux armées
132 : Apprécie une séance de « vrai » théâtre
141 : Prix du papier à l’auto-bazar (vap 204)
167 : Spectacle d’un duel aérien, avion allemand abattu, description
156 : Explosion d’une lampe à acétylène, 2 blessés
: Etat sanitaire médiocre de la compagnie
157 : Ce qu’il mange en « extra »
158 : Fabrique un piège à rat (vap 274, 275, 278 (il en brûle un vif), 279
162 : Sur le pinard (vap 185 « quand le pinard est signalé dans les environs » !, 187 (abus), 206, 222 « nerf de la guerre », 227
163 : Cafard après la permission (vap 168)
168 : Touche des équipements d’hiver (vap 222, 263, 366)
169 : Utilise des sabots « sans ordre »
170 : Indemnités de voyage, 2,50 f.
171 : « Les boches sont comme nous, ils en ont marre ! », prévoit la fin de la guerre en 1917
172 : Se moque de Mme de Thèbes
174 : Tout gèle. « De ce temps, le moral du poilu baisse avec la température ! » (vap 179)
185 : Espère apprendre les raisons d’un coup de main allemand en lisant le journal !
186 : Vue de civils délivrés, « tels des cadavres »
210 : Après l’espoir du 16 avril,1ères impressions de la « boucherie », moral, il parle de « confirmation du feu »
212 : Alcool de menthe, usage potabilisant (vap 215)
: Mange du cheval
213 : L’escouade prend le nom d’atelier du génie
214 : Pinard manquant, eau potable rare
215 : Durée de la guerre (+ 3 ans) après la publication des buts de guerre français
219 : Motif de retenue de permission (vap 242, différents régimes, 237, 2 jours de plus pour citation)
232 : Espions belges !
233 : Belges curieux
: Chemin des Dames, « zone d’extermination »
241 : Supplément du 14 juillet
247 : Punitions pour les indiscrétions contenues dans les lettres
248 : Vue de prisonniers : « loustics heureux de se sauver de là-dedans ! » (vap 264, 267 et 268)
258 : Fier de porter sa croix de guerre
263 : Ce qu’on trouve pour 3 francs par jour
273 : « Le Russe et le Macaroni valent le même prix ! »
280 : Punition et sentiment d’être « traités comme des chiens », lieutenant forcé de punir
295 : Sur le changement de position du port du calot, ce qu’il en pense !
296 : Fin du tabac gratuit le 16 février 1918
297 : Sur le pommes de terre germées à garder pour les potages militaires
300 : Italien « pas sympathique » ?
302 : Sa famille écrit en morse, clin d’œil à son apprentissage de la discipline au Génie
307 : Repas du Vendredi Saint
312 : Recommande des réfugiés possibles à ses parents
319 : Eau de Vals
325 : Fin de guerre appelée « grande permission »
327 : Abandon d’affaires personnelles dans la fuite, mais en y mettant le feu sur consigne
333 : Américains buveurs « de tout », cuites et bagarres
336 : Sur les risques encourus par les soldats de la classe 1920, dont son petit frère, qu’il conseille en vue de son incorporation (vap 338)
337 : Vision d’un terrain libéré, odeur, utilise sa pipe (vap 339, mouches, 341, 344)
341 : Sur l’absence de respect aux morts
345 : Disparition de la pomme de terre
347 : Les armes tranquilles selon Lasbleis : Génie, RAL, RAC
357 : Vue de prisonniers d’octobre, « jeunes et contents de leur sort »
: Quinquina complet contre la grippe espagnole (vap 363 autres remèdes)
360 : Durée et fin de la guerre, « bout de l’histoire » pour cette année (le 11 octobre !)
361 : « Grand Goastel », utilisé pour l’Armistice, gâteau breton en forme de récompense
: Ravage du Chemin des Dames
366 : Ambiance au 18 novembre 1918
367 : « Les copains n’ont rien eu pour l’Armistice, ni congé, ni pinard …»
: Vue du Luxembourg, débâcle allemande, ambiance, faim des allemands
Yann Prouillet, 21 janvier 2026
Perrin, Pierre (1888-1975)
Laurendon, Gilles. Un guerrier d’occasion. Journal illustré du fantassin Pierre Perrin (1914-1918), Rennes, Ouest-France, 2012, 375 p.
Résumé de l’ouvrage :
Parti de Rigny-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, le 3 août 1914, Pierre Perrin est soldat au 27e RI de Dijon. Sous forme de journal de guerre, mais reportant en fait ses souvenirs, il rapporte une guerre impressionnante de fronts hyperactifs sur La Marne, au Bois d’Ailly, à Verdun, sur La Somme où les Monts de Champagne, qu’il traverse par une suite de miracles continus. Il est à proximité de Reims quand l’allemand plie enfin à l’été 1918. Gazé devant la Suippe, il apprend l’Armistice à Rigny, en permission, miraculé d’avoir traversé quasiment sans blessure une guerre aussi intense que violente.
Éléments biographiques :
Gilles Laurendon, présentateur du témoignage, dans sa courte préface, donne très peu d’éléments sur l’auteur. Aussi, c’est le fils de Pierre Perrin qui nous fournit les éléments complémentaires d’état-civil manquants dans l’ouvrage. Pierre François Léonard Perrin est né le 11 novembre 1888 à Rigny-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, de Jean Marie et de Marie Perrin. Ses parents ont une petite maison sur la place de l’Église du village, à côté de l’édifice. Il a deux frères, dont l’un, Benoît Léonard Joseph, caporal au 29e RI, né le 20 août 1891, meurt le 13 mars 1915 à l’hôpital de Commercy, ayant contracté la typhoïde. Pierre apprend par une carte le 8 mars son admission à l’ambulance n°6, dans la caserne Oudinot. Il va le voir quelques jours plus tard et apprend sa mort le 14, puis son enterrement le lendemain. Pierre Perrin vivait à Paris (17e), 8 rue des Nollets, depuis le 27 octobre 1912, où il travaillait comme dessinateur quand la guerre le mobilise au 27e RI de Dijon, 11e escouade. Il avait fait son service dans ce même régiment en 1913. Il aura lui-même trois enfants. Il occupera aux tranchées plusieurs fonctions, comme planton du colonel de bataillon ou agent de liaison et même infirmier de fortune lorsqu’il est légèrement gazé par exemple. Il est blessé légèrement à la tête par une pierre projetée dans un bombardement le 15 avril 1915, au Bois d’Ailly, et revient au front dès le 20. Il est à nouveau blessé le 18 avril 1917 par éclat d’obus à la jambe droite, au Bois de la Guille, rejoignant le 15 mai suivant. Il est nommé soldat de 1ère classe le 3 juillet 1918 et est ypérité le 6 octobre suivant en bordure de la Suippe pour ne plus revenir au front que le 27 novembre, les combats ayant cessé. Ces blessures finalement légères n’obèrent pas le sentiment d’une suite impressionnante de miracles renouvelés, tel cet obus qui tombe à trois mètres de lui le 25 août 1918, et qui n’éclate pas (p. 339). Alors qu’il avait refusé par trois fois le grade, il est nommé caporal le 1er mai 1919 avant d’être enfin démobilisé le 10 juillet suivant. Il a été cité à l’ordre du régiment le 13 novembre 1915 dans ces termes : « Au cours d’une attaque au petit jour a assuré à plusieurs reprises la transmission des ordres en traversant sous le feu de l’artillerie et de mitrailleuses des terrains découverts, a toujours fait preuve de décision et de courage dans des missions analogues ». Il obtient à ce titre la croix de guerre avec étoile de bronze. Il est à nouveau cité à l’ordre de la Brigade le 9 novembre 1918 avec ce motif : « Très bon agent de liaison, s’est fait remarquer pendant la période du 1er au 4 octobre 1918 en assurant la liaison dans des circonstances difficiles. Intoxiqué ». Il est décoré de la Médaille militaire le 22 mars 1928. Faute d’éléments biographiques plus précis, il faut faire confiance au présentateur de ces souvenirs qui nous indique, pour l’après-guerre : « De retour dans sa famille, Pierre Perrin a recopié scrupuleusement, sans retouche, les lettres, le journal qu’il avait rédigés au front. Sans rien retrancher, sans rien ajouter, au mot près. Il a ainsi rempli quatre cahiers de sa petite écriture serrée et précise » (p. 12), écrits auxquels s’ajoutent un corpus de dessins, des portraits de soldats dénommés, dont quelques-uns sont publiés en couleurs en cahier central ou insérés au fil de l’ouvrage. Il revient à Rigny dès sa démobilisation et sera recensé 10 rue St Sauge à Autun en janvier 1920. Pierre Perrin deviendra professeur de dessin dans plusieurs établissements de la ville. Il est libéré de ses obligations militaires en 1937. Il décède à Rigny le 03 juin 1975.
Commentaires sur l’ouvrage :
Indubitablement classable comme l’un des tout meilleurs témoignages de la Grande Guerre, les souvenirs de Pierre Perrin sont précis, fourmillants de tableaux, d’anecdotes et de descriptions qui révèlent une foultitude de points d’intérêt à chaque page. Il décrit de manière détaillée ce qu’il voit, comme les hommes et les officiers, qu’il dénomme et descend en flammes parfois. Par exemple à Verdun le capitaine Robillot « lèche-botte et faux bonhomme, grossier avec ses inférieurs et plat devant ses supérieurs » (p. 190). Ainsi, il fournit une mine de données utiles à l’historien, livrant un récit incontournable, rappelant celui d’Emile Morin ou de Gaston Mourlot. Doté d’une intelligence supérieure, il connaît le nom des fleurs et des lichens (p. 271), travaille de ses mains, dessine, fait des menus, des écussons, des pancartes, des programmes, des plans de secteur… Il lit beaucoup, dont du André Theuriet, auteur argonnais, et a parfois quelques envolées poétiques sur la nature. Mais Pierre Perrin est surtout un miraculé permanent, renversé par un obus, plusieurs fois blessé, il traverse les secteurs les plus mortifères avec une facilité de façade désarmante. Son témoignage laisse l’impression d’une guerre sans fin, ayant manifestement combattu dans les pires secteurs. Il laisse échapper parfois des sentences qui témoignent de son état d’esprit, par exemple quand ses camarades tombent autour de lui. Il dit alors : « Nous payons chers le droit de vivre libres, et cependant notre volonté ne fléchit pas » (p. 190). Ses sentences peuvent aussi être politiques lorsqu’il assène, en mars 1917 : « Que de grenades qui se perdent » (p. 234) lorsqu’il apprend la démission de Lyautey. L’ouvrage comporte quelques rares erreurs de transcription (Lionville pour Liouville, Léronville pour Lérouville, Mont Rémois pour Mont Trémois ou V13 pour VB) et aurait gagné à accueillir un index toponymique et patronymique, même si particulièrement denses.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 18 : Soldat mort d’insolation
24 : Passage de la frontière vers Avricourt le 15 août, ne voit pas de poteau-frontière
25 : Baptême du feu
: Bruit du départ du 75 « comme des coups de pieds dans un ballon de football, et les longs sifflements soyeux et graves »
27 : Héming pillé par les français
: Bruit des balles : « On se croirait au milieu d’un essaim en révolte »
34 : Soldat atteint d’une balle sans force
31 : Vue impressionnante de divers morts allemands
38 : Traite des vaches abandonnées, à la chaîne, cochon tué à la baïonnette
40 : Pétris des babouins dans la glaise
: « Nous ramenons nos pans de capote sur nos pantalons rouges »
: Bruit des marmites « avec un bruit de wagons lancés à toute vitesse »
42 : Tombe et nom gravé sur une écorce
: Ordures laissées par les Allemands
: Voit sauter le fort de Manonviller, détruit à l’explosif par les Allemands
43 : Lecture du Bulletin des Armées de la République
46 : Madame de Thèbes
49 : N’a pas pris de rasoir car croyait une guerre courte, se fait raser avec des ciseaux pliants de poche
51 : Médailles amulettes au képi
: Se déguise pour tromper un gendarme zélé (l’épicerie de l’autre côté de la rue n’est pas dans le secteur de son régiment !)
53 : Cuisiniers collectionneurs de trophées
: Boîtes de conserve servant de pots de chambre
: Mannequin-leurre allemand
55 : S’abonne aux Annales pour s’occuper
57 : Homme égaré tué par erreur, (vap 70 pour lui-même, sentinelle lui tirant dessus)
59 : Obus cassant son fusil, en trouve un sur un tas d’équipements des morts
60 : Main de mort dépassant de la tranchée
: Marmites qu’il appelle bouteille, (vap 61 obus plus petits appelés saucissons, vap 169 casque à pique pour du 240)
61 : Morceaux humains en emplissant des sacs de terre
62 : Abri allemand fait avec des fusils français
65 : Miction dysentérique
: Description d’une marche harassée
69 : Contact, bouteilles lancées contenant des blagues et des insultes contre les boches
71 : Archives de Brasseite pillées
: Mortiers crapouillots de 1844 et 1855 (vap 65)
73 : Obus direct sur 4 hommes
74 : Méridionaux sans gêne
76 : Bottes canadiennes et en caoutchouc
77 : Vu d’anglais à Commercy
78 : Obus allemand à double éclatement
80 : Catapultes à roues
83 : Eau de vie au goût d’éther
: Adresses des familles laissées en cas d’attaque
84 : Vision impressionnante du bombardement, bruit et sapes
87 : Mort d’André Chaumont, d’Epoisses, auteur dans La revue de Bourgogne
89 : Colis américain contenant « un mouchoir, du papier à lettres, un crayon, un savon, du chocolat, une pipe creusée dans une sorte de panouille avec un tube en roseau, et… du papier hygiénique » (vap 366 « un petit sac de toile qui contient du papier à lettres, un crayon, une blague et des cartes à jouer. Quelques-uns y trouvent un rasoir mécanique, d’autres une paire de ciseaux. Petit, lui, y trouve une toupie mécanique… »
90 : Démonte des grenades allemandes
92 : Buse abattue au fusil (vap 119 une autre soignée à la teinture d’iode)
93 : Casque à pointe, trophée convoité
: Général Blazer, détesté, surnommé von Blazer (vap 95 et 115)
96 : Rififi entre régiments (8e et 56e) suite à la perte d’une tranchées
: Caisse de calendriers = grenades
: Mutinerie
97 : Capitaine Boll surnommé « capitaine-crapouillot »
98 : Homme tué en pêchant à la grenade (vap 326)
102 : Homme tuant un renard par erreur
: Artisanat de tranchée (vap 107, 109 cannes, 117)
105 : Moustiques
107 : Contact avec des soldats allemands polonais, échange de cigares et de bonbons contre du pain blanc
109 : Poilu’s Park (vap 118 sa description, 284)
111 : Bras tranché abandonné par son propriétaire
113 : Sur le commandement : « Les hommes commandés par de telles savates sont incapables de quoi que ce soit »
114 : Vision épique de la récupération d’un cadavre
: Condamnation à mort d’un soldat par Blazer, réhabilité sous le feu
116 :Recherche des fusées d’obus et part avec 20 kg de débris d’obus
117 : Canon de 7
: Déserteurs pacifistes fusillés, vue de leur exécution
118 : Distribution de couteaux, pas de succès (vap 161)
: Concert improvisé sur des douilles d’obus
: TPS et Alsaciens employés à l’écoute, ce qu’ils entendent (vap 167)
123 : Paperasserie
126 : Cartes distribuées en prévision d’une attaque
: Couleurs d’obus de 75, croix blanche sur peinture kaki et bandes rouges sombre
128 : Accident de grenade
: Sculpte des blocs de craie
129 : Explosion d’un fourneau de mine, pense à une secousse sismique
130 : Le 27e RI touche le casque le 8 octobre
: Corvée de fusil, horreur de la tranchée, fouille macabre pour des trophées
: Eclatement d’un canon de 270
132 : Avion-canon
133 : Fait des croix et des plaques de craie gravée (vap 137)
136 : Giclous ou zim-boum, surnom des 88 autrichiens
137 : Têtes sculptées par des coloniaux dans des maisons en craie de Saint-Rémy-sur-Bussy
141 : Déserteur allemand, précurseur d’autres volontaires déserteurs, ruse qui ne prend pas
: Soldats nettoyeurs, qualifiés d’apaches
145 : Brassards allemands pour les attaques de nuit
146 : Mocos (argot pour marins) méridionaux (vap 151 et 152, anti-midi)
150 : Poudre en lamelle (pour les 75) ou en macaroni (pour les 77), fait chauffer le café avec
151 : Girouette et cloche à gaz (vap 197 un avion girouette dans la tranchée)
154 : Déserteurs aux mains liés
: Fumier
: Apprentissage du morse (vap 233, 254)
159 : Obus nouveaux à éclatement successifs et balles traçantes
160 : Avion descendu par une mitrailleuse
: Soldat fataliste
: Fusils braqués sur des cadavres
161 : Cadavre récupéré, analogie avec Dayet
: Obus en bois, cad qui n’éclatent pas
162 : Hommes signalés car ils ont tiré sur des poules
: Obus non éclatés rouillés
163 : Guidetti lance-bombe
Lance-bombe inutilisé pour ne pas recevoir de contre feu
: Chat qui fait la navette entre les lignes françaises et allemandes, à qui on a attaché un ruban tricolore (rappelle Joyeux noël de Carion)
: « Quel temps pour se faire casser la gueule ! »
164 : Contacts, cris allemands
: Voit une photo aérienne de son secteur
: Peur incontrôlable
165 : Démonte une grenade pour étudier son fonctionnement qu’il décrit (vap 170)
166 : Arbre observatoire (vap 175 percuté par un obus)
167 : Explosion d’un dépôt de munition, débris humains
169 : « …chasseurs dont le ventre s’allume au soleil comme un ablette entre deux eaux »
170 : Tracts allemands par ballons
: Désertion retardant une relève
171 : Apache que l’on doit enfermer en prison
173 : Pilons et huîtres, « grenades plates comme des galets lancés à la main »
: « Quatre jours de permission à ceux qui donneront cinq cents francs en or pour la Défense nationale. Le procédé, financièrement, est peut-être habile, mais ignoble. Aussi on s’est promis de casser la gueule à ceux qui profiteraient de cette annonce. Personne ne s’est présenté »
174 : Torpilles Save
: Habitants revenant dans leur maison avec des gendarmes pour chercher des affaires (vap 341)
: Bourrage de crâne lu dans un rapport à propos d’une désertion de 2 régiments du 15e corps, qui ne prend pas
175 : Tranchée minée
: Vue de Spahis
176 : Fabrique un violon fantaisie avec un vieux bidon et des fils de téléphone
182 : Corps phénolés en attente de sépulture
190 : Prisonnier allemand aidant le transport sanitaire à Verdun
191 : Vision dantesque de la poudrière de Souville
192 : Allemand devenu fou ayant bu de la teinture d’iode
: Odeur de la putréfaction « que Toussaint comparait à celle du saucisson de Lyon »
: On prend les effets des sacs des morts
193 : Hommes « placés à l’arrière des voitures, chez qui on ne distingue plus que la bouche et les yeux » à cause de la poussière
194 : Broderie de Lunéville
197 : Confectionne des pancartes pour les tranchées
: Contact, lettre posée par les Allemands, avec texte et photo, pour rendre compte des honneurs rendus à des morts français en mars 1916 à Gondrexon (vap 198)
200 : Pierre à percuter les grenades
201 : Tank comparés aux cuirassés de terre d’H-G Wells
202 : Description de lance-flammes
204 : Lange Max vu par un guetteur depuis l’hôtel de Ville de Nancy ; qui prévient des tirs pour mettre les gens à l’abri dans le délai entre le départ et l’arrivée de l’obus et vue d’une collection d’obus de divers calibres au même endroit
205 : Conférence tombant faux d’un Alsacien qui parle de Boche
206 : Auto combustion du foin
: Jeux sportifs, score, tricherie, prix remis
207 : Coud une peau de mouton sur son « sac à viande » (vap 221, matelassé)
208 : Menace un épicier sur le prix usuraire des bougies
211 : Boue moirée d’essence
220 : « La guerre est longue à ceux surtout qui la font à pied »
: Comment il braconne le lièvre : « On met du plomb dans le canon du fusil, une bourre de papier par-dessus et une cartouche sans balle » (vap 294)
223 : Prix des denrées
224 : Souliers entourés de drap pour lutter contre le verglas
225 : Argonne : « le bois est partout rasé, on dirait une plantation de manches à balai »
227 : Soldats écroulant les maisons pour récupérer les poutres (vap 233)
: Mange du corbeau et du chat (ceux de Vienne-le-Château), (vap 236 un chat dépouillé)
228 : Faux canons en bois
231 : Dévisse une grenade suffocante pour en faire une lampe à pétrole
: Mention de section franche
233 : Prisonnier de Clairvaux ayant demandé à retourner au front
234 : Perle d’un général « Les autres hommes des petits postes se reposeront en travaillant »
: Tir sur des oies sauvages
235 : Caillebotis tapissés de sacs à terre pour amortir le bruit des pas.
: Prix comparé d’un bombardement
236 : « Le phosphore des trous d’obus éclaire vaguement l’obscurité »
: Piano Erard dans une sape
: Pillage dans Vienne-le-Château par Van den Busche, brocanteur
237 : Signe un acte de décès
: Vue du cimetière de Florent-en-Argonne, horribles cocardes tricolores en fer peint
: Contact, écriteau allemand
239 : « Des gendarmes donc pas d’obus ! »
242 : Proclamation sanguinaire du colonel pour gagner la fourragère
: Voit une photo aérienne de son secteur
: Communication par le sol à l’aide de lampes spéciales et d’une antenne de quelques mètres, fichée en terre (vap 254 TPS et TSF, stage, divers et explications)
: Engagé à ne pas faire de prisonniers, protestation
246 : Bâton près de la tête pour marquer un corps enterré, ce avant la croix
: Pressentiment de la mort
: Légèrement blessé par un obus de 105, il retire lui-même son éclat à la jambe
247 : Hôpital de Bar-le-Duc, description du traitement
: Tirailleur ne voulant pas le thermomètre anal
248 : Obusite Shell shock
: Prêtre pistonné par une commission de réforme
251 : Martiniquais mal traités (vap 252)
: Vol de chaussure ! (vap 256 pour bidon et musette)
252 : Colonel limogé pour avoir dit merde à général
: Lampe à acétylène faite avec un quart, une boîte de conserve et deux ficelles
: Bruit du canon de 37 qui « claque comme un fouet de charretier »
: Officier mort par bravade suite à une assertion de peur
254 : Revue de chevaux
: Evadé prisonnier allemand blessé, tentative infructueuse
255 : Camp disciplinaire du 129e mutiné, culasses des fusils ôtées. Complot pour aller à Paris
: Vue des péniches bloquées sur la Meuse depuis 1914
256 : Description des femmes dans une usine de munitions
260 : Sur l’effet de la note de Pétain « Pourquoi nous nous battons »
261 : Sur les plusieurs façons d’écrire l’Histoire après un coup de main
: Pas assez grand pour faire porte drapeau au défilé du 14 juillet 1917 à Paris !
263 : « Dans l’air, on suit la courbe des torpilles et la lueur de leur mèche allumée »
264 : Enterrement difficile à cause de la décomposition des corps
: Pochard perdu entre les lignes
268 : Saucisse ressemblant « à quelque monstrueux poisson de légende »
: Trouve des os et les signale, respect dû au mort
: Piège à rat
270 : Saucisse enflammée par avion (vap 287, 299)
171 : Allemand utilisant des 203 japonais
272 : Portes amiantées (vap 286)
273 : Pancarte allemande
274 : Curieux canons anglais à l’âme hexagonale, posés sur des affûts rudimentaires en pierre
: Bataillon du Pacifique
: Fillette tuée par un avion allemand à Talant près de Dijon (Bourrage de crâne ?)
275 : Observateurs japonais
276 : Anglais venu de l’arrière avec une espèce de cloche sur le dos pour recueillir les gaz afin de les étudier
277 : Obus à gaz quasi silencieux
: Chants allemands entendus depuis la tranchée française
: Rats tués par les gaz (vap 322 idem pour les abeilles)
: Portes annamites
: Obus allemands à messages avec nom de prisonnier et renseignements (vap 315 et 316 avec ballonnets de journaux, et 353 journaux allemands jetés par avion)
287 : Concours de grenades VB
290 : Ballonnets pour vérifier la direction du vent pour les gaz
291 : Match de foot anglais contre français, gagné 2 à 1 par les anglais
293 : Mange des moineaux bardés de lard
: Théâtre aux Armées
297 : Pillage et destruction systématique, registre d’état-civil traînant sur le parquet de la mairie de Dommartin-sous-Hans
: Poêle réalisé avec des tôles
301 : Voit un phénomène naturel curieux : « un nuage est apparu, s’est scindé en deux et, par deux fois, un anneau jaunâtre est apparu »
308 : Poisson d’avril
310 : Américains aux dents en or
312 : Vision d’un coup de main dans le vide
: Baraques métro en tôle
314 : Américain abattu car meurtrier
315 : Nuage artificiel
316 : Horreur d’une tête de mort nettoyée par les fourmis !
318 : Pour les Américains, Jeanne d’Arc est la madone de l’Alsace
319 : Américain faisant une photo d’un pont pour prouver qu’il n’est pas gardé !
: Boxe avec des noirs américains, officiers blancs, tatoué ganté, discriminations
320 : Idiotie de la désinfection des paillasses
324 : Américains excités imprudents se baladant sur les parapets sans souci du danger
328 : Faux laisser-passer pour rentrer à Epernay
: Réfugiés logés sous des ponts aux arches aménagées
329 : Canons anti grêle à Épernay
330 : Se brûle légèrement les yeux à cause d’une fiole d’acide chlorhydrique (vap 331)
: Stahlhelm abandonnés par les allemands car trop lourds
332 : Bruit « bien connu » du 210, « un départ sourd, un bruit de wagonnet »
: Découvre dans une sape (piégée ?) un essai de fougasse composée de trois obus de 105, de pilons et de détonateurs
: Ersatz allemand
333 : Essai de signaux optiques
: Obus au phosphore, reflets à long terme
: Renard blessé
: Pipe Pétain
: Change son casque
: Tombe d’anglais avec casque
334 : Chevaux dépecés
335 : Bronzage
338 : Melons et raisons blancs
: Interdiction de familiarité avec les noirs « pour ne pas choquer les officiers blancs qui considèrent les Noirs comme de race inférieure. Et leur guerre de Sécession a duré quatre ans pour libérer les esclaves noirs du Sud ! »
339 : Détruit un nid de guêpe avec des détonateurs
340 : Chien de liaison
: Radeau fait avec des sacs rempli de paille pour passer la Vesle
342 : Pilote abattu non blessé se servant encore de sa mitrailleuse
343 : Nacelle de ballon détachable avec parachute
347 : Gaz pallite ?
: Seins coupés sur une envahie (histoire rapportée !)
348 : Homme tué par une sentinelle dont il n’avait pas entendu les sommations
350 : Sacs Habert
354 : Paillasses allemandes entoilées de papier
: Affiche allemande « représentant un soldat anglais écoutant à un microphone, placée près d’un appareil téléphonique pour avertir de faire attention aux conversations »
: Lanterne pensée piégée mais en fait non, peur des pièges
: Gargousses payées 1 franc par pièce, mais spoliation par des « artilleurs qui, eux, restent plus longtemps que nous et auront le temps de brocanter notre matériel »
355 : Prisonnier occupé à désamorcer les explosifs
357 : Gazé, se lave les yeux avec du café
358 : Comment il est traité
360 : Effets de l’ypérite
362 : Vue de cimetières, spécificités par nationalité
363 : Définition de l’intérieur « ce pays de rêve où on n’entend plus le canon et, le soir, on n’a pas besoin de camoufler les lumières »
364 : Grippe espagnole
: Vue d’Auxerre
365 : Paperasserie risible pour un bonnet de police (vap 366 pour des bretelles)
: Enterrement de Russe
366 : Huile goménolée
367 : 11 novembre 1918
369 : Corneilles mascottes avec des noms allemands
371 : 10 juin 1919, on ne sait comment occuper les hommes, cours multiples
372 : Costume Abrami et visière de casque
373 : Citation de la 2ème Cie du 27e RI et la sienne (12 novembre 1915)
Yann Prouillet, 2 octobre 2025
Janériat, Joseph (1879 – 1916) et Joséphine (1884- 1956)
Lettres à Joséphine Histoires intimes de la Grande Guerre 1914 – 1916
Karine Chavas
« Mon Joseph aimé, je te quitte, il faut aller donner aux vaches. Voilà quatre heures, le temps est sombre, ça sera vite nuit. »
1. Les témoins
En 1914, Joseph et Joséphine Janériat sont des cultivateurs qui vivent dans une ferme à Sainte-Colombe (Rhône). En 1914, leurs trois filles ont respectivement 9, 7 et 5 ans. J. Janériat est d’abord affecté au 109e RIT à Vienne puis à Bollène (Vaucluse) ; il monte en ligne en avril 1915 avec le 299e RI et est longtemps stationné en Lorraine en secteur calme ; il est tué en novembre 1916 à Verdun, dans la bataille de reconquête de Vaux-Douaumont (début le 24 octobre 1916).
2. Le témoignage
La correspondance échangée entre Joseph et Joséphine a été découverte par la famille, classée et présentée à Sainte-Colombe à l’occasion du Centenaire. Karine Chavas a retranscrit cet ensemble (une centaine de lettres et une centaine de cartes) et l’a publié en 2017 (Lettres à Joséphine, éditions Sutton, 190 p.). Elle précise en avant-propos avoir seulement corrigé l’orthographe et ajouté de la ponctuation, en gardant la syntaxe et la grammaire d’origine, pour profiter au mieux de « de la verve et du langage typique de l’époque ».
3. Analyse
Nous avons ici une correspondance paysanne marquée surtout par l’affection et l’attachement familial. L’évocation de l’arrière-plan agricole est constante mais le détail des activités militaires de Joseph est lui presque complètement absent.
a. « Joséphine, contrairement à Joseph, aime beaucoup écrire » (Karine Chavas)
Joséphine adresse de longues et fréquentes lettres à son mari (avec autorisation de citation, 5.01.1915, p. 20) « Mon époux bien aimé, je m’en vais te quitter pour aujourd’hui. Voilà trois lettres que je t’envoie à la file, je vais finir par écrire comme un notaire, toutes mes soirées passant à faire des lettres. » Elle correspond le plus souvent possible, faire écrire les trois filles à leur père, et révèle une aisance réelle dans ses courriers, avec un style très marqué par l’oralité ; elle donne des nouvelles des enfants, de proches ou de connaissances qui sont « montés » à la ferme, fait le bilan des travaux de la journée et des projets pour le lendemain.
Joséphine reproche à Joseph de ne pas écrire assez souvent, et surtout de n’en pas « mettre suffisamment », elle voudrait que ses lettres ressemblent aux siennes ; dès le début de la séparation, elle lui signale (p. 16) « Tu m’a fait joliment attendre pour m’écrire depuis mercredi. J’attendais, je n’ai reçu qu’aujourd’hui. J’étais désolée (…) Mon Joseph aimé, écris moi bien souvent, tu seras si gentil. Moi, je te fais de si jolies lettres. » Les cartes de Joseph sont laconiques, ce qui déclenche des plaintes répétées (p. 26)« Et encore, on dirait toujours que tu es pressé de finir. Tu me racontes que des choses ennuyeuses. Tes lettres n’ont point d’amitié. » Soulignons que toujours, après les reproches, vient un changement de ton et de nombreux témoignages de tendresse, ce qui fait que Joseph ne peut se formaliser, les missives n’ayant jamais une tonalité acariâtre ; dans la même logique, avec malice, les filles sont instrumentalisées (p. 64), ainsi de Marie : « Mon cher papa aimé Que je suis contente que tu nous aies écrit aujourd’hui. Maman t’écrivait tous les jours, nous étions si tristes de n’avoir point de réponse. Tu avais trop à faire car tu nous aimes trop pour nous oublier comme ça.»Joséphine sait aussi reconnaitre les progrès (p. 34) : « C’est bien gentil pour toi de m’avoir vite répondu, surtout de m’en avoir bien mis.» Il est probable que le courrier est plus vital pour elle, un peu isolée dans sa ferme en haut du village, que pour lui, socialisé en permanence avec les camarades de sa section.
b. Joseph, une courbe d’apprentissage de la correspondance ?
L’historien préfère toujours l’authenticité de la source, mais ici la transcriptrice a eu raison de rectifier l’orthographe, cela permet d’apprécier ce que dit Joseph sans le diminuer, par exemple p. 15 : « je dérdire bauqot que mas lettre tant trouve de même » pour « je désire beaucoup que ma lettre t’en trouve de même. » ou p. 124 « s’il na reverien » pour « s’il n’arrive rien ». Il n’a pas l’inspiration de sa femme (p. 29) : « Je te réponds de nouveau car on me dit que je ne t’écris jamais assez souvent. Je ne sais pas quoi il faut mettre pour garnir ce pareil papier. » Ses cartes restent courtes mais apparaît progressivement un jeu sur ses amorces et ses salutations, marqué par une inventivité tendre qui le dédouane probablement un peu de son manque d’inspiration, on a successivement : « Chère bien aimée, Chère épouse, Chère amie, Bien chère petite maman, Ma bonne amie ou Chère bonne amie… » et on passe en signature du « Joseph » tout simple à « Ton ami bien aimé, Joseph, Ton Joseph qui t’embrasse bien fort, Ton Joseph qui t’aime, Ton ami (plusieurs fois) », et un tendre « À ma petite maman » signé « Ton gamin ».
Joseph, souvent bonhomme, est toujours rassurant et parfois savoureux (p. 114, 24.06.15) : « L’on vit un peu en philosophe dans les bois. L’on ne sait pas trop les nouvelles. Tout va bien ici, rien de nouveau. » Remerciant pour un colis qu’il partage (2.07.15, p.118) : «J’en ai trois à mon escouade qui ne sont pas riches (…) Ici, l’on s’aime les uns aux autres. » Il fait une seule fois allusion aux embusqués, ne parle jamais des opérations militaires ni des Allemands, et sur ces sujets adopte toujours avec Joséphine un ton distancié (21.07.15, p. 127) « Aujourd’hui, l’on apprend à lancer des boîtes à mitraille et des fusées. Tu sais, je vais finir par devenir galopin, l’on apprend rien qu’à mal faire au régiment. »
c. Plus que de guerre, il est avant tout question d’amour dans cette correspondance (Karine Chavas)
Ici, comme dans d’autres correspondances d’époux séparés par la guerre, c’est l’éloignement qui fait découvrir la force de l’attachement (p.42, 3.02.15) : [perspective de se revoir] « Mon Aimé, nous serons plus libres, nous serons comme des jeunes amoureux car je crois qu’on le devient. » et plus loin « Je ne t’avais, je crois, jamais aimé comme à présent, nous nous étions jamais si bien compris. Je prie Dieu beaucoup que tu reviennes pour t’aimer encore d’avantage (…) ». De même, comme dans d’autres témoignages ruraux, l’éloignement fait attribuer aux correspondants les désaccords passés à une mère ou à un père qui vit à la ferme avec eux (p. 54, 19.02.15) :« jusqu’à présent, nous étions jamais bien compris, supporté et aimé l’un l’autre grâce à mon pénible père qui était l’auteur de tous nos ennuis et tous nos désaccords ; [son frère François] « Il me disait : pauvre petite sœur, prend patience, que veux-tu, il n’est au monde que pour le travail et pour ronfler. Il n’a jamais su ce que c’était qu’autre chose.»
d. Les enfants
Joséphine donne souvent des nouvelles des enfants, et attache de l’importance au maintien du lien familial (p. 69, 3.03.15) « Toute ta petite famille va bien. Marie et Marcelle dorment sur la table. Alice fait des additions. Nous allons faire notre prière pour toi. Chaque soir nous la faisons ensemble. » Elle fait écrire aux filles des cartes pour les fêtes ou l’anniversaire (p. 39) : « (…) Le temps nous dure bien que tu viennes pour de bon. Espérons que ce sera bientôt petit père chéri. Les gros mimis de tes trois filles qui t’aiment bien. » Elle aide la plus petite (6 ans, p.60) : (…) Je t’envoie une jolie carte en attendant que tu viennes me faire des gros mimis. La maman conduit ma petite menotte et moi je suis bien contente.» Alice envoie à son père en mars 1916 un poème qu’elle a composé et celui-ci a annoté au dos de la carte (p.151) « Chère Alice, que Dieu du ciel entende ta petite voix pour toujours Ton papa qui t’embrasse. »
e. les travaux et les jours
Pour Joséphine les journées de travail, jointes aux soins aux enfants, sont harassantes, et l’inquiétude du lendemain et un relatif isolement produisent une véritable usure physique et psychologique. L’extrait conséquent qui suit pourrait tout à fait être reproduit à titre d’exemple pédagogique dans un manuel d’histoire au collège (28.05.15, p. 100) – elle dit ne pas avoir le temps de faire une grande lettre – «Mais tu me pardonneras pour cette fois, petit adoré, ta mignonne est si las ce soir. J’ai tant bûché ces deux jours. Nous avons fini de rentrer nos luzernes de la baraque cet après-midi. Nous avons fait trois voyages avec Lulu et puis avec les bœufs de Joséphine. C’est moi, petit chéri, qui ai fait le voyage et puis tu sais, il était même gros. Le père Combe m’a fait compliment comme j’avais bien su faire. J’ai bien bûché cette semaine et je ne sais vraiment pas ce qui peut me tenir debout. Ce doit être la Sainte Vierge car je ne suis guère forte. Je n’ai pas un pauvre moment pour le foin, les vignes qu’il faudrait attacher. Mon quatre-fonds est resté tout inculte, maintenant il ne faut pas songer. De tout côté il sort du travail et toujours du monde en moins pour le faire. Le père Rivoire m’aidait encore de temps en temps. Il a reçu sa feuille. »
f. La fin
Joseph passe avec le 299e en octobre 1916 à l’arrière de Verdun, pour une période d’entraînement avant une offensive, et il rassure sa femme, sur des secteurs « pas mauvais. » Joséphine n’est qu’à moitié dupe, déjà en 1915 (p. 118) elle lui avait fait remarquer : « Jean Guignard a écrit aujourd’hui, j’ai vu sa lettre qui explique comme ta compagnie est mal placée. Un homme a été tué. Toi, tu ne racontes rien de tout ça à ta petite femme pour ne pas l’effrayer. » Les préparatifs de l’offensive Nivelle-Mangin (24 octobre 1916 – reprise de Vaux et Douaumont) finissent par être connus à l’arrière, et Joséphine s’inquiète (22.10.16, p. 174) : « (…) Beaucoup me disent que vous allez attaquer dans l’endroit où vous êtes et que ça sera très dangereux. »
La dernière carte de Joseph date du 23 octobre, veille de l’offensive :
« Nous sommes par là, dans des camps de bivouac, pour des divisions. Je suis en bonne santé. (…) Rien de bien important pour le moment que bien des cassements de tête. Reçois mes nouvelles chère femme et en t’embrassant de tout mon courage, et bien des caresses aux enfants. » « rien de bien important pour le moment… » : quand on pense au tumulte effroyable de la préparation d’artillerie qui précède cet assaut général sur Verdun… Joseph minore jusqu’au bout les dangers, et le lecteur contemporain, lui aussi anesthésié, est finalement assez surpris d’apprendre sa mort le 1er novembre : au propre comme au figuré, Joseph a jusqu’au bout protégé les siens.
On voit en définitive que c’est surtout par l’évocation de la forte affection que se portent les membres de cette famille paysanne que ce recueil est intéressant ; cet univers est si puissant que la transcriptrice termine ses remerciements par une mention bien sympathique, assez rare dans l’univers austère de l’historiographie de la Grande Guerre (p. 186) : « Et comme il s’agit dans ces lettres bien plus de famille et d’amour que de guerre, je souhaite pour conclure renouveler justement tous mes vœux d’amour à mes merveilleuses filles et à mon compagnon (…) pour qui je vais voler… quelques mots à Joséphine : « Je ne t’avais, je crois, jamais aimé comme à présent ». »
Vincent Suard, septembre 2025
Lec’hvien, Michel (1890 – 1974)
War hent ar gêr Sur la route de la maison
Hen ivez, pell a oa, a verve gant ar c’hoant da lâret, ha hepdale, kenavo d’ar Boched.
Lui aussi, depuis longtemps, bouillait du désir de dire sans délai kénavo aux Allemands.
1. Le témoin
À la mobilisation, Michel Lec’hvien est cultivateur dans la ferme de son père à Kermestr (Ploubazlanec, Côtes d’Armor). Il rejoint à 24 ans le 3e régiment d’artillerie à pied de Cherbourg, puis est transporté à Maubeuge pour renforcer l’artillerie de l’ensemble fortifié : il est fait prisonnier le 8 septembre 1914 lors de la chute de la place. Détenu dans différents camps, il réussit en avril 1916 à s’évader avec deux camarades et à atteindre la frontière hollandaise. Réincorporé au 3e RAP, il fait de l’instruction à Cherbourg jusqu’à son retour volontaire en ligne, avec le 105e régiment d’artillerie lourde en janvier 1918. Démobilisé en août 1919, il reprend la ferme familiale en 1921.
2. Le témoignage
War hent ar gêr – Sur la route de la maison –, sous-titré La Grande Guerre banale et exceptionnelle de Michel Lec’hvien, est un ensemble de textes publié aux éditions À l’ombre des mots en 2018 (275 pages). Le recueil a été publié à l’initiative de Marie-Claire Morin, éditrice fondatrice d’À l’ombre des mots et petite-fille de M. Lec’hvien. L’ouvrage propose deux versions du récit, avec des commentaires et explications de Yann Lagadec et Hervé Le Goff.
a. Le texte en breton est assez court, puisque ce récit d’évasion occupe 22 pages (p. 41 à p.62). War hent ar gêr est un petit opuscule paru en 1929, qui reprend avec quelques modifications mineures le texte original paru en 1928 dans l’hebdomadaire Breiz. Ce récit est signé « eul laboureur » (le laboureur), dans un hebdomadaire régionaliste modeste par son tirage mais influent par sa diffusion dans les milieux bretonnants, il veut promouvoir la langue et la culture bretonne, son autre but étant moral et religieux, voire catéchistique (note 13 p. 31, H. Le Goff).
b. Suit une traduction du récit de 1929 (p. 65 à p. 95), effectuée vers 1995 par Job Lec’hvien, prêtre et neveu de Michel, à usage familial. Cette traduction a été revue par Jef Philippe.
c. Viennent ensuite les Souvenirs d’un ancien combattant, la seconde version du témoin Michel Lec’hvien, rédigée cette fois en français vers 1970 ; ce récit a une taille plus conséquente (p. 97 à p. 153).
d. Hervé Le Goff propose un intéressant décryptage culturaliste (p. 15 à 38) et Yann Lagadec un appareil d’explication et de mise en perspective historique (p. 155 à 269).
3. Analyse
a. Le récit d’origine en breton
Dans le registre « témoignage Grande Guerre », outre la rare relation d’une évasion réussie – nous ne manquons pas de récits de captivité –, l’intérêt est ici la forme de cette narration. Il s’agit d’un texte en langue bretonne, très marqué par l’oralité, et pouvant ainsi être destiné à un jeune lectorat ; la publication dans la revue est accompagnée de quelques gravures d’illustration, la revue Breiz se voulant aussi un biais pour familiariser avec la lecture du breton ceux qui n’en étaient pas familiers (A. Le Goff).
b. Le texte d’origine traduit
On trouve ici les figures de style du conte, avec une invitation à l’écoute, et, scandant le récit, des comparaisons imagées, de la sagesse populaire, des proverbes et des dictons familiaux. Il s’agit vraiment d’un témoignage historique, nous dit le locuteur au début, car (p. 64) « ce n’est pas un conte [au sens de : ce n’est pas une fiction], ce que je vais écrire, mais une histoire vécue et véridique d’un bout à l’autre. » On peut prendre (avec autorisation de citation) cinq exemples pour exemplifier cette façon d’écrire ;
– p. 71 les prisonniers doivent abattre des arbres « Aucun salaire ne nous était donné pour notre peine. Je me fatiguai. « Si vous faites le mouton, disaient les anciens, vous serez tondus » De crainte d’être tondu trop court, je demandai à revenir à Sennelager. »
– p. 74 il se décide à préparer son évasion :
« Homme sage, avant d’entreprendre
Prends conseil tout d’abord. »
– pour fuir, il s’associe avec deux camarades, mais pas davantage (p. 75) : « Nous étions maintenant assez de trois. Il ne fallait pas trop publier le désir qui était dans notre esprit. Car, comme disent les Léonards :
La poule perd son œuf
Qui chante trop après pondre. »
– arrive le jour favorable (3 avril 1916) : « le vent était bon, il était temps de vanner. »
– puis pour clore cette première partie de l’évasion (p. 80) :
« Kenavo, ferme de Kamen,
Kenavo, gardien inattentif !
Demain, devant ton maître,
Tu feras une danse sans sonneurs ! »
Alain Le Goff précise que le frère de l’auteur, l’abbé Pierre-Marie Lec’hvien, un des principaux animateurs de la revue Breiz, a fait ajouter dans livret de 1929, avec l’accord de son frère, la phrase prosélyte finale (réussite totale de l’entreprise, fin du récit): « Le lendemain, dimanche des Rameaux, avec mon père (…) j’étais dans mon église paroissiale à la grand’messe, remerciant le Seigneur Dieu, la glorieuse Vierge Marie et Madame Sainte Anne. »
c. Souvenirs d’un ancien combattant
En 1970, Michel Lec’hvien réécrit en français une nouvelle relation de son épopée (terme impropre car – en breton comme en français – le propos est très sobre). La trame est identique, mais l’ensemble est bien plus détaillé ; ainsi, la période qui va de la mobilisation à la capture à Maubeuge occupe une page en 1929 et cinq dans le récit personnel et non publié de 1970. Le style est factuel, descriptif et exempt de toute l’oralité du texte d’origine. On peut constater que les éléments centraux sont à peu près identiques, mais le temps ayant fait son œuvre, la faim ou la brutalité des Allemands sont atténuées dans le second récit : (p. 110) « Des colis arrivaient de France, de nos familles, ce qui nous permettait de tenir sans trop de mal. » L’évasion devient possible parce que l’auteur va travailler à l’extérieur dans des fermes, et il signale y avoir été bien traité. De même il est intéressant de constater qu’en breton (1928 et 1929), si l’auteur utilise « an Alamaned » (les Allemands) et « soudarded an Alamagn » (les soldats allemands), il cite à plusieurs reprises « ar Boched » (les Boches) : ce sobriquet méprisant a disparu sous le trait de l’auteur en 1970, de même que dans la traduction du texte breton par Job Lec’hien en 1995, on voit ici qu’avec le temps, la Mémoire prend le relais de l’Histoire, en arrondissant les aspérités.
La préparation de l’évasion est minutieuse, et M. Lec’hvien explique comment il a trouvé des conseils avant de se lancer dans ces 75 km à vol d’oiseau qui le séparaient de la frontière (4 jours de marche de nuit, p. 113) « Ceux-là qui étaient repris, se voyaient les vêtements marqués. Habituellement sur la manche de la veste-capote, était cousu un tissu à couleur vive, rouge écarlate, vert cru, bleu, jaune. Cette façon de procéder était de la part des Allemands une lourde erreur. En effet, qui pouvait fournir des renseignements précis à ceux-là qui songeaient à s’évader, sinon ces évadés repris ? Ils pouvaient être considérés à juste titre comme des « professeurs d’évasion ». » Ils sont chaleureusement accueillis par les Hollandais, avec pain blanc à profusion et gestes amicaux (p. 131) : « L’un d’eux nous photographia parmi un groupe de soldats [hollandais] et, nous demandant nos adresses, nous promit de nous envoyer à chacun une photo, il tint parole. » Il n’a pas été possible de retrouver cette photographie en 2016.
d. contribution savante
Yann Lagadec apporte des éclairages sur ce témoignage ; il reproduit l’article de L’Éclaireur du Finistère (p. 158) qui évoque l’évasion réussie, et qui insiste sur les informations rapportées par les fuyards sur la situation en Allemagne (p. 169, exemplaire du 29 avril 1916) : « La garde des camps est confiée à des territoriaux et à des réformés qui sont nourris comme les prisonniers. C’est une preuve qu’en dépit des fanfaronnades du chancelier, les vivres n’abondent pas en Allemagne. ». Il croise aussi le texte de M. Lec’hvien avec des récits de prisonniers et d’évadés bretons et note par exemple que sur le plan matériel, l’installation de l’électricité dans les baraquements (avec interrupteur extérieur) impressionne les prisonniers (p. 203 note 70) : « Pour ces ruraux bretons, le fait d’être éclairés à l’électricité n’a rien de banal. »
Les motivations profondes des trois évadés sont difficiles à éclairer, mais c’est revoir les siens et la Bretagne qui domine ; la volonté de reprendre le combat n’est pas évoquée et Y. Lagadec n’a trouvé pour cette motivation qu’un seul cas de figure avec un interné civil qui n’avait jamais vu le front (p. 222) ; il se dit en désaccord avec Stéphane-Audouin-Rouzeau et Annette Becker (« Oubliés de la Grande Guerre, 1998, p. 126 et 127, et « 14-18 Retrouver la Guerre », 2000, p. 119), qui proposent la généralisation selon laquelle les prisonniers brûlent de s’évader pour des raisons patriotiques et pour poursuivre le combat (p. 119) « le désir logique du capitaine de Gaulle comme de celui de l’immense majorité des prisonniers est l’évasion. Car elle est espoir de retour au cœur de la guerre (…). » Selon Y. Lagadec, (p. 222, note 99) cette démonstration « ne parvient pas à convaincre à la lecture des témoignages de la plupart des évadés étudiés. »
Donc un témoignage intéressant, inscrit dans l’histoire de l’évolution rapide de la Bretagne des années Soixante. La force du témoignage de Michel Lech’vien tient dans sa concision, sa modestie-même (Y. Lagadec, p. 268), et, pour le récit en breton, dans sa forme proche du style des conteurs itinérants pour publics adultes, encore nombreux en 1914. Pierre-Jakez Hélias (« Le quêteur de mémoire », 1990, p. 267) montre que ces conteurs accueillis aux veillées avant 1914 ont progressivement été marginalisés par l’alphabétisation des publics, puis entre-deux guerres par l’éclairage électrique et la T.S.F., le poste de télévision venant achever ce processus de disparition. Peut-être Michel Lec’hvien a-t-il voulu proposer en 1970 un récit en français plus dans l’air du temps ? Si celui-ci est plus complet, on lui préférera quand même le court récit d’origine, qui mélange irruption de la modernité de la Grande Guerre et univers culturel bien plus ancien.
Vincent Suard, septembre 2025