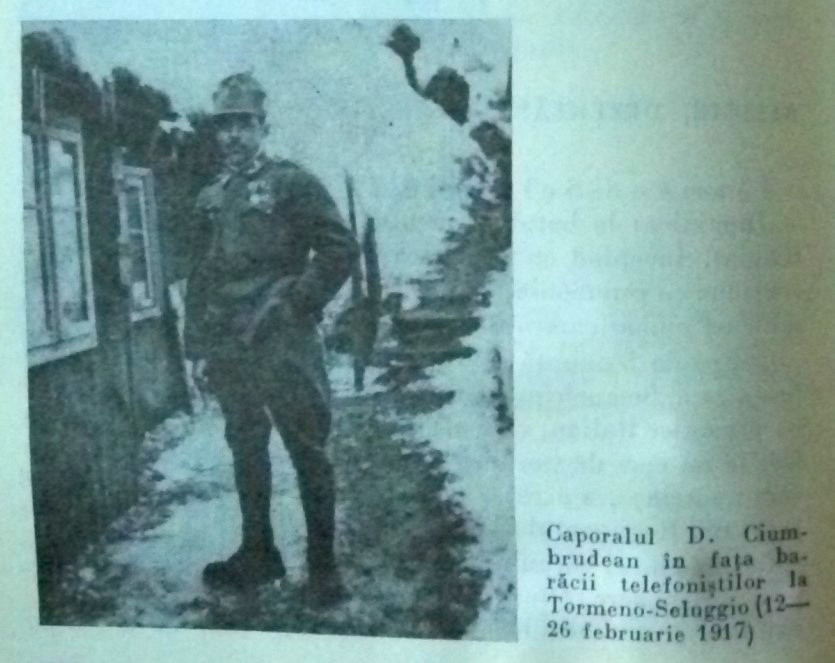Olivier Roussard, Août 1914 L’artilleur Alexandre Richard témoigne
1. Le témoin
Alexandre Richard, né en Savoie dans une famille d’agriculteurs, habite à Saint-Étienne (Loire) à la mobilisation, et y exerce la profession d’ajusteur. Mobilisé en août au 6e régiment d’artillerie de Valence, il combat en Alsace puis dans la Somme. Blessé le 1er octobre 1914, il est hospitalisé puis classé service auxiliaire. Il est ensuite versé dans un groupe d’aviation (Lyon) comme mécanicien-ajusteur. Représentant de commerce (outillage pour travail du bois) entre les deux guerres, il décède accidentellement en 1948.
2. Le témoignage
Olivier Roussard, journaliste d’entreprise et du domaine économique, a publié en 2017 aux éditions Baudelaire « Août 14 L’Artilleur Alexandre Richard témoigne » (185 pages). Il s’agit de la retranscription du journal de guerre de son arrière-grand-père, qui s’étend du 2 août au 1er octobre 1914, soit deux mois de campagne dans l’artillerie au cours de la guerre de mouvement. L’ouvrage est riche en présentations et explications diverses, puisque sur 185 pages, le témoignage proprement dit occupe une place modeste (de la page 103 à 141).
3. Analyse
En introduction de ce récit de début de campagne dans l’artillerie, Olivier Roussard affirme « faire son devoir de mémoire personnel » (p. 9) en publiant ce témoignage, et tous les éléments qui accompagnent ce journal de guerre relèvent probablement d’une passion pour la Grande Guerre, puisqu’outre la biographie fouillée d’A. Richard, bienvenue, on a des considérations nombreuses sur les uniformes, les armements, les décorations, etc… et ceci pour les différents belligérants. Ce sympathique engouement n’est pas exempt de maladresses, ainsi par exemple p. 11 « Ces derniers [les Français] étaient dans leur ensemble parmi les plus bellicistes, tel que le démontra l’ «Union sacrée », ou à la même page « Victime du bourrage de crâne, il est arrivé à Alexandre Richard de qualifier les Allemands de « Boches » dans son journal. ». Le volume se divise d’abord en une longue présentation, puis vient le témoignage proprement dit, qui précède une sorte de guide « Retrouvez la trace de vos ancêtres Poilus » ; c’est une évocation des différents services d’archive, avec une bibliographie (la partie « témoignages de combattants », avec une cinquantaine de références, est bien documentée) et une abondante sitographie. Le récit d’Alexandre Richard, probablement issu de la tenue journalière d’un premier carnet, a été ensuite recopié en belle anglaise, et O. Roussard nous dit l’avoir retranscrit « mot pour mot » (p. 39).
Le 6e d’artillerie de Valence est transporté vers Épinal le 9 août 1914 ; les mentions sont assez courtes, l’auteur décrit son itinéraire, les noms des villages parcourus, les nouvelles indirectes des engagements … Le régiment évolue au-delà de la frontière pendant trois jours, sans d’abord rencontrer beaucoup de troupes allemandes. Les Français sont acclamés (18 août), mais l’auteur mentionne aussi le lendemain, au village de Steige, que 61 hommes du 52e RI de Montélimar ont été tués par « traîtrise des Allemands et des paysans du village.» (p.114). Il semble qu’A. Richard est surtout à l’échelon, car s’il évoque les mises en batterie, il ne parle pas du pointage et du tir. Cette position en retrait est confirmée par une mention du 29 août (p. 121) : «nous apprenons la mauvaise nouvelle : notre groupe, les 4e, 5e, 6e batteries, est cette fois presque anéanti. On ramène des blessés, trois canons et les chevaux valides.» C’est ensuite beaucoup plus calme pour lui en septembre, dans la région de Saint-Dié.
Engagé à Harbonnières (Somme) le 24 septembre, l’auteur décrit un front mouvant, avec des tirs de soutien à l’infanterie et de fréquents changements de positions, à cause de la contre-batterie allemande très insistante, et il mentionne régulièrement des tués et des blessés, ainsi le 26 (p. 133) : « L’artillerie allemande fait beaucoup de victimes parmi nos batteries de 75, à 12 h 00 nous recevons une pluie d’obus qui nous tue trois camarades et en blesse sept. (…) ». L’auteur bénéficie d’un peu de repos le 30 à Bray-sur-Somme et ce jour-là il est changé d’affectation, il signale (p. 136) « Je marche à la batterie de tir comme un conducteur de derrière, cela me donne à réfléchir. » Il passe donc à une position plus exposée, et la sanction a lieu dès le lendemain : c’est le moment fort du témoignage (Bray sur Somme, 1er octobre 1914, p. 137). Une « grêle d’obus » leur tombe dessus au moment où ils attèlent pour changer de position, les coups s’allongent vers eux « de 100 mètres par 100 mètres » et les font plonger au sol. Au moment où l’auteur se relève pour dire au chef « de changer de place», leur attelage est foudroyé : blessé à la jambe, il essaie de dégager son chef de dessous son cheval, mais s’aperçoit que celui-ci est décapité, il est épouvanté « car en plus du chef cinq ou six camarades sont morts, les uns le ventre ouvert, les autres déchiquetés, on ne peut se l’expliquer. » Une autre explosion le blesse d’un deuxième éclat, mais il réussit à marcher 400 m en arrière vers un poste de secours, puis est évacué à l’ambulance de Bray-sur-Somme. Il se remettra lentement à l’hôpital de Dinard.
Ce court témoignage est intéressant pour décrire le danger pour les servants d’attelage sous le feu, ces hommes sont un peu moins exposés que ceux des batteries, mais les canons allemands les menacent lors des fréquents changements de positions. Statistiquement, le danger est moins fort que dans l’infanterie, mais les coups au but sont terribles (p. 138) : « hommes et chevaux jonchent le sol, les caissons de munitions sont en feu, les blessés qui gémissent car leurs blessures sont très graves, surtout dans l’artillerie. Les cris vous arrachent le cœur. »
Vincent Suard, mai 2023