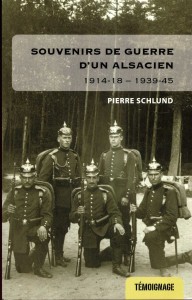– le témoin :
Charles Rudrauf naît le 23 décembre 1895 dans une famille alsacienne traditionnellement francophile. Son père est chef d’atelier à la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM) de Graffenstaden et la famille, qui compte six enfants (Emile, Louise, Lucien, Charles, Lina et Albert, mort en bas âge) vit dans un logement de fonction proche de l’usine. Après une scolarité à l’école communale d’Illkirch, il suit comme Lucien avant lui un enseignement scientifique à l’Oberrealschule beim Kaiserpalast (« école supérieure près du Palais impérial »), selon le vœu de son père qui les destine à une carrière d’ingénieur à la SACM. Toutefois, les deux finissent par s’écarter de cette voie et Charles, qui manifeste assez tôt un goût pour la peinture, décide de poursuivre ses études à l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg. En juin 1912, il effectue son premier séjour à Paris et y retrouve Lucien, déjà installé, qui l’introduit dans le milieu artistique et dans les cercles patriotiques de la capitale, notamment les associations d’Alsaciens-Lorrains. Au terme de sa deuxième année en école d’arts, en automne 1913, il y retourne pour un long séjour, logeant quelque temps avec Lucien chez Paul Ledoux, un artiste peintre lui aussi originaire d’Illkirch-Graffenstaden. Recommandé par son professeur de français strasbourgeois, il intègre l’atelier de l’artiste Cormon et bénéficie en outre d’une bourse délivrée par le même mécène que Lucien. En dehors de l’atelier d’apprentissage, il fréquente assidument les musées et les expositions de Paris, et perfectionne ainsi son art. Il rentre en Alsace en juillet 1914 et s’y trouve donc au moment de la déclaration de guerre, contrairement à Lucien. Dans un premier temps, il est incorporé dans l’Ungedienter Landsturm (territoriale pour ceux qui n’ont pas encore effectué leur service militaire), au sein d’un bataillon de travailleurs occupé à creuser des tranchées à l’ouest de Strasbourg. En novembre, il passe devant le conseil de révision qui le déclare apte à servir dans la prestigieuse Garde impériale, mais attend encore quelques mois avant de recevoir son ordre de mobilisation, prévue finalement le 1er juillet 1915. Comme beaucoup d’étudiants, il s’est engagé comme volontaire, sans doute pour pouvoir bénéficier d’une formation supplémentaire d’élève-officier. Il l’entame dans une caserne de Berlin, revêtu de la tenue de grenadier de la Garde. Sa première période d’instruction s’achève en septembre 1915 ; il est alors envoyé parfaire son apprentissage au sein d’une compagnie de mitrailleurs alpins dans le Riesengebirge (les Monts des Géants, dans le massif des Sudètes). Il se réjouit d’être préservé des dangers du front et y apprécie les bonnes conditions de vie, ayant désormais « le loisir de penser quelquefois à autre chose qu’à graisser des bottes et à nettoyer des armes » (p. 45), c’est-à-dire la possibilité d’exploiter la source d’inspiration que constituent les montagnes pour s’exercer à son art. A la fin du mois de mars 1916, un ordre interrompt cette quiétude et l’envoie en renfort sur le front ouest avec tous les hommes non encore partis combattre. Il part ainsi le 9 avril à destination des Ardennes, où il reste quelques jours avant de rejoindre le secteur de Verdun, en retrait de la ligne de front. En juillet, il est chargé du ravitaillement de l’état-major du régiment au fort de Douaumont. Le 15 juillet, alors qu’il se trouve dans la zone des combats, il est blessé au menton et à la main. Deux semaines plus tard, il décède de ses blessures dans une ambulance allemande à Romagne-sous-les-Côtes. Inhumé dans un cimetière militaire allemand, sa tombe est par la suite transférée par les autorités françaises avec celles d’autres Alsaciens au cimetière national de Mangiennes, où une croix indique : « Ici repose Rudrauf Charles, Alsacien, mort pour la France ».
– le témoignage :
Charles Rudrauf, Le drame de la mauvaise frontière : Lettres d’un Alsacien (1914-1916), Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1924, 115 p.
Le parcours de ce témoin mort au front en 1916 serait resté inconnu sans le travail de mémoire mené inlassablement par son frère, Lucien Rudrauf. A l’aide de ses propres compléments dans l’ouvrage, ainsi que de ses publications postérieures, il nous est possible – et cela est nécessaire pour bien comprendre le témoignage – de reconstituer son parcours et de comprendre ses motivations. Aîné de Charles avec six ans de plus, il semble avoir exercé sur lui une certaine influence artistique et politique (patriotisme pro-français). Proches depuis leur enfance, leurs liens sont encore renforcés par ces centres d’intérêts communs. Après des études de philosophie à l’Université de Strasbourg, Lucien quitte l’Alsace pour Paris en octobre 1911 afin d’y parfaire sa connaissance du français, et d’y continuer ses études de littérature française et d’histoire de l’art. Recommandé par son professeur de français Hubert Gillot, lecteur à l’Université de Strasbourg, il est introduit dès son arrivée dans le cercle des patriotes alsaciens de la capitale par l’intermédiaire d’Esther Chevé, collaboratrice de Zislin pour la revue satirique Dur’s Elsass. Il rencontre ainsi les grands noms de la cause française en Alsace-Lorraine tels que Zislin, Hansi, Preiss, Laugel, Wetterlé, Bucher, mais aussi les membres de la Ligue des jeunes amis d’Alsace, ainsi que ceux de la Ligue des patriotes, notamment Paul Déroulède. Six mois après son arrivée, après avoir écoulé toutes ses économies, il bénéficie du mécénat généreux de Paul Mellon, lié par alliance (par un de ses fils) à la famille d’industriels alsaciens De Dietrich, ce qui lui permet de rester à Paris. Il entreprend ainsi une thèse sur la lithographie romantique. A l’entrée en guerre, il s’engage volontairement et combat sur le front français avec le 113e RI, notamment en Argonne, sous le nom d’emprunt de Lucien Rivière. Blessé puis promu sergent, il finit la guerre en entrant à Strasbourg avec le 55e RI, dont il porte le drapeau.
En 1924, Lucien est à l’origine de la publication posthume des lettres de son frère, après les avoir rassemblées (elles proviennent de la famille et de quelques amis de Charles), triées (un choix a été opéré : il ne s’agit pas d’un corpus complet de correspondance), et traduites de l‘allemand en français. Dans les lettres sélectionnées, certains passages ont été supprimés, considérés sans importance, résumés parfois en une phrase comme : « (Ici quelques plaintes au sujet de la nourriture insuffisante) » (p. 18). En outre, les passages laissant entrevoir le patriotisme pro-français de Charles sont mis en valeur avec des caractères en italique.
Les lettres ne sont jamais très longues, et comportent très peu de détails sur les aspects militaires de la vie quotidienne. Elles sont principalement adressées à ses parents, à son frère Emile, à sa sœur Louise, institutrice à Mutzig, et à un ami (Schenkbecher). Une ou l’autre sont adressées à son frère Lucien. En effet, la famille peut compter sur une dame originaire d’Illkirch-Graffenstaden, Mme Cruchon, pour passer le courrier en France, via la Suisse où elle réside (elle est pourvue pendant quelques temps d’un laisser-passer pour se rendre en Alsace auprès de sa mère malade).
En définitive, il s’agit d’un témoignage partiel et partial, à classer parmi les œuvres de propagande francophile. Son contenu, mis en forme par Lucien, reflète certes l’état d’esprit d’une partie minoritaire de la population de ces provinces, mais tend à être généralisé à tous les Alsaciens-Lorrains sous le titre Le drame de la mauvaise frontière. C’est d’ailleurs confirmé en 1966 par Lucien, qui note : « Le recueil de ses lettres est un prodigieux document pour la connaissance psychologique du « drame de la mauvaise frontière » ». L’ouvrage est dédicacé à Paul Déroulède et Paul Mellon (le mécène parisien), et préfacé par Georges Delahache, archiviste à Strasbourg issu d’une famille d’ « optants ». Ce dernier y développe le thème de l’Alsace restée fidèle à la France. L’épilogue est quant à lui signé par Esther Chevé qui conclut en dénonçant la « vraie tragédie », celle de « l’Annexion forcée » (p. 114), avant d’implorer les Français d’apaiser « ces Ombres douloureuses (…) par une juste réparation ». Ce n’est pas un hasard si ce livre, qui est le premier témoignage d’un Alsacien de l’armée allemande à être publié en France, s’attire les bonnes faveurs de la presse française qui en fait la critique, en particulier le Journal des Débats Politiques et littéraires (10.06.1924), et Le Mercure de France (01.01.1925).
– Analyse :
Ces avertissements donnés, le témoignage est au moins intéressant à deux titres : d’une part sur l’identité francophile d’un soldat de l’armée allemande, de l’autre sur la place d’un artiste dans la guerre. Forcément conscient des risques liés au contrôle postal, Charles n’exprime pas explicitement ses idées politiques, mais les manifeste ponctuellement à l’aide de sous-entendus qui laissent peu de doutes. Ses lettres ne contiennent cependant aucune critique ouverte du militarisme allemand, ni d’évocation de discriminations à l’égard des Alsaciens-Lorrains. Si celles-ci ont existé et ont parfois été amèrement ressenties, il faut se garder de les généraliser. Au sujet d’un de ses sous-officiers, il note même en août 1915 qu’il est un « homme très convenable » (p. 25). Un mois plus tôt, à peine arrivé à la caserne, il écrit, étonné : « Le traitement n’a rien eu d’humiliant jusqu’à présent » (p. 8). Certes, il est conscient des avantages liés à son statut : « les volontaires d’un an sont traités d’une manière un peu à part ». Au final, il se plaint surtout de la pénibilité des exercices, même s’il se félicite d’y résister fort bien. Ce qui le fait « cruellement souffrir » (p. 3), c’est la séparation d’avec sa vie d’avant, ses connaissances à Paris, sa famille, et surtout son frère (il regrette de ne pas pouvoir combattre à ses côtés, p. 26. Il se montre toujours impatient d’avoir de ses nouvelles. En outre, il craint que son engagement dans l’armée allemande constitue un fossé qui, en se creusant, le sépare toujours davantage de ses proches : « Je me demande souvent avec effroi combien nous serons devenus étrangers l’un à l’autre, lorsque nous nous reverrons, mon frère, moi, et nos autres amis. Combien faudra-t-il de temps pour lancer un pont par-dessus l’immense gouffre que les évènements ont creusé entre nous ? » (p. 43). Et de continuer, plus loin, sur une considération plus générale englobant les Alsaciens-Lorrains : « Faut-il que ceux qui sont les plus innocents de l’affaire en aient à souffrir le plus terriblement ! » Pris en tenaille dans ce conflit, il s’impatiente de voir aboutir la paix, à condition qu’il s’agisse de la « bonne », c’est-à-dire, à demi-mot, celle qui accompagne la victoire de la France. Car il éprouve le sentiment trouble de se trouver dans le mauvais camp. Berlin n’a pour lui aucun charme (p. 6, 10, 12, 24, 25), en comparaison avec Paris, « notre belle capitale » (p. 41). Toutefois, il est ravi d’y trouver la presse française comme le Temps ou le Figaro, où il peut lire le récit de « nos grandes victoires » (p. 20). Il en fait même parvenir des exemplaires à sa famille en Alsace. Par ailleurs, il porte un regard très distant, voire franchement hostile, à l’égard de ses « Kameraden » (p. 47) : « Le fait d’être parqué avec tant d’individus étrangers, vulgaires et abrutis, a éveillé en moi des instincts aristocratiques. » Quand les Allemands font la fête pour la nouvelle année 1916, il se tient à l’écart. Il préfère se replier sur les quelques Alsaciens « avec qui on peut s’entendre » (p. 9). La ressemblance est ici frappante avec ces lignes de Barrès : « Ma répugnance de principe à servir l’Allemagne se doublait d’une sorte d’incapacité physique à causer avec mes “camarades” », extraites du roman Au service de l’Allemagne, dont on sait qu’il figurait en bonne place dans la bibliothèque de Charles Rudrauf (p. 26). Il est bien tentant de penser que ses lectures passées constituaient pour lui une source d’inspiration.
Dans les dernières pages, la mort de Charles apparaît mystérieuse. En effet, sa dernière lettre, datée du 31 juillet, exprime un message optimiste : « Je suis en voie de guérison. » Or, il décède trois jours plus tard. La dernière lettre reproduite est celle signée de la main du médecin chef de l’ambulance, qui explique la dégradation rapide de l’état de Charles, suite à la suppuration de ses plaies. Mais cette version officielle est mise en doute par Lucien et le soupçon plane à la fin de l’ouvrage. Il l’exprime clairement en 1966, dans un ouvrage biographique consacré à Charles : « Ne semble-t-il pas que tout se soit passé comme si le Docteur Diehl avait trouvé un moyen rapide pour éliminer ce blessé peu intéressant pour l’armée allemande, frère d’un sergent de l’armée française ? » Lucien fonde cette conviction sur des passages dans les lettres de Charles évoquant son désir de mettre bientôt en œuvre son « dessein », ainsi que sur les circonstances mystérieuses qui entourent sa mort : à son avis, les autorités militaires auraient profité de cette hospitalisation pour se débarrasser de Charles après une tentative avortée de désertion.
En tant qu’artiste francophile isolé dans l’armée allemande, le lien épistolaire avec sa famille et ses proches est absolument vital : ses parents lui donnent les nouvelles qu’il attend avec impatience, en particulier de son frère, tandis qu’il entretient sa passion de l’art avec certains de ses amis, notamment Schenkbecher. Tous, famille comme amis, lui procurent des livres (par exemple la Divine comédie de Dante, ou du Dostoïewski), des revues et des catalogues d’art, ainsi que des cahiers de dessin, c’est-à-dire autant de moyens pour lui d’échapper à son quotidien morne, de « s’arracher à l’inertie intellectuelle qui est le grand danger de la vie militaire », comme le note Lucien à l’appui des lettres de son frère. Dès qu’il le peut, il s’adonne à son art, faisant à l’occasion prendre la pose ses compatriotes (p. 50), mais regrette souvent de manquer de temps. S’intéressant surtout aux portraits et aux paysages, il porte également un regard émerveillé sur certaines contrées qu’il est amené à traverser.
Sources :
Maurice Barrès, Au service de l’Allemagne : les bastions de l’Est, F. Juven, Paris, 1906 (5e éd.).
Charles Rudrauf, Le Drame de la mauvaise frontière : Lettres d’un Alsacien (1914-1916), Nancy-Paris-Strasbourg, France, Berger-Levrault, 1924, 115 p.
Lucien Rudrauf, « Charles Rudrauf, peintre et martyr », in L’Alsace française, juillet 1936, n° 770, p. 173-177
Lucien Rudrauf, Un maître alsacien de vingt ans: Charles Rudrauf, mort pour la France, Strasbourg, 1966, 179 p.