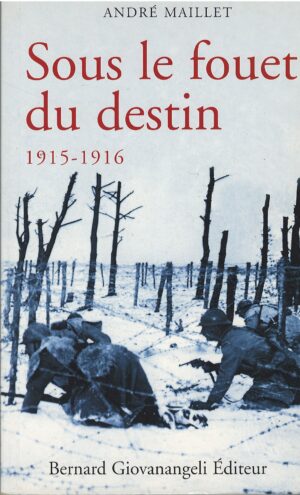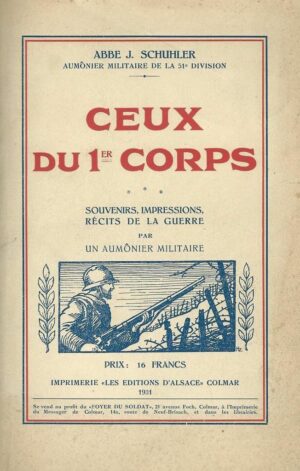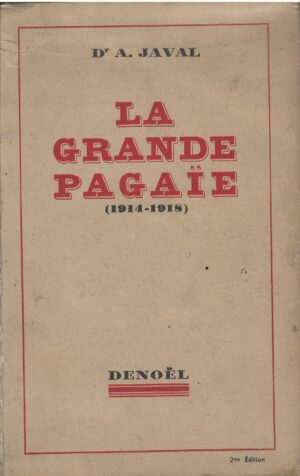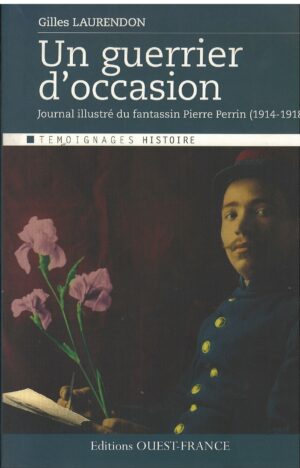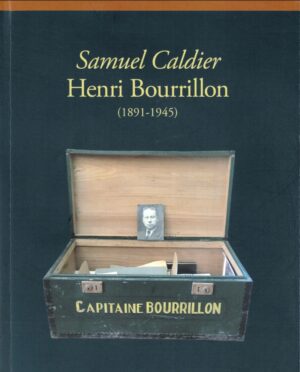Mouton, Auguste, Rosée sanglante. Journal d’un soldat de la Grande Guerre, CSV éditions, 2017, 257 p.
1. Le témoin
Auguste Mouton est né le 30 avril 1891 à Bourges, dans le Cher. En 1904, il entre au petit séminaire Saint-Célestin, aujourd’hui lycée Jacques Cœur, dans cette même ville. Il y acquiert manifestement de solides éduction et connaissance générale. Il parle anglais, ce qui lui servira à la fin de la guerre, avec 3 sergents noirs américains en Argonne (p. 211) ou se fera même un temps interprète auprès des anglais (p. 229). Il joue de l’harmonium, mais il ne sait toutefois pas nager. À sa sortie, il est employé de banque et demeure à Paris. En 1912, il fait sa période militaire au 51e RI de Beauvais, caserne Watrin, d’abord comme élève caporal puis occupant des fonctions de secrétaire. Il termine sa période peu avant la déclaration de guerre qui le rappelle le 2 août à la 20e compagnie. Il quitte la caserne le 14. Il perd sa belle-mère le 6 juin 1916, nouvelle qui l’attriste, puis épouse en pleine guerre Elise, qu’il appelle Lily, en l’église de La Madeleine à Paris, où il demeure, rue Victor Massé, le 15 septembre 1917. Il fait d’ailleurs à plusieurs reprises, en fonction de ses fonctions ou de ses stations à l’arrière du front, venir sa femme « en douce » à chaque fois que possible. Il ne sera démobilisé que le 16 août 1919. Il reprend d’ailleurs, au cours d’une permission, quelques jours, son travail à la banque parisienne Société Générale avant même d’être démobilisé. Dans les années 30, il s’installe dans l’Eure, à Nassandres. Du couple naîtront André, né le 19 septembre 1919, (mort le 15 février 1942), Monique, née le 25 juin 1930 (décédée le 21 mars 1948) et Eliane, née le 21 février 1935. Auguste décède à Evreux le 3 décembre 1972 à l’âge de 81 ans. C’est Véronique Normand, arrière-petite-fille d’Auguste qui publie les souvenirs de guerre du témoin.
Son parcours dans la guerre étant divers, le sont aussi ses différentes affectations relevées de son récit : 51e RI (20e puis 30e Cie) jusqu’au 30 avril 1915 où il passe à la vaguemestre du 3e compagnie hors rang du 3e bataillon du 402e bataillon de marche, à l’existence éphémère puisqu’il est dissous début avril 1916. Il est donc muté au 111e d’Antibes, régiment qui sera lui-même dissous début juillet 1917. Il passe alors dans différentes compagnies du 298e RI, changements multiples qui s’accompagnent le plus souvent d’une phase de cafard. Après-guerre, ce dernier régiment est à son tour dissous, lui occasionnant à nouveau la charge d’en liquider la comptabilité, rendant ses comptes à l’officier de Détails (p. 239 et 240). Il est alors affecté aux 5ème puis 7ème compagnies du 120e RI où il occupe diverses tâches, dont celle de repérer les obus non éclatés pour les signaler aux artilleurs pour le désobusage.
Il apprend le 23 novembre 1916 qu’il est proposé pour la croix de guerre avec une belle citation pour sa conduite au fort de Vaux (p. 160), qui lui sera remise dans la tranchée-même début mars 1917 (p.e 168). Il en obtient une seconde en août 1918. Paradoxalement il gardera toute la guerre son grade de sergent, expliquant « que mon poste de sergent-vaguemestre était plus enviable que les galons de sous-lieutenant » (p. 101). La guerre terminée et avant sa démobilisation, il occupe un temps la fonction de sergent-major, redevenant fourrier après la dissolution de son dernier régiment (298e). A noter que sa fonction de vaguemestre, rarement documentée, rapproche cette partie du témoignage de celui de Félix Braud in Les carnets de guerre du sergent vaguemestre Félix Braud, (1914-1917) (Senones, Edhisto, 2002, 191 p.).
C’est lui qui donne la conclusion de son récit, aussi encyclopédique que pédagogique, lorsqu’il est enfin libéré de ses 8 années de vie militaire : « Adieu donc à ce passé où la souffrance a eu la plus large place, où la mort m’a survolé tant de fois. Adieu aussi aux inepties du métier ! Adieu enfin aux heures si rares de franche gaieté que j’ai pu y trouver, car l’esprit français est ainsi fait qu’il oublie facilement le danger pour ne penser qu’aux joies connues ». Il ressortira toutefois du conflit avec un profond sentiment antiallemand, n’étant pas sorti de la guerre pacifiste : « Pour ma part, étant revenu indemne de cette longue guerre, je ne peux que remercier Dieu, mais toute ma vie je me souviendrai du mal que l’Allemand m’a causé ; je ne lui pardonnerai jamais d’avoir brisé ma jeunesse pour satisfaire son ambitieuse folie des grandeurs. L’ayant vu à l’œuvre, je sais qu’il est plus barbare que nous, plus cruel et indigne de la moindre pitié. Je ne lui connais aucun acte loyal à son actif et j’enseignerai à mon petit André la haine nécessaire pour un tel adversaire à jamais conciliable. Car malgré la défaite, il va travailler comme par le passé pour la Revanche » (page 250).
2. Le témoignage :
Recomposé après-guerre sous forme de synthèse construite et enrichie, Auguste Mouton nous renseigne dans une émouvante dédicace sur ses conditions et le pourquoi de son écriture, manifestement basée sur un scrupuleux journal de guerre : « Pour toi mon petit André chéri [son premier fils], j’ai réuni dans ce cahier les heures les plus douloureuses de mon existence avec les impressions que j’en ai ressenties au jour le jour. Ce recueil, dont le premier chapitre avait déjà été dédié et offert à ta petite maman avant que tu ne fusses de ce monde est la reproduction exacte et fidèle de celui que je traçais quotidiennement soit pendant les heures de répit que me laissait la mitraille soit au repos ou à l’abri des obus. C’est le résumé de mes 5 années passées sous les armes alors que je finissais à peine mes deux ans de service obligatoire au 51e régiment d’infanterie à Beauvais. Quand tu seras en âge de le lire et que certains passages te forceront à me questionner tellement les horribles détails de ce monstrueux carnage te paraîtront effrayants, ce sera ma joie d’être près de toi et de fournir les explications nécessaires à ta jeune imagination. (…) Tu pourras grandir dans la paix et le bonheur mon petit André, aux côtés de ton papa et de ta maman, après avoir eu la chance inouïe de se retrouver malgré le plus effroyable cataclysme que la terre ait jamais vu, n’ont eu qu’un désir : te connaître pour t’aimer et être aimé de toi » (p. 11). Mais Auguste Mouton nous renseigne également sur son processus d’écriture en insérant quelques informations architecturales de son récit pour le lecteur. P. 45, il prévient : « Là s’arrête la première partie de mon récit ». Il tient donc un journal et écrit également sa correspondance, qui n’est pas publiée ici. Il dit : « J’écris encore pour que les êtres qui me sont chers aient de mes nouvelles, car je sais que nos lettres arrivent paisiblement et lentement à leurs destinataires » (p. 53), lettres qu’il fait passer parfois en dehors du circuit militaire (p. 105). Poursuivant la pédagogie de sa narration à l’endroit du lecteur, à l’issue de son transfert à l’arrière après sa blessure, il avise : « Les pages qui vont suivre ne seront pas aussi riches en détails pour les deux raisons suivantes. La première c’est que du jour où j’ai quitté la zone dangereuse, j’avais moins d’intérêt à faire un journal vulgaire de ma vie que je considérais définitivement sauvée à ce moment-là. La deuxième raison c’est que le jour où, à mon grand désappointement, je rejoignis la ligne meurtrière, il était interdit de conserver sur nous des carnets de guerre ou autres feuilles similaires. Les événements nous avaient appris en effet que les Allemand avaient su tirer par de ces renseignements divers trouvés sur des prisonniers. Ils connaissaient ainsi le moral des officiers et des soldats, nos habitudes de relèves dans certains secteurs et même nos projets d’attaque qui ne se produisaient pas toujours ». Il ajoute enfin : « Malgré l’absence de ces notes, les chapitres suivants n’en contiendront pas moins des dates et des faits rigoureusement exacts puisqu’ils ont été reconstitués à l’aide de la correspondance quotidienne échangée entre ma chère Lily et moi et grâce à laquelle j’ai pu tirer d’aussi justes renseignements que d’un carnet de route » (p. 69 à 70). Dès lors, le récit d’Auguste est bien un journal de guerre recomposé mais seule son honnêteté intellectuelle permet de le déceler tant l’écriture est précise et continue sur l’ensemble des six années de guerre.
L’avant-propos de Véronique Normand nous renseigne sur l’explication du titre de l’ouvrage. Elle précise : « Rosée sanglante » est le titre d’un encart inséré dans le livre relatant le soir du 26 septembre 1914 où un combat sanglant eut lieu près de La Neuville, hameau du secteur de Commercy dans la Meuse » (p. 7 et 52). C’est Auguste Mouton lui-même qui fait ressortir par encarts quelques épisodes marquants de sa guerre. Ainsi : Le rempart humain (p. 21 – 23 août 1914) – Rosée sanglante (p. 52-53) – Une visite médicale aux armées, Le Sourrriat – 20 avril 1918 (p. 208 à 210).
Par sa précision et son extrême diversité d’expérience, le récit d’Auguste Mouton se classe parmi les tout meilleurs témoignages émanant d’un soldat d’infanterie ayant, miraculé de nombreuses fois, fait l‘ensemble de la campagne sur divers fronts, souvent les plus dangereux, sur l’ensemble du conflit, période d’hôpital non comprise puisqu’il a été blessé plusieurs fois. Un nombre considérable d’éléments utiles à l’historien sont ainsi à dégager de ces pages denses et précises. Sa formation de jeunesse au Petit Séminaire fait comprendre la grande piété toujours manifestée d’Auguste Mouton, qui se tourne fréquemment vers Dieu, notamment aux périodes les plus menaçantes, pendant lesquelles il l’implore même parfois (7 décembre 1917 lors d’un nouveau séjour à Verdun (p. 192)). Dès lors il se pense protégé par ses prières (p. 44 et 51) et le fait qu’il se fie souvent à sa « bonne étoile » l’est à juste raison finalement (p. 153). Il le dit ouvertement le 16 octobre 1918 : « …mais comme toujours j’ai confiance en ma bonne étoile et je suis persuadé que je vais m’en tirer » (p. 230). Il quitte par exemple son gourbi quelques minutes à cause d’un bombardement, pour le retrouver complètement défoncé. Il dit alors : « Probablement que si j’étais resté dans mon gourbi, j’aurai été aplati comme une galette » (page 189). Malgré ce sentiment de protection, il est lucide et dit, le 17 octobre : « Nous sentons une terrible appréhension en approchant de la fin de la lutte. Fatalement on devient égoïste et ce n’est pas une lâcheté après cinquante mois de guerre. Je ne réclame que mon droit, celui de vivre après tant d’épreuves et de souffrances ce qui ne serait que justice » (p. 230).
3. Analyse
Un formidable témoignage, issu d’un homme lettré, réflexif, à la profonde culture religieuse, et avec un vrai talent narratif. Noms et lieux sont décrits précisément, de même que mille données et anecdotes qui rendent l’ouvrage particulièrement vivant et fourmillant d’informations, parfois successives à chaque page, ce jusqu’à la dernière.
Dès la mobilisation en masse, dont il participe à l’organisation comme sergent, il n’est pas dupe sur les heures terribles qui l’attendent. Il dit, le 12 août : « j’éprouve l’impression que nous sommes des bestiaux qu’on embarque vers un lointain abattoir » (p. 16). Comme nombre de soldat, il aspire à combattre. Le 14 août, montant sans frein vers le nord, il confie : « Le temps est radieux, nous vivons presque tranquilles. C’est à croire que la guerre va se terminer sans notre intervention » (p. 17). Mais il commence bientôt à entendre le bruit du canon au loin, qui génère les premières angoisses.
Le témoignage est honnête et sincère, assez peu teinté par l’exagération et le bourrage de crâne, même s’il n’en est très ponctuellement pas universellement exempt. Comme ce rempart de cadavres allemands, qu’il rapporte toutefois, ne l’ayant pas constaté lui-même : « D’après leur récit, ils ont plutôt fait l’œuvre de fossoyeurs car, pendant un recul momentané des Allemands, ils ont ramassé un nombre considérable de cadavres au point de s’en faire une ligne de rempart toute grise derrière laquelle ils attendaient le retour offensif de l’ennemi » (p.20). De même ces allemands brûlant 800 corps de leurs camarades debout dos à dos, témoignage par procuration des civils (p. 38). Les pages qui suivent témoignent de la pression qui fait redescendre population en exode et tout le régiment vers le sud, l’armée perdant la bataille des frontières, il constate : « Partout c’est la misère qui passe et de voir pleurer tant d’innocents, nous maudissons la guerre et nous leur promettons en passant d’être impitoyables avec les Boches » (p. 24). Le doute général s’installe alors et il note : « …nous voyons bien que nos officiers sont indifférents et qu’ils en savent plus long qu’ils ne veulent en dire » (p. 24). Dès lors, son état physique, alignant sans fin les kilomètres de la retraite, témoigne du moment : « Ah ! Mes jambes, comme elles sont faibles ! Et mes épaules je ne les sens plus ; j’ai la sensation d’une brûlure dans les reins, tellement les courroies de mon sac deviennent insupportables. Je marche donc comme un automate, comme un bête folle sans plus d’espoir que d’atteindre le lieu de la grande halte ou du cantonnement suivant » (p. 24). Il en vient alors à envier les blessés : « Quelques blessés s’en vont plus loin à l’arrière. Heureux veinards dont nous envions le sort avant de savoir l’étendue de leur mal ! » (p. 28). Une phrase semble écrite après-guerre lorsqu’il dit : « Nous longeons la fameuse tranchée des baïonnettes où des visages noircis nous regardent d’une fixité effrayante, l’arme à la main » (p. 156).
Son récit, s’il ne fait pas état d’un pacifisme revendiqué, rapporte, certainement comme il le constate, l’état d’esprit des soldats. Par exemple, la bataille de La Marne à peine gagnée, il décrit : « Trempés, malades, les hommes se révoltent et veulent se porter d’eux-mêmes dans le village. Des réflexions venimeuses à l’adresse des officiers commencent à circuler hautement. Ceux-ci parlent de brûler la cervelle au premier qui bronche. Aussitôt des coups de sifflets et des jurons répondent à cette menace. Alors les officiers deviennent plus doux essayent de calmer leurs hommes, mais la patience de chacun est à bout et passant outre la colonne se rue dans le village » (p. 41-42). Il use le plus souvent possible de stratégies d’évitement (par exemple former la classe 1916 pour prolonger de 3 mois son retrait du front à l’issue de sa convalescence bretonne (p. 90) ou pour éviter une piqûre paratyphoïdique (p. 148 et 183), jusqu’à envier ceux qui parviennent à s’extraire du front, même pour quelques mois seulement, pour participer à des stages par exemple). Lors de la période des mutineries, qu’il vit dans les Vosges, il confie toutefois sa lassitude, allant jusqu’à dire, en septembre 1917, n’obtenant pas une permission pour se marier : « Je deviens anarchiste », assertion qu’il renouvelle le 4 avril suivant devant la fatigue des mouvements inutiles (page 205). Mais son mariage à cette date remonte un peu son moral. Il dit : « Il me semble que j’attendrai mieux la fin de la guerre et j’aurai une famille légale en cas d’accident » (p. 184). Car la guerre est longue, bien trop. Alors qu’il participe à un stage obligatoire, fin janvier 1918, et dit, désabusé : « … je n’ai plus rien à attendre de l’armée, sauf la Croix de Bois » (…) De plus, les jeunes classes sont mieux considérées pour aspirer aux grades supérieurs car le gouvernement les paie moins chers que ceux qui ont quatre ans de service et plus » (p. 199). Mais en fonction des circonstances, il confesse toutefois, comme au combat de Soupir, devant l’attaque allemande, avoir pris plaisir à tirer « sur cette fourmilière », prenant « plaisir pendant 10 minutes à viser sur cette ligne grisâtre aplatie dont les survivants n’osent plus avancer »… « grisés par la poudre, les cris, les commandement de toutes sortes » (. 67). Il rapporte également les épisodes, repartis à plusieurs moments de la guerre des incidents, mouvements voire mutineries qui s’allument de temps en temps dans les unités. À Brest, où se situe le dépôt des 51e et 251e RI, il égrène les morts sur les fronts de ces régiments.
Son témoignage est aussi une longue suite de miracles tant il est au feu à de nombreuses phases violentes de sa guerre, mais aussi de blessures, plus ou moins graves. Le 29 août, « je sens un obus passer si près de nous que j’ai une sensation de chaleur dans le dos ». C’est à cette occasion qu’il est très légèrement brûlé « à la main gauche, c’est un petit éclat qui vient de m’écorcher » (p. 25). Le 29 septembre, il s’empale le pied sans grande gravité dans une baïonnette allemande (p. 53). Sa plus grave blessure est une balle dans la tête reçue au combat de Soupir, le 2 novembre 1915, (p. 67) qui l’éloigne plusieurs mois de la première ligne, et dont il nous fait suivre la gravité (parcours de la balle et nerf coupé (p. 73)), l’évolution, l’évitement qu’il cherche à prolonger, avant de retourner, guéri et sans séquelle, autre miracle, en première ligne. Il en dit : « Il me semble que la guerre est finie pour moi et que je viens d’échapper définitivement à cet enfer maudit. Dans la sombre nuit, j’ai une pensée pour les pauvres compagnons de misère que j’ai laissés là-bas morts et vivants, et dans mon petit coin, l’œil à la vitre, je fouille l’horizon noir sans rien voir, mais sans pouvoir dormir » (p. 69). Mais il doit se résigner, retapé, à retourner au front. Parfois philosophe, il dit, le 4 mai 1915 : « Puisqu’il faut y retourner, puisque cette maudite guerre ne veut pas finir, il faut que je souffre et je m’en rapporte à Dieu pour mon destin » (p. 93). Devant le fort de Vaux, il est à nouveau blessé légèrement par un éclat d’obus au genou, sans qu’il soit évacué toutefois, préférant rester à l’abri de la tranchée que de risquer la mort sur le trajet du poste de secours (p. 156). Le 7 avril 1918, alors qu’il occupe une sape en Argonne, à La Fille-morte, il est brûlé aux yeux par l’ypérite et consent, devant son état de cécité, heureusement temporaire, à se faire évacuer (p 207). Il retourne à son unité le 14 mai suivant mais la longue liste de ses souffrances n’en est pas terminée pour autant. Il est à nouveau blessé le 30 juillet 1918 dans le secteur de Villeneuve-sur-Fère d’une balle traversante au bas du mollet (page 225) qui l’éloigne jusqu’à la fin de septembre suivant, date à laquelle il remonte encore en ligne (p. 228).
Parisien, il reprend vie dans sa ville et dit : « Là j’ai vu qu’on ignorait totalement la guerre et que c’était le véritable endroit où ceux qui comme moi la connaissaient si bien pouvaient venir guérir leur moral ébranlé » (…) Un mois sur le front paraît un an mais un mois à Paris, ce fut pour moi une bien courte permission » (p. 82 et 83). Il revient dans les mêmes termes sur l’ambiance parisienne plus loin en rapportant l’impression d’un ami, en décembre 1915 : « …on pourrait faire un corps d’armée avec les civils embusqués qui s’y promènent. La vie y est très normale et les meurs singulières. On y oublie complètement la guerre » (p. 122). Il parle souvent d’ailleurs de son moral, fluctuant en raison de ses multiples affectations régimentaires, de poste ou de front en fonction de leur dangerosité. Il dit par exemple, apprenant le 30 septembre 1917 qu’il quitte les Vosges pour Verdun et retourne au fort de Vaux : « À partir d’aujourd’hui, j’ai compris que j’avais mangé mon pain blanc » (p. 149).
Sensible, Auguste Mouton ne s’est finalement jamais habitué complètement à la mort et à l’horreur de ce qu’il traverse. Lors d’un énième séjour à Verdun, en janvier 1918, il dit, à la vue de « vieux » morts des deux belligérants réunis dans une sape : « Nous avons soin, malgré notre vieille habitude des morts comme compagnons, de détourner nos regards de ces yeux fixes et de ces bouches grimaçantes » (p. 197). Verdun sera d’ailleurs assurément le pire secteur qu’il ait jamais vécu à la guerre. Il dit, le 22 décembre 1917 : « Cette dernière journée a été l’une des plus terribles de ma vie de guerrier » (p. 194) et réitère cette funeste constatation dès le 16 janvier 1918 : « Ah ! Ces relèves à Verdun ! Je n’ai pas vu de moments plus tragiques et plus douloureux » (…) « c’est un spectacle digne d’émouvoir les cœurs les plus durs s’il était permis à ces profanes de nous voir une seule minute avec la souffrance reflétée sur nos visages » (p.197 et 198).
Humain toutefois, plongé tant dans un océan d’hommes que d’horreur et de misère, il récupère le 27 août un chien mascotte, Fure, qui subit également la violence des combats.
L’ouvrage, très bien présenté et architecturé, permettant un suivi facile, ne multiplie pas les notes inutiles et n’est entaché que de rare fautes (celle, traditionnelle, à cote (p. 30), ballade p. 162, Strausstruppen p. 166 ou west pocket (p. 211)) ou toponymiques (rivière incorrecte page 111, fort et tunnel de Lavannes p. 151 ou Côte du Pauvre (au lieu de Poivre, p. 198). Elles relèvent toutefois de l’ordre de la coquille sur une telle masse. Il est agrémenté de 24 photographies très intéressantes, la plupart de lui-même, de sa famille et des personnages, prises tout au long du conflit, soit en atelier, soit sur le front.
Le livre est de même enrichi de 19 croquis cartographiques des phases importantes de sa guerre : Combats d’Urvillers, 29 août 1914 – Bataille de Château-Thierry, 3 septembre 1914 – Bataille de La Marne (Courgivaux), 6 septembre 1914 – Combat de la cote 100 et position de la Neuville, du 15 septembre au 14 octobre 1914 – Combat de Rouvroye Parvillers (Somme), 8 octobre 1914 – Positions et attaque de Soupir, 2 novembre 1914 – Camp de la Valbonne, du 11 mai au 3 septembre 1915 – Offensive de Champagne, 7 septembre 1915 – Front d’Alsace (secteur est de Belfort), du 22 janvier au 22 mars 1916 – Prise du fort de Vaux ; novembre 1916 – Saint-Mihiel, du 25 novembre 1916 au 31 mars 1917 – La Halte et La Chapelotte. Vosges, du 19 mai au 18 juin 1917 – Mort Homme. Prise de la croix Fontenoy, 7 juillet 1917 – Château de Murauvaux, du 5 au 12 octobre 1917 – Les Eparges, du 5 au 8 novembre 1917 – Cote 344, du 1er décembre 1917 au 18 janvier 1918 – La Placardelle et La Harazée, 27 février au 6 mars 1918 – La Fille Morte et Livonnières, 5 avril et 27 mai 1918 – Les Maviaux, dernière offensive allemande, 14 juillet 1918.
Secteurs tenus – date :
Bataille de la Marne – 2 août – 15 septembre 1914
Guerre de tranchée – 16 septembre – 5 novembre 1914
Loin du canon (Saumur – Brest – Lyon) – 6 novembre 1914 – 3 septembre 1915
Offensive de Champagne – 4 septembre – 14 octobre 1915
Repos et reformation – 15 octobre 1915 – 25 janvier 1916
L’Alsace et les Vosges – 26 janvier – 30 septembre 1916
Verdun (fort de Vaux) – 1er octobre – 25 novembre 1916
Saint-Mihiel et les Vosges – 26 novembre 1916 – 28 juin 1917
Verdun (Mort Homme et Les Éparges) – 29 juin – 30 novembre 1917
Verdun (Cote 344) – 1er décembre 1917 – 5 février 1918
L’Argonne (La Harazée – la Fille morte) – 6 février – 16 juillet 1918
Offensive de la Victoire – 17 juillet – 11 novembre 1918
Après l’Armistice – 12 novembre 1918 – 16 août 1919
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Un volume considérable d’informations peut être dégagé de ces pages.
P. 14 : Pleureuse à la grille de la caserne, spectacle triste, ambiance au 3 août 1914
: Menaces de mort à l’adresse de Guillaume II
: « La cour ressemble à un marché juif où s’étalent pantalons rouges, capotes bleues, sacs et fusils »
: Pleurs au discours du commandant, le départ des 51ème, 251ème et 11ème R.I.T.
15 : Chiffres des unités, où elles vont
: Noircissage des gamelles
: Marches victorieuses, Waterloo et Liège, fausses nouvelles, ignorance de la réalité
: Retour de la foi
16 : « La moitié du régiment tombe d’insolation »
18 : 16 août, construction de tranchées
: 17 août, bruits lointains et angoisses, construction de barricades
19 : Tirs contre avions, 1ères émotions
: Prix d’un repas le 22 août 1914
: Exode belge (vap 22,23)
20 : Espionnite
: Baptême du feu du régiment
23 : Flegme anglais
: Frelons
: « Nos sentinelles voient des uhlans partout et tirent des coups de fusil à chaque instant »
: Pillage de cave et de maison pour ne rien laisser aux Allemands
25 : Trophées (vap 40)
: Bois planté en terre pour signaler une tombe
: Charge à la baïonnette de 800 mètres, « Pas une balle, pas un obus pendant ce trajet »
: Débandade prussienne
: Folle bravoure d’un capitaine (vap 85 un fanatique)
26 : Combat épique d’Urvillers
28 : « La sueur de la veille qui a séché avec la poussière a formé comme de noires cicatrices à chacun »
: Larges rations d’eau de vie distribuées
30 : Soupe renversée
32 : Destruction d’un canon abandonné
33 : Vue d’autobus
37 : Avion se posant près des batteries pour les renseigner
38 : Allemand brûlant 800 de leurs morts debout dos à dos « pour ne pas les laisser sur le terrain après leur fuite »
: « Les Allemands ont empoisonné tous les puits en jetant des bêtes mortes, des entrailles et des détritus de toutes sortes »
39 : Après la bataille de La Marne, maisons pillées, boîtes aux lettres défoncées, animaux dépecés, saleté
40 : Il pille une école et se ravitaille en papier
: Harangue du colonel sur les exactions de l’ennemi
: Million de cartouches allemandes abandonnées
41 : Faim
: Ferment de mutinerie, révolte due à la fatigue et la faim (vap 100)
47 : Brûle des meules de paille pour éclairer la plaine
49 : Drapeaux blancs pièges d’où abattage des allemands qui veulent se rendre
: Echappe à quelques centimètres à un éclat d’obus qui casse son fusil, chance
50 : Brosse d’arme utilisée comme blaireau
: Opium contre la cholérine
: Fausse tranchée
51 : Allemands commandant leurs feux en français
: Se blesse sur une baïonnette de mort allemand
52 : Soldats morts noyés dans un marais
54 : Espionnite, maison dans laquelle a été trouvé un uniforme d’officier allemand, tonneau de vin piégé par un obus
: Missionné pour chercher des égarés, 5 déserteurs fusillés au 254e RI
: Volets décrochés utilisés comme brancards
: Blague à tabac faite dans un sac allemand
: Bombardement surnommé l’angelus
55 : Vue pittoresque des cuisines de La Neuville « On dirait un pays lacustre habité par des indiens »
: Impressionnant combat aérien (victorieux)
: « J’ai abandonné ma toile de tente boche qui m’avait rendu de grands services depuis un mois » et ramasse et garde un revolver allemand
: Maisons pillées et inscription allemande sur une porte « maison pillée par les Français »
61 : Assainissement des lieux, enterrement des chevaux et des vaches, 200 kg de chaux
62 : Tranchée anglaise, bien faite, cuisine hygiénique avec filtration, surnom de cagnas
63 : Tireurs d’élite
: Guerre des mines (Aisne, 23 octobre) ?
: Comment on enterre un cheval dans le no man’s land
64 : Effet de grenade
65 : Machette de tirailleurs
: But de patrouille : Ramener un prisonnier, un casque, une patte d’épaule et reconnaître une nouvelle tranchée allemande (dimensions, contenu)
66 : Soldats agitant des mannequins
: Fume des feuilles de marronniers
67 : Grisé par l’attaque, fusil brûlant
68 : Fiche rouge d’évacuation
: Entend dire que les blessés prisonniers étaient achevés par les allemands
69 : Croit que sa balle dans la tête était une dum-dum
: « … sur toute la ligne [ferroviaire] les femmes françaises sont admirables et nous gâtent »
73 : Où sont les rescapés de Soupir
74 : Victuailles par la population
75 : Electroaimant pour tenter d’extraire la balle
78 : Subit une petit guerre des médecins sur le traitement à lui infliger
81 : Réveillon de 1914, menu
82 : Craint de retourner au front (vap 86 pour les camarades)
85 : Bretons ne parlant pas le français
: Tropine, gouttes dans l’œil et touche des lunettes noires
: Voit une escadre de guerre
: « En ce moment le Dépôt fabrique des pelotons de robusticité, d’enraidis, de convalescents, etc…, c’est-à-dire de quoi arriver à un résultat final : chasser tout le monde dans un bataillon de marche et l’expédier aussitôt formé »
86 : Vue de Brest : « Les rues de Brest sont très bruyantes et remplies d’ivrognes et de mauvaises femmes, c’est un peu écœurant »
87 : Touche 53,10 francs d’indemnité de convalescence
89 : Fraises de Plougastel-Daoulas générant 1 million de revenus
91 : Revoit un ancien blessé de 1914, déformé et vieilli
93 : Mutinerie au Dépôt (vap 100)
: Vaguemestre, il touche une bicyclette Aiglon
95 : Activité du vaguemestre (partie à rapprocher du sergent-vaguemestre Félix Braud)
96 : Signaux optiques
: Maison de Messimy à Pérouges
: Remise des drapeaux des 401ème et 402ème R.I. nouvellement créés
100 : Lutte contre les puces (vap 138)
: « Une infirmière suisse qui se trouvait dans un train de boches a lancé sur le quai une carte avec ces mots : « Salut aux Français, glorieux vaincus de la grande guerre »
101 : Accident de train à la gare de Valbonne, 3 tués et un blessé
: Tribune de Genève germanophile pour voir qualifié « 157ème Bon d’embusqués »
103 : Revient sur la durée de la guerre et rappelle, le 27 août 1915, qu’il avait écrit : « que la guerre ne peut pas durer encore un an car il n’y aurait plus de combattants vivants ». Plus lucide, il y revient page 114 : « Voilà plus de quatorze mois que la guerre dure et nous constatons chacun avec un sentiment mêlé de déception et d’étonnement que, contrairement à ce que nous espérions quelques mois avant, les événements ne laissent nullement prévoir une fin prochaine »
105 : Censure qui « fonctionne dur ; il est interdit d’écrire d’autres détails que ceux concernant la santé ». Fait passer ses lettres directement par un ami. Vaguemestre, armée cycliste de facteurs (vap 139)
: « Je trouve que les femmes ont un air bien gavroche et que la guerre ne les attriste pas toutes »
107 : Sur le sentiment d’être perdu dans un océan d’hommes : « On vit côte à côte sans se connaître »
: Envie les prisonniers : « Quelques prisonniers allemands reviennent par petits paquets et ils ont l’air joyeux d’en être quittes à si bon compte »
109 : Vaguemestre en première ligne : « À mon tour d’être témoin de cet horizon nouveau »
110 : 400 sur 600 lettres retournées avec la mention « disparu » ou « évacué » (vap 113 : « Nous avons rendu aux T. et P. pendant ces deux jours plus de trois mille lettres et environ douze sacs de colis »
111 : Noms « belliqueux » de canons de marine : « Revanche » et « Tonnerre de Brest »
112 : Vision surréaliste d’un cheval mort avec une pancarte Kamarad !
116 : Achète un rasoir pour 6,50 frs
118 : Comme vaguemestre ne veut plus annoncer les morts
119 : Gal, en fait colonel Gratier, très antipathique
121 : Noyé par accident
122 : Doit se raser, sinon 8 jours d’arrêt et suppression de permission : « Il paraît que la victoire dépend de notre coupe de cheveux »
123 : Chambre à gaz
125 : Philosophe
130 : En Alsace, le 6 février 1916 : « Pas un coup de canon, c‘est le pays rêvé pour faire la guerre »
133 : Incident avec des gendarmes au sujet de la lumière
135 : Mauvaise réputation du 111e RI d’Antibes, liée aux méditerranéens (« les gens du midi et les gens du nord ne s’accordent pas très bien ») et au comportement à Verdun (bois de Chippy et Malancourt) (vap 136, 140 et 141)
: Sur la durée de la guerre, Poincaré prédit le 11 avril 1916 « une guerre encore longue avec notre succès final »
136 : Durée de la guerre dans la Gazette des Ardennes, allemands résolus à la poursuivre encore 10 ans !
141 : Punition pour refus d’obéissance : « De mauvaises têtes se voient condamnées à la prison pour refus d’obéissance. L’ensemble est corrompu et, à un rassemblement où le Comt Bénier lit une circulaire qu’il veut faire terminer par le chant de la Marseillaise, ses hommes répondent par un chanson comique »
: Alsaciens qualifiés de boches car portrait du Kaiser, que Mouton a brûlé en partant !
143 : Écrit son courrier sur une borne frontière
: Voit la pierre gravée près de Petit-Croix sur le lieu de la chute de Pégoud
144 : Marchal survolant Berlin et lançant des proclamations
: Théâtre de verdure de Fraize (vap 145)
145 : Homme puni cassé de son grade par un général pour avoir fait monter une femme dans sa voiture pour lui rendre service
148 : Camp d’Arches
149 : « Verdun, c’est le crible géant de notre armée »
153 : Tenue d’attaque composée de « deux musettes garnies de biscuits, de boîtes de singe, de chocolat, de grenades, de pétards, de fusées éclairantes, de balles, deux bidons de deux litres plein de vin, mon fusil, mon tampons à gaz et un browning »
154 : « De là-haut [fort de Vaux] les blessés boches et français descendent en se donnant le bras »
157 : Victuailles souillées immangeables, état sanitaire des hommes
: Bruit du 420 comme un train de marchandises
: Fanion du Sacré-Cœur (vap 170)
158 : Essaye de réveiller… un mort
159 : Tonne à eau bienvenue sur le front
: Flacon de Ricqlès
161 : Bottes de tranchée
162 : Entend des chants allemands de Noël
163 : Cris d’animaux comme signes d’appels
: Méprise nocturne et tirs amis
164 : Allemands en draps blancs
168 : Groupes francs
169 : Tubes explosif allemands anti barbelés type Bangalores
170 : Rend les honneurs devant la maison de Jeanne d’Arc et subterfuge pour ne pas gêner les consciences : « En passant devant la maison de Jeanne d’Arc, notre colonel ayant fait placer le drapeau en face, tout le régiment défile en rendant les honneurs. De sorte que les consciences ne sont pas froissées puisque personne ne peut dire si nous avons présenté les armes au drapeau ou à la sainte »
172 : Vue de Moyenmoutier
173 : Construit des abris sous roche au-dessus de Moyenmoutier (mai-juin 1917)
174 : Chalet Zimm à La Halte
175 : Surréalisme de la guerre dans les Vosges : « C’est incroyable la guerre dans cette région et quand on a vu Verdun on croit rêver »
: Observateur ayant un tableau très détaillé des points dangereux à surveiller
176 : Vue de la guerre des mines à La Chapelotte
177 : Mouvement révolutionnaire dans le régiment, ambiance pacifiante, liste de pétitions, mutins, répression, rébellion avortée « Nous sommes redevenu doux comme des agneaux qu’on mène à la boucherie »
181 : Bataille + orage : « On croirait la fin du monde »
183 : Croup
184 : Mariage
190 : Déclaré inapte à une visite dentaire pour Salonique
192 : Compare la cote 344 (Verdun) à un plateau volcanique
195 : Cinéma de la Citadelle
196 : Soldat gazé en déféquant
: Horreur
: Section de discipline, difficulté du commandement
: Patrouille avec des draps blancs
: Homme à cheval sur son fusil dans un tranchée pleine d’eau
198 : Fonck
201 : Tranchée Clemenceau
202 : Condé, vrai village africain
203 : Arabes paresseux
206 : Aliments et boissons jetés à cause de la souillure de l’Ypérite
: Homme non atteint par les gaz car ivre
216 : Entend des cris de joie allemands à l’annonce des victoires du printemps 1918
217 : Match de foot
226 : 2ème citation qui lui vaut une étoile blanche et 2 jours de plus de convalescence
228 : Croix de guerre dessinée sur une statue au bras cassé à Château-Thierry
230 : Stout
231 : Grippe espagnole
: Humilie en paroles des prisonniers allemands
232 : 11 novembre, (vécu à Deinze en Belgique) joie calme et sage
234 : Famille belge flamande de 21 enfants, qui lui font penser aux mœurs bretonnes
235 : Paperasserie (vap 237, la maudit)
237 : Programme Deschamps pour la démobilisation des classes d’âge
: Homme ivre voulant « tuer un chinois »
: Evoque « trois jeunes filles d’ailleurs sérieuses et qui prennent part à nos discussion philosophiques sur la femme du siècle »
241 : Vue et désillusion sur le Manneken-Pis
: Pyramide de canons à Givet
242 : Longuyon, plaque tournante suite aux ponts coupés sur la Meuse
243 : Se réjouit de ne pas aller en Allemagne
247 : Incidents dus à la boisson (vap 249)
Yann Prouillet, février 2026
Maillet, André (1889-1968)
Maillet, André, Sous le fouet du destin. 1915-1916, Paris, Bernard Giovanangeli, 2008, 157 p.
Résumé de l’ouvrage :
Le jurassien et intellectuel André Maillet est soldat au 23e RI de Bourg-en-Bresse, qui tient La Fontenelle, dans les Vosges, à la mi-décembre 1915. Son régiment est alors appelé à renforcer le 15-2 qui doit attaquer sur le Hartmannswillerkopf le 21. Racontant par étapes ce qu’il considère comme une montée au Golgotha, il relate cinq jours épiques et sanglants dans les « Régions infernales » dont il échappe, blessé, les pieds gelés, sauvé par miracle par des brancardiers.
Eléments biographiques :
André Maillet est né le 30 novembre 1889 à Le Vaudioux, canton de Champagnolle, dans le Jura, d’un père scieur. Volontiers poète, il est instituteur à son recrutement et professeur au collège de Nantua à la déclaration de guerre. Il dit : « Je voulais former des jeunes gens, mes élèves, pour la lutte qui les attendaient… » (p. 46). Bernard Giovanangeli, qui introduit cette réédition, évoque le cercle intellectuel dans lequel, jeune, il évolue avant la guerre, écrivant poèmes et « pièces de sa composition ». Il publie chez Jouve en 1918 un premier livre de poèmes, écrits avant la guerre (1909-1912), sous le titre L’Angoisse éternelle, puis chez Perrin en 1919 Sous le fouet du destin. D’autres livres suivent, dont le dernier paraît en 1965. Son parcours militaire est ténu, très vraisemblablement du fait de sa faible constitution. Il est d’abord réformé pour « faiblesse générale et imminence » le 26 octobre 1911, puis reconnu apte au service armé par le Conseil de Révision de Nantua le 26 novembre 1914. Il est d’abord incorporé au 60e RI à compter du 16 février 1915, puis passe au 23e RI le 14 août suivant. [Il n’a donc pas participé aux combats sur La Fontenelle de juin et juillet, particulièrement âpres pour son régiment]. La gelure de ses pieds à la fin de la bataille du HWK entraîne une inaptitude temporaire d’un mois, avant qu’il soit classé au service auxiliaire le 27 novembre 1916 pour « amaigrissement et dyspepsie ». Il est finalement reconnu définitivement inapte à faire campagne pour faiblesse générale, gastro-entérite, anémie et amaigrissement par la commission de réforme de Dôle du 26 novembre 1917. Il ne retournera finalement jamais au front et sera démobilisé le 10 mai 1919. Jean Norton Cru, qui lui consacre une longue notice analytique dans Témoins (p. 363 à 366), indique qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité en 1919 et qu’il exerce les métiers de professeur au lycée d’Alais (aujourd’hui Alès) puis inspecteur primaire à Montceau-les-Mines. Il est également recensé à Aurillac et Nîmes (1921) ou Villefranche (1933). André Maillet meurt le 16 avril 1968 à Lyon.
Commentaires sur l’ouvrage :
Licencié en philosophie, sa formation littéraire transpire à chaque ligne de son impressionnant témoignage uniquement vosgien, sombre et très intellectualisé, qu’il circonscrit à l’attaque du HWK le 21 décembre 1915. Lancinant d’abord, à partir du moment où il apprend que le régiment doit quitter La Fontenelle pour aider à l’attaque de la « Mangeuse d’hommes » avec le 15-2, régiment vosgien qui l’occupe, Maillet multiplie les références bibliques, évoquant alors une longue montée au Calvaire. Puis l’ouvrage tourne au terrible et horrifique l’apocalypse déclenché. On sent la formation classique rien qu’à l’énoncé de son chapitrage, en forme de d’une pièce de théâtre en 15 tableaux empruntant au registre dramatique :
Premier tableau – Le sort en est jeté : La méditation du factionnaire – Dans la grange du corps de garde – La proclamation aux guerriers
Deuxième tableau – Sous le fouet du festin : La traversée de l’oasis – Le rêve des guerriers – Vers l’Alsace – L’étape – L’ascension du Golgotha
Troisième tableau – Les régions infernales : L’assaut – Le tir de barrage – En patrouille – En contre-attaque – En attendant la mort – La fête des damnés – Des profondeurs de l’abîme.
Peu des camarades qu’il cite et côtoie survivent à la boucherie dans un style dramatique impressionnant dont il ne se fait aucune illusion sur l’issue, s’abandonnant à l’idée de la mort : « C’est vrai… je me résigne. La mort n’est pour moi ni un châtiment, ni une promesse » (p. 119). Très tôt dans l’ouvrage, il évoque en effet la certitude de sa mort prochaine, comme de celle des autres d’ailleurs ! Il dit « Celui-là ne reviendra pas » ! » (p. 43) et plus loin « Lesquels laisseront sur la terre encore inconnue leur dépouille aujourd’hui frémissante ? » (p. 44). Il se révolte à l’idée de sa propre mort sacrificielle mais dit qu’elle ne l’effraie pas : « J’ai passé de trop longues nuits de méditation avec les sages et les poètes, mes amis, pour craindre son coup définitif et brutal » (p. 44). Et plus loin : « … je regarde ce sang, et je cherche les âmes de ceux qui ne sont plus » (page 80). Oscillant entre mythologie et christianisme, il avance un parallèle christique : « Et je comprends le bonheur divin du Christ, agonisant sur le promontoire tragique du Golgotha, pour délivrer le monde » (p. 74).
Il incarne quelque peu aussi le Hartmannswillerkopf, parlant du « râle immense de la montagne » (p. 90).
Patriote, le passage de la frontière (au col de Bussang) révèle sa souffrance traumatique de 1871 : « Voici enfin la réalisation du rêve de mon enfance » (page 51) alors qu’il participe à récupérer la province perdue. Ayant pourtant une vision très poétique des allemands, il en affirme aussi une haine certaine, marquant l’opposition irréconciliable des deux races. Il affirme que « la vie nationale est supérieure à la vie individuelle » (p. 117).
Comme Eugène Lemercier, dont le statut intellectuel et la psychologie sont similaires, André Maillet a une haute opinion de sa classe, tendant parfois à la condescendance. Il dit, à la vue de territoriaux transformés en cantonniers : « Ils se relèvent, lourdement, brisés, à notre passage, et, de l’air placide et calme des ruminants, nous regardent défiler » (p. 56). Plus, il avance : « Le penseur a même ici moins de valeur que le rustique, car il réfléchit trop, il raisonne trop, et une machine à tuer ne doit pas penser » (p. 76).
Il intériorise en permanence son « expérience » de combattant et cherche à analyser, dans un mélange d’utopie et de pacifisme, les sentiments et les rouages qui le poussent à agir contre sa volonté. Il dit : « Quelle est donc la force qui nous pousse à la mort ? Quelle est donc la force qui nous attire aux enfers ? Quel nom donner à la mystérieuse puissance des Ténèbres qui nous conduit au sacrifice ? », l’expliquant, réaliste, par le simple consentement (p. 70), ajoutant plus loin : « L’aiguillon de la nécessité fait des prodiges » (p. 87). Aussi, il se révolte en vain contre l’obligation d’ôter la vie : « Tuer des hommes ! quelle horreur ! Est-ce possible ? Tout ce que j’ai d’humain se dresse contre ces crimes » (p. 93). Et il appréhende ce moment : « … Je redoute l’instant où je devrai tuer. Et pourtant, je sens, je sais que, au premier signal je lâcherai mon coup de feu, et que ma balle portera juste, terriblement meurtrière… Je le sais. Je sais que je tuerai parce qu’il y va de la sécurité de mes camarades qui comptent sur moi, parce qu’il y va de leur vie…. Je tuerai parce que j’y suis obligé, parce que c’est le devoir ! » (p.111). Pour la liberté, il accepte et justifie alors la notion de meurtre : « C’est pour la défendre et la conserver que nous avons accepté ces meurtres et ces tueries que nous n’avons, en particulier, pas voulus » (p. 118). Il revient plus loin sur ce terme : « Notre tuerie se passe en champ clos. Nous sommes seuls admis à franchir le seuil des régions infernales ». Et il se confie alors sur l’indicible horreur, comme celle, la guerre suivante, des camps de la Shoah, que l’on ne croira pas : « Quand tu narreras tes aventures, on ne te croira pas. On sourira avec une légère pointe de pitié condescendante en pensant : « Il chevauche son dada » (p. 141), s’interrogeant page suivante sur la difficulté de trouver les mots, voire d’autres vecteurs, convoquant ainsi musiciens, peintres ou poètes du futur, pour évoquer la réalité de la sauvagerie à laquelle les poilus ont survécu. Ainsi « Seuls devraient avoir le droit d’en causer ceux qui l’ont vécue, ceux qui ont souffert » (p. 143). Et sa conclusion est formelle : « Si les hommes connaissaient toutes ces tortures, s’ils pouvaient souffrir tous, par la pensée, ce que nous avons réellement souffert, c’en serait à jamais fait des guerres » (p. 142). Hélas, il n’est pas optimiste sur l’oubli prévisible des générations futures et sur la certitude formelle et désabusée que « La guerre ne disparaîtra qu’avec le dernier soupir du dernier des mourants » (p. 144).
Le témoignage de Maillet, soldat du 23e RI, qui n’est sur le Hartmannswillerkopf qu’en renfort temporaire pour l’attaque du 21 décembre 1915, est à rapprocher de celui d’Auguste Chapatte (Souvenirs d’un poilu du 15-2), qu’il pourrait même avoir vu lors de sa blessure de ce dernier, voyant, p.86, « les bombardiers se glissent vers les fortins, en les attaquant à la grenade ; font sauter les derniers centres de résistance et les derniers repaires de mitrailleuses » ; même lieu, même temporalité mais unités différentes, sans que l’un cite l’autre et réciproquement le régiment frère de circonstance d’ailleurs !
Au sortir de la bataille, après son récit épique et impressionnant, André Maillet dresse un bilan surréaliste et très lucide : « Je n’ai plus que mon fusil… J’ai perdu mes musettes, mon masque à gaz, ma couverture, ma toile de tente, ma pelle-bêche, mes guêtres, mon masque et ma cravate… Je n’ai plus rien. J’ai perdu toutes mes forces et ma santé. Je ne suis plus qu’une loque, qu’une épave exsangue, qu’un squelette, qui se traine mû par ce qui me reste de puissance de volonté. J’ai laissé là-bas tout ce que j’avais encore de possibilités de bonheur, tout ce que nourrissaient d’espoirs mon cœur et mon cerveau. (…) Je ne suis plus un homme » (p. 136). Et quand même les survivants retrouvent leur sac, celui-ci a été pillé pendant leur absence au cœur de la bataille ! (p. 137).
Au final, l’ensemble de l’ouvrage est ainsi celui d’un intellectuel idéaliste et fataliste mais résigné à donner sa vie à la France. L’ouvrage est très riche psychologiquement et assez pauvre quant à certaines précisions (toponymes, souvent oubliés, dates ou unités ; il ne cite par exemple jamais le 15-2 alors que son régiment, prélevé de La Fontenelle, à 80 kilomètres au nord, soutient l’attaque principale par cette unité), circonscrivant le témoignage à une seule période comprise entre la mi-décembre 1915 et le 1er janvier 1916. Maillet apporte ainsi à la littérature de guerre un récit intellectualisé plus qu’un témoignage « technique », voire journalistique, de soldat.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 48 : Vue de Bussang
56 : Surnomme le front « le toboggan »
57 : Sentiments anti-alsaciens, pris pour des espions
60 : Défilé du régiment à Saint-Amarin, « pour l’image », puis effondrement dans l’épuisement !
64 : Achète une carte d’état-major pour suivre ses déplacements
66 : Homme faisant son testament avant l’attaque, et toilette de condamnés à mort
83 : Pancarte allemande demandant quand aura lieu l’attaque française !
89 : Perçoit un couteau de tranchée (qui lui servira à creuser son trou sur le champ de bataille, qu’il appellera sa tombe)
90 : Prisonniers allemands enviés car ils quittent le champ de mort
99 : « … le principal effet du bombardement est de nous endormir »
110 : Décide de ne plus faire de prisonniers
126 : Bruit des éclats d’obus : « grand bruit d’étoffes froissées et de râles désespérés »
131 : Veut bombarder Mulhouse insolemment éclairée
132 : Aide des brancardiers allemands à franchir une tranchée, tués juste après
136 : Ferme les yeux pour ne pas voir la montagne devenue cimetière à ciel ouvert
141 : Sur les lettres : « Les lettres sont douces. On nous parle comme si nous étions encore du monde des humains… »
Yann Prouillet, février 2026
Schuhler, Julien (1881-1955)
Schuhler, Julien (abbé). Ceux du 1er Corps. Souvenirs, impressions, récits de la guerre par un aumônier militaire, Colmar, Les éditions d’Alsace, 1933, 432 p.
Résumé de l’ouvrage :
Le 30 juin 1931, à Colmar, l’abbé Julien Schuhler, aumônier de la 51e division du 1er aorps d’armée, met un point final à ses souvenirs, impressions et récits de sa Grande Guerre, ce à partir du 13 juillet 1915, date à laquelle il est rapatrié d’Allemagne, du camp d’Heidelberg, alors qu’il était en captivité, et aumônier des officiers français prisonniers. Démarre alors une petite encyclopédie composite d’un aumônier divisionnaire en forme de journal de guerre, largement enrichi de tableaux et de réflexions, particulièrement précis sur les dates, les lieux et les personnages cités, ce sur toute la durée de « sa » guerre.
Eléments biographiques :
Julien Charles Alphonse Schuhler est né le 9 janvier 1881 à Fontaine, dans le Territoire de Belfort. Il est le fils d’Aloïse et de Célestine Charpiot. Il passe son enfance à Petit-Croix, petit village situé à quelques kilomètres au sud de Fontaine. Décoré de la Croix de guerre, il est fait chevalier de Légion d’Honneur le 1er septembre 1920, date à laquelle il est toujours aumônier militaire attaché à la 3e division de l’amée du Rhin à Mayence. A la date de rédaction de son ouvrage, en 1932, il demeure 4 rue Aristide Briand à Colmar et c’est au 2 boulevard du Champ qu’il habite lorsqu’il meurt, dans sa ville, le 25 février 1955.
Commentaires sur l’ouvrage :
Un ouvrage dense, complet, précis et documenté sur la Grande Guerre d’un aumônier divisionnaire, récit mêlant souvenirs, impressions, fourmille d’informations, de données et de tableaux, parfois terribles, d’un religieux qui, certes place son ministère et sa foi au centre d’un apostolat quasi missionnaire, mais dans un style précis et bien écrit. L’ensemble tient ainsi de l’historique divisionnaire, souvent régimentaire (des 33e, 233e, 73e et 273e RI plus particulièrement), enrichis de tableaux descriptifs ; l’érigeant en référence testimoniale du genre. Les noms sont cités et la table des matières, qui ne reprend même pas tous les sous chapitrages internes de l’ouvrage, permet de suivre les différentes affectations de Schuhler, comme ses déplacements, dans une longue campagne haletante, parfois sous la menace de la balle et au milieu des rafales d’obus.
L’ouvrage débute le 13 juillet 1915 alors que l’abbé Schuhler se trouve dans un train qui rapatrie en France, à Lyon, un convoi de prisonniers, grands blessés, médecins et infirmiers. Cette entrée en matière rappelle par ailleurs la restitution des formations sanitaires à l’issue de la bataille des frontières (cf. les témoignages de François Perrin, de François Leleu, d’Édouard Laval ou de Georges Faleur). Le prêtre indique avoir été capturé, avec son ambulance, à l’issue des combats de Burnhaupt, le 8 janvier 1915 (p. 31), dont il fustige la conduite défaillante du commandement. Il était, pendant les six mois précédents aumônier des officiers français prisonniers au camp de Heidelberg. Dès son arrivée, il établit une demande officielle pour être agrégé à l’Aumônerie militaire, puis passe au Ministère de la Guerre « pour y verser des documents intéressants et des photographies rapportés de captivité ». Il éclaire également ses interlocuteurs sur la réalité de l’Allemagne intérieure, un an après la guerre, éclairant sur une réalité loin de la propagande journalistique. Il ajoute également passer à l’ambassade de Russie où il dit remettre « le document « Adamowitsch » où se trouvent condensé, en un rapport saisissant, le récit des atrocités, mauvais traitements, sévices et privations infligés en représailles aux officiers russes prisonniers » (p. 13). À La Belle Jardinière, il achète des effets militaires : calot, imperméable, guêtres, cantine, chaussures robustes, musette et bidon en prévision de sa campagne. Il monte au front dans la Somme le 5 août suivant, où il intègre en tant qu’aumônier le GBD de la Division, dont il expose la composition nominative (p. 18). Il récupère un cheval belge « qui ne figurait pas sur les contrôles officiels » (p. 22) mais se dit cavalier novice au début de sa campagne. Attaché à la 51e DI, il précise: « fut scellé le pacte qui me liait pour un an au 33e [RI] » (p. 193). Suit le parcours facilement retraçable de sa campagne : La Somme, Verdun, repos en Alsace, la Somme encore, la Champagne, l’Aisne, l’Yser, le Chemin des Dames, Soissons, la Deuxième Marne, repos en Haute-Alsace puis la poursuite dans le Nord, jusqu’à l’Armistice en Belgique.
Le style d’écriture s’emporte parfois profondément dans une religiosité bien compréhensible, l’héroïsme sacrificiel ou la littérature ampoulée, voire des envolées patriotiques. Mais l’auteur multiplie également les belles phrases plus profondes telles « Minutes inoubliables qui font époque dans une vie qui ne fut jamais si près de son éternité ! » (p. 108) ou « Dans l’armée française, le respect de l’ennemi vaincu et désarmé » a toujours été un honneur ; les blessés sont sacrés » (p. 153). Plus loin, ce paragraphe teinte quelque peu tout l’ouvrage, en forme de tableau qui rappelle le carré de Sidi-Brahim : « Épuisé de fatigue, tenaillés par la faim, torturés par la soif sous ce soleil implacable, fauchés par la mitraille, décimés, haletants, éclaboussés de sang, couverts de débris d’arbres et de terre, entourés de morts, de blessés gémissants, les braves combattants résistent à tous les assauts dans le carré héroïque qui flotte sous les remous de la bataille et les obus qui ébranlent l’atmosphère » (p. 327-328). Celui de la défense, à Cutry, le 12 juin 1918, du PC du colonel Coudin, ressemble quant à lui à un tableau de Neuville représentant la Maison des dernières cartouches (p. 347). Tout l’ouvrage est bien entendu aussi un vibrant hommage, légitime, à son ordre : « Rien ne fécondera mieux les sillons labourés par la guerre que le sang des 3 000 prêtres martyrs et de nos héros chrétiens » (page 168). Il affirme même « le côté spirituel et divin de la guerre » (p. 334). Il se fait parfois allégorique, voire même poète. Il dit, le 11 novembre 1918 : « Les feuilles de la forêt de Trélon tombent des arbres dans tout l’éclat de leur suprême beauté comme sont tombés nos morts » (p. 417). Pour lui, le rôle de l’aumônier est bien entendu central ; il analyse cette place dans son chapitre « L’aumônier militaire » (p. 231 et 232) en alléguant être un acteur majeur, véritable thermomètre moral pour le commandement, capable de remettre une attaque si ce facteur manquait. Il allègue avoir administré 5 000 soldats et 200 officiers (p. 273). Il met aussi bien entendu la foi au centre de son témoignage et affirme à maintes reprises sa centralité au front de la guerre : « Les âmes se retrempaient aux sources religieuses » (p. 210) ou : « Les messes militaires furent sans contredit l’un des spectacles les plus grandioses et les plus impressionnants de la guerre » (p. 395). Il avance même : « Le maréchal Foch lui-même reconnaît l’intervention de Dieu dans la victoire de la Marne » (page 398), y revenant quelques lignes plus loin en synthétisant ladite victoire par le quadriptyque « grands chefs », héroïsme des soldats, qualité de la race et Allié du Ciel (p. 399). Enfin, il évoque les « 14 points de l’Evangile du 8 janvier » évoquant la proposition de paix du président Wilson (p. 400).
Plusieurs chapitres sont consacrés aux hommes du front, soldats et officiers bien entendu, mais également infirmières, vantant chez elles leur bénéfice moral (p. 313). Il rend aussi à plusieurs reprises hommage au courage de l’ennemi (p. 328). Il se fait également parfois pédagogue de la guerre ; en témoigne par exemple sa longue définition du No man’s land (p. 386 et 387). Les pages d’héroïsme sacrificiel de juin 1918 sont également impressionnantes. Lui-même décide, devant l’imminence de la submersion ennemie, de se laisser capturer avec ses blessés, avant l’arrivée miraculeuse d’un camion qui les sauve de la captivité (p. 364, secteur de Nesle-le-Repons, dans la Marne). Enfin, sa narration, à partir de Lassigny, de la poursuite d’une Allemagne en déroute le 22 octobre, est très éclairante, tant sur les paysages qu’il découvre que sur l’état des régions libérées et de leur population, le plus souvent affamée, jusqu’à la Victoire, vécue en Belgique, dans la région de Chimay (p. 415). Au final, l’abbé Julien Schuhler n’a pas témoigné d’une « guerre de général » ; il a failli maintes fois mourir, sous les bombardements ou atteint par les balles, ou être capturé, ce jusqu’au bout de sa guerre, donnant à son récit la longue litanie d’une guerre dense et combattante même sans qu’il n’ait jamais porté le fusil ou fait le coup de feu.
Schuhler, photographe, agrémente son ouvrage de 68 clichés (l’édition étudiée comprend la mention en 1ère de couverture : « 2e édition – 5e mille»), y compris d’après-guerre. Le livre aurait mérité une table de ces illustrations ainsi qu’un glossaire des noms tant il en fourmille (voir par exemple la liste des « modernes chevaliers » qu’il donne p. 267), même s’il pratique parfois l’autocensure (cas du député qu’il considère antipatriote Charles Maurras, p. 285). L’ouvrage comporte peu d’erreurs (quelques-unes typographiques) et comme beaucoup de soldats, Schuhler se trompe sur le mot « cote », qu’il orthographie côte. Il utilise par ailleurs le mot mitraillette (p. 322), rarement usité pendant la guerre, confirmant une écriture tardive (1931). En effet, à la fin de l’ouvrage, il annonce clôturer son livre à Colmar le 30 juin 1931 ; toutefois, sa note n°1 p. 383 rapporte la mort de Georges Xavier Laibe, 1er blessé de la Grande Guerre (à Suarce le 2 août 1914), le 20 novembre 1932. [Même si cette annonce est fausse puisque que Georges Laibe meurt en fait en 1958 à l’âge de 77 ans].
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 26 : Aspect du camp des GBD de la Tour Carrée
28 : Durée de la guerre « La guerre sera finie en juin [1915], par l’usure totale des Allemands »
30 : Fantôme-As
33 : Crâne attitude de la blessure du Gal Marchand
40 : Sur la mort des chevaux
43 : Bar-sur-Aube reçoit 590 obus pour 300 victimes
44 : « 3 000 hommes sont entassés dans un village de 150 habitants. Il semble que durant la guerre, les êtres humains soient devenus plus compressibles, et l’on reste stupéfait à la pensée du peu de place tenu par le poilu dans un logis, comme aussi de la simplicité spartiate de ses goûts »
50 : Sur la Loi des curés sac au dos
53 : Accident d’un fusil non déchargé
55 : Son musée de guerre et artisanat de tranchée
73 : 32 000 prêtres ou religieux mobilisés pendant la guerre, dont 300 aumôniers militaires officiels en soutane
94 : Il se fait capturer sa chapelle
103 : Fusée blanche pour faire allonger les tirs
106 : Tirs amis
107 : Jet du brassard de la Croix-Rouge par des hommes pour prendre le fusil
112 : Rend hommage à l’audace du lieutenant allemand Brandis
117 : Ordre d’évacuation de Verdun ; Ginisty doit partir, et vision d’exode
118 : Voie Sacrée, système de la poulie sans fin
124 : Exécution d’un fantassin du 327e et d’un cavalier du 11ehussard ; évoque les fusillés de Vingré
126 : Sur le mariage : « On ne se mariait pas pendant la guerre, sinon avec la mort »
: « Aussi le déficit des naissances nous fit perdre 1 200 000 existences humaines et le feu nous en coûta 1 350 000 »
131 : Vue des Vosges, en instruction au camp d’Arches (fin 135)
142 : « Faire la guerre c’est attendre »
148 : Tir ami (grenade)
152 : « Il n’y a plus de sécurité nulle part, pas même pour les gendarmes qui ne dorment que d’un œil »
172 : Rats ayant dévoré ses hosties et ses cires pour les offices
183 : Décoration intérieure de cagna : « Aux parois de la sape sont collés ou suspendus des chromos, des gravures découpées dans des illustrés ou des magazines : alpin encadré de drapeaux, les grands chefs : Joffre, Pétain, Foch, que les gravures ou le dessin ont popularisés »
187 : Choral de Luther, exécuté par de belles voix d’en face
191 : Joffre le « temporisateur »
193 : Chiffres sur le Camp de Châlons, créé par Napoléon III en 1857 qui achète 11 000 hectares de pouilleuse et dépense 4 millions. Camp tracé par le capitaine du Génie Weynant. On peut y placer 25 000 hommes
195 : Chiffres sur le vignoble de champagne : 20 millions de bouteilles produites dont la moitié à l’étranger pour 450 000 hectolitres de récolte annuelle
196 : Carrières de Romain (Aisne), odeur, aménagements
219 : Régiment du Sacré-Cœur, constitution
231 : L’aumônier militaire, rôle et aspect, thermomètre moral pour le commandement, capable de remettre une attaque si le facteur moral manquait
: II qualifie l’infanterie « d’arme souffrante »
244 : Mort par éclatement de pièce
258 : Trophées allemands trouvés dans les tranchées ennemies (liste), achète des objets, goût des poilus pour les objets « de prise »
259 : Chevaux non enterrés
: Horreur d’un coup direct sur des artilleurs
: Bruit de trolley de l’obus
260 : « Des essaims d’allemands sont restés au fond des abris et des tranchées comme les poissons au fond d’un lac desséché »
: Tableau de soldat passant une rivière à gué
270 : Sur le creuset de la guerre : « Le poilu, c’est le paysan, l’ouvrier, toutes les classes sociales, toutes les professions fondues au même creuset »
: « Attendre est la grande affaire de la guerre et de la vie aux tranchées »
271 : 25 000 officiers tués, dont 11 632 de l’active et 13 965 de complément
272 : Esprit religieux des combattants : Barrès dit : « Les Français se battent en état religieux »
273 : Allègue que le Montgolfier est un ancien sous-marin allemand transformé (non confirmé)
274 : Couleur des bâches des fourgons
: Feuilles à tabac Job ou Riz la Croix
275 : « Le tabac, « passe-temps des paresseux » au dire de napoléon, a rendu les plus grands services pendant la guerre. Avec le pinard, il fut l’un des facteurs de la Victoire » (vap 367)
: Tringlots donnant des mégots aux mioches
277 : Perte des instruments de musique du 233e RI dans un incendie à Saint-Just
: « J’accuse » écrit sur les murailles de Senlis, incendiée par les Allemands
278 : 1 200 bouteilles de champagne bues par un état-major allemand dans le château de Chamant
286 : Mise à pied par circulaire qui supprime les chevaux des aumôniers
287 : Sur la chapelle règlementaire, « très encombrante et peu utilisée »
288 : Éclatement de pièce d’artillerie
: Voit Thellier de Poncheville (aumônier du 14e corps) en Alsace avant la guerre,
293 : Italien disant « Nous avons déconcerté l’ennemi par la rapidité de notre retraite » de la Piave
296 : Sur la paperassite : « toute cette floraison dactylographiée que la guerre a fait surgir comme champignons après la pluie »
300 : Hurlement d’enfer du bombardement
302 : « Les mets se ressentent des gaz qui leur donnent une âcre saveur guerrière ; ils sont même saupoudrés de petits éclats qui crissent sous la dent comme des plombs dans le gibier »
313 : À Guyencourt, baraques ambulances dénommées des noms des héros.
: Aspect des infirmières, bénéfice moral et hommage
314 : Sur les cimetières, tombes, aspects et entretien
328 : Rend hommage à un officier allemand courageux : « Belle vaillance qu’il faut admirer des deux côtés… »
329 : Avion allemand abattu au FM
332 : Ordre d’abattre les fuyards, conscience de la gravité d’un tel ordre
333 : Défense d’une batterie à l’arme blanche et au débouchoir zéro
: Un section brûle 30 000 cartouches
335 : Critique de Le Feu de Barbusse
339 : Ambulance FIAT
340 : Canonnade déterrant les morts : « Quel spectacle que cette canonnade impie qui, sur les champs de bataille ou dans nos petits cimetières du front, déterre, déchire, tue à nouveau les cadavres »
: Fils téléphoniques entravant les roues des voitures sur les routes
341 : Mort du général des Vallières
: Les obus ne respectent plus la Croix Rouge (mai 1918)
347 : Défense du PC de Cutry
356 : Cordons explosifs entre les lignes pour arrêter les chars
358 : Il sauve des objets de culte, qu’il envoie en camion à l’évêché à Châlons-sur-Marne
: Vue des caves du château du sénateur Vallé
360 : Conditions du passage de La Marne par pontons actionnés par des câbles d’acier dans la boucle de Tréloup
366 : Pertes au 273ème R.I.
: Colonel exhumé
368 : Ce qu’il pense du Pays de Montbéliard
372 : Revue tchéco-slovaque à Masevaux (vap 374)
373 : Vue des défenses devant Belfort
371 : Colchiques appelées « veilleuses »
374 : Masevaux siège du gouvernement français en Alsace
: Vue d’enfants alsaciens habillés en soldats français, et vieux de 1870 bardés de décorations
375 : Tranchées construites le jour dans le bois d’Hirzbach, trouvées pleines d’allemands au retour au matin, conquises sans combat pendant la nuit
381 : Vue de groupes francs, aspect, composition (par des volontaires, « gaillards décidés, amoureux du risque, fortes têtes parfois, guettant l’occasion de se réhabiliter »
383 : Grippe espagnole
: Couscous préparé par Mohammed
: M. Laibe, douanier, premier blessé de 1914, à Faverois (Haut-Rhin), annoncé mort le 20 novembre 1932 (mais en fait mort en 1958)
386 : Gourbis, guitounes et cagnas d’Hirzbach
: Longue définition intéressante du No man’s land (fin 387)
388 : L’Alsace, considérée en 1918 comme une « cale de radoub »
390 : Chevrières, pays de l’oignon
392 : Vision des régions libérées, ligne Hindenbourg, Noyon, Saint-Quentin
400 : Ligne Hunding
406 : Mines, destructions allemandes de novembre et vision des populations délivrées
407 : Le bombardement, c’est la « musique de la guerre »
408 : Abandon du matériel allemand, débâcle (vap 417 : « Des mitrailleuses, des canons, des voitures, des armes, des obus jonchent le sol piétinés par la troupe en retraite, marquant ainsi comme une trainée lamentable et sinistre les étapes et l’agonie d’une armée »
364 : Fabrique un drapeau de la Croix-Rouge en vue de sa capture
369 : Dissolution le 7 août 1918 du 273e RI, versé dans les 33ème et 73ème
371 : Photographie de la borne TCF de Largitzen
409 : Tir ami par avion
412 : Sur le parcours des plénipotentiaires allemands
413 : Ce qui se passe entre le 7 et le 11 novembre, problème du capitaine plénipotentiaire von Heldorf, qui ne peut repasser les lignes pour ramener les conditions de paix, finalement acheminées par avion à Spa, siège du G.Q.G. allemand
: Pierre d’Haudroy le 7 novembre
416 : 11 novembre, comportement des soldats, « présentez armes » face à l’est, feux de joie
Yann Prouillet, janvier 2026
Javal, Adolphe (1873-1944)
Javal, Adolphe, La grande pagaïe, Denoël, 1937, 329 p.
Résumé de l’ouvrage :
La feuille de route de sa mobilisation affecte le docteur Adolphe Javal à l’ambulance n°5 du 5e corps d’armée, qu’il rejoint à Fontainebleau avec 24 heures d’avance, avant même la déclaration de guerre. Se considérant plus comme un administrateur de formations sanitaires que comme un « urgentiste », la narration de sa guerre est dès lors une impressionnante suite d’anecdotes, émaillant ses nombreuses mutations, dans un monde médical du front et de l’arrière-front qui évolue lui-même au fil de la guerre. Il « collectionne » ainsi un nombre impressionnant d’affectations jusqu’à sa démobilisation en 1919, offrant un nombre tout aussi conséquent d’analyses de ces milieux divers et variés.
Eléments biographiques :
Louis Adolphe Javal est né le 11 juin 1873 à Paris (16e arrondissement). Il est le fils du célèbre docteur Emile Javal, membre de l’Académie de médecine et homme politique, et de Maria-Anna Elissen, demeurant un hôtel particulier 5 boulevard de la Tour-Maubourg. Il a deux sœurs, Alice et Jeanne et aura deux enfants (Mathilde et Sabine). Ses travaux en médecine lui font obtenir en 1904 le prix Desportes (thérapeutique médicale). Il écrit dans la presse spécialisée, teintant ses écrits de militance. Il dit : « J’étais tellement écœuré de voir pratiquer ce système, que je fis paraître dans la « Tribune Médicale » du mois de septembre 1915… » (p. 75). Passionné d’agriculture, il possède un château dans l’Yonne, à Vauluisant, ferme de 250 hectares dans laquelle il se rend fréquemment pendant la Grande Guerre, parvenant même à se faire un temps affecter dans des formations proches pour « gérer » le domaine. Son parcours pendant le conflit est particulièrement divers, avant d’être démobilisé le 24 avril 1919. Après-guerre, à plusieurs reprises, il tente une carrière politique, notamment sénatoriale, et écrit de nombreux articles médicaux et au moins deux ouvrages, le plus souvent anecdotiques, notamment sur ses relations ubuesques avec l’administration (26 références à la BNF). Juive, toute la famille (sa fille Mathilde et ses deux filles) est déportée à Auschwitz, en 1943 et 1944. Son nom est inscrit sur un cénotaphe dans le Panthéon parmi les 197 écrivains morts pour la France dans la Deuxième Guerre mondiale.
Commentaire sur l’ouvrage :
La guerre médicale d’un docteur Javal plongé dans le monde sanitaire kafkaïen à la guerre mêle empêcheur d’embusquer en rond et journal de route d’un médecin qui tient parfois plus de l’adjudant de compagnie (même si on doit lui reconnaître en ce domaine une évidente compétence). Il dit d’ailleurs lui-même préférer le rôle d’administrateur (p. 168) que du praticien d’ambulance de front. Aussi, son témoignage est une œuvre finalement très surréaliste mais de référence quant au parcours d’un médecin au sein de différences formations (hôpitaux, ambulances, fixes ou mobiles, centres sanitaires, etc.) dans les différentes phases de la Grande Guerre. Comme d’autres témoins des ambulances hippomobiles de 1914, Javal évoque un certain inemploi, voire un abandon de blessés autour de la bataille de la Marne, notamment pendant ce qu’il appelle le « circuit de la Meuse ». Il synthétise ce sentiment : « Nous parcourûmes environ 500 kilomètres pour fonctionner exactement quatre fois : c’était extrêmement peu pour s’initier à l’art de faire la guerre » (page 45). Son ouvrage, dense et très militant, fourmille, toutefois d’indications sur le milieu médical subordonné au monde militaire, récit souvent teinté de surréalisme voire de truculence.
Particulièrement critique, mais tout aussi lucide, il analyse en permanence et dénonce à chaque fois qu’il le faut, et il ne s’en prive jamais, les situations qu’il vit, dans le détail comme dans le fonctionnement général des services qu’il côtoie ou subit le plus souvent. Resté civil même sous l’uniforme, il ne se conformera finalement jamais à l’omnipotence parfois surréaliste du militaire. Par-delà son caractère polémique (et procédurier), l’ouvrage fourmille d’informations. Il dit : « J’estime le rendement de la main d’œuvre militaire à 25 % au maximum de celui de la main d’œuvre civile à l’heure, et à 10 % de celui de la main d’œuvre civile à la tâche » (p. 35). Il applique d’ailleurs cette sentence peu amène plus loin : « Le rendement du travail d’un militaire, se chiffre, chacun le sait, par un coefficient extrêmement bas. Le chef est désarmé pour améliorer ce rendement, puisque le travail du militaire est, en général, sans sanctions. Il faut truquer pour obtenir quelque chose » (page 245). Il n’est parfois pas moins tendre à l’endroit des fonctionnaires : « Ce petit jeune homme de dix-huit ans avait du sang de fonctionnaire dans les veines » (p. 66). Souvent, il mâtine son récit d’axiomes, de réflexions psychologiques, voire philosophiques, luttant sans cesse contre la démagogie également. Sur l’égalitarisme, il dit : « L’égalité, appliquée à l’espèce humaine, produirait ce que les critiques appellent le nivellement par le bas. Au point de vue de la guerre actuelle, ce principe a causé des désastres irréparables » (p. 94). Plus loin, il avance : « Rien ne ressemble moins en effet à la médecine militaire du temps de paix que la médecine militaire du temps de guerre et, au risque de passer pour paradoxal, j’ose dire que les médecins civils de réserve qui ne connaissent ni l’une ni l’autre et encore moins les règlements, étant exempts de tous préjugés et de toute idée préconçue, faisaient beaucoup meilleure besogne que certains médecins de l’active » (p. 96-97). Aussi, il n’hésite pas cette sentence : « … l’infirmerie est mon domaine : c’est même mon royaume » (p. 189) et en effet, il y fait régner une manière de despotisme éclairé, bien à sa main, avec parfois des luttes pied à pied contre une hiérarchie qu’il épargne rarement. Aussi il fait de son temps militaire un combat incessant contre la hiérarchie, les normes, le fonctionnarisme et l’impéritie. Analyste du quotidien et des mœurs, il explique la haine du gendarme : « C’est par l’intermédiaire de la prévôté que se faisait souvent la liaison entre l’état-major du C. A. et la troupe chargée des travaux de cantonnement, ce qui explique facilement la haine farouche du gendarme qui s’encra rapidement dans le cœur du poilu » (p. 135). L’étude de son récit permet également d’alimenter l’étude de nombreux symptômes de guerre tels la simulation, le gestion de la syphilis (autre stratégie d’évitement parfois), les contagieux, les embusqués, etc. Il aime à dire « je guéris les simulateurs et je débusque les embusqués » (page 243), sport dont il se fait le champion, notamment lors de son séjour à Fontainebleau. De même quelques épisodes cocasses, comme cet accouchement qu’il gère dans son ambulance, générant des débats tout militaires, sont représentatifs de la dichotomie militaire/civil. Il fustige souvent l’administration idiote, par exemple appliquée à la gestion des réfugiés, cas qu’il étudie de près puisqu’il en recueille, et emploie, comme des prisonniers d’ailleurs, dans son château bourguignon (cf. son chapitre sur les réfugiés p. 150 à 158). Il évoque ce qu’on peut appeler des « affaires » comme le pillage de Louppy-le-Petit, la débandade de Vauquois, les typhiques de Bar-le-Duc, estimés à 3 000, l’affaire de Joinville, l’affaire Rabier, etc. Il reporte également parfois intégralement plusieurs rapports, parfois techniques, qu’il rédige soit dans le cadre de ce qu’il pense être de bonne gestion, soit médicaux, soit comme comptes-rendus hiérarchiques, dont certains sont « gratinés » et d’une spiritualité peu militaire. Il participe ainsi à la statistique, y compris rétrospective (comme à Verdun, voir p. 232), et la paperassite qu’il dénonce à longueur d’ouvrage. Il dit : « … la capacité du chef se mesurait au volume de paperasse envoyé à ses supérieurs » (p. 237). Il résume souvent sa pensée, en forme de leitmotiv du livre : « Au début, en août 1914, c’était la pagaïe : mais en janvier 1916, c’était encore la pagaïe avec une différence cependant : le gaspillage d’argent en plus » (p. 177). Il n’est pas tendre non plus sur la classe 17, « élevés dans du coton », considérant leur « gestion » par des auxiliaires ou des territoriaux comme grotesque ! (page 182). Bien entendu, son caractère entier lui vaut jalousies (notamment quand il rentre hebdomadairement dans sa ferme de Vauluisant), inimitiés, y compris politiques (voir page 93) et plaintes, qu’il traite sérieusement sans s’en faire, et avec une certaine routine (voir p. 185). Il rapporte une punition elle-même surréaliste, à la suite de son long chapitre sur sa « question noire », celle de la « température anale » constituant « une grossière inconvenance » (p. 288). Mais en grande partie, l’ouvrage, qui se veut caustique, ne manque pas de finesse d’analyse et est écrit avec un savoureux second degré. Par exemple, pages 189-190, il dresse une liste des maladies qu’il considère comme « contagieuses » : pigritia (paresse), claudication, colique, réformite, auxiliarite (vap 319) ! Il reporte quelques « méthodes », parfois « fermes », pour lutter contre les simulateurs et les maladies arrangeantes pour les tire-au-flanc, ce qu’il appelle les « attitudes vicieuses » (il cite les coxalgies, les ankyloses ou les adhérences par exemple (p.197)). Son livre abonde ainsi en personnages cocasses, surréalistes, qui témoignent d’une réalité entre évitement du front et déviance comportementale qui touchent souvent à la psychiatrie, formant un tableau général de soldats bien loin de l’héroïsme patriotard lisible par ailleurs. Il en débusque souvent et partout, parfois dans l’auxiliaire même, osant cette sentence : « tous ces déchets humains qui ont encombré les dépôts et les formations sanitaires, n’ont produit aucun travail utile et ont coûté très cher » (p. 204-205). Plus loin, il dit même : « Le dépôt fut l’école de la paresse » (p. 226). Pourtant il doit souvent faire des choix qui lui posent cas de conscience. Il dit : « Peut-on concevoir au monde quelque chose de plus injuste que la sélection qu’un médecin doit faire entre les hommes qui auront le devoir de faire la guerre et ceux qui auront le droit de ne pas la faire ? » (p. 205). Plus loin, il dit : « Que les chiffres soient exacts ou faux, utilisables ou non, peu importe ; il y en aura des millions. La médecine militaire est bien plus occupée à compter les malades qu’à les soigner. Personne ne s’occupe d’ailleurs de savoir si la circulaire est exécutable, si les infirmiers ou les thermomètres sont en nombre suffisant. L’ordre est formel : il faut des chiffres » (p. 221 et aussi 316). De forte personnalité, il goûte peu les gens du midi… et les curés et les religieuses, qui transforment son ambulance en « séminaire » et pratiquant des conversions plus ou moins forcées (p. 241 et suivantes) ! Il n’aime pas beaucoup plus la hiérarchie, et assène : « … la pléthore des chefs superposés ne sert qu’à défaire par l’un ce que l’autre à fait » (p. 245). Il a également une analyse singulière de la question noire, qu’il expose dans le chapitre « le tutu des nègres » (page 284). L’armistice signé, qu’il vit à Coulommiers, l’ambiance est particulière. Javal fait une analyse également singulière de son environnement ; il dit par exemple, sur le traitement féminin des rapatriés : « Les dames infirmières n’étaient pas contentes de le nouvelle orientation que prenait mon établissements. Elles voulaient des blessés : elles avaient soif de sang. A la rigueur, elles auraient accepté des malades, mais laver, épouiller et nourrir ces rapatriés ne leur allait pas… » (p. 300). Ses analyses, permanentes, classent cet ouvrage tant dans le domaine du témoignage que dans celui de la réflexion analytique détaillée sur la Grande Guerre sanitaire.
Son parcours est très diversifié ; le 24 avril 1918, il écrit : « né en 1873 et ramené à la classe 1891 par mes deux enfants, j’ai fait deux ans et demi de front ». Le reprendre en totalité est fastidieux ; il est ballotté d’abord dans l’ambulance 5 puis se trouve à Bar-le-Duc le 16 juillet 1916. Le 18 mars 1917, il est nommé médecin-chef de l’ambulance 4/37. Le 1er janvier 1918, il est nommé (par le ministre) médecin-chef de service de groupement des centres (centre de réentraînement d’Estissac et de Cravant), centre de rééducation physique de Pithiviers) de la 5e région. Il monte une station-magasin à Montereau le 23 avril 1918 (« avec 600 hommes à soigner : 200 vieux territoriaux et 400 nègres qu’on avait fait venir du Maroc et qu’on payait 7 fr. 50 par jour ») (il y revient p. 238 et 289 zone d’étape), puis c’est l’hôpital d’évacuation de Vasseny, entre Reims et Soissons (2 août 1917), au camp d’Estissac (2 octobre 1917), à l’hôpital de Sens (11 février 1918), à l’hôpital mixte d’Orléans (29 août 1918), à l’hôpital 92 de Coulommiers, le 5 novembre 1918 par exemple. Après l’Armistice, arrivé à Paris (7 décembre 1918), à la direction du service de santé du gouvernement militaire qui siégeait au lycée Buffon, et avant sa démobilisation le 24 avril 1919, il est un temps affecté au Val-de-Grâce (mais dans les affres de la guerre tout juste finie, ne semble pas y avoir exercé). Le fourmillement de ses affectations a certainement à voir avec son comportement personnel comme ses pratiques professionnelles. Il conviendrait de rependre précisément le déroulé de l’ouvrage pour en retracer le parcours complet daté et localisé.
Les annexes reportées sont intéressantes, surtout la 2ème, intitulée « La Paperassite », sous-titrée (étude bactériologique, clinique et expérimentale), avec comme chapitrage I. Etude bactériologique, II. Formes cliniques, III. Marche – Durée – Terminaison. IV. Complications. V. Traitement (p. 309 à 318). L’ouvrage est enrichi d’un index des noms cités.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 16 : 16 ambulances de Corps d’Armée, 96 médecins
24 : Composition de la colonne
62 : Général Micheler assassinant un soldat car il avait perdu son fusil
64 : Autobus touristique Cook pour visiter Paris
: Chiffres des malades (dysentériques, typhiques, gelures) et blessés fin septembre 1914
66 : Comment il crée la gare sanitaire de Clermont-en-Argonne
70 : Sur la vaccination antityphoïdique
77 : Chambre de sulfuration pour l’épouillage
79 : Notice d’utilisation des douches
85 : Crée un magasin d’occasion distribuant des effets donnés après désarmement des hommes abandonnant leurs vêtements et par les apports des gendarmes (vap 87 les 1 500 fusils qu’il « recycle »)
100 : « Débandade de Vauquois », négociation avec les docteurs, menaces du commandement
103 : Cas de conseils de guerre
106 : Pieds gelés : « malades ou blessés » ? (vap 227, statistiques, 235, nombre)
109 : Vue des Garibaldiens, qui ils sont, but
123 : Douche froide contre les simulations (vap 128 sur ce sujet)
129 : Gère un accouchement, polémique tout militaire
136 : Sur les gendarmes pendus à Verdun
142 : Salvarsan contre la syphilis
154 : Gabegie de l’allocation aux chevaux de réfugiés
164 : Sur les typhiques de Bar-le-Duc
170 : Il couche dans la maison de Poincaré à Sampigny
172 : Chiffres sur la consommation de liquide (café, thé, vin) des troupiers du centre de Condé
173 : Chiffres de l’argent touché par hommes par mandats et bons de poste
178 : Rédige un billet d’hôpital qu’il considère comme efficace, aucun succès
180 : Sur la permission de 24 heures
182 : Comment il traite la classe 17 « élevés dans du coton » ! (vap 189 sur les visites médicales, 220, 222 : « Les bleus de la classe 17 ont acquis, pendant leur séjour au dépôt, un entraînement magnifique à défiler tout nus devant leur médecin : ils me paraissent aptes à partir maintenant pour les camps d’instruction militaire »)
182 : Chasse aux embusqués
195 : Février 1916, entrée des femmes de service embauchées dans les casernes
199 : Scandale de l’avancement des embusqués
200 : Repère sur les pansements pour éviter qu’ils ne soient défaits
206 : Hôpital du Tibre à Fontainebleau pour les malades mentaux
207 : « Ne jamais résoudre une difficulté, mais la repasser au voisin »
208 : Sur l’héroïsme : « Des centaines de mille hommes n’ont pas fait autre chose, pendant la guerre, que le circuit des formations sanitaires, parce que l’administration du service de santé, c’était la pagaïe, du commencement jusqu’à la fin. Et ce sont ceux-là qui crieront le plus fort après la guerre, qui porteront les chevrons, débanderont des décorations et des pensions. Les costauds sont morts et seront vite oubliés »
214 : Pansement Leclerc
215 : Registres et paperasserie (vap 237, 238, 305, 313, qualifié de « torchecul »)
216 : Orléans, hôpital Chataux pour les contagieux
: Problème administratif d’un homme ayant deux maladies contagieuses !
217 : Manques de médicaments, différences entre deux établissements (« affaire » des médecins du fort Saint-Bris)
226 : « Le règlement, c’est comme l’argent, il y en a de deux espèces : le sien et celui des autres »
: Sur l’après-guerre : « Avoir fait la guerre, la vraie guerre, avoir eu l’indépendance, la camaraderie et les initiatives du front, puis, tout à coup, retrouver les brimades de l’intérieur, les règlements de la vie de caserne, non, ce n’était pas supportable »
232 : Ecrit cagnia pour cagna
242 : Antimidi, car « l’ambulance 4/37 était une ambulance de méridionaux. On y parlait beaucoup mais on agissait peu »
: Curés syndiqués
251 : 65 médecins sans malades ni blessés à l’hôpital d’évacuation de Vasseny
257 : Description du camp d’Estissac
258 : Différence entre infirmerie (maladies légères) et hôpital
261 : 100 litres d’essence par mois pour son infirmier-chauffeur d’ambulance (vap 283, crise)
263 : Moniteurs pompiers
277 : Voit des nègres du Maroc, fainéants, nés paresseux
280 : Permission agricole
284 : Grippe espagnole
: Noirs refusant la température rectale (vap 285 polémique, et 292, conférence) et ramadan
: Soviet des nègres
285 : Rôle de l’inspecteur de la main d’œuvre
291 : Il dit, après une sanction : « il est sans exemple que, dans un rapport militaire, un chat soit appelé un chat » !
297 : Désordre gai, dû à la victoire proche, à Coulommiers le 5 novembre 1918
: Hôpital de Coulommiers
298 : Traitement des prisonniers allemands et utilisation civile de la troupe
: Paye des permissionnaires
: 7 signatures pour un sortant
299 : Armistice et ambiance : « Ces hommes avaient fait la guerre pendant si longtemps ! La guerre finie, on ne pouvait plus les tenir dans une caserne »
300 : « Ce n’était plus l’hôpital, ce fut l’auberge » et retour des prisonniers
302 : Perte de clientèle par les médecins
: 17 00 médecins mobilisés
320 : Centres de réentrainement et de rééducation et méthode de Joinville (circulaire ministérielle du 12 décembre 1917) et chiffres
Yann Prouillet, janvier 2026
Perrin, Pierre (1888-1975)
Laurendon, Gilles. Un guerrier d’occasion. Journal illustré du fantassin Pierre Perrin (1914-1918), Rennes, Ouest-France, 2012, 375 p.
Résumé de l’ouvrage :
Parti de Rigny-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, le 3 août 1914, Pierre Perrin est soldat au 27e RI de Dijon. Sous forme de journal de guerre, mais reportant en fait ses souvenirs, il rapporte une guerre impressionnante de fronts hyperactifs sur La Marne, au Bois d’Ailly, à Verdun, sur La Somme où les Monts de Champagne, qu’il traverse par une suite de miracles continus. Il est à proximité de Reims quand l’allemand plie enfin à l’été 1918. Gazé devant la Suippe, il apprend l’Armistice à Rigny, en permission, miraculé d’avoir traversé quasiment sans blessure une guerre aussi intense que violente.
Éléments biographiques :
Gilles Laurendon, présentateur du témoignage, dans sa courte préface, donne très peu d’éléments sur l’auteur. Aussi, c’est le fils de Pierre Perrin qui nous fournit les éléments complémentaires d’état-civil manquants dans l’ouvrage. Pierre François Léonard Perrin est né le 11 novembre 1888 à Rigny-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, de Jean Marie et de Marie Perrin. Ses parents ont une petite maison sur la place de l’Église du village, à côté de l’édifice. Il a deux frères, dont l’un, Benoît Léonard Joseph, caporal au 29e RI, né le 20 août 1891, meurt le 13 mars 1915 à l’hôpital de Commercy, ayant contracté la typhoïde. Pierre apprend par une carte le 8 mars son admission à l’ambulance n°6, dans la caserne Oudinot. Il va le voir quelques jours plus tard et apprend sa mort le 14, puis son enterrement le lendemain. Pierre Perrin vivait à Paris (17e), 8 rue des Nollets, depuis le 27 octobre 1912, où il travaillait comme dessinateur quand la guerre le mobilise au 27e RI de Dijon, 11e escouade. Il avait fait son service dans ce même régiment en 1913. Il aura lui-même trois enfants. Il occupera aux tranchées plusieurs fonctions, comme planton du colonel de bataillon ou agent de liaison et même infirmier de fortune lorsqu’il est légèrement gazé par exemple. Il est blessé légèrement à la tête par une pierre projetée dans un bombardement le 15 avril 1915, au Bois d’Ailly, et revient au front dès le 20. Il est à nouveau blessé le 18 avril 1917 par éclat d’obus à la jambe droite, au Bois de la Guille, rejoignant le 15 mai suivant. Il est nommé soldat de 1ère classe le 3 juillet 1918 et est ypérité le 6 octobre suivant en bordure de la Suippe pour ne plus revenir au front que le 27 novembre, les combats ayant cessé. Ces blessures finalement légères n’obèrent pas le sentiment d’une suite impressionnante de miracles renouvelés, tel cet obus qui tombe à trois mètres de lui le 25 août 1918, et qui n’éclate pas (p. 339). Alors qu’il avait refusé par trois fois le grade, il est nommé caporal le 1er mai 1919 avant d’être enfin démobilisé le 10 juillet suivant. Il a été cité à l’ordre du régiment le 13 novembre 1915 dans ces termes : « Au cours d’une attaque au petit jour a assuré à plusieurs reprises la transmission des ordres en traversant sous le feu de l’artillerie et de mitrailleuses des terrains découverts, a toujours fait preuve de décision et de courage dans des missions analogues ». Il obtient à ce titre la croix de guerre avec étoile de bronze. Il est à nouveau cité à l’ordre de la Brigade le 9 novembre 1918 avec ce motif : « Très bon agent de liaison, s’est fait remarquer pendant la période du 1er au 4 octobre 1918 en assurant la liaison dans des circonstances difficiles. Intoxiqué ». Il est décoré de la Médaille militaire le 22 mars 1928. Faute d’éléments biographiques plus précis, il faut faire confiance au présentateur de ces souvenirs qui nous indique, pour l’après-guerre : « De retour dans sa famille, Pierre Perrin a recopié scrupuleusement, sans retouche, les lettres, le journal qu’il avait rédigés au front. Sans rien retrancher, sans rien ajouter, au mot près. Il a ainsi rempli quatre cahiers de sa petite écriture serrée et précise » (p. 12), écrits auxquels s’ajoutent un corpus de dessins, des portraits de soldats dénommés, dont quelques-uns sont publiés en couleurs en cahier central ou insérés au fil de l’ouvrage. Il revient à Rigny dès sa démobilisation et sera recensé 10 rue St Sauge à Autun en janvier 1920. Pierre Perrin deviendra professeur de dessin dans plusieurs établissements de la ville. Il est libéré de ses obligations militaires en 1937. Il décède à Rigny le 03 juin 1975.
Commentaires sur l’ouvrage :
Indubitablement classable comme l’un des tout meilleurs témoignages de la Grande Guerre, les souvenirs de Pierre Perrin sont précis, fourmillants de tableaux, d’anecdotes et de descriptions qui révèlent une foultitude de points d’intérêt à chaque page. Il décrit de manière détaillée ce qu’il voit, comme les hommes et les officiers, qu’il dénomme et descend en flammes parfois. Par exemple à Verdun le capitaine Robillot « lèche-botte et faux bonhomme, grossier avec ses inférieurs et plat devant ses supérieurs » (p. 190). Ainsi, il fournit une mine de données utiles à l’historien, livrant un récit incontournable, rappelant celui d’Emile Morin ou de Gaston Mourlot. Doté d’une intelligence supérieure, il connaît le nom des fleurs et des lichens (p. 271), travaille de ses mains, dessine, fait des menus, des écussons, des pancartes, des programmes, des plans de secteur… Il lit beaucoup, dont du André Theuriet, auteur argonnais, et a parfois quelques envolées poétiques sur la nature. Mais Pierre Perrin est surtout un miraculé permanent, renversé par un obus, plusieurs fois blessé, il traverse les secteurs les plus mortifères avec une facilité de façade désarmante. Son témoignage laisse l’impression d’une guerre sans fin, ayant manifestement combattu dans les pires secteurs. Il laisse échapper parfois des sentences qui témoignent de son état d’esprit, par exemple quand ses camarades tombent autour de lui. Il dit alors : « Nous payons chers le droit de vivre libres, et cependant notre volonté ne fléchit pas » (p. 190). Ses sentences peuvent aussi être politiques lorsqu’il assène, en mars 1917 : « Que de grenades qui se perdent » (p. 234) lorsqu’il apprend la démission de Lyautey. L’ouvrage comporte quelques rares erreurs de transcription (Lionville pour Liouville, Léronville pour Lérouville, Mont Rémois pour Mont Trémois ou V13 pour VB) et aurait gagné à accueillir un index toponymique et patronymique, même si particulièrement denses.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 18 : Soldat mort d’insolation
24 : Passage de la frontière vers Avricourt le 15 août, ne voit pas de poteau-frontière
25 : Baptême du feu
: Bruit du départ du 75 « comme des coups de pieds dans un ballon de football, et les longs sifflements soyeux et graves »
27 : Héming pillé par les français
: Bruit des balles : « On se croirait au milieu d’un essaim en révolte »
34 : Soldat atteint d’une balle sans force
31 : Vue impressionnante de divers morts allemands
38 : Traite des vaches abandonnées, à la chaîne, cochon tué à la baïonnette
40 : Pétris des babouins dans la glaise
: « Nous ramenons nos pans de capote sur nos pantalons rouges »
: Bruit des marmites « avec un bruit de wagons lancés à toute vitesse »
42 : Tombe et nom gravé sur une écorce
: Ordures laissées par les Allemands
: Voit sauter le fort de Manonviller, détruit à l’explosif par les Allemands
43 : Lecture du Bulletin des Armées de la République
46 : Madame de Thèbes
49 : N’a pas pris de rasoir car croyait une guerre courte, se fait raser avec des ciseaux pliants de poche
51 : Médailles amulettes au képi
: Se déguise pour tromper un gendarme zélé (l’épicerie de l’autre côté de la rue n’est pas dans le secteur de son régiment !)
53 : Cuisiniers collectionneurs de trophées
: Boîtes de conserve servant de pots de chambre
: Mannequin-leurre allemand
55 : S’abonne aux Annales pour s’occuper
57 : Homme égaré tué par erreur, (vap 70 pour lui-même, sentinelle lui tirant dessus)
59 : Obus cassant son fusil, en trouve un sur un tas d’équipements des morts
60 : Main de mort dépassant de la tranchée
: Marmites qu’il appelle bouteille, (vap 61 obus plus petits appelés saucissons, vap 169 casque à pique pour du 240)
61 : Morceaux humains en emplissant des sacs de terre
62 : Abri allemand fait avec des fusils français
65 : Miction dysentérique
: Description d’une marche harassée
69 : Contact, bouteilles lancées contenant des blagues et des insultes contre les boches
71 : Archives de Brasseite pillées
: Mortiers crapouillots de 1844 et 1855 (vap 65)
73 : Obus direct sur 4 hommes
74 : Méridionaux sans gêne
76 : Bottes canadiennes et en caoutchouc
77 : Vu d’anglais à Commercy
78 : Obus allemand à double éclatement
80 : Catapultes à roues
83 : Eau de vie au goût d’éther
: Adresses des familles laissées en cas d’attaque
84 : Vision impressionnante du bombardement, bruit et sapes
87 : Mort d’André Chaumont, d’Epoisses, auteur dans La revue de Bourgogne
89 : Colis américain contenant « un mouchoir, du papier à lettres, un crayon, un savon, du chocolat, une pipe creusée dans une sorte de panouille avec un tube en roseau, et… du papier hygiénique » (vap 366 « un petit sac de toile qui contient du papier à lettres, un crayon, une blague et des cartes à jouer. Quelques-uns y trouvent un rasoir mécanique, d’autres une paire de ciseaux. Petit, lui, y trouve une toupie mécanique… »
90 : Démonte des grenades allemandes
92 : Buse abattue au fusil (vap 119 une autre soignée à la teinture d’iode)
93 : Casque à pointe, trophée convoité
: Général Blazer, détesté, surnommé von Blazer (vap 95 et 115)
96 : Rififi entre régiments (8e et 56e) suite à la perte d’une tranchées
: Caisse de calendriers = grenades
: Mutinerie
97 : Capitaine Boll surnommé « capitaine-crapouillot »
98 : Homme tué en pêchant à la grenade (vap 326)
102 : Homme tuant un renard par erreur
: Artisanat de tranchée (vap 107, 109 cannes, 117)
105 : Moustiques
107 : Contact avec des soldats allemands polonais, échange de cigares et de bonbons contre du pain blanc
109 : Poilu’s Park (vap 118 sa description, 284)
111 : Bras tranché abandonné par son propriétaire
113 : Sur le commandement : « Les hommes commandés par de telles savates sont incapables de quoi que ce soit »
114 : Vision épique de la récupération d’un cadavre
: Condamnation à mort d’un soldat par Blazer, réhabilité sous le feu
116 :Recherche des fusées d’obus et part avec 20 kg de débris d’obus
117 : Canon de 7
: Déserteurs pacifistes fusillés, vue de leur exécution
118 : Distribution de couteaux, pas de succès (vap 161)
: Concert improvisé sur des douilles d’obus
: TPS et Alsaciens employés à l’écoute, ce qu’ils entendent (vap 167)
123 : Paperasserie
126 : Cartes distribuées en prévision d’une attaque
: Couleurs d’obus de 75, croix blanche sur peinture kaki et bandes rouges sombre
128 : Accident de grenade
: Sculpte des blocs de craie
129 : Explosion d’un fourneau de mine, pense à une secousse sismique
130 : Le 27e RI touche le casque le 8 octobre
: Corvée de fusil, horreur de la tranchée, fouille macabre pour des trophées
: Eclatement d’un canon de 270
132 : Avion-canon
133 : Fait des croix et des plaques de craie gravée (vap 137)
136 : Giclous ou zim-boum, surnom des 88 autrichiens
137 : Têtes sculptées par des coloniaux dans des maisons en craie de Saint-Rémy-sur-Bussy
141 : Déserteur allemand, précurseur d’autres volontaires déserteurs, ruse qui ne prend pas
: Soldats nettoyeurs, qualifiés d’apaches
145 : Brassards allemands pour les attaques de nuit
146 : Mocos (argot pour marins) méridionaux (vap 151 et 152, anti-midi)
150 : Poudre en lamelle (pour les 75) ou en macaroni (pour les 77), fait chauffer le café avec
151 : Girouette et cloche à gaz (vap 197 un avion girouette dans la tranchée)
154 : Déserteurs aux mains liés
: Fumier
: Apprentissage du morse (vap 233, 254)
159 : Obus nouveaux à éclatement successifs et balles traçantes
160 : Avion descendu par une mitrailleuse
: Soldat fataliste
: Fusils braqués sur des cadavres
161 : Cadavre récupéré, analogie avec Dayet
: Obus en bois, cad qui n’éclatent pas
162 : Hommes signalés car ils ont tiré sur des poules
: Obus non éclatés rouillés
163 : Guidetti lance-bombe
Lance-bombe inutilisé pour ne pas recevoir de contre feu
: Chat qui fait la navette entre les lignes françaises et allemandes, à qui on a attaché un ruban tricolore (rappelle Joyeux noël de Carion)
: « Quel temps pour se faire casser la gueule ! »
164 : Contacts, cris allemands
: Voit une photo aérienne de son secteur
: Peur incontrôlable
165 : Démonte une grenade pour étudier son fonctionnement qu’il décrit (vap 170)
166 : Arbre observatoire (vap 175 percuté par un obus)
167 : Explosion d’un dépôt de munition, débris humains
169 : « …chasseurs dont le ventre s’allume au soleil comme un ablette entre deux eaux »
170 : Tracts allemands par ballons
: Désertion retardant une relève
171 : Apache que l’on doit enfermer en prison
173 : Pilons et huîtres, « grenades plates comme des galets lancés à la main »
: « Quatre jours de permission à ceux qui donneront cinq cents francs en or pour la Défense nationale. Le procédé, financièrement, est peut-être habile, mais ignoble. Aussi on s’est promis de casser la gueule à ceux qui profiteraient de cette annonce. Personne ne s’est présenté »
174 : Torpilles Save
: Habitants revenant dans leur maison avec des gendarmes pour chercher des affaires (vap 341)
: Bourrage de crâne lu dans un rapport à propos d’une désertion de 2 régiments du 15e corps, qui ne prend pas
175 : Tranchée minée
: Vue de Spahis
176 : Fabrique un violon fantaisie avec un vieux bidon et des fils de téléphone
182 : Corps phénolés en attente de sépulture
190 : Prisonnier allemand aidant le transport sanitaire à Verdun
191 : Vision dantesque de la poudrière de Souville
192 : Allemand devenu fou ayant bu de la teinture d’iode
: Odeur de la putréfaction « que Toussaint comparait à celle du saucisson de Lyon »
: On prend les effets des sacs des morts
193 : Hommes « placés à l’arrière des voitures, chez qui on ne distingue plus que la bouche et les yeux » à cause de la poussière
194 : Broderie de Lunéville
197 : Confectionne des pancartes pour les tranchées
: Contact, lettre posée par les Allemands, avec texte et photo, pour rendre compte des honneurs rendus à des morts français en mars 1916 à Gondrexon (vap 198)
200 : Pierre à percuter les grenades
201 : Tank comparés aux cuirassés de terre d’H-G Wells
202 : Description de lance-flammes
204 : Lange Max vu par un guetteur depuis l’hôtel de Ville de Nancy ; qui prévient des tirs pour mettre les gens à l’abri dans le délai entre le départ et l’arrivée de l’obus et vue d’une collection d’obus de divers calibres au même endroit
205 : Conférence tombant faux d’un Alsacien qui parle de Boche
206 : Auto combustion du foin
: Jeux sportifs, score, tricherie, prix remis
207 : Coud une peau de mouton sur son « sac à viande » (vap 221, matelassé)
208 : Menace un épicier sur le prix usuraire des bougies
211 : Boue moirée d’essence
220 : « La guerre est longue à ceux surtout qui la font à pied »
: Comment il braconne le lièvre : « On met du plomb dans le canon du fusil, une bourre de papier par-dessus et une cartouche sans balle » (vap 294)
223 : Prix des denrées
224 : Souliers entourés de drap pour lutter contre le verglas
225 : Argonne : « le bois est partout rasé, on dirait une plantation de manches à balai »
227 : Soldats écroulant les maisons pour récupérer les poutres (vap 233)
: Mange du corbeau et du chat (ceux de Vienne-le-Château), (vap 236 un chat dépouillé)
228 : Faux canons en bois
231 : Dévisse une grenade suffocante pour en faire une lampe à pétrole
: Mention de section franche
233 : Prisonnier de Clairvaux ayant demandé à retourner au front
234 : Perle d’un général « Les autres hommes des petits postes se reposeront en travaillant »
: Tir sur des oies sauvages
235 : Caillebotis tapissés de sacs à terre pour amortir le bruit des pas.
: Prix comparé d’un bombardement
236 : « Le phosphore des trous d’obus éclaire vaguement l’obscurité »
: Piano Erard dans une sape
: Pillage dans Vienne-le-Château par Van den Busche, brocanteur
237 : Signe un acte de décès
: Vue du cimetière de Florent-en-Argonne, horribles cocardes tricolores en fer peint
: Contact, écriteau allemand
239 : « Des gendarmes donc pas d’obus ! »
242 : Proclamation sanguinaire du colonel pour gagner la fourragère
: Voit une photo aérienne de son secteur
: Communication par le sol à l’aide de lampes spéciales et d’une antenne de quelques mètres, fichée en terre (vap 254 TPS et TSF, stage, divers et explications)
: Engagé à ne pas faire de prisonniers, protestation
246 : Bâton près de la tête pour marquer un corps enterré, ce avant la croix
: Pressentiment de la mort
: Légèrement blessé par un obus de 105, il retire lui-même son éclat à la jambe
247 : Hôpital de Bar-le-Duc, description du traitement
: Tirailleur ne voulant pas le thermomètre anal
248 : Obusite Shell shock
: Prêtre pistonné par une commission de réforme
251 : Martiniquais mal traités (vap 252)
: Vol de chaussure ! (vap 256 pour bidon et musette)
252 : Colonel limogé pour avoir dit merde à général
: Lampe à acétylène faite avec un quart, une boîte de conserve et deux ficelles
: Bruit du canon de 37 qui « claque comme un fouet de charretier »
: Officier mort par bravade suite à une assertion de peur
254 : Revue de chevaux
: Evadé prisonnier allemand blessé, tentative infructueuse
255 : Camp disciplinaire du 129e mutiné, culasses des fusils ôtées. Complot pour aller à Paris
: Vue des péniches bloquées sur la Meuse depuis 1914
256 : Description des femmes dans une usine de munitions
260 : Sur l’effet de la note de Pétain « Pourquoi nous nous battons »
261 : Sur les plusieurs façons d’écrire l’Histoire après un coup de main
: Pas assez grand pour faire porte drapeau au défilé du 14 juillet 1917 à Paris !
263 : « Dans l’air, on suit la courbe des torpilles et la lueur de leur mèche allumée »
264 : Enterrement difficile à cause de la décomposition des corps
: Pochard perdu entre les lignes
268 : Saucisse ressemblant « à quelque monstrueux poisson de légende »
: Trouve des os et les signale, respect dû au mort
: Piège à rat
270 : Saucisse enflammée par avion (vap 287, 299)
171 : Allemand utilisant des 203 japonais
272 : Portes amiantées (vap 286)
273 : Pancarte allemande
274 : Curieux canons anglais à l’âme hexagonale, posés sur des affûts rudimentaires en pierre
: Bataillon du Pacifique
: Fillette tuée par un avion allemand à Talant près de Dijon (Bourrage de crâne ?)
275 : Observateurs japonais
276 : Anglais venu de l’arrière avec une espèce de cloche sur le dos pour recueillir les gaz afin de les étudier
277 : Obus à gaz quasi silencieux
: Chants allemands entendus depuis la tranchée française
: Rats tués par les gaz (vap 322 idem pour les abeilles)
: Portes annamites
: Obus allemands à messages avec nom de prisonnier et renseignements (vap 315 et 316 avec ballonnets de journaux, et 353 journaux allemands jetés par avion)
287 : Concours de grenades VB
290 : Ballonnets pour vérifier la direction du vent pour les gaz
291 : Match de foot anglais contre français, gagné 2 à 1 par les anglais
293 : Mange des moineaux bardés de lard
: Théâtre aux Armées
297 : Pillage et destruction systématique, registre d’état-civil traînant sur le parquet de la mairie de Dommartin-sous-Hans
: Poêle réalisé avec des tôles
301 : Voit un phénomène naturel curieux : « un nuage est apparu, s’est scindé en deux et, par deux fois, un anneau jaunâtre est apparu »
308 : Poisson d’avril
310 : Américains aux dents en or
312 : Vision d’un coup de main dans le vide
: Baraques métro en tôle
314 : Américain abattu car meurtrier
315 : Nuage artificiel
316 : Horreur d’une tête de mort nettoyée par les fourmis !
318 : Pour les Américains, Jeanne d’Arc est la madone de l’Alsace
319 : Américain faisant une photo d’un pont pour prouver qu’il n’est pas gardé !
: Boxe avec des noirs américains, officiers blancs, tatoué ganté, discriminations
320 : Idiotie de la désinfection des paillasses
324 : Américains excités imprudents se baladant sur les parapets sans souci du danger
328 : Faux laisser-passer pour rentrer à Epernay
: Réfugiés logés sous des ponts aux arches aménagées
329 : Canons anti grêle à Épernay
330 : Se brûle légèrement les yeux à cause d’une fiole d’acide chlorhydrique (vap 331)
: Stahlhelm abandonnés par les allemands car trop lourds
332 : Bruit « bien connu » du 210, « un départ sourd, un bruit de wagonnet »
: Découvre dans une sape (piégée ?) un essai de fougasse composée de trois obus de 105, de pilons et de détonateurs
: Ersatz allemand
333 : Essai de signaux optiques
: Obus au phosphore, reflets à long terme
: Renard blessé
: Pipe Pétain
: Change son casque
: Tombe d’anglais avec casque
334 : Chevaux dépecés
335 : Bronzage
338 : Melons et raisons blancs
: Interdiction de familiarité avec les noirs « pour ne pas choquer les officiers blancs qui considèrent les Noirs comme de race inférieure. Et leur guerre de Sécession a duré quatre ans pour libérer les esclaves noirs du Sud ! »
339 : Détruit un nid de guêpe avec des détonateurs
340 : Chien de liaison
: Radeau fait avec des sacs rempli de paille pour passer la Vesle
342 : Pilote abattu non blessé se servant encore de sa mitrailleuse
343 : Nacelle de ballon détachable avec parachute
347 : Gaz pallite ?
: Seins coupés sur une envahie (histoire rapportée !)
348 : Homme tué par une sentinelle dont il n’avait pas entendu les sommations
350 : Sacs Habert
354 : Paillasses allemandes entoilées de papier
: Affiche allemande « représentant un soldat anglais écoutant à un microphone, placée près d’un appareil téléphonique pour avertir de faire attention aux conversations »
: Lanterne pensée piégée mais en fait non, peur des pièges
: Gargousses payées 1 franc par pièce, mais spoliation par des « artilleurs qui, eux, restent plus longtemps que nous et auront le temps de brocanter notre matériel »
355 : Prisonnier occupé à désamorcer les explosifs
357 : Gazé, se lave les yeux avec du café
358 : Comment il est traité
360 : Effets de l’ypérite
362 : Vue de cimetières, spécificités par nationalité
363 : Définition de l’intérieur « ce pays de rêve où on n’entend plus le canon et, le soir, on n’a pas besoin de camoufler les lumières »
364 : Grippe espagnole
: Vue d’Auxerre
365 : Paperasserie risible pour un bonnet de police (vap 366 pour des bretelles)
: Enterrement de Russe
366 : Huile goménolée
367 : 11 novembre 1918
369 : Corneilles mascottes avec des noms allemands
371 : 10 juin 1919, on ne sait comment occuper les hommes, cours multiples
372 : Costume Abrami et visière de casque
373 : Citation de la 2ème Cie du 27e RI et la sienne (12 novembre 1915)
Yann Prouillet, 2 octobre 2025
Laroche, Jules (1872-1961)
Jules Laroche. Au Quai d’Orsay avec Briand et Poincaré. 1913-1926. Paris, Hachette, 1957, 231 p.
Résumé de l’ouvrage :
Jules Laroche, venant de l’ambassade d’Italie, est nommé secrétaire au ministère des Affaires Étrangères, le quay d’Orsay, en juin 1913. Dès lors commence le report de 13 années de souvenirs, en forme de témoin privilégié, à cette éminente fonction qui l’amène à gérer de nombreux dossiers importants dans la conduite politique, en lien avec le militaire, dans la Grande Guerre. Celle-ci terminée débute une autre phase majeure de son activité ; la gestion de l’après-guerre et de la paix européenne, du traité de Versailles (dont il est l’un des principaux négociateurs) à celui de Locarno, côtoyant Aristide Briand comme Raymond Poincaré et tous les autres hommes politiques européens avec lesquels il a eu affaire. Ainsi peu d’aspects politiques contemporains de cette période n’échappent à son « rapport » précis et éclairant jusqu’à son départ, nommé ambassadeur de Pologne.
Éléments biographiques :
Jules-Alfred Laroche est né le 4 novembre 1872 chez ses parents, 8 rue Las Cases, à Paris (7e arrondissement) de Théodore Joseph, propriétaire, remarié avec Augustine Eugénie Chavanne, sans profession. Il s’unit à Constantinople avec Pauline Caporal le 5 juillet 1899 et a trois enfants ; Hervé, né en 1900, Anne-Marie, née en 1903 et Frédérique, née en 1907. Licencié en droit, il est stagiaire en 1896 puis attaché d’ambassade l’année suivante, ayant la même fonction à la direction politique à Rome en 1898. Il monte les grades dans sa fonction (3e classe en 1900, puis 2e classe en 1904), postes au cours desquels il fait preuve d’efficacité dans des dossiers sensibles européens (annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908 par exemple). Il exercera entre autres les fonctions de ministre plénipotentiaire de 1re classe, sous-directeur d’Europe et directeur des affaires politiques et commerciales au Ministère des affaires Étrangères (dès octobre 1924). C’est à ce titre qu’il aura, après-guerre, de nombreuses importantes fonctions quant à la rédaction du Traité des Versailles et de tous ceux qui vont suivre, et notamment dans les multiples épineuses questions de la redéfinition des frontières européennes redessinées entre vainqueurs et vaincus. Jules Laroche décède à Dinard, Ille-et-Vilaine, le 13 juillet 1961.
Commentaires sur l’ouvrage :
Publiée en 1957, faisant référence à la Deuxième Guerre mondiale, Au Quai d’Orsay est un livre de souvenirs faisant précisément état de la position centrale de l’auteur pendant ses fonctions secrétariales de 1913 à 1926. La période de la Grande Guerre couvre les pages 20 à 56 mais le reste de l’ouvrage traite de ses conséquences. Il gère par exemple la liaison avec le Ministère de la Guerre et dit : « …vécus dès lors heure par heure les douloureux événements dont on dissimulait le développement au public » (page 21). Après avoir mis sa famille à l’abri à Arcachon, chez l’une des sœurs de sa femme, et suit quant à lui le gouvernement à Bordeaux. Sa vision, de l’intérieur, de la grande machine qui gère le conflit, est très éclairante comme parfois vertigineuse. Ses pages sur Paris vivant l’Armistice sont vivantes et émouvantes. À l’issue, il faut gérer la paix, la dissolution des empires, le tracé des nouvelles frontières et la signature des multiples traitées qui vont s’étaler jusqu’à celui de Locarno en décembre 1925. Sur ces points, Laroche décrit les mécanismes, les enjeux mais aussi les arrière-cours et les personnalités de tous les politiques qu’il a eu à côtoyer. Pour la période 1914-1918, il n’a pas à connaître l’ensemble des dossiers qui composent la gestion du conflit tant dans le milieu politique que militaire mais il est éclairant sur certains dossiers qu’il a à traiter ; il faut ainsi se reporter à l’ensemble des sous-chapitres contenus dans les 14 chapitres qu’il reporte sur la période. L’ouvrage est également très précis sur la description et le caractère des grands hommes de la période, certes de Briand comme de Poincaré, qu’il a reportés dès le titre, mais d’une foultitude de contemporains avec lesquels il a des liens plus ou moins étroits. Longtemps affecté en Italie, l’ouvrage est intéressant sur les liens avec ce pays, notamment pour le faire basculer dans le camp des Alliés. Il y a donc un tropisme italien compréhensible dans le témoignage. Dans les pages finales de son récit, Jules Laroche, fait lui-même le bilan de la période qu’il livre au public. Il dit : « Mes longues années de labeur au Quai d’Orsay avaient été marquées pour moi par la diversité de ma tâche autant que par son intérêt et avaient accru mon expérience professionnelle » (…) À Paris, j’appris à connaître l’autre aspect de l’action diplomatique, à discerner mieux l’enchevêtrement des problèmes, leurs répercussions réciproques, et aussi l’influence de la politique intérieure et de l’impératif parlementaire sur la façon d’envisager les événements extérieurs. (…) Pendant cette période, j’avais pu suivre de près la conduite d’une grande guerre et mesurer les difficultés internes d’une coalition. Appelé à participer au règlement territorial le plus vaste depuis le Congrès de Vienne, j’avais vu la divergence des conceptions, la rivalité des ambitions, non moins que le heurt des personnalités, désagréger l’union des vainqueurs. La conséquence la plus grave en fut sans doute le repli des Etats-Unis, qui se désintéressèrent de l’exécution d’une paix qui portait si fortement la marque de leur influence » (p. 229).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
P. 10 : Il apprend l’écriture diplomatique
17 : Coïncidence des auberges tenues par des allemands à proximité de forts d’arrêt. Elaboration d’un projet de Loi restreignant les achats de propriétés et l’exercice de certaines professions par des étrangers dans les département frontières
20 : Après la mobilisation : « Rien n’avait été prévu pour maintenir l’efficacité de notre action diplomatique »
: « Quand la nécessité de combler les vides s’imposa, on eut recours à des auxiliaires dénués de compétence, mais pourvus d’appuis politiques, qui furent plus nuisibles qu’utiles »
23 : Brassard Tricolore A.E. (pour Affaires Etrangères) car les fonctionnaires étaient traités d’embusqués
25 : Crise du 75
: Peur du GQG que leur chiffrement ne fût pas sûr
: Spectre de la dictature en France du fait du rapprochement Doumer/Galliéni
: Retour à Paris le 8 décembre 1914
27 : Giolitti, chantre du neutralisme italien
44 : Bon résumé de la CRB, Hoover, comment Laroche s’en occupe et ce que cela implique. Le Comité des mandataires des villes envahies du Nord présidé par le sénateur Trystram (fin 46) (vap 90)
48 : Relation avec Monaco et problème de succession
52 : Sur l’action des maisons de champagne s’opposant à l’évacuation de Reims du fait de la valeur de leur stock, de plusieurs centaines de millions de francs, et coût de la défense négociée par la consommation par les coloniaux qui ont défendu la ville
53 : Paris au 14 juillet 1918
54 : Projet par des membres du Comité Allié de Versailles de réserver l’occupation de l’Alsace-Lorraine aux Américains à l’exclusion des troupes françaises
57 : Sur la retraite en novembre 1918 de 25 000 allemands en passant par la Hollande, qui ne réagit pas
: Sur les Alliés peu préparés à la victoire, trop concentrés à l’obtenir militairement
65 : Sur le choix de la langue officielle de la conférence de la paix, finalement franco-anglaise. Comment elle s’organise
68 : Sur le problème des carburants entre la Royal Dutch des Anglais et des Français et la Standart Oil des Américains
77 : Wilson à 4 pattes au-dessus d’une carte
80 : Attentat contre Clemenceau
87 : Traités non ratifiés mais ententes quand même entre les parties
90 : Voyage au Chemin des Dames en 1919 (vap 115 dans le Noyonnais), description et colère de Poland, directeur de la CRB dans le Nord et en Belgique, devant les destructions
91 : Wilson a refusé de visiter les régions dévastées « pour que des considérations sentimentales ne vinssent pas influencer son jugement »
93 : Sur l’arrivée des signataires allemands au Traité de Versailles : « Je ne pus me défendre de plaindre ces hommes qui, n’appartenant pas au clan du Kaiser, venaient entériner la défaite de leur pays »
98 : Sur le comportement du Tigre, rogue et impoli
105 : Sur l’article 435 avec la Suisse, sur le maintien problématique des zones franches
122 : « Quiconque n’est pas incurablement atteint de la maladie de la victoire, doit reconnaître que ce n’est pas avec des « diktats » qu’on avance les choses »
: Problème allégué par les Allemands de l’occupation de la Ruhr par les noirs
162 : Salut romain (repris par les nazis), Mussolini pas pris au sérieux
189 : « Il faut que la France paraisse pauvre pour bien montrer notre droit aux réparations ! »
Yann Prouillet, septembre 2025
Lec’hvien, Michel (1890 – 1974)
War hent ar gêr Sur la route de la maison
Hen ivez, pell a oa, a verve gant ar c’hoant da lâret, ha hepdale, kenavo d’ar Boched.
Lui aussi, depuis longtemps, bouillait du désir de dire sans délai kénavo aux Allemands.
1. Le témoin
À la mobilisation, Michel Lec’hvien est cultivateur dans la ferme de son père à Kermestr (Ploubazlanec, Côtes d’Armor). Il rejoint à 24 ans le 3e régiment d’artillerie à pied de Cherbourg, puis est transporté à Maubeuge pour renforcer l’artillerie de l’ensemble fortifié : il est fait prisonnier le 8 septembre 1914 lors de la chute de la place. Détenu dans différents camps, il réussit en avril 1916 à s’évader avec deux camarades et à atteindre la frontière hollandaise. Réincorporé au 3e RAP, il fait de l’instruction à Cherbourg jusqu’à son retour volontaire en ligne, avec le 105e régiment d’artillerie lourde en janvier 1918. Démobilisé en août 1919, il reprend la ferme familiale en 1921.
2. Le témoignage
War hent ar gêr – Sur la route de la maison –, sous-titré La Grande Guerre banale et exceptionnelle de Michel Lec’hvien, est un ensemble de textes publié aux éditions À l’ombre des mots en 2018 (275 pages). Le recueil a été publié à l’initiative de Marie-Claire Morin, éditrice fondatrice d’À l’ombre des mots et petite-fille de M. Lec’hvien. L’ouvrage propose deux versions du récit, avec des commentaires et explications de Yann Lagadec et Hervé Le Goff.
a. Le texte en breton est assez court, puisque ce récit d’évasion occupe 22 pages (p. 41 à p.62). War hent ar gêr est un petit opuscule paru en 1929, qui reprend avec quelques modifications mineures le texte original paru en 1928 dans l’hebdomadaire Breiz. Ce récit est signé « eul laboureur » (le laboureur), dans un hebdomadaire régionaliste modeste par son tirage mais influent par sa diffusion dans les milieux bretonnants, il veut promouvoir la langue et la culture bretonne, son autre but étant moral et religieux, voire catéchistique (note 13 p. 31, H. Le Goff).
b. Suit une traduction du récit de 1929 (p. 65 à p. 95), effectuée vers 1995 par Job Lec’hvien, prêtre et neveu de Michel, à usage familial. Cette traduction a été revue par Jef Philippe.
c. Viennent ensuite les Souvenirs d’un ancien combattant, la seconde version du témoin Michel Lec’hvien, rédigée cette fois en français vers 1970 ; ce récit a une taille plus conséquente (p. 97 à p. 153).
d. Hervé Le Goff propose un intéressant décryptage culturaliste (p. 15 à 38) et Yann Lagadec un appareil d’explication et de mise en perspective historique (p. 155 à 269).
3. Analyse
a. Le récit d’origine en breton
Dans le registre « témoignage Grande Guerre », outre la rare relation d’une évasion réussie – nous ne manquons pas de récits de captivité –, l’intérêt est ici la forme de cette narration. Il s’agit d’un texte en langue bretonne, très marqué par l’oralité, et pouvant ainsi être destiné à un jeune lectorat ; la publication dans la revue est accompagnée de quelques gravures d’illustration, la revue Breiz se voulant aussi un biais pour familiariser avec la lecture du breton ceux qui n’en étaient pas familiers (A. Le Goff).
b. Le texte d’origine traduit
On trouve ici les figures de style du conte, avec une invitation à l’écoute, et, scandant le récit, des comparaisons imagées, de la sagesse populaire, des proverbes et des dictons familiaux. Il s’agit vraiment d’un témoignage historique, nous dit le locuteur au début, car (p. 64) « ce n’est pas un conte [au sens de : ce n’est pas une fiction], ce que je vais écrire, mais une histoire vécue et véridique d’un bout à l’autre. » On peut prendre (avec autorisation de citation) cinq exemples pour exemplifier cette façon d’écrire ;
– p. 71 les prisonniers doivent abattre des arbres « Aucun salaire ne nous était donné pour notre peine. Je me fatiguai. « Si vous faites le mouton, disaient les anciens, vous serez tondus » De crainte d’être tondu trop court, je demandai à revenir à Sennelager. »
– p. 74 il se décide à préparer son évasion :
« Homme sage, avant d’entreprendre
Prends conseil tout d’abord. »
– pour fuir, il s’associe avec deux camarades, mais pas davantage (p. 75) : « Nous étions maintenant assez de trois. Il ne fallait pas trop publier le désir qui était dans notre esprit. Car, comme disent les Léonards :
La poule perd son œuf
Qui chante trop après pondre. »
– arrive le jour favorable (3 avril 1916) : « le vent était bon, il était temps de vanner. »
– puis pour clore cette première partie de l’évasion (p. 80) :
« Kenavo, ferme de Kamen,
Kenavo, gardien inattentif !
Demain, devant ton maître,
Tu feras une danse sans sonneurs ! »
Alain Le Goff précise que le frère de l’auteur, l’abbé Pierre-Marie Lec’hvien, un des principaux animateurs de la revue Breiz, a fait ajouter dans livret de 1929, avec l’accord de son frère, la phrase prosélyte finale (réussite totale de l’entreprise, fin du récit): « Le lendemain, dimanche des Rameaux, avec mon père (…) j’étais dans mon église paroissiale à la grand’messe, remerciant le Seigneur Dieu, la glorieuse Vierge Marie et Madame Sainte Anne. »
c. Souvenirs d’un ancien combattant
En 1970, Michel Lec’hvien réécrit en français une nouvelle relation de son épopée (terme impropre car – en breton comme en français – le propos est très sobre). La trame est identique, mais l’ensemble est bien plus détaillé ; ainsi, la période qui va de la mobilisation à la capture à Maubeuge occupe une page en 1929 et cinq dans le récit personnel et non publié de 1970. Le style est factuel, descriptif et exempt de toute l’oralité du texte d’origine. On peut constater que les éléments centraux sont à peu près identiques, mais le temps ayant fait son œuvre, la faim ou la brutalité des Allemands sont atténuées dans le second récit : (p. 110) « Des colis arrivaient de France, de nos familles, ce qui nous permettait de tenir sans trop de mal. » L’évasion devient possible parce que l’auteur va travailler à l’extérieur dans des fermes, et il signale y avoir été bien traité. De même il est intéressant de constater qu’en breton (1928 et 1929), si l’auteur utilise « an Alamaned » (les Allemands) et « soudarded an Alamagn » (les soldats allemands), il cite à plusieurs reprises « ar Boched » (les Boches) : ce sobriquet méprisant a disparu sous le trait de l’auteur en 1970, de même que dans la traduction du texte breton par Job Lec’hien en 1995, on voit ici qu’avec le temps, la Mémoire prend le relais de l’Histoire, en arrondissant les aspérités.
La préparation de l’évasion est minutieuse, et M. Lec’hvien explique comment il a trouvé des conseils avant de se lancer dans ces 75 km à vol d’oiseau qui le séparaient de la frontière (4 jours de marche de nuit, p. 113) « Ceux-là qui étaient repris, se voyaient les vêtements marqués. Habituellement sur la manche de la veste-capote, était cousu un tissu à couleur vive, rouge écarlate, vert cru, bleu, jaune. Cette façon de procéder était de la part des Allemands une lourde erreur. En effet, qui pouvait fournir des renseignements précis à ceux-là qui songeaient à s’évader, sinon ces évadés repris ? Ils pouvaient être considérés à juste titre comme des « professeurs d’évasion ». » Ils sont chaleureusement accueillis par les Hollandais, avec pain blanc à profusion et gestes amicaux (p. 131) : « L’un d’eux nous photographia parmi un groupe de soldats [hollandais] et, nous demandant nos adresses, nous promit de nous envoyer à chacun une photo, il tint parole. » Il n’a pas été possible de retrouver cette photographie en 2016.
d. contribution savante
Yann Lagadec apporte des éclairages sur ce témoignage ; il reproduit l’article de L’Éclaireur du Finistère (p. 158) qui évoque l’évasion réussie, et qui insiste sur les informations rapportées par les fuyards sur la situation en Allemagne (p. 169, exemplaire du 29 avril 1916) : « La garde des camps est confiée à des territoriaux et à des réformés qui sont nourris comme les prisonniers. C’est une preuve qu’en dépit des fanfaronnades du chancelier, les vivres n’abondent pas en Allemagne. ». Il croise aussi le texte de M. Lec’hvien avec des récits de prisonniers et d’évadés bretons et note par exemple que sur le plan matériel, l’installation de l’électricité dans les baraquements (avec interrupteur extérieur) impressionne les prisonniers (p. 203 note 70) : « Pour ces ruraux bretons, le fait d’être éclairés à l’électricité n’a rien de banal. »
Les motivations profondes des trois évadés sont difficiles à éclairer, mais c’est revoir les siens et la Bretagne qui domine ; la volonté de reprendre le combat n’est pas évoquée et Y. Lagadec n’a trouvé pour cette motivation qu’un seul cas de figure avec un interné civil qui n’avait jamais vu le front (p. 222) ; il se dit en désaccord avec Stéphane-Audouin-Rouzeau et Annette Becker (« Oubliés de la Grande Guerre, 1998, p. 126 et 127, et « 14-18 Retrouver la Guerre », 2000, p. 119), qui proposent la généralisation selon laquelle les prisonniers brûlent de s’évader pour des raisons patriotiques et pour poursuivre le combat (p. 119) « le désir logique du capitaine de Gaulle comme de celui de l’immense majorité des prisonniers est l’évasion. Car elle est espoir de retour au cœur de la guerre (…). » Selon Y. Lagadec, (p. 222, note 99) cette démonstration « ne parvient pas à convaincre à la lecture des témoignages de la plupart des évadés étudiés. »
Donc un témoignage intéressant, inscrit dans l’histoire de l’évolution rapide de la Bretagne des années Soixante. La force du témoignage de Michel Lech’vien tient dans sa concision, sa modestie-même (Y. Lagadec, p. 268), et, pour le récit en breton, dans sa forme proche du style des conteurs itinérants pour publics adultes, encore nombreux en 1914. Pierre-Jakez Hélias (« Le quêteur de mémoire », 1990, p. 267) montre que ces conteurs accueillis aux veillées avant 1914 ont progressivement été marginalisés par l’alphabétisation des publics, puis entre-deux guerres par l’éclairage électrique et la T.S.F., le poste de télévision venant achever ce processus de disparition. Peut-être Michel Lec’hvien a-t-il voulu proposer en 1970 un récit en français plus dans l’air du temps ? Si celui-ci est plus complet, on lui préférera quand même le court récit d’origine, qui mélange irruption de la modernité de la Grande Guerre et univers culturel bien plus ancien.
Vincent Suard, septembre 2025
Bourrillon, Henri (1891-1945)
Samuel Caldier, responsable des archives municipales de Mende a publié un ouvrage sur Henri Bourrillon (Maire de Mende et chef de la Résistance en Lozère mort en déportation) : Henri Bourrillon (1891-1945), L’ours de granit, Médiathèque de Mende, 2025, 243 p. Si l’auteur évoque longuement l’action publique de cette personnalité locale et son combat de l’ombre face à l’occupant nazi, il consacre également deux chapitres inédits sur son parcours militaire durant la Grande Guerre puis sur son militantisme au sein des associations d’anciens combattants.
Un poilu dans la Grande guerre (p 47-58)
Né dans une famille de notable lozérien profondément acquise aux valeurs de la Troisième République, Henri Bourrillon n’a aucune vocation pour suivre une carrière militaire. Etant de la classe 1911, il termine ses études en droit en 1913 puis effectue son service militaire dans la subdivision de Clermont-Ferrand. Le 11 août 1914, il est incorporé à la 1ère compagnie du 105ème RI. Simple 2ème classe au début du conflit, il obtient le grade de sous-lieutenant à la fin de la guerre. Son courage et son énergie expliquent cette promotion. Le 30 avril 1916, au cœur de la bataille de Verdun, il obtient une première citation pour avoir assuré la liaison entre le chef de bataillon et le commandant de la brigade sous le feu de l’ennemi. L’année suivante, au petit matin du 20 août, il est grièvement blessé par balle lors d’une attaque menée contre les lignes allemandes dans cette même région d’Avocourt. Encore convalescent, il reçoit une deuxième citation avec croix de guerre (étoile dorée) ainsi que la distinction de chevalier de la Légion d’Honneur. Il est démobilisé le 24 août 1919.
Durant ces années de guerre, Henri Bourrillon écrit quelques courriers à ses proches [aujourd’hui conservés par sa famille]. Certains se distinguent par leur contenu et leur contexte. Dans une lettre écrite en 1917, il décrit l’attaque entrainant sa blessure. Non seulement ce courrier témoigne de la violence des combats mais il décrit également les différentes étapes de prise en charge d’un blessé sur le front ainsi que les difficultés et parfois l’impréparation d’une partie du personnel médical face aux contraintes et aléas de la guerre. Deux autres cartes postales sont envoyées à son père en novembre-décembre 1918. Il l’informe qu’il se rend à Paris pour assister au passage du couple royal de Belgique dans la capitale. Il envisage aussi de se rendre dans les régions dans lesquelles il a combattu : Oise et Somme. Henri Bourrillon a besoin de se souvenir et de réfléchir sur les conséquences de cette boucherie humaine qui caractérise ce conflit majeur.
Un militant des anciens combattants (p 61-79)
Après sa démobilisation, Henri Bourrillon prend la présidence de l’Association mendoise des Anciens Combattants et Mobilisés de guerre puis de la Fédération lozérienne des A.C. Il participe également à la rédaction de quelques articles dans le journal Le Poilu lozérien. Mais la réflexion et la volonté d’agir d’Henri Bourrillon ne s’arrêtent pas là. L’originalité de son militantisme est d’être un des pionniers de la Semaine du Combattant créée en 1922. Ce mouvement, né en province, entend échapper à « la domination parisienne » et veut unir toutes les associations françaises (rurales et urbaines) pour être force de proposition et élaborer un socle commun de revendications. En 1923, lors du congrès de Tours, Henri Bourrillon s’exprime en ces termes :
« Je me demande aujourd’hui si le mouvement généreux qui nous fit nous grouper à notre retour des armées ne se serait pas éteint bientôt sans l’action de la « Semaine » et si nous n’aurions pas eu à enregistrer la faillite définitive de nos associations, de celles du moins qui prétendent à autre chose qu’à l’organisation d’un banquet annuel.
En appelant toutes les associations de France, même les plus petites sections de village, à participer à ses travaux et à étudier en commun ces questions d’intérêt majeur qui sont portées à l’ordre du jour du congrès, la « Semaine » marquera le réveil de beaucoup de nos groupements qui ne chercheront plus leur raison d’être puisque cette grande coalition dans le travail aboutira à la rédaction du cahier minimum de nos revendications et, pour le triomphe de celles-ci à l’indispensable conjonction de nos efforts. »
A la fin des années 20, de nombreuses avancées sont réalisées (carte d’ancien combattant, retraite, journée officielle du 11 novembre, etc.). Henri Bourrillon voit ses efforts récompensés par la venue du ministre de la Guerre André Maginot à Mende lors du congrès national de la Fédération des Associations françaises des Mutilés, Réformés, Anciens Combattants, Veuves, Orphelins et Ascendants qui se tient du 29 au 31 mai 1931.
En plus de son engagement pour donner une plus grande place aux anciens combattants dans la société française notamment pour encadrer la jeunesse, Henri Bourrillon n’a de cesse de militer pour la paix. Tous ses discours publics, qu’ils soient associatifs ou politiques, mettent en avant son pacifisme. Malgré tout, il sera à nouveau mobilisé en 1939 comme capitaine de réserve sur la place de Lavaur dans le Tarn puis il mènera un nouveau combat de l’ombre au sein de la Résistance lozérienne.
Samuel Caldier, juillet 2025
Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943)
Pierre-Barthélemy Gheusi, Cinquante ans de Paris. Mémoires d’un témoin, (1889 –1938), Paris, Plon, 1939, 505 pages
Résumé de l’ouvrage :
Pierre-Barthélemy Gheusi, journaliste, écrivain et directeur de théâtre à Paris, livre, de 1889 à 1938, ses souvenirs déroulés au fil d’une vie dense et à multifacette dans les domaines du journalisme (il est rédacteur au Figaro), de la musique (il est directeur de l’Opéra-Comique), de la politique et même de la Grande Guerre, occupant, en tant que capitaine, la fonction d’officier d’ordonnance de Galliéni. Ses souvenirs sont distillés dans autant de tableaux chronologiés dans les petits et les grands épisodes de sa vie omnisciente. L’ouvrage se décompose ainsi en trois tiers inégaux ; l’avant-guerre, la Grande Guerre et un après-guerre qui se termine peu avant la survenance de la Deuxième Guerre mondiale.
Eléments biographiques :
Pierre-Barthélemy Gheusi est né à Toulouse, le 21 novembre 1865, de Joseph Antoine, alors employé de banque, cousin de Gambetta, et de Hélène Mimard, sans profession. Il étudie au collège de Castres, où il rencontre Jean Jaurès, puis fait des études de droit à Toulouse. Dès 1887, il collabore à une revue (Le Décadent) et se frotte un temps à la politique. Il devient chef de cabinet du sous-préfet de Reims puis, obtenant une mutation à Paris, demeurant rue de Miroménil puis rue Saint-Florentin, il collabore avec le Gouvernement. Il fait ensuite plusieurs voyages à l’étranger, avec des rôles divers, dont diplomatiques. Il occupe diverses fonctions, comme officier de l’Instruction publique, chargé de mission en Syrie et en Palestine, membre de la commission du Théâtre Antique d’Orange, membre de la commission d’admission et d’installation de l’exposition de 1900, membre de la Société des Auteurs Dramatiques, de la Société des Gens de Lettres, du Comité des Expositions à l’Étranger ou de l’Association des Journalistes Parisiens. Il est ancien chef de cabinet du préfet et du secrétaire général de la Seine, attaché aux Ministères de l’Intérieur et des Travaux Publics. Enfin, il est, pendant la Guerre, officier à l’état-major de l’artillerie territoriale de Paris (cf. Base Léonore). Il épouse en 1894 Adrienne Willems, avec laquelle il a plusieurs enfants, dont un fils, Raymond, artilleur, et Robert, aviateur. Directeur de la Nouvelle Revue, il est promu directeur-administrateur du Figaro après-guerre, avant d’être congédié en 1932. Directeur également de l’Opéra-Comique, il en est renvoyé en 1918 par Clemenceau puis, rétabli dans ses fonctions, contraint à la démission en 1936. Il aura écrit dans sa vie 23 œuvres musicales, œuvres dramatiques ou livrets d’opéra, 12 romans, 8 livres d’Histoire et divers autres livres (source Wikipédia). Il meurt à Paris, à son domicile du 4 rue de Florentin, dans le 1er arrondissement, le 30 janvier 1943.
Commentaire sur l’ouvrage :
L’ouvrage, dense, fouillé et multifacette, est un document incontournable sur la vie politique, artistique, mondaine et militaire (pour la Grande Guerre) parisienne pendant toute la 3ème République. Ami de Jaurès, zélateur de Gambetta (par lien familial), et sectateur-réhabilitateur universel de Galliéni, dont il est l’officier d’ordonnance, et sur lequel il a écrit plusieurs livres, Gheusi est un personnage incontournable. Son livre, qui suit un fil chronologique, tout en reportant peu de dates, en est donc difficile à appréhender dans toutes ses acceptions et subtilités, sauf à être un contemporain du même milieu social ou très fin connaisseur de la période. Œuvrant dans de nombreux domaines liés à ses fonctions et la centralité de ses rôles, il construit son ouvrage par tableaux dans une foultitude de domaines, à Paris, en France, comme à l’étranger. Divisé en quatre grands chapitres (Souvenirs de jeunesse – Avant la guerre – La Guerre et Après la guerre), c’est bien entendu le chapitre consacré à la guerre (pages 223 à 387), et notamment par sa position centrale, en 1914, dans l’entourage de Galliéni, qui forme le cœur de l’intérêt de ces mémoires. Il est donc heureux qu’un index paginé des noms cités soit présent en fin d’ouvrage. Il convient donc de s’y reporter pour toute analyse des données que ce livre contient. Bien entendu, quelque peu auto-promotionnel comme autocentré, le contenu de cet ouvrage demande à être confronté aux témoignages politiques et artistiques de mêmes niveau et ampleur. Gheusi est assez direct, décrivant opportunément le plus souvent les milieux qu’il côtoie, y compris montrant les intellectuels habillés en uniforme pendant la Guerre. Le livre est mâtiné, çà et là, de phrases centrales et frappées du coin du bon sens voire même de descriptions à contre-courant. Ainsi par exemple, il n’est pas tendre sur les « m’as-tu-vue-en-infirmière », assimilant les bénévoles sanitaires mondaines en demi-mondaines (page 228). Tout au long de l’ouvrage, il milite pour Gambetta et Galliéni, martelant bien entendu que ce dernier a sauvé Paris. Il donne également quelques éléments militaires intéressants, ainsi bien sûr que des éléments d’ambiance sur le Paris de la Grande Guerre, dans de nombreux domaines, civils comme militaires, et mondains comme politiques. L’ouvrage est donc bien celui d’un témoin, privilégié par sa position comme par sa centralité. Certes, il parisiannise tout, quitte à faire des erreurs factuelles, comme « l’affaire du Zeppelin Z-VIII – L22 » abattu au-dessus des Vosges meurthe-et-mosellanes, qui selon son témoignage menaçait Paris au point de lui faire passer une nuit d’« insomnie de fièvre et d’attente » (page 232). Sa vision d’une Paris menacée, occasionnant le départ du gouvernement, instructive, notamment pour l’ambiance politique pendant les quatre mois de son absence. Il évoque les « réfugiés en province » invités à partir, les députés « paniquards », ceux qui se plaçaient, pour fuir, sur la liste des otages allemands quand ces derniers seraient entrés dans Paris, évoquant une véritable « phrase-médaille » (page 239), etc. Il décrit l’ambiance militaire des tirs contre avions et de leurs risques pour les parisiens, et rapporte également quelques rumeurs de bourrage de crâne, comme les notables de Senlis assassinés et enterrés les pieds en l’air (page 240). Mais cette partie de son récit, dans les heures pénibles précédant la bataille de La Marne et son issue victorieuse, est intéressante. Témoin privilégié, il rapporte faits et ambiance, jusqu’à affirmer : « Pour donner une idée de l’autorité indiscuté de Galliéni, dès ce jour [3 septembre 1914], dans tous les milieux, rappelons un fait sans précédent en une cité menacée des pires désordres par l’approche de l’ennemi. Pendant quatre mois, malgré la réduction quasi-totale de toute police administrative, dispersée désormais et employée ailleurs, pas un crime et pas un délit n’ont été commis, fût-ce dans une des innombrables maisons abandonnées de la capitale – pas même un vol à la tire. Le « jusqu’au bout ! » du Chef, devenu en une nuit l’idole et l’égide de Paris, a rassuré les bons et terrifié les autres » (pages 241 et 242). Il ajoute plus loin, relativement au départ pour Bordeaux du gouvernement : « Le Ministre de la Guerre, une heure avant de rallier le train furtif, mais gouvernemental, qui allait gagner Bordeaux sans être sûr – autre légende que nous laissions circuler malgré son ânerie – de ne pas être enlevé, vers Villeneuve-Saint-Georges, par les uhlans de Von Kluck (…) » (page 243). Bien que n’ayant pas lui-même suivi les exilés bordelais, il y rapporte une atmosphère empoisonnée (page 276). Évoquant les possibles d’une invasion allemande de Paris, il donne détails intéressants sur la rédaction de la proclamation de Galliéni aux parisiens, où elle a été imprimée, ce que voulait dire son « jusqu’au bout » et conclut : « Nous avions, à tous les degrés de la hiérarchie, la bravoure facile de l’indifférence et de la fatalité » (page 243). Il fait même quelques excursions au front, dont il dresse des tableaux parfois surréalistes. Là encore, il atteste : « Nous avons vécu les journées suivantes dans le sillage de la retraite ennemie. Derrière eux, les Allemands on laissé, de chaque côté de la route, des amoncellements de bouteilles vides. Elles attestent que l’orgie est venue au secours du sol envahi et que les vins du terroir ont, eux aussi, contribué à démoraliser l’envahisseur. Mais il laisse après lui la tenace puanteur de ses excès stercoraires, les profanations sacrilèges de son luthéranisme congénital, la nausée de ses atrocités et de ses crimes » (page 255). Sensible à l’ambiance d’alors du champ de bataille, Gheusi rapporte quelques récits d’espionnite, tel celui du pont d’Epluches, qui n’était que prostatique ! (page 267).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Il convient de se reporter à la table des chapitres (4 majeurs et 12, 16, 15 et 17 sous-chapitres) pour hiérarchiser l’ouvrage, ainsi qu’à l’index des patronymes.
Page 197 : Publie dans La Nouvelle Revue, « deux ans et demie avant qu’elle éclatât » un article sur la guerre inévitable, lequel lui vaut des reproches du Quai d’Orsay
224 : En voyage à Berlin six semaines avant la guerre, et dit : « Toute l’Allemagne pue la guerre »
: Camp de concentration en Bretagne (vap 248 pour y interner l’autrichien Max Nordau, qui considère la France « comme le peuple le plus pourri, le plus faraud, le plus gangrené de toutes les tares latines du vieux monde »)
: Sur les Allemands, il dit : « Ce peuple absorbe la musique comme il absorbe de la bière et de la saucisse. Son avidité musicale se satisfait d’ailleurs de n’importe quels sons, de même que sa gloutonnerie se satisfait de n’importe quelle nourriture »
225 : Mort de la femme de Galliéni, qui le plonge dans la guerre corps et âme
232 : Antiallemand, il dit : « Il ne suffira plus, maintenant, de châtier l’Allemagne ; il faut aussi la déshonorer devant le monde »
239 : Tirs contre avions par les Écossais (vap 240 sur les risques encourus et le tireur d’élite de l’Opéra-Comique)
240 : Maire, M. Eugène Odent, et notables de Senlis fusillés et enterrés les pieds en l’air
242 « Train furtif » gouvernemental pour Bordeaux
250 : Sur l’épisode des Taxis de La Marne
252 : Abattage des chiens errants et achèvement des chevaux, puis leur enterrement par des zouaves et des sapeurs de Paris, après La Marne
255 : Bouteilles vides de la retraite allemande au bord des routes, orgies contributrices à la défaite allemande
255 : Effets de 75
260 : Officiers allemands fuyards exécutés par des officiers allemands
: Sur des dormeurs qui sont en fait des soldats morts !
: Réservistes angevins modèles de terrassiers par leurs tranchées paysannes
274 : Contrôle télégraphique et ses surréalismes pour l’affaire Louis-Dreyfus (fin 283), qui rappelle que l’espionnite, multiforme, ne concernait pas que la zone du front
279 : Ordre en blanc
290 : Sur le retour du gouvernement : « Le Gouvernement rentre dans Paris comme il en est sorti, avec une discrétion qui ne comporte ni tambours, ni trompettes, en sorte que la population ne se sera guère plus aperçue du retour des ministres que de leur départ… »
310 : Spectacle des zeppelins pour les parisiens
316 : Crise des 75
344 : Il adjective tous les ministres (le 4 février 1916)
353 : Chiffres sur l’Opéra-Comique
358 : Textilose pour les décors
363 : Voit Mussolini en 1917
369 : 74 voyages d’artistes dans les cantonnements de repos du front (en 1917)
372 : Vue de Mata-Hari (vap 373 son exécution, par une seule balle l’ayant atteinte !)
Yann Prouillet, 5 septembre 2025
Tatin, Louis (1863-1916)
TATIN, Louis, Edmond, Adhémar (1863-1916)
1. Le témoin.
TATIN, Louis Edmond, Adhémar, est né le 25 novembre 1863 à Saint Michel-l’Écluse-et-Léparon en Dordogne, canton de Saint-Aulaye. Dès 1884, il s’engage volontairement dans l’armée pour une durée de cinq ans au 57ème régiment d’infanterie en garnison à Bordeaux. La carrière militaire semble lui convenir puisqu’ il entre le 17 avril 1888 à l’École militaire d’infanterie, devient élève sous-officier, puis sous-lieutenant en sortant 32e sur 450 élèves et est affecté le 18 mars 1889 au 63ème RI. en garnison à Limoges-Bénédictins. Là, il gravit les différents grades, lieutenant (15 octobre 1889) lieutenant porte-drapeau (28 août 1894). Sa carrière se poursuit très brièvement à Caen au 36ème R.I. en qualité de capitaine, il y arrive le 3 novembre 1900 et dès le 26 novembre 1900 il est de retour à Limoges au 78ème RI. Cette carrière militaire est couronnée assez rapidement par la Légion d’honneur, le capitaine Louis Tatin est fait chevalier le 30 décembre 1900, à 37 ans. En août 1914, Louis Tatin est capitaine-adjoint, il apparaît au troisième rang dans l’ordre hiérarchique après le colonel Arlabosse, le lieutenant-colonel de Montluisant dans l’encadrement du 78e régiment d’infanterie. Au cours de la guerre, il gagne ses galons de commandant. Chef de bataillon à titre temporaire, un décret du 28 décembre 1914 le nomme à titre définitif à compter du 25 décembre 1914. Le capitaine puis chef de bataillon Tatin, occupant la troisième place dans le commandement du régiment du 2 août 1914 au début avril 1916, prend le 7 avril 1916 le commandement du 2ème bataillon. Devenant ainsi le bataillon Tatin très durement éprouvé deux jours plus tard. Le chef de bataillon Tatin est tué le 9 avril 1916, à la Côte du Poivre. Il repose à Verdun, dans la nécropole nationale du Faubourg Pavé, dans le carré des officiers.
2. Le témoignage.
Le cahier du Chef de Bataillon Tatin a été conservé dans la bibliothèque du presbytère de Guéret (Creuse) sans que l’on ait pu déterminer de quelle façon il y était parvenu après la guerre de 1914-1918. Sa veuve, décédée en 1947, sans enfant, avait peut-être confié le cahier à un prêtre de Limoges, nommé à Guéret. Le cahier a été conservé à partir de 1971 par un adolescent devenu professeur d’histoire et de géographie. « Notes et souvenirs, 1914, 1915, 1916 », tel est le titre que l’auteur a donné à son récit présenté dans un cahier de moleskine noir, de format 17 cm x 22 cm. Sur les 136 pages que contient le cahier, seules 119 sont noircies d’une écriture très régulière qui dénote une aisance du scripteur. La mise en page du texte est très simple sur l’ensemble du cahier : les dates sont indiquées dans la marge, à chaque date ou ensemble de dates correspond un développement. Le 2 août 1914 et le 2 avril 1916 définissent les bornes du témoignage du soldat. Ce cahier n’a fait l’objet d’aucun repentir, d’aucune rature et surtout n’a pas été remanié par son auteur ; c’est un témoignage brut qui nous est ainsi proposé. Ce document est à classer dans l’ensemble des carnets et mémoires des soldats qui se sont exprimés sur la guerre telle qu’ils l’ont vécue.
3. Principaux thèmes du contenu du témoignage.
Le soldat a certainement voulu conserver le souvenir de cette guerre en fixant par écrit les différents mouvements de son régiment. Il y a bien sûr une grande concordance entre le récit de Louis Tatin et les indications contenues dans le Journal de Marche et d’Opérations du 78ème RI.
Le thème le plus intéressant réside dans la réflexion personnelle de l’officier sur la conduite de la guerre. Le capitaine, puis commandant Tatin passe rapidement de l’optimisme aux doutes. Si dans un premier temps il pense que la guerre va se dérouler comme l’Etat-major l’a prévu et que la victoire sera vite acquise, Tatin doit se rendre à l’évidence. Il comprend la dureté des engagements, le mauvais entraînement des hommes, le manque de méthode, le manque de matériel, les mauvaises décisions de l’État-major. Et, il expose ouvertement ces critiques dans son cahier.
L’autre intérêt de ce cahier est l’approche de la sensibilité de cet officier, issu de la petite bourgeoisie catholique, rurale du Sud-Ouest de la France, qui découvre la France de l’Est et du Nord et exprime beaucoup d’empathie vis-à-vis de ses concitoyens civils, victimes des bombardements, et des exactions des deux belligérants.
Son regard porté sur les hommes est émouvant car dépourvu de jugement, sauf sur des aspects qui heurtent la morale de son milieu, l’alcoolisme et la prostitution.
Malgré les critiques exprimées à l’égard des officiers supérieurs qui conduisent la guerre au niveau de la division ou au plus haut niveau de l’État-major, rien n’affecte sa loyauté et son patriotisme vis-à-vis de sa hiérarchie et de son engagement de soldat faisant son devoir jusqu’au bout.
Paul Busuttil, 03 septembre 2025