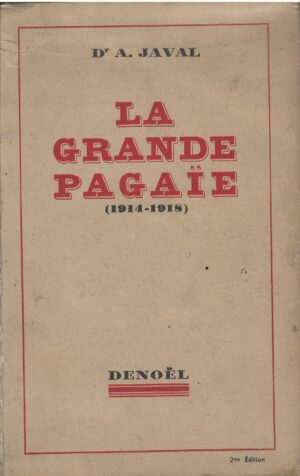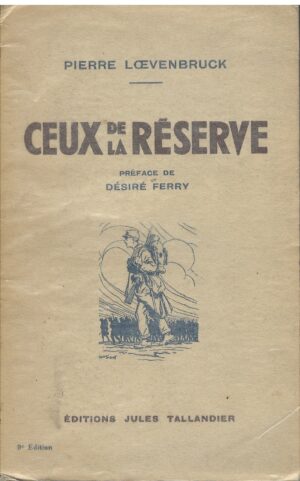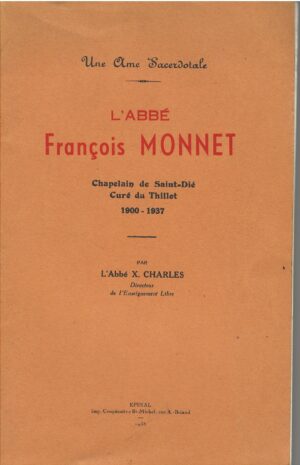Javal, Adolphe, La grande pagaïe, Denoël, 1937, 329 p.
Résumé de l’ouvrage :
La feuille de route de sa mobilisation affecte le docteur Adolphe Javal à l’ambulance n°5 du 5e corps d’armée, qu’il rejoint à Fontainebleau avec 24 heures d’avance, avant même la déclaration de guerre. Se considérant plus comme un administrateur de formations sanitaires que comme un « urgentiste », la narration de sa guerre est dès lors une impressionnante suite d’anecdotes, émaillant ses nombreuses mutations, dans un monde médical du front et de l’arrière-front qui évolue lui-même au fil de la guerre. Il « collectionne » ainsi un nombre impressionnant d’affectations jusqu’à sa démobilisation en 1919, offrant un nombre tout aussi conséquent d’analyses de ces milieux divers et variés.
Eléments biographiques :
Louis Adolphe Javal est né le 11 juin 1873 à Paris (16e arrondissement). Il est le fils du célèbre docteur Emile Javal, membre de l’Académie de médecine et homme politique, et de Maria-Anna Elissen, demeurant un hôtel particulier 5 boulevard de la Tour-Maubourg. Il a deux sœurs, Alice et Jeanne et aura deux enfants (Mathilde et Sabine). Ses travaux en médecine lui font obtenir en 1904 le prix Desportes (thérapeutique médicale). Il écrit dans la presse spécialisée, teintant ses écrits de militance. Il dit : « J’étais tellement écœuré de voir pratiquer ce système, que je fis paraître dans la « Tribune Médicale » du mois de septembre 1915… » (p. 75). Passionné d’agriculture, il possède un château dans l’Yonne, à Vauluisant, ferme de 250 hectares dans laquelle il se rend fréquemment pendant la Grande Guerre, parvenant même à se faire un temps affecter dans des formations proches pour « gérer » le domaine. Son parcours pendant le conflit est particulièrement divers, avant d’être démobilisé le 24 avril 1919. Après-guerre, à plusieurs reprises, il tente une carrière politique, notamment sénatoriale, et écrit de nombreux articles médicaux et au moins deux ouvrages, le plus souvent anecdotiques, notamment sur ses relations ubuesques avec l’administration (26 références à la BNF). Juive, toute la famille (sa fille Mathilde et ses deux filles) est déportée à Auschwitz, en 1943 et 1944. Son nom est inscrit sur un cénotaphe dans le Panthéon parmi les 197 écrivains morts pour la France dans la Deuxième Guerre mondiale.
Commentaire sur l’ouvrage :
La guerre médicale d’un docteur Javal plongé dans le monde sanitaire kafkaïen à la guerre mêle empêcheur d’embusquer en rond et journal de route d’un médecin qui tient parfois plus de l’adjudant de compagnie (même si on doit lui reconnaître en ce domaine une évidente compétence). Il dit d’ailleurs lui-même préférer le rôle d’administrateur (p. 168) que du praticien d’ambulance de front. Aussi, son témoignage est une œuvre finalement très surréaliste mais de référence quant au parcours d’un médecin au sein de différences formations (hôpitaux, ambulances, fixes ou mobiles, centres sanitaires, etc.) dans les différentes phases de la Grande Guerre. Comme d’autres témoins des ambulances hippomobiles de 1914, Javal évoque un certain inemploi, voire un abandon de blessés autour de la bataille de la Marne, notamment pendant ce qu’il appelle le « circuit de la Meuse ». Il synthétise ce sentiment : « Nous parcourûmes environ 500 kilomètres pour fonctionner exactement quatre fois : c’était extrêmement peu pour s’initier à l’art de faire la guerre » (page 45). Son ouvrage, dense et très militant, fourmille, toutefois d’indications sur le milieu médical subordonné au monde militaire, récit souvent teinté de surréalisme voire de truculence.
Particulièrement critique, mais tout aussi lucide, il analyse en permanence et dénonce à chaque fois qu’il le faut, et il ne s’en prive jamais, les situations qu’il vit, dans le détail comme dans le fonctionnement général des services qu’il côtoie ou subit le plus souvent. Resté civil même sous l’uniforme, il ne se conformera finalement jamais à l’omnipotence parfois surréaliste du militaire. Par-delà son caractère polémique (et procédurier), l’ouvrage fourmille d’informations. Il dit : « J’estime le rendement de la main d’œuvre militaire à 25 % au maximum de celui de la main d’œuvre civile à l’heure, et à 10 % de celui de la main d’œuvre civile à la tâche » (p. 35). Il applique d’ailleurs cette sentence peu amène plus loin : « Le rendement du travail d’un militaire, se chiffre, chacun le sait, par un coefficient extrêmement bas. Le chef est désarmé pour améliorer ce rendement, puisque le travail du militaire est, en général, sans sanctions. Il faut truquer pour obtenir quelque chose » (page 245). Il n’est parfois pas moins tendre à l’endroit des fonctionnaires : « Ce petit jeune homme de dix-huit ans avait du sang de fonctionnaire dans les veines » (p. 66). Souvent, il mâtine son récit d’axiomes, de réflexions psychologiques, voire philosophiques, luttant sans cesse contre la démagogie également. Sur l’égalitarisme, il dit : « L’égalité, appliquée à l’espèce humaine, produirait ce que les critiques appellent le nivellement par le bas. Au point de vue de la guerre actuelle, ce principe a causé des désastres irréparables » (p. 94). Plus loin, il avance : « Rien ne ressemble moins en effet à la médecine militaire du temps de paix que la médecine militaire du temps de guerre et, au risque de passer pour paradoxal, j’ose dire que les médecins civils de réserve qui ne connaissent ni l’une ni l’autre et encore moins les règlements, étant exempts de tous préjugés et de toute idée préconçue, faisaient beaucoup meilleure besogne que certains médecins de l’active » (p. 96-97). Aussi, il n’hésite pas cette sentence : « … l’infirmerie est mon domaine : c’est même mon royaume » (p. 189) et en effet, il y fait régner une manière de despotisme éclairé, bien à sa main, avec parfois des luttes pied à pied contre une hiérarchie qu’il épargne rarement. Aussi il fait de son temps militaire un combat incessant contre la hiérarchie, les normes, le fonctionnarisme et l’impéritie. Analyste du quotidien et des mœurs, il explique la haine du gendarme : « C’est par l’intermédiaire de la prévôté que se faisait souvent la liaison entre l’état-major du C. A. et la troupe chargée des travaux de cantonnement, ce qui explique facilement la haine farouche du gendarme qui s’encra rapidement dans le cœur du poilu » (p. 135). L’étude de son récit permet également d’alimenter l’étude de nombreux symptômes de guerre tels la simulation, le gestion de la syphilis (autre stratégie d’évitement parfois), les contagieux, les embusqués, etc. Il aime à dire « je guéris les simulateurs et je débusque les embusqués » (page 243), sport dont il se fait le champion, notamment lors de son séjour à Fontainebleau. De même quelques épisodes cocasses, comme cet accouchement qu’il gère dans son ambulance, générant des débats tout militaires, sont représentatifs de la dichotomie militaire/civil. Il fustige souvent l’administration idiote, par exemple appliquée à la gestion des réfugiés, cas qu’il étudie de près puisqu’il en recueille, et emploie, comme des prisonniers d’ailleurs, dans son château bourguignon (cf. son chapitre sur les réfugiés p. 150 à 158). Il évoque ce qu’on peut appeler des « affaires » comme le pillage de Louppy-le-Petit, la débandade de Vauquois, les typhiques de Bar-le-Duc, estimés à 3 000, l’affaire de Joinville, l’affaire Rabier, etc. Il reporte également parfois intégralement plusieurs rapports, parfois techniques, qu’il rédige soit dans le cadre de ce qu’il pense être de bonne gestion, soit médicaux, soit comme comptes-rendus hiérarchiques, dont certains sont « gratinés » et d’une spiritualité peu militaire. Il participe ainsi à la statistique, y compris rétrospective (comme à Verdun, voir p. 232), et la paperassite qu’il dénonce à longueur d’ouvrage. Il dit : « … la capacité du chef se mesurait au volume de paperasse envoyé à ses supérieurs » (p. 237). Il résume souvent sa pensée, en forme de leitmotiv du livre : « Au début, en août 1914, c’était la pagaïe : mais en janvier 1916, c’était encore la pagaïe avec une différence cependant : le gaspillage d’argent en plus » (p. 177). Il n’est pas tendre non plus sur la classe 17, « élevés dans du coton », considérant leur « gestion » par des auxiliaires ou des territoriaux comme grotesque ! (page 182). Bien entendu, son caractère entier lui vaut jalousies (notamment quand il rentre hebdomadairement dans sa ferme de Vauluisant), inimitiés, y compris politiques (voir page 93) et plaintes, qu’il traite sérieusement sans s’en faire, et avec une certaine routine (voir p. 185). Il rapporte une punition elle-même surréaliste, à la suite de son long chapitre sur sa « question noire », celle de la « température anale » constituant « une grossière inconvenance » (p. 288). Mais en grande partie, l’ouvrage, qui se veut caustique, ne manque pas de finesse d’analyse et est écrit avec un savoureux second degré. Par exemple, pages 189-190, il dresse une liste des maladies qu’il considère comme « contagieuses » : pigritia (paresse), claudication, colique, réformite, auxiliarite (vap 319) ! Il reporte quelques « méthodes », parfois « fermes », pour lutter contre les simulateurs et les maladies arrangeantes pour les tire-au-flanc, ce qu’il appelle les « attitudes vicieuses » (il cite les coxalgies, les ankyloses ou les adhérences par exemple (p.197)). Son livre abonde ainsi en personnages cocasses, surréalistes, qui témoignent d’une réalité entre évitement du front et déviance comportementale qui touchent souvent à la psychiatrie, formant un tableau général de soldats bien loin de l’héroïsme patriotard lisible par ailleurs. Il en débusque souvent et partout, parfois dans l’auxiliaire même, osant cette sentence : « tous ces déchets humains qui ont encombré les dépôts et les formations sanitaires, n’ont produit aucun travail utile et ont coûté très cher » (p. 204-205). Plus loin, il dit même : « Le dépôt fut l’école de la paresse » (p. 226). Pourtant il doit souvent faire des choix qui lui posent cas de conscience. Il dit : « Peut-on concevoir au monde quelque chose de plus injuste que la sélection qu’un médecin doit faire entre les hommes qui auront le devoir de faire la guerre et ceux qui auront le droit de ne pas la faire ? » (p. 205). Plus loin, il dit : « Que les chiffres soient exacts ou faux, utilisables ou non, peu importe ; il y en aura des millions. La médecine militaire est bien plus occupée à compter les malades qu’à les soigner. Personne ne s’occupe d’ailleurs de savoir si la circulaire est exécutable, si les infirmiers ou les thermomètres sont en nombre suffisant. L’ordre est formel : il faut des chiffres » (p. 221 et aussi 316). De forte personnalité, il goûte peu les gens du midi… et les curés et les religieuses, qui transforment son ambulance en « séminaire » et pratiquant des conversions plus ou moins forcées (p. 241 et suivantes) ! Il n’aime pas beaucoup plus la hiérarchie, et assène : « … la pléthore des chefs superposés ne sert qu’à défaire par l’un ce que l’autre à fait » (p. 245). Il a également une analyse singulière de la question noire, qu’il expose dans le chapitre « le tutu des nègres » (page 284). L’armistice signé, qu’il vit à Coulommiers, l’ambiance est particulière. Javal fait une analyse également singulière de son environnement ; il dit par exemple, sur le traitement féminin des rapatriés : « Les dames infirmières n’étaient pas contentes de le nouvelle orientation que prenait mon établissements. Elles voulaient des blessés : elles avaient soif de sang. A la rigueur, elles auraient accepté des malades, mais laver, épouiller et nourrir ces rapatriés ne leur allait pas… » (p. 300). Ses analyses, permanentes, classent cet ouvrage tant dans le domaine du témoignage que dans celui de la réflexion analytique détaillée sur la Grande Guerre sanitaire.
Son parcours est très diversifié ; le 24 avril 1918, il écrit : « né en 1873 et ramené à la classe 1891 par mes deux enfants, j’ai fait deux ans et demi de front ». Le reprendre en totalité est fastidieux ; il est ballotté d’abord dans l’ambulance 5 puis se trouve à Bar-le-Duc le 16 juillet 1916. Le 18 mars 1917, il est nommé médecin-chef de l’ambulance 4/37. Le 1er janvier 1918, il est nommé (par le ministre) médecin-chef de service de groupement des centres (centre de réentraînement d’Estissac et de Cravant), centre de rééducation physique de Pithiviers) de la 5e région. Il monte une station-magasin à Montereau le 23 avril 1918 (« avec 600 hommes à soigner : 200 vieux territoriaux et 400 nègres qu’on avait fait venir du Maroc et qu’on payait 7 fr. 50 par jour ») (il y revient p. 238 et 289 zone d’étape), puis c’est l’hôpital d’évacuation de Vasseny, entre Reims et Soissons (2 août 1917), au camp d’Estissac (2 octobre 1917), à l’hôpital de Sens (11 février 1918), à l’hôpital mixte d’Orléans (29 août 1918), à l’hôpital 92 de Coulommiers, le 5 novembre 1918 par exemple. Après l’Armistice, arrivé à Paris (7 décembre 1918), à la direction du service de santé du gouvernement militaire qui siégeait au lycée Buffon, et avant sa démobilisation le 24 avril 1919, il est un temps affecté au Val-de-Grâce (mais dans les affres de la guerre tout juste finie, ne semble pas y avoir exercé). Le fourmillement de ses affectations a certainement à voir avec son comportement personnel comme ses pratiques professionnelles. Il conviendrait de rependre précisément le déroulé de l’ouvrage pour en retracer le parcours complet daté et localisé.
Les annexes reportées sont intéressantes, surtout la 2ème, intitulée « La Paperassite », sous-titrée (étude bactériologique, clinique et expérimentale), avec comme chapitrage I. Etude bactériologique, II. Formes cliniques, III. Marche – Durée – Terminaison. IV. Complications. V. Traitement (p. 309 à 318). L’ouvrage est enrichi d’un index des noms cités.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 16 : 16 ambulances de Corps d’Armée, 96 médecins
24 : Composition de la colonne
62 : Général Micheler assassinant un soldat car il avait perdu son fusil
64 : Autobus touristique Cook pour visiter Paris
: Chiffres des malades (dysentériques, typhiques, gelures) et blessés fin septembre 1914
66 : Comment il crée la gare sanitaire de Clermont-en-Argonne
70 : Sur la vaccination antityphoïdique
77 : Chambre de sulfuration pour l’épouillage
79 : Notice d’utilisation des douches
85 : Crée un magasin d’occasion distribuant des effets donnés après désarmement des hommes abandonnant leurs vêtements et par les apports des gendarmes (vap 87 les 1 500 fusils qu’il « recycle »)
100 : « Débandade de Vauquois », négociation avec les docteurs, menaces du commandement
103 : Cas de conseils de guerre
106 : Pieds gelés : « malades ou blessés » ? (vap 227, statistiques, 235, nombre)
109 : Vue des Garibaldiens, qui ils sont, but
123 : Douche froide contre les simulations (vap 128 sur ce sujet)
129 : Gère un accouchement, polémique tout militaire
136 : Sur les gendarmes pendus à Verdun
142 : Salvarsan contre la syphilis
154 : Gabegie de l’allocation aux chevaux de réfugiés
164 : Sur les typhiques de Bar-le-Duc
170 : Il couche dans la maison de Poincaré à Sampigny
172 : Chiffres sur la consommation de liquide (café, thé, vin) des troupiers du centre de Condé
173 : Chiffres de l’argent touché par hommes par mandats et bons de poste
178 : Rédige un billet d’hôpital qu’il considère comme efficace, aucun succès
180 : Sur la permission de 24 heures
182 : Comment il traite la classe 17 « élevés dans du coton » ! (vap 189 sur les visites médicales, 220, 222 : « Les bleus de la classe 17 ont acquis, pendant leur séjour au dépôt, un entraînement magnifique à défiler tout nus devant leur médecin : ils me paraissent aptes à partir maintenant pour les camps d’instruction militaire »)
182 : Chasse aux embusqués
195 : Février 1916, entrée des femmes de service embauchées dans les casernes
199 : Scandale de l’avancement des embusqués
200 : Repère sur les pansements pour éviter qu’ils ne soient défaits
206 : Hôpital du Tibre à Fontainebleau pour les malades mentaux
207 : « Ne jamais résoudre une difficulté, mais la repasser au voisin »
208 : Sur l’héroïsme : « Des centaines de mille hommes n’ont pas fait autre chose, pendant la guerre, que le circuit des formations sanitaires, parce que l’administration du service de santé, c’était la pagaïe, du commencement jusqu’à la fin. Et ce sont ceux-là qui crieront le plus fort après la guerre, qui porteront les chevrons, débanderont des décorations et des pensions. Les costauds sont morts et seront vite oubliés »
214 : Pansement Leclerc
215 : Registres et paperasserie (vap 237, 238, 305, 313, qualifié de « torchecul »)
216 : Orléans, hôpital Chataux pour les contagieux
: Problème administratif d’un homme ayant deux maladies contagieuses !
217 : Manques de médicaments, différences entre deux établissements (« affaire » des médecins du fort Saint-Bris)
226 : « Le règlement, c’est comme l’argent, il y en a de deux espèces : le sien et celui des autres »
: Sur l’après-guerre : « Avoir fait la guerre, la vraie guerre, avoir eu l’indépendance, la camaraderie et les initiatives du front, puis, tout à coup, retrouver les brimades de l’intérieur, les règlements de la vie de caserne, non, ce n’était pas supportable »
232 : Ecrit cagnia pour cagna
242 : Antimidi, car « l’ambulance 4/37 était une ambulance de méridionaux. On y parlait beaucoup mais on agissait peu »
: Curés syndiqués
251 : 65 médecins sans malades ni blessés à l’hôpital d’évacuation de Vasseny
257 : Description du camp d’Estissac
258 : Différence entre infirmerie (maladies légères) et hôpital
261 : 100 litres d’essence par mois pour son infirmier-chauffeur d’ambulance (vap 283, crise)
263 : Moniteurs pompiers
277 : Voit des nègres du Maroc, fainéants, nés paresseux
280 : Permission agricole
284 : Grippe espagnole
: Noirs refusant la température rectale (vap 285 polémique, et 292, conférence) et ramadan
: Soviet des nègres
285 : Rôle de l’inspecteur de la main d’œuvre
291 : Il dit, après une sanction : « il est sans exemple que, dans un rapport militaire, un chat soit appelé un chat » !
297 : Désordre gai, dû à la victoire proche, à Coulommiers le 5 novembre 1918
: Hôpital de Coulommiers
298 : Traitement des prisonniers allemands et utilisation civile de la troupe
: Paye des permissionnaires
: 7 signatures pour un sortant
299 : Armistice et ambiance : « Ces hommes avaient fait la guerre pendant si longtemps ! La guerre finie, on ne pouvait plus les tenir dans une caserne »
300 : « Ce n’était plus l’hôpital, ce fut l’auberge » et retour des prisonniers
302 : Perte de clientèle par les médecins
: 17 00 médecins mobilisés
320 : Centres de réentrainement et de rééducation et méthode de Joinville (circulaire ministérielle du 12 décembre 1917) et chiffres
Yann Prouillet, janvier 2026
Abraham Pierre (né Bloch Pierre) (1892 – 1974),
Les trois frères
1. Le témoin
Pierre Abraham est le nom de plume pris par Pierre Bloch, lorsque celui-ci se lance dans une carrière littéraire et journalistique à la fin des années Vingt. Il a été auparavant un étudiant brillant, admis à X en 1913. Mobilisé au 6e régiment d’artillerie à pied à Toul, il réussit rapidement à intégrer l’aviation d’observation et rejoint la MF 5 [Maurice Farman] en novembre 1914. Chef des observateurs à la BL 18 [Blériot] en décembre 1914, il vole ensuite presque deux ans à la C9 (lieutenant observateur- Caudron G3 et G4). En décembre 1916, il prend le commandement de la C 21 (observation) jusqu’en juillet 1918. Passé capitaine en juin 1917, il termine la guerre détaché au G.H.Q. américain. Le Maitron signale que compagnon de route en 1936, puis résistant à partir de 1941, il a été adhérent au P.C.F. après-guerre, exerçant comme journaliste, critique et écrivain, notamment comme directeur de la revue Europe.
2. Le témoignage
Pierre Abraham publie en 1971 « Les trois frères » aux Éditeurs Français Réunis (préface de Jacques Duclos, 378 pages). Il s’agit d’un ouvrage autobiographique, avec une structure composite, puisque se succèdent des chapitres sur son père, sa jeunesse, ses frères, puis sur son expérience de la Grande Guerre, dont les étapes sont entrecoupées de petits interludes évoquant la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. La Grande Guerre occupe environ 130 pages de ces souvenirs, et quelques indications montrent des fragments surtout rédigés au milieu des années Soixante. Ronald Hubscher a largement utilisé ce témoignage (dix occurrences en index des noms de personnes) dans « Les aviateurs au combat », Privat, 2016.
3. Analyse
Artilleur
Pierre Abraham décrit une expérience décevante au début de la guerre, puisque responsable d’une batterie avancée (le Tillot) de l’enceinte fortifiée de Toul, il reste en dehors des combats. Intéressé dès avant le conflit par l’aviation, sa demande de mutation comme observateur est refusée, son colonel voulant garder son officier, artilleur qualifié. En septembre 1914, il est chargé de la formation d’une nouvelle batterie de 75 qui s’établit vers Pont-à-Mousson, mais la trop grande prudence de son chef – ne pas se faire repérer – fait que bombardé, il ne tire pas. L’auteur parle de « batterie-fantôme » (p. 205), et en repli derrière Flirey, conclut après une salve unique : « tels sont les quatre coups de canon que j’aurai tirés, dans ma carrière d’officier d’artillerie au long de la Première Guerre mondiale. » C’est en novembre 1914 qu’il réussit à être muté comme observateur aérien au D.A.L. (Détachement d’Armée de Lorraine), qui demande des volontaires, en court-circuitant la voie hiérarchique.
Observateur
Officier-observateur sur avion Maurice-Farman puis sur Blériot, l’auteur évoque les débuts de l’aviation d’observation, les essais de T.S.F., en y mêlant des réflexions sur la gloire, le courage en mission, ou les « succès féminins. » P. Abraham fait partie des précurseurs, il vole en observation dès 1914, dans un emploi tactique nouveau : à la C9, il participe avec deux camarades à l’élaboration théorique de ce que seront les principes du réglage du tir d’artillerie par avion (p.231) : «Le GQG m’interroge sur le texte d’une instruction qu’il désire faire paraître à ce sujet. » Ce travail, « revu par les manitous de là-haut, deviendra un petit bouquin rouge, bible du travail en commun de l’artillerie et de l’aviation sur tout le front. » Il évoque aussi des reconnaissances lointaines derrière les lignes allemandes, « à compter les fumées de locomotive » (p. 233), c’est aussi l’occasion de réflexions sur le courage et la peur au combat. Le récit de l’attaque d’un drachen allemand avec des fusées incendiaires génère des considérations morales, il n’a pas visé les observateurs de la nacelle (p. 235) : « Détruire le matériel, c’est notre but. Mais tirer comme des lapins des gars abandonnés par leur treuil et qui ne peuvent pas nous répondre, c’est autre chose. ». Cette action lui vaut la première citation de l’escadrille, et une des premières croix de guerre arborée à Nancy (mai 1915, p. 236) : « Sur le trottoir de la rue St-Jean, je suis arrêté par des hommes de l’âge de mon père, qui me demandent à soupeser de leur main la décoration nouvelle. »
Pilote puis chef d’escadrille
À la C9, lieutenant observateur, il réussit aussi à passer son brevet de pilote, sans partir en formation, et le fait de piloter lui permet de tester les observateurs nouveaux venus, ainsi que les avions reçus, G4, G6, Morane-Parasol, puis A.R. et Spad biplace. Il se montre très critique (narration d’accidents mortels) envers le Morane et l’A.R. (avion Dorand). Passé ensuite chef d’escadrille à la C 21, Il dresse un tableau de l’aviation au bout de deux ans de guerre. Pour lui le groupe des pilotes en 1916 est débarrassé des précurseurs, des mondains associés ici à des membres de l’aristocratie ; les survivants de ce groupe, rejoints par leurs jeunes cousins, forment une classe aristocratique minoritaire. Un groupe prolétarien est celui des mécaniciens, d’origine ouvrière et passés pilotes ; la presse, dit l’auteur, aime exposer leurs succès (p.280) « par une conception fausse de la démocratie, en réalité par démagogie. » Cette presse met en scène les frasques de « ces « grands enfants » qu’il s’agissait de rendre « populaires » avec une petite touche de dédain ». On peut penser ici à R. Nungesser ou G. Carpentier, car J. Navarre et G. Guynemer viennent de la bourgeoisie aisée. Pour P. Abraham, il y a une troisième couche, majoritaire, la moins médiatisée, ni aristocratique ni ouvrière, qu’il appelle la bourgeoisie. Et il conclut (p. 280) : pour lui, «L’ensemble des pilotes de guerre, à partir de 1917, reproduisaient assez bien, sauf du point de vue des proportions, l’aristocratie, la bourgeoisie et le prolétariat de la société française à cette époque-là. »
À propos du 16 avril 1917, il raconte les difficiles liaisons à basse altitude dans le mauvais temps, avec l’angoisse de se trouver sur une trajectoire d’artillerie, puis il extrapole à l’évolution tactique généralisée de l’appui-feu de l’aviation pour les attaques d’infanterie (1918), soulignant le paradoxe par rapport à ce qui avait été la règle depuis 1914, c’est à dire la recherche continue de l’altitude la plus élevée possible. Passé capitaine à l’été 1917, il forme avec la C 21 des observateurs américains au camp du Valdahon. Il aborde longuement des thèmes qui paraissent marginaux aujourd’hui, comme la différence de conception sur ce que doit être la place du vin et des boissons alcoolisées au front entre les Français et les Américains ; après être reparti au printemps 1918 combattre sur le front des offensives allemandes, il termine la guerre associé au G.H.Q. US pour former un groupement tactique qui deviendra sans objet avec l’Armistice.
Un aviateur moraliste
Ce qui fait la singularité du témoignage de Pierre Abraham, que l’on peut comparer avec la dizaine de notices d’aviateurs du dictionnaire du Crid, c’est le mélange, dans son récit, de remarques factuelles avec des réflexions éthiques et psychologiques, à propos de l’attitude au combat, du vol, des camarades, de leurs frasques communes, aussi bien qu’à propos des aventures féminines. Cela donne paradoxalement un ensemble extrêmement sérieux, un peu pontifiant (p. 202): « Et la gloire ? J’éprouve un étrange scrupule à m’aventurer dans cette auscultation rétrospective. (…) L’appétit de gloire, comment le faire comprendre, à quoi le comparer. Peut-être à cette « fureur de vivre » dont on nous rebat les oreilles pour la jeunesse d’aujourd’hui. » (…) « Fureur de vivre » était pourtant inexact en 1914. Et je préférerais, au risque de piétiner toute pudeur – la mienne et celle de mes camarades disparus – parler de ce qui nous possédait alors et qui, réellement concrètement, pouvait s’appeler « fureur de mourir ». » L’auteur « méprise de fort haut » (p. 225) les revues comme La Vie Parisienne ou Fantasio pour l’image des aviateurs qu’ils véhiculent, et avec moins de sévérité, il dit n’être pas satisfait de certains livres comme L’équipage [1923] et « de certains films techniquement bons et moralement déplaisant comme Le Diable au Corps. [1947]». L’auteur signale son incompréhension et ses relations distantes, toujours pour des raisons éthiques, avec l’unité de bombardement aérien de Malzéville (1915) : pour lui, jeter des bombes sur des localités s’apparente un peu à de l’assassinat (p. 242) et lorsque lui aussi est envoyé jeter des bombes à ailette sur la ville de Luxembourg, il déclare : « me voilà devenu pareil aux bombardiers de Malzéville que je méprise si fort pour leur besogne de tueurs. » On rappellera que l’auteur fut un des fondateurs communistes du Mouvement de la Paix en 1948.
Le chapitre des femmes est plusieurs fois abordé, il évoque ce qu’il appelle sa « vie de garçon », refusant l’engagement amoureux, comme si c’était un passage obligé de ce type de mémoires. Il se range en fait assez vite puisqu’il se marie en 1915, ce qui est aussi assez atypique : il dit effectuer avec ce mariage (p. 256) « un retour à ce qu’on aurait alors appelé la pureté. » Ici, place à un amour qui le ramène à une « règle de vie quasi – monastique qui correspondait, sinon à mon caractère, du moins à une de ses faces les plus durables. » Ce ton très particulier s’explique probablement en partie par le contexte de la rédaction ; en 1964 il est directeur de l’exigeante revue Europe, et son engagement communiste est public : le parti est puritain, et la période Jeannette Vermeersch n’est pas loin… Ces prismes sont du reste conscients et assumés (p. 237) : « Au moment de faire écho à nos joyeuses prouesses, je devrais sans doute me ceindre les reins d’une ceinture à pointes, me couvrir la tête de cendre et faire pieusement pénitence. Il n’en sera rien. Ni l’âge, ni les réflexions, ni le contexte – austère au regard de la société – où je vis depuis nombre d’années, ni la désapprobation éventuelle de ceux qui sont mes camarades d’un autre combat, ne m’amèneront à renier la fougue de notre jeunesse et les excès qui l’ont accompagnée. » Il fait aussi de nombreuses allusions au vin, aux beuveries, et aux canulars qui les accompagnent.
Un témoignage original
Ce témoignage est inscrit dans un contexte (années Soixante) où les récits factuels de pilotes sont finalement assez rares, et où la vision des aviateurs est dominée par des clichés glorieux que l’auteur veut remettre en perspective. Il est aussi possible que l’auteur aborde longuement ces thèmes (femmes, beuveries) parce ce que c’est ce qu’on attend de ce type de récit à l’époque ; pour un précurseur qui vole en missions de guerre dès 1914, il n’y a finalement dans le livre qu’assez peu de descriptions de missions et de réglages, de rencontres ou d’évitements de l’ennemi. Insistant beaucoup sur sa modestie, son inexpérience mais dans le même temps sur ses réussites et ses succès, son propos n’est pas exempt d’une certaine suffisance (c’est tout le contraire de G. Villa, par exemple), mais il est aussi certain qu’il a fait « une belle guerre », pour employer une expression des années Trente. Cette contradiction entre une ambiance potache, avec de très jeunes gens à peine sortis des Ecoles, et les dures responsabilités de la guerre confiées à ces aviateurs, n’est pas en soi originale dans le petit monde des escadrilles ; ce qui l’est plus, c’est d’évoquer ces frasques de jeunesse avec l’expérience de la vie, d’une autre guerre, des engagements politiques et intellectuels, d’une existence austère… son frère l’écrivain communiste Jean-Richard Bloch est mort en 1947, miné par la disparition de sa fille résistante, exécutée par les Allemands en 1943 ; leur mère a été assassinée à Auschwitz en 1944… En fait, loin de le desservir, c’est aussi ce caractère composite de l’ensemble, avec ce ton marqué par les expériences ultérieures de la vie et par le regard des camarades, qui fait l’intérêt historique de ce témoignage.
Vincent Suard, décembre 2025
Gargadennec Eugène (1896 – 1982)
Ma vie telle que je me souviens
1. Le témoin
Eugène Gargadennec est né dans une famille de pêcheurs de sardines à Tréboul (Douarnenez – Finistère). La famille est pauvre, la pêche irrégulière, mais avec sa mère ouvrière en conserverie, il dit ne pas avoir pas connu la faim dans son enfance. Mousse à 11 ans, il est pêcheur jusqu’à sa mobilisation en avril 1915. Il passe le conflit avec des affectations variées, essentiellement comme matelot canonnier. Après sa démobilisation, il multiplie les emplois à terre (ouvrier en région parisienne, travaux publics d’entretien des ports) et en mer (pêche), il terminera sa carrière comme patron de vedette de tourisme (île d’Yeu).
2. Le témoignage
Les Éditions Le Télégramme ont publié en 2003 Ma vie telle que je me souviens, les Mémoires d’Eugène Gargadennec, (148 pages). Les notes qui composent le manuscrit ont été rédigées entre 1965 et 1978. La période de la Grande Guerre va de la page 46 à la page 104.
3. Analyse
Le témoignage de notre marin se caractérise par la diversité des expériences vécues pendant le conflit. Classe 16, l’auteur est convoqué à Brest en avril 1915, « et le voilà marin de l’État». Il ne fait pas l’intégralité de ses classes, car à cause du nombre important de navires arrivant dans la rade, il est employé comme docker (p. 47, avec autorisation de citation): «On nous envoyait par équipe de jour et de nuit décharger les cargos. Blé, charbons, divers, de ce fait, je n’ai eu qu’une connaissance très sommaire sur le maniement du fusil. »
À bord du cuirassé Marseillaise
Il embarque en août 1915 comme apprenti-canonnier sur la Marseillaise. En arrivant, on lui montre dans un pont inférieur « les deux crocs où on devra crocher son hamac le soir et la case où on devait ramasser notre sac. » Lors du branle-bas (6 h 30, p. 49), « il y en avait toujours qui tiraient leur flemme, les quartiers-maîtres passaient sous les hamacs, et d’un coup d’épaule le flemmard était vite sur la cuirasse. » Il raconte la vie à bord, le charbonnage éreintant, toute une journée en équipe à la file, avec des briquettes de 12 kg, les difficultés à se laver ensuite. Les sorties à Brest sont possibles, mais les matelots sont désargentés : « quand on avait fait une petite tournée dans la rue de Siam et une petite bifurcation dans la rue Guyot, la paye du mois passait comme un feu de paille. » Ils appareillent en janvier 1916, faisant route à l’ouest par gros temps, et l’auteur signale que les malades sont majoritaires. À la recherche d’hypothétiques navires allemands, ils font escale aux Antilles, charbonnent en Jamaïque, puis vont mouiller à Saint-Domingue : une révolte est en cours dans la capitale, et des familles françaises viennent se réfugier quelques jours à bord. Le calme revenu, la Marseillaise revient à Brest en octobre 1916. Il est débarqué, étant en excédent à l’effectif, malgré le capitaine canonnier qui lui demande de rester, « je trouvais que je n’aurais eu de l’avancement de sitôt. »
Paquebot mixte Niagara
Le canonnier nouvellement breveté est embarqué sur le paquebot mixte Niagara, il s’agit de servir une des deux pièces de 90 mm du navire. Il y navigue de mars à juillet 1917; la paye n’est pas « bien forte », dit-il, mais hors la veille dans les zones dangereuse, il leur est « interdit de travailler. » Le Niagara va jusqu’au Venezuela où il commence à embarquer viande et café, puis refait la route des Antilles en chargeant des bananes. Il décrit une virée à terre à Colon (Panama) où il se taille un grand succès en interprétant une goualante célèbre (L’étoile d’amour) (p. 60) : « J’avais récolté 12 dollars, en ce temps-là, un dollar valait 5 francs. Nous étions en pompon rouge, cela faisait de l’effet. On avait vite fait des douze dollars pour les dépenser. Si les deux Nantaises nous ont fait monter le copain et moi gratuitement par commisération pour nous, les deux autres copains, les dollars en communauté, ils en ont profité. ». En mer, le danger est modéré, sauf à proximité des côtes françaises (p.62) : « Venant de dépasser l’île d’Oléron, nous étions arrivés par le travers de la Courbre, deux torpilles ont passé de justesse derrière nous, on les voyait venir de loin.» Ils sont plus tard canonnés par un sous-marin à trois jours de mer de l’embouchure de la Gironde, mais ils réussissent à le distancer.
Embarquements divers
Passé quartier-maître, il est mis à disposition de l’A.M.B.C. (armement des bateaux de commerce) à Calais. Il navigue sur le charbonnier Ville de Dunkerque, avec des rotations Cardiff et Hull, et le service est exigeant « ce n’était pas la bonne vie du Niagara ». Volontaire pour une place de chef de section pour la protection de la grande pêche (morutier), il relie en train Calais à Brest, improvisant une permission à Paris (sanction : 4 jours de prison et 8 points rouges sur son carnet), « Les petites midinettes m’ont apporté probablement beaucoup de chance par la suite, car mon pompon les attirait, et toutes voulaient le toucher. » Le soir, à Montparnasse, il rencontre une petite bonne bretonne (p. 68) : « Loin du pays où l’on se retrouve, on ose prendre plus de liberté. (…) On se quitte le matin, en jurant de ne rien dire au pays de la nuit mémorable. » Arrivé à ce moment du récit, E. Gargadennec signale que les dates commencent à s’estomper dans sa mémoire, son récit ne s’appuyant pas sur des carnets.
New-York – Savannah – Charleston
On déduit du récit que l’auteur est envoyé avec d’autres marins aux États-Unis pour former les équipages de grands voiliers qui reviendront en France avec des cargaisons de charbon. « L’ordre nous est venu d’embarquer le 23 mars 1918 sur un grand paquebot qui venait de débarquer 10 000 hommes de troupe à Brest. » Il commence par passer deux mois à Brooklyn en attendant que son voilier soit prêt à Savannah ; ils sont logés sur un bateau à deux étages à quai, c’est un dépôt de marins US où il découvre le self-service, où l’on mange debout ; il signale sa bonne vie (p. 72) « il arrivait tous les jours à bord plus d’invitations qu’on était de marins français. Les Américains faisaient un point d’honneur d’avoir deux, trois et plus de marins français quand ils avaient des invités en soirée. » Il a la chance d’être assez bon danseur (fox trot), « la danse, ça rentrait assez vite » Durant ces deux mois, c’est du manque de sommeil qu’il a le plus souffert, le réveil à bord étant fixé impérativement à 6 h 30. Il a un peu honte, au moment où il consigne ces aventures festives à New-York, en pensant aux malheureux soldats dans la tranchée, mais il ne se sent pas responsable (p. 71) : « J’ai demandé à être volontaire, j’ignorais alors comment je me serai trouvé par la suite. (…) j’ai passé deux mois de la sorte. Une chose que je n’oublierai pas. Nous étions demandés par les grands théâtres pour chanter La Marseillaise aux entractes, j’avais de la voix alors. »
L’ambiance change radicalement lorsqu’ils prennent en main à Savannah leur quatre-mâts goélette Ypres (équipage 22 hommes), il devient alors gabier et doit vaincre le vertige. Le voyage inaugural vers la France tourne rapidement à la catastrophe car, chargé de charbon, dans une mer très forte, « un mât libéré de ses haubans tribord se casse au ras du pont entraînant avec lui l’étai de tangage, et le mât d’artimon qui se casse à moitié. » L’ambiance n’est plus au fox-trot : « Le commandant fait monter l’équipage sur la dunette arrière et me dit de me préparer à tirer avec le canon sur l’étai de tangage pour faire tomber le troisième mât. [les coups de roulis menaçant la structure du bateau] ; 4 coups de canon sont tirés et finissent par atteindre leur but, puis il faut ensuite mettre de l’ordre dans l’enchevêtrement des espars et des débris sur le pont. Après quelques heures d’un travail dangereux (des barils ayant rompu leurs amarres passent et repassent rapidement…), le bateau n’est plus qu’une épave flottante. La TSF permet de prévenir un remorqueur, qui ramène le Ypres à Charleston. Ils y restent deux mois jusqu’en octobre 1918, le temps pour les charpentiers américains de réparer les mâts. On désigne l’auteur comme « quartier de commission » : se débrouillant en américain, il va faire les courses, et, invité par les fournisseurs, il fréquente les cinémas ; il mentionne également la ségrégation raciale. Le Ypres appareille enfin, et le 11 novembre 1918 le trouve dans la rade de Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada).
Police de la pêche
Revenu à Brest, notre marin est affecté sur un chalutier pris aux Russes (le T 35 qui devient le Commandant Vergognan), et le 1er janvier 1919, il appareille avec deux autres chalutiers armés pour Terre-Neuve, en mission de surveillance et de police des pêches. Son commandant qui l’apprécie essaie de le convaincre de rester dans la Marine : « à 33 ans, vous aurez 15 ans [de service] et je vous prédis que vous serez alors maître, vous pourrez si vous voulez prendre votre retraite et vous trouveriez dans le civil les meilleures places. » E. Guargadennec confie « qu’il a beaucoup regretté de n’avoir pas suivi ces conseils », car son itinéraire professionnel entre-deux guerres a été très difficile. Démobilisé le 21 novembre 1919, il conclut son évocation de la guerre en disant qu’il n’a jamais eu ni faim ni soif et que contrairement à la majorité des soldats, il n’a jamais été beaucoup en danger.
Voici donc un témoignage intéressant, bien qu’assez atypique, certes parce que les marins ne représentent qu’une minorité de l’ensemble des mobilisés, mais surtout en raison de l’originalité du parcours de l’auteur, au gré de ses aventures variées.
Vincent Suard, décembre 2025
Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943)
Pierre-Barthélemy Gheusi, Cinquante ans de Paris. Mémoires d’un témoin, (1889 –1938), Paris, Plon, 1939, 505 pages
Résumé de l’ouvrage :
Pierre-Barthélemy Gheusi, journaliste, écrivain et directeur de théâtre à Paris, livre, de 1889 à 1938, ses souvenirs déroulés au fil d’une vie dense et à multifacette dans les domaines du journalisme (il est rédacteur au Figaro), de la musique (il est directeur de l’Opéra-Comique), de la politique et même de la Grande Guerre, occupant, en tant que capitaine, la fonction d’officier d’ordonnance de Galliéni. Ses souvenirs sont distillés dans autant de tableaux chronologiés dans les petits et les grands épisodes de sa vie omnisciente. L’ouvrage se décompose ainsi en trois tiers inégaux ; l’avant-guerre, la Grande Guerre et un après-guerre qui se termine peu avant la survenance de la Deuxième Guerre mondiale.
Eléments biographiques :
Pierre-Barthélemy Gheusi est né à Toulouse, le 21 novembre 1865, de Joseph Antoine, alors employé de banque, cousin de Gambetta, et de Hélène Mimard, sans profession. Il étudie au collège de Castres, où il rencontre Jean Jaurès, puis fait des études de droit à Toulouse. Dès 1887, il collabore à une revue (Le Décadent) et se frotte un temps à la politique. Il devient chef de cabinet du sous-préfet de Reims puis, obtenant une mutation à Paris, demeurant rue de Miroménil puis rue Saint-Florentin, il collabore avec le Gouvernement. Il fait ensuite plusieurs voyages à l’étranger, avec des rôles divers, dont diplomatiques. Il occupe diverses fonctions, comme officier de l’Instruction publique, chargé de mission en Syrie et en Palestine, membre de la commission du Théâtre Antique d’Orange, membre de la commission d’admission et d’installation de l’exposition de 1900, membre de la Société des Auteurs Dramatiques, de la Société des Gens de Lettres, du Comité des Expositions à l’Étranger ou de l’Association des Journalistes Parisiens. Il est ancien chef de cabinet du préfet et du secrétaire général de la Seine, attaché aux Ministères de l’Intérieur et des Travaux Publics. Enfin, il est, pendant la Guerre, officier à l’état-major de l’artillerie territoriale de Paris (cf. Base Léonore). Il épouse en 1894 Adrienne Willems, avec laquelle il a plusieurs enfants, dont un fils, Raymond, artilleur, et Robert, aviateur. Directeur de la Nouvelle Revue, il est promu directeur-administrateur du Figaro après-guerre, avant d’être congédié en 1932. Directeur également de l’Opéra-Comique, il en est renvoyé en 1918 par Clemenceau puis, rétabli dans ses fonctions, contraint à la démission en 1936. Il aura écrit dans sa vie 23 œuvres musicales, œuvres dramatiques ou livrets d’opéra, 12 romans, 8 livres d’Histoire et divers autres livres (source Wikipédia). Il meurt à Paris, à son domicile du 4 rue de Florentin, dans le 1er arrondissement, le 30 janvier 1943.
Commentaire sur l’ouvrage :
L’ouvrage, dense, fouillé et multifacette, est un document incontournable sur la vie politique, artistique, mondaine et militaire (pour la Grande Guerre) parisienne pendant toute la 3ème République. Ami de Jaurès, zélateur de Gambetta (par lien familial), et sectateur-réhabilitateur universel de Galliéni, dont il est l’officier d’ordonnance, et sur lequel il a écrit plusieurs livres, Gheusi est un personnage incontournable. Son livre, qui suit un fil chronologique, tout en reportant peu de dates, en est donc difficile à appréhender dans toutes ses acceptions et subtilités, sauf à être un contemporain du même milieu social ou très fin connaisseur de la période. Œuvrant dans de nombreux domaines liés à ses fonctions et la centralité de ses rôles, il construit son ouvrage par tableaux dans une foultitude de domaines, à Paris, en France, comme à l’étranger. Divisé en quatre grands chapitres (Souvenirs de jeunesse – Avant la guerre – La Guerre et Après la guerre), c’est bien entendu le chapitre consacré à la guerre (pages 223 à 387), et notamment par sa position centrale, en 1914, dans l’entourage de Galliéni, qui forme le cœur de l’intérêt de ces mémoires. Il est donc heureux qu’un index paginé des noms cités soit présent en fin d’ouvrage. Il convient donc de s’y reporter pour toute analyse des données que ce livre contient. Bien entendu, quelque peu auto-promotionnel comme autocentré, le contenu de cet ouvrage demande à être confronté aux témoignages politiques et artistiques de mêmes niveau et ampleur. Gheusi est assez direct, décrivant opportunément le plus souvent les milieux qu’il côtoie, y compris montrant les intellectuels habillés en uniforme pendant la Guerre. Le livre est mâtiné, çà et là, de phrases centrales et frappées du coin du bon sens voire même de descriptions à contre-courant. Ainsi par exemple, il n’est pas tendre sur les « m’as-tu-vue-en-infirmière », assimilant les bénévoles sanitaires mondaines en demi-mondaines (page 228). Tout au long de l’ouvrage, il milite pour Gambetta et Galliéni, martelant bien entendu que ce dernier a sauvé Paris. Il donne également quelques éléments militaires intéressants, ainsi bien sûr que des éléments d’ambiance sur le Paris de la Grande Guerre, dans de nombreux domaines, civils comme militaires, et mondains comme politiques. L’ouvrage est donc bien celui d’un témoin, privilégié par sa position comme par sa centralité. Certes, il parisiannise tout, quitte à faire des erreurs factuelles, comme « l’affaire du Zeppelin Z-VIII – L22 » abattu au-dessus des Vosges meurthe-et-mosellanes, qui selon son témoignage menaçait Paris au point de lui faire passer une nuit d’« insomnie de fièvre et d’attente » (page 232). Sa vision d’une Paris menacée, occasionnant le départ du gouvernement, instructive, notamment pour l’ambiance politique pendant les quatre mois de son absence. Il évoque les « réfugiés en province » invités à partir, les députés « paniquards », ceux qui se plaçaient, pour fuir, sur la liste des otages allemands quand ces derniers seraient entrés dans Paris, évoquant une véritable « phrase-médaille » (page 239), etc. Il décrit l’ambiance militaire des tirs contre avions et de leurs risques pour les parisiens, et rapporte également quelques rumeurs de bourrage de crâne, comme les notables de Senlis assassinés et enterrés les pieds en l’air (page 240). Mais cette partie de son récit, dans les heures pénibles précédant la bataille de La Marne et son issue victorieuse, est intéressante. Témoin privilégié, il rapporte faits et ambiance, jusqu’à affirmer : « Pour donner une idée de l’autorité indiscuté de Galliéni, dès ce jour [3 septembre 1914], dans tous les milieux, rappelons un fait sans précédent en une cité menacée des pires désordres par l’approche de l’ennemi. Pendant quatre mois, malgré la réduction quasi-totale de toute police administrative, dispersée désormais et employée ailleurs, pas un crime et pas un délit n’ont été commis, fût-ce dans une des innombrables maisons abandonnées de la capitale – pas même un vol à la tire. Le « jusqu’au bout ! » du Chef, devenu en une nuit l’idole et l’égide de Paris, a rassuré les bons et terrifié les autres » (pages 241 et 242). Il ajoute plus loin, relativement au départ pour Bordeaux du gouvernement : « Le Ministre de la Guerre, une heure avant de rallier le train furtif, mais gouvernemental, qui allait gagner Bordeaux sans être sûr – autre légende que nous laissions circuler malgré son ânerie – de ne pas être enlevé, vers Villeneuve-Saint-Georges, par les uhlans de Von Kluck (…) » (page 243). Bien que n’ayant pas lui-même suivi les exilés bordelais, il y rapporte une atmosphère empoisonnée (page 276). Évoquant les possibles d’une invasion allemande de Paris, il donne détails intéressants sur la rédaction de la proclamation de Galliéni aux parisiens, où elle a été imprimée, ce que voulait dire son « jusqu’au bout » et conclut : « Nous avions, à tous les degrés de la hiérarchie, la bravoure facile de l’indifférence et de la fatalité » (page 243). Il fait même quelques excursions au front, dont il dresse des tableaux parfois surréalistes. Là encore, il atteste : « Nous avons vécu les journées suivantes dans le sillage de la retraite ennemie. Derrière eux, les Allemands on laissé, de chaque côté de la route, des amoncellements de bouteilles vides. Elles attestent que l’orgie est venue au secours du sol envahi et que les vins du terroir ont, eux aussi, contribué à démoraliser l’envahisseur. Mais il laisse après lui la tenace puanteur de ses excès stercoraires, les profanations sacrilèges de son luthéranisme congénital, la nausée de ses atrocités et de ses crimes » (page 255). Sensible à l’ambiance d’alors du champ de bataille, Gheusi rapporte quelques récits d’espionnite, tel celui du pont d’Epluches, qui n’était que prostatique ! (page 267).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Il convient de se reporter à la table des chapitres (4 majeurs et 12, 16, 15 et 17 sous-chapitres) pour hiérarchiser l’ouvrage, ainsi qu’à l’index des patronymes.
Page 197 : Publie dans La Nouvelle Revue, « deux ans et demie avant qu’elle éclatât » un article sur la guerre inévitable, lequel lui vaut des reproches du Quai d’Orsay
224 : En voyage à Berlin six semaines avant la guerre, et dit : « Toute l’Allemagne pue la guerre »
: Camp de concentration en Bretagne (vap 248 pour y interner l’autrichien Max Nordau, qui considère la France « comme le peuple le plus pourri, le plus faraud, le plus gangrené de toutes les tares latines du vieux monde »)
: Sur les Allemands, il dit : « Ce peuple absorbe la musique comme il absorbe de la bière et de la saucisse. Son avidité musicale se satisfait d’ailleurs de n’importe quels sons, de même que sa gloutonnerie se satisfait de n’importe quelle nourriture »
225 : Mort de la femme de Galliéni, qui le plonge dans la guerre corps et âme
232 : Antiallemand, il dit : « Il ne suffira plus, maintenant, de châtier l’Allemagne ; il faut aussi la déshonorer devant le monde »
239 : Tirs contre avions par les Écossais (vap 240 sur les risques encourus et le tireur d’élite de l’Opéra-Comique)
240 : Maire, M. Eugène Odent, et notables de Senlis fusillés et enterrés les pieds en l’air
242 « Train furtif » gouvernemental pour Bordeaux
250 : Sur l’épisode des Taxis de La Marne
252 : Abattage des chiens errants et achèvement des chevaux, puis leur enterrement par des zouaves et des sapeurs de Paris, après La Marne
255 : Bouteilles vides de la retraite allemande au bord des routes, orgies contributrices à la défaite allemande
255 : Effets de 75
260 : Officiers allemands fuyards exécutés par des officiers allemands
: Sur des dormeurs qui sont en fait des soldats morts !
: Réservistes angevins modèles de terrassiers par leurs tranchées paysannes
274 : Contrôle télégraphique et ses surréalismes pour l’affaire Louis-Dreyfus (fin 283), qui rappelle que l’espionnite, multiforme, ne concernait pas que la zone du front
279 : Ordre en blanc
290 : Sur le retour du gouvernement : « Le Gouvernement rentre dans Paris comme il en est sorti, avec une discrétion qui ne comporte ni tambours, ni trompettes, en sorte que la population ne se sera guère plus aperçue du retour des ministres que de leur départ… »
310 : Spectacle des zeppelins pour les parisiens
316 : Crise des 75
344 : Il adjective tous les ministres (le 4 février 1916)
353 : Chiffres sur l’Opéra-Comique
358 : Textilose pour les décors
363 : Voit Mussolini en 1917
369 : 74 voyages d’artistes dans les cantonnements de repos du front (en 1917)
372 : Vue de Mata-Hari (vap 373 son exécution, par une seule balle l’ayant atteinte !)
Yann Prouillet, 5 septembre 2025
Loevenbruck, Pierre (1891-1972)
Pierre Lœvenbruck, Ceux de la réserve, Paris, Tallandier, 1931, 223 pages
Résumé de l’ouvrage :
Pierre Lœvenbruck, lorrain de Pont-à-Mousson, est sergent à la 7ème compagnie du 69ème R.I. de Nancy et de Toul depuis deux ans déjà quand il commence son journal le 30 juillet 1914, alors qu’il rentre de manœuvres sur le Mont d’Amance, au nord de Nancy. Il y apprend la mobilisation prochaine de l’armée française et se demande s’il va l’être lui-même dans le régiment d’active (69ème). Affecté finalement à la 1ère section (puis à la 4ème) de la 23ème compagnie du 269ème RI, il décrit dès lors, à 23 heures le jour-même, la mise sur le pied de guerre de son unité, formée des réservistes meurthe-et-mosellans de toutes origines sociales. Il doit alors les habiller et les transformer en soldats avant que l’unité ne quitte les casernes pour les premiers combats. Suit une description, débutant dès la nuit, à la limite du surréalisme, d’une mise en état effective de guerre jusqu’à la marche à la frontière, vers le nord, le samedi 8 août. Rêvant d’entrer rapidement victorieux dans Metz, en Lorraine allemande, Lœvenbruck passe la frontière, le 19 août, à Ajoncourt, dont les poteaux ont été mis à terre et fait une courte incursion en territoire du Reich. La Seille est en effet bien vite repassée sans combats dès le 22, après un baptême du feu qui le met en face de la réalité de la guerre. Son premier mort, les visions d’exode des paysans lorrains, la canonnade, tout cela n’altère pas encore l’ « âme de conquérant » des réservistes. Pourtant, la défaite qui se joue en Moselle ramène la guerre devant Nancy. Débute alors la bataille du Grand Couronné qui va hacher le régiment au nord de la ville pour la protéger de l’invasion. Dès lors, le sergent évoque, dans le détail, les journées épiques autant que mortifères, jusqu’à la victoire, très temporaire, qui s’est jouée sur La Marne, le 17 septembre. Le 29, le régiment doit participer à la phase suivante de la guerre, qui l’amène devant Douai, dans le Nord, où se joue la Course à la mer. Les combats n’y sont pas moins violents, et le 3 octobre, peinant à réaliser la surprise de la situation, il est fait prisonnier à Billy-Montigny par un houzard du 7ème Kavallerie Korps. Son épopée s’arrête alors qu’il découvre l’inscription « Kriegsgefangenen Lager Parchim » sur la porte d’entrée du camp de prisonnier, qu’il franchit le 8 octobre 1914.
Eléments biographiques :
Marie, Joseph, Pierre Lœvenbruck, (parfois orthographié Lœwenbruck) est né le 2 avril 1891 à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. Son père, Louis Henri, né à Thionville, est négociant et sa mère, Marie, Joseph, Claudine Noël est sans profession. Il a une sœur et un jeune frère, âgé de 13 ans quand il entre en guerre. Il obtient son baccalauréat général et débute son service militaire dans la foulée, en 1912. Fait rapidement prisonnier, il cumulera 7 années de services militaires et 9 années de services civils, dont trois ans et demi à l’étranger. Il racontera chez le même éditeur, également en 1931, son « expérience » de captivé dans un ouvrage intitulé Bouches inutiles, Quarante mois de captivité en Allemagne. Il épouse à Berne, en Suisse, Marie Antonia Kressig, le 6 février 1920. Outre une petite carrière littéraire, il exercera la fonction de Consul de France (de 2ème classe) en 1934, attaché à l’administration centrale, puis sera promu à la veille de la 2ème Guerre mondiale, en août 1939. Convaincu de « participer en France à une résistance active en dehors de ses tâches professionnelles » (cf. son dossier de Légion d’Honneur, Base Léonore), il est alors mis en sursis par le Gouvernement de Vichy (en mars 1942). La Libération intervenue, il est rétabli dans ses fonctions en mai 1944 et confirmé en décembre suivant puis nommé Consul Général (de 2ème classe) en avril 1945, « en reconnaissance des services rendus ». Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 9 avril 1930 et officier le 14 août 1946. Il décède le 4 décembre 1972 à son domicile, 116 rue de la Convention, dans le 15ème arrondissement à Paris.
Commentaire sur l’ouvrage :
Désiré Ferry, président de l’Union nationale des Officiers de Réserve de France, introduit l’ouvrage en vantant les mérites d’un journal de guerre, genre loin d’avoir épuisé la curiosité des lecteurs, celui-ci issu de « ceux de la réserve », nous renseignant sur l’origine de ce carnet. Il dit : « Le réserviste prenait des notes selon sa fantaisie, au hasard des cantonnements. C’était tantôt un journal de route, tantôt un recueil d’impression. C’était pour lui-même, « quand il serait vieux », qu’il consignait ses souvenirs » (page IV). En effet, sous l’apparence d’un carnet de route qui couvre, quasi jour par jour, la période du 30 juillet au 8 octobre 1914, Ceux de la réserve est bien un livre de souvenirs. Mais ceux-ci, relatés simplement, et rapportant la vision exacte et bien décrite des grandes phases qui ont marqué sa courte expérience de guerre : La mobilisation et l’entrée en guerre d’un régiment de Réserve, la marche à la frontière (mosellane), la bataille du Grande Couronné, et la Course à la Mer. Pierre Lœvenbruck confirme cette architecture en la précisant : La mobilisation – La victoire en chantant – Le Grand-Couronné – Un secteur de tout repos – La course à la mer et À travers l’Allemagne. A l’échelle d’un régiment (le 69ème et son régiment de réserve, le 269ème), l’ouvrage revêt donc un indéniable intérêt local, montrant la mise en état de guerre des classes d’âge meurthe-et-mosellanes autour de Nancy et de Toul, Lœvenbruck étant né à Pont-à-Mousson et terminant son service militaire puisque depuis deux ans déjà sous l’uniforme. Il est sergent lorsque la guerre le surprend en pleine manœuvre autour de Nancy. Pour ses camarades et certainement pour lui également, le 30 juillet 1914, la guerre, d’abord, n’est pas possible. L’habillement en cours des civils transformés en militaires, le fourrier dit encore, le lendemain : « Je m’en fous. Je suis peinard, ici, où je dois assurer l’habillement des réservoirs pendant vingt-cinq jours. Aussi, la fête sera finie quand je serai en état de rejoindre » (page 18). Plus loin encore, le 4 août, il rapporte même : « … nous ne devons pas combattre mais simplement suivre – et de loin – les troupes de l’active dans leur avance en pays ennemi. D’ailleurs, attaqués par les Français d’un côté, par les Russes et les Serbes de l’autre, les Allemands ne tiendront pas longtemps ; c’est l’évidence même ! et dans six semaines, deux mois, nous reviendront à Nancy en vainqueurs » (pages 42 et 43). Le mythe de la guerre courte est tenace ; il tient encore, le 18 août, quand Lœvenbruck avance, alors qu’il découvre un numéro de l’Est Républicain, daté du 16 : « On y raconte des histoires admirables sur la famine qui menace l’Allemagne, sur le « mordant » de notre cavalerie (2ème édition) et le « cran » de nos chasseurs. Chacun sait que les autres troupes n’existent pas. Tout ce bourrage de crâne qui nous enchante, nous paraît naturel et il n’est pas un de nous qui ne soit persuadé que dans quinze jours, mettons trois semaines pour les plus exigeants, la guerre ne soit terminée » (page 74). Mythe qui existe d’ailleurs également chez les Allemands, qui le déclarent eux-aussi au prisonnier Lœvenbruck début octobre (page 208). Sur la famine allemande, il y reviendra après sa capture et sa « traversée de l’Allemagne » comme prisonnier, en glosant, le 3 octobre : « … quant à la famine qui, d’après nos journaux règne dans leurs rangs… je souhaiterais aux rédacteurs de ces articles de manger aussi bien qu’eux ! » (page 211). Lœvenbruck livre donc une particulière intéressante « vue de l’intérieur » de la réception de la mobilisation, de l’engagement en masse des réserves qu’il faut équiper de pied en cap et mettre en état de guerre, tant psychologique que, 22 jours plus tard, confronté à la violence d’une guerre qui révèle son vrai visage, abattant les fantasmes d’une victoire facile et rapide. Il en dresse un tableau impressionnant : « Près de la caserne A. R. [de Toul], les terrains de manœuvres, qui servaient naguère à l’artillerie, sont littéralement couverts de civils endormis : on y voit toutes les classes de la société, des bourgeois, des jeunes gens, des vieux, des ouvriers, des paysans en blouse, quelques prêtres en soutane, combien sont-ils qui attendent qu’on veuille les recevoir dans les casernes où il doivent être habillés ? Deux mille, trois mille peut-être, arrivés dans la nuit et que les postes de garde ont eu la cruauté de laisser dehors » (pages 34 et 35). L’ouvrage, qui n’est pas teinté de bourrage de crâne, – page 110, il dit à propos de l’espionnite : « je ne crois guère à ces histoire de roman-feuilleton » – rapporte ce qui fut une certaine réalité voulant que certains, affectés dans la réserve, virent dans cette affection un éloignement de la gloire. Il dit, lorsqu’il apprend, manifestement déçu et inquiet, son affectation effective : « Que sera le 269ème de réserve ? Un tas d’inconnus, de nouveau chefs, de nouveaux collègues et, pendant que nous ferons l’exercice dans un fort de Toul, le 69ème entrera dans Metz ou dans Strasbourg » (page 17) ! Dès les premières marches vers la frontière, Lœvenbruck s’épanche sur les difficultés que ses 22 ans éprouvent à se faire obéir d’une telle diversité sociale. Il dit : « Les débuts furent durs, très durs, pénibles pour tous, pour nos officiers comme pour nous, gradés de l’active ; pour ces hommes arrachés à leur famille, à leurs travaux, à leurs douces habitudes, le changement était trop brutal, la discipline depuis trop longtemps oubliée ; partis de chez eux en chantant, ils s’apercevaient soudain que la rigolade était finie ; que le sac était lourd, que la route était longue, que les godillots mal graissés les blessaient, tandis que l’équipement leur sciait les épaules, et, naturellement c’est nous qu’ils en rendaient responsables, et parmi nous ceux qui étaient le plus près d’eux, ces « sous-officiers » abhorrés et détestés… jusqu’au jour où, petit à petit, ils s’aperçurent qu’au lieu d’être des ennemis, des tortionnaires, nous étions leurs amis, que notre souci était toujours de chercher pour eux le meilleur abri contre les rafales d’artillerie ou le cantonnement le plus confortable à l’étape, et alors, peu à peu, mais très vite, leur attitude à tous, et je dis tous sans exception, même et surtout Monier et Grégori, changea radicalement » (page 51). Mais cette « découverte » du feu qui tue n’est pas immédiate. D’abord après une rapide marche à la frontière au nord de Nancy, il franchit sans combat ni résistance la Seille, rivière formant la frontière entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, à proximité de Delme, et n’entend le son que loin derrière les collines qui lui font face, en direction de Morhange. Il se sait pas encore que depuis plusieurs jours, les français sont déjà morts en masse en Belgique et en Moselle et que cette journée du 22 août sera la plus meurtrière de toute la Grande Guerre. Il découvre petit à petit lui-aussi les « caractéristiques » de la « vraie » guerre. Apprenant par l’épreuve les « vertus » de s’enterrer, il confie, le 10 août : «… nous tous qui allions devenir les remueurs de terre que l’on sait, on ne nous avait fait exécuter qu’une seule fois, pendant mes deux années de service militaire, des travaux de campagne avec les outils de parc, c’est-à-dire de vraies pelles et de vraies pioches » (page 62). Sa « découverte » des premiers morts l’impressionne. Le 12 août, il décrit : « Dans une petite prairie, bien verte, gisent des cadavres de chevaux, ceux que montaient les propriétaires des lances, sans doute. C’est la première image de mort qui se présente à nous depuis notre entrée en campagne et soudain, nos rangs si bruyants tout à l’heure, deviennent totalement silencieux » (page 67). Mais le premier mort qu’il découvre n’intervient que le 20 août ; il ajoute « mais nous ne pouvons pas encore nous figurer que pareil sort nous menace » (page 79). Hélas, devant l’exode des populations les villages qui brûlent et les salves d’artillerie qui s’abattent à ses alentours ; la guerre finit par rejoindre le régiment et le baptême du feu est terrible. Le 23, devant la seille, à Moivrons, il décrit le « tintamarre » et le commandant Wurster qui dit : « Arrêtez ! lâches ! Le premier qui recule, je lui brûle la gueule ! » (…) « sa crânerie arrêt[ant] les fuyards » (page 90). La suite est alors, dans les combats du Grand Couronné ou dans ceux de la Course à la Mer, une longue suite de miracles pour le sergent, bousculé à plusieurs reprises par des obus éclatant à proximité (pages 98, 118 ou 189) ou recevant, à au moins cinq reprises (pages 105, 125, 135, 136 ou 182), balles et éclats d’obus qui dans la capote, qui dans la musette et ce qu’elle contient. Certains jours sont terribles de bombardements, comme le 25 août, heureux d’en être sorti entier. Prisonnier, les circonstances et le traitement que Pierre Lœvenbruck décrit sont intéressants. Exhibé à plusieurs reprises à la vindicte allemande (pages 203 et 218), honnête, il dit n’avoir pourtant pas subi de réels mauvais traitements.
Au final, tout l’ouvrage, par sa simplicité, la sobriété de ses tableaux et surtout leur véracité, est résolument l’un des tout meilleurs témoignages rapportant l’entrée en guerre et les premiers combats des civils, réservistes, devenus du jour au lendemain ceux que l’on appellera quelques semaines plus tard les poilus.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Parcours suivi par l’auteur (date) :
Essey-lès-Nancy (caserne Kléber) : 30 juillet 1914
Nancy : 31 juillet
Toul (caserne A.R.) – Domgermain : 1er août
Velaine-en-Haye : 7 août
Pont de Malzéville – Boudonville : 8 août
Malzéville – Pixerécourt – Bouxières-aux-Dames – Custines – Malleloy : 8 août
Col de Lixières : 10 août
Morey : 11 août
Arraye-et-Han – Ajoncourt – Moivrons – Col de Bratte – Bois de Grémecey : 12-24 août
Villers-les-Moivrons – Faulx – Lay-Saint-Christophe – Agincourt – Lenoncourt – Buissoncourt – Gellenoncourt – Haraucourt – Drouville – Col de la Fenêtre – Réméréville : 25 août – 16 septembre
Valhey – Bathelémont-lès-Beauzémont : 17-27 septembre
Laneuveville-devant-Nancy – Einville – Maixe – Crévic – Dombasle : 28-29 septembre
En train : Nancy (gare de Mon-Désert) – Frouard – Toul – Montereau – Palaiseau – Versailles – Mantes – Vernon – Eu – Montreuil – Berck – Etaples – Saint-Pol-sur-Ternoise – Drocourt : 29 septembre – 1er octobre
Drocourt – Rouvroy – Billy-Montigny : 1er – 3 octobre
Prisonnier : Billy-Montigny – Château de Beaumont – Douai – En train : Valenciennes – Charleroi – Namur – Liège – Verviers – Aix-la-Chapelle – Dusseldorf – Elberfeld – Hanovre – Wittenberge – Parchim : 3-4 octobre.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 18 : Garde-poux, garde magasin
29 : Colonel Granges, commandant du 269ème, « adoré du régiment »
30 : Fusil et drapeau oublié lors d’une marche
35 : Magasin bric-à-brac pour habiller les 250 hommes de la compagnie
38 : Perception des armes
39 : Seulement 3 tailles d’effets
40 : Matriculage personnel des effets
42 : Vue de Toul en état de siège
48 : Couvres képis faits avec des cravates bleues pour masquer la couleur rouge
53 : Gautherot, maire de Pont-à-Mousson
57 : Espionnite (vap 109)
61 : Carapace, « toute la compagnie s’accroupit la tête des uns dans le derrière des autres, de façon à ne plus présenter qu’une croûte de sacs »
68 : Ivrognerie généralisée
70 : Sur la reconnaissance des avions : « La veille [13 août], une note du général a fait savoir à toutes les troupes que lorsque, par erreur, elles tireraient sur un aéroplane français, celui-ci exécuterait en l’air un 8 »
71 : Moustiques
77 : Frontière allemande et poteaux arrachés
: Habitante cachée dans son armoire
78 : Changement de la boîte aux lettres Kaiserliche Briefkaste en fonte d’Ajoncourt par une française
80 : Exode lorrain
81 : Bruit du 75 « semblable à celui d’une cloche de bronze heurtée violemment »
82 : Retraite en pagaïe, impression de débâcle (vap 90, arrêtée par menace par un officier)
88 : Maison pillée dont le propriétaire est soupçonné d’être un espion
94 : Gendarmes serre-file
95 : Mâche de l’herbe pour tromper sa soif
98 : Obus de 77 tombant « comme des gros cailloux »
102 : Vision de charnier, collecte les plaques et les papiers des morts
103 : Allemand blessé
105 : Soldat nommé sergent car il a ramené une mitrailleuse
107 : Obus non éclaté qui « est venu se terrer dans le parapet comme un lapin »
108 : 3 septembre, Sedantag et rituel allemand inutile
120 : Enterrement sur le front, description et croix
121 : Premiers abris (6 septembre)
150 : Annonce au poste de police de Buissoncourt de la Victoire de La Marne
163 : Sacs à grains vides servant de capuchons sous la pluie
169 : Supériorité de la tranchée allemande
170 : Milliers de bouteilles vides dans les abris et les tranchées allemandes abandonnées
171 : Arbre observatoire, doté d’un téléphone
: Première messe (22 septembre)
173 : Vue de tombes, constituées en remplissant les fossés de la route
180 : Vente de souvenirs du front et prix (exorbitants)
188 : Horreur d’un cavalier mort traîné par son cheval
189 : Horreur d’un obus touchant au but sur un homme
193 : Fracture une porte puis une fenêtre d’une maison abandonnée
203 : Intervention d’un officier allemand qui lui empêche d’être maltraité (vap 210)
: Photographié par des soldats allemands avec des kodaks
216 : Inscriptions allemandes sur les trains
220 : Prisonniers servis à la gare de Wittenberge servis par des maîtres d’hôtel en habits !
Yann Prouillet, août 2023
Leddet, Jean (1878 – 1958)
Lignes de tir
Un artilleur sans complaisance, carnets de guerre 1914 – 1918
1. Le témoin
Jean Leddet est un militaire de carrière, artilleur passé par Polytechnique (1899). Passionné d’équitation, ce capitaine commande une batterie du 7e RA (Rennes), et il combat avec « ses Bretons » dans la guerre de mouvement, en Artois, en Champagne, à Verdun, et devant Reims en 1917. Au début de 1918, il est nommé à sa demande instructeur à Fontainebleau. Il poursuit après la guerre sa carrière d’artilleur et prend sa retraite comme colonel en 1937.
2. Le témoignage
À l’initiative de sa petite-fille Caroline Leddet, et avec une présentation scientifique de Max Schiavon, les éditions Anovi ont publié « Lignes de tir, Un artilleur sans complaisance, carnets de guerre 1914 – 1918 » (2012, 286 pages). Max Schiavon signale que Jean Leddet a repris en 1925 des notes écrites durant la guerre pour en composer un ensemble cohérent, et que seules d’infimes modifications ont été apportées après 1945. C’est donc un texte rédigé à fois à proximité des événements, mais aussi avec une certaine distance de « décantation ». La dactylographie du manuscrit précède de peu l’édition de 2012.
3. Analyse
Jean Leddet, qui indique en introduction vouloir s’en tenir à un récit factuel, produit ici un texte à la fois technique et vivant des opérations vécues au 7e RA : c’est cette volonté documentaire, presque didactique, alliée à un ton acerbe et à un talent de conteur, qui rend ce document exceptionnel.
L’encadrement rhabillé pour l’hiver
L’auteur procède d’abord à une présentation des cadres de son unité, avec une ambiance « Hécatombe des généraux » (P. Rocolle) avant l’heure : c’est à la fois méchant, drôle et bien documenté ; ce type d’inventaire critique, avec les noms des officiers, est évidemment impubliable en l’état au XXe siècle, et pour l’historien, c’est bien plus qu’un simple dézingage, car ce sont les motivations techniques qui font l’intérêt de ces jugements de valeur. Ainsi (avec autorisation de citation) du général Bonnier, commandant la 19e DI (p. 34) « C’eût été peut-être un bon chef de bataillon, [mais] ne connaissant rien à l’emploi de l’infanterie et de l’artillerie (…) », et du Colonel Haffner, chef du 7e RA (p. 34 et 35) « Le rapport, auquel j’ai assisté quelquefois, était une vraie comédie. Il assassinait de questions son major, le commandant Perrin, un brave débris, bon pied-de-bouc, sourd comme une trappe, qui, à une question sur les ordinaires, répondait que le temps était assez incertain. À eux deux, c’était du bon Courteline. » Pour le Commandant Grosset, commandant le 1er groupe : « Ce n’était pas un mauvais homme, mais quelle chiffe ! » ; 2e groupe (le sien), commandant Dautriche « C’était un bon cavalier, il avait été aux volants, mais comme artilleur, il était en dessous du médiocre : physiquement, il était très fatigué. » ; 3e groupe, le commandant « était un certain Marcotte, complètement gâteux. » et il conclut (p. 37) « bref, le régiment n’était pas commandé. » Après des débuts très peu concluants, tous ses supérieurs ont été changés en octobre 1914 (p. 39) « En résumé, nous avons laissé au dépôt, en partant, un lieutenant-colonel et un chef d’escadron et, au bout de deux mois de campagne, le général commandant le 10e corps, le général commandant la 19e division, le colonel et trois chefs d’escadron étaient limogés. »
La guerre de mouvement
Jean Leddet sait raconter, et son récit des engagements d’août et septembre 1914, tout en étant très vivant, est d’une grande précision documentaire, ainsi du premier contact avec l’artillerie ennemie (21 août, Sambre, p. 50) « vers deux heures de l’après-midi nous entendîmes un sifflement prolongé et un obus vint s’abattre à un kilomètre sur notre gauche, dans une plaine où se trouvait le groupe Grosset : l’éclatement produisit une fumée noire et un bruit effroyable : c’étaient les premiers 15 que nous voyons tomber. On se regarda. Ça, ça n’était plus du jeu. On nous avait ressassé les oreilles que l’explosif de 75 était supérieur à tout ce qui existait dans le genre, que le 15 allemand n’éclatait que rarement… C’est que celui-ci éclatait joliment bien ! » Il est à la fois sobre et critique pour décrire l’engagement de Fosse (22 août) et les hésitations de son chef de groupe. La participation à la bataille de Guise se passe mieux, mais défilés, ses 75 tirent au-delà d’une butte, sans contact visuel ni possibilité de régler ; les Allemands se rapprochent, il le constate aux ordres de diminution progressive de portée, et au bruit métallique que font les balles sur son bouclier, au sommet de son échelle de chef de batterie. Plus de munitions au moment où les Allemands émergent et qu’arrive l’ordre d’amener les avant-trains sous les balles et les shrapnels, « À ce moment, je vis nettement les Allemands se profiler sur la crête, à 1400 mètres devant moi. Jamais je n’ai autant regretté de ne pas avoir un ou deux caissons pleins de cartouches à leur vider dessus. »
Autour de la Marne
Il attribue les piètres résultats de sa 19e DI aux maigres possibilités laissées, pour l’entraînement, par le terrain de Coëtquidan. Ainsi, (p. 71) « contre une infanterie aussi manœuvrière, nos troupes du 10e corps, que le terrain couvert de Bretagne réduisait à des évolutions de compagnie, n’étaient pas de taille. » Il s’élève aussi contre les journaux qui prétendent que les régiments de réserve ont sauvé la mise au moment de la Marne (p. 71) « Je ne sais pas ce que valaient les régiments de réserve des autres corps d’armée, mais ceux du 10° corps n’étaient bons qu’à foutre le camp. C’était forcé, aussi, avec leur organisation. » La journée du 6 septembre est bien décrite, mais avec un bilan décevant pour l’auteur, à cause de l’inefficacité de l’infanterie devant lui (p. 81) « Salauds de fantassins…manœuvrent comme des crétins… pour une fois qu’on pouvait avoir la victoire, ils loupent la commande…». Il décrit une intéressante tentative empirique de réglage de tir improvisée avec l’aviateur Vuillemin, à son avis couronnée de succès (p. 83). Certains tirs de concentration donnent de bons résultats, mais au final (p. 91) « Le fantassin breton était un brave type, mais les échecs de la Sambre et de l’Oise l’avaient découragé et il n’avait pas surmonté la passivité naturelle de son caractère. Quant à l’artillerie, on peut juger, d’après ce que j’ai dit, de la nullité de son rôle. Aucune liaison, aucune pratique du tir à grande distance et sur la carte. Nous nous bornons à faire des évolutions et à changer de position de batterie. » Le 7e RA est arrêté devant Reims et il y est légèrement blessé.
Guerre de position et offensive d’Artois
Sa batterie est en position au sud puis au nord d’Arras en octobre 1914, et les tirs sont peu fournis à l’automne, à cause du manque de munitions. Il décrit une tranchée allemande du secteur d’Écurie-Roclincourt (p. 128-129), qu’il a pu visiter après les avancées de mai 1915 «(…) les Allemands avaient fait leurs abris à l’épreuve du 155, alors que nous n’avions que du 75. C’était toute la différence d’organisation de deux peuples : après cela, on jugera des bobards des journaux français, qui prétendaient que les Allemands ne s’occupaient pas de leurs hommes, tandis que c’était tout juste si les nôtres n’étaient pas bordés chaque soir dans leur lit, par un de leurs officiers ! » Il décrit le 9 mai, à Roclincourt, l’attaque qui est tout de suite manquée, les hommes établis sur le parapet déclenchant en retour un « terrible feu de mousqueterie (…) il y avait au moins 15 mitrailleuses en action ! » (p. 132). Le récit des attaques d’Arras en juin et juillet 1915 est aussi de bonne qualité.
Verdun 1916
Le groupe de l’auteur est engagé d’abord dans le secteur de la forêt de Hesse, puis en juillet à Montzéville, derrière la côte 304, mais tirant sur le Mort-Homme. Au repos début août en Haute-Marne, il y rencontre le célèbre dessinateur Georges Scott (p. 199), « dit l’Alpin Scott car il était en vague tenue de caporal d’alpins. C’était un petit gros, rond comme une boule. Sainte-Beuve qui était un poussah regrettait de ne pas avoir été lieutenant de hussards. Scott compensait la rondeur en ne dessinant que des militaires hauts sur pattes. Au demeurant, brave type et très occupé de ses fonctions de directeur de Théâtre du front [note de J. Leddet: « encore une de ces fumisteries pour embusqués qui donnaient des représentations à d’autres embusqués. »]. Il évoque ensuite ses tirs à Verdun (rive droite), en août 1916 (p. 204) « Nous tirions sur une tranchée du bois Nawé, qu’on ne pouvait voir que du saillant d’Hardaumont. Six kilomètres à vol d’oiseau et douze kilomètres de fil ! [haché en permanence] On avait la communication un quart d’heure par semaine, autant dire jamais. On a essayé de vérifier nos tirs de toutes les façons possibles, par observateur terrestre, par avion : on n’a jamais pu y arriver. C’est une situation odieuse pour un commandant de batterie, et malheureusement il n’y a pas grand-chose à faire. » »
Secteur du Cornillet (du 24 avril au 1er juin 1917)
La 19e DI participe aux assauts du Mont Cornillet, mais c’est un échec le 30 avril, et le 4 mai « ce fut bien pire » (p. 240). Il évoque les problèmes de réglage, de demandes de barrage et de coups courts liés à la malfaçon des obus, mais il a son explication (p. 241) : « Quoi qu’il en soit, j’ai constaté une chose : quand la 48e division, une vraie division d’attaque, celle-là, [formée de tirailleurs et de zouaves] a relayé la nôtre, vers le 15 mai, nous n’avons plus jamais entendu parler de coups courts… et nous avons pris le Cornillet ! » Malgré ce succès tardif, le général commandant la 19 DI est menacé de sanction, et réussit à s’en sortir grâce à ses appuis politiques (p. 246) « il avait employé le procédé classique : il avait débarqué son artillerie. C’est la faute à l’artillerie ! » J. Leddet fait partie de la charrette, et est rayé du tableau d’avancement.
1918
Il se fait nommer instructeur à Fontainebleau en février 1918, puis la création d’une subdivision de l’école l’emmène à Sézanne puis à Joigny, où il passe l’été à instruire des sous-officiers d’artillerie « c’était la vie de garnison. » (p. 273). Il fait venir sa femme, et enchaîne avec l’organisation d’un nouveau cours : « On n’en voyait pas la fin (juillet 1918) et je me dis que trois mois de plus de tranquillité, avec Jeanne, seraient toujours les bienvenus. ». Il est surpris par l’Armistice alors qu’il se préparait à reprendre un commandement sur le front.
« Lignes de tir » est un des meilleurs textes produit sur la guerre pour l’artillerie : précis et didactique, on ressort de sa lecture plus savant, comme breveté après un stage à Fontainebleau. Le ton Leddet, acerbe et cynique, par sa méchanceté envers les Bretons, les Méridionaux, les Parisiens ou les brancardiers, amuse souvent mais lasse aussi : notre capitaine a dû exaspérer plus d’un supérieur, et sa morgue lui a certainement coûté beaucoup pour son avancement. Avec ce texte, on constate de nouveau qu’on trouve les meilleurs témoignages dans des corpus tardifs, correspondances ou textes personnels, non destinés à la publication, et donc dégraissés du poids énorme de l’autocensure. Il suffit de reprendre en comparaison un témoignage d’artilleur, même de bonne qualité, publié au début des années vingt : ce n’est pas la même guerre, on a l’impression que ces témoins, même honnêtes, ne disent à peu près rien. Ainsi le temps long, qui se retire comme la marée sur la grève, libère l’estran : excellente perspective, qui nous fait déjà saliver sur de futures pépites.
Vincent Suard, mai 2025
Monnet, François (1900-1937)
Résumé de l’ouvrage :
L’abbé François Monnet. Chapelain de Saint-Dié. Curé du Thillot. 1900-1937 par l’Abbé X. Charles, Imprimerie Coopérative Saint-Michel, 1938, 109 p.
François, Marie, Camille Monnet naît le 16 octobre 1900 à La Bresse, dans les Vosges. Troisième d’une famille de huit enfants, deux sœurs le précèdent. Son père est fondé de pouvoir de M. Bodenreider, industriel, et sa mère élève la fratrie dans la religiosité. Dès l’âge de 11 ans, il souhaite être prêtre. Après une première formation au presbytère de sa commune, il entre à 13 ans au petit séminaire de Mattaincourt. Son père est mobilisé alors que la commune n’est pas loin du front de la Grande Guerre dans les Vosges mais il poursuit ses études à partir de la réouverture de son établissement scolaire religieux en mars 1915. Ne pouvant rejoindre Saint-Dié, sous la menace des canons allemands, pour intégrer le grand séminaire, il poursuit à Mattaincourt et c’est étudiant qu’il vit l’Armistice, qu’il décrit quelque peu. En octobre 1920, il fait son service de deux années au 170e R.I. qui tient garnison en terre allemande, à Kehl. Il est caporal, nommé secrétaire du chef de bataillon. La fin de la guerre est pour lui une période de trouble qui correspond au basculement de la guerre à la paix mais également à un après-guerre qui questionne sa foi comme sa vie de jeune adulte dans les prémices de la Belle Epoque. Il dit, peu avant l’Armistice, le 2 novembre : « Moi-même ne suis-je pas un représentant du XXe siècle ? » (p. 12), poursuivant en écrivant : « Si je n’étais pas chrétien, je serais un Renan, sensible, porté à une métaphysique nuageuse, avec des attraits de mysticisme, cherchant toute jouissance d’esprit et de cœur ; peut être de plus basses » (p. 13). Son biographe décrit ses sentiments le soir du 11 suivant, entrevoyant « une vague de jouissance qui va déferler » faisant tressailler son âme sacerdotale devant un « débordement de plaisirs » : Le jeune séminariste dit : « Quelle va être mon attitude à moi ? Quelle doit être l’attitude d’un prêtre et d’un séminariste devant ces événements ? Il me semble qu’il faut répondre : compenser par des mortifications… Voici une nouvelle ère de l’histoire du monde » (p. 16). [Car il pratique la mortification et plus loin il en décrit les instruments : cilice, bracelet, privations de vin, heure de travail parfait, bréviaire debout, travail à genoux, dizaine de chapelet bras en croix, etc. (page 65)] Son temps militaire effectué, il entre, en octobre 1922 au grand séminaire de Saint-Dié. Il est nommé prêtre le 5 avril 1924 et nommé vicaire à la paroisse Saint-Maurice d’Épinal dès le 11 suivant. S’en suivent de multiples affectations (curé d’Housseras en 1928-1929), missions et direction spirituelle dans les Vosges avant d’être nommé curé du Thillot en 1935. Le 26 janvier 1937, il est victime d’un accident de moto sur la route du Thillot à la Bresse et meurt à l’hôpital de Remiremont le 3 février suivant à l’âge de 37 ans.
Commentaires sur l’ouvrage :
Cette biographie compréhensiblement laudative vaut par l’âge de son sujet, qui, de 14 à 18 ans, vit la Grande Guerre au petit séminaire de Mattaincourt. Ne tenant pas de carnet, sauf quelques rares éléments repris dans un court cahier de notes tenu du 21 octobre au 20 novembre 1918, ce livre n’est pas un témoignage de guerre. De fait, très peu de références au conflit ne sont contenues dans cet ouvrage, à rapprocher des souvenirs de l’abbé Alphonse Haensler dans son ouvrage Curé de campagne par le parcours d’un prêtre vosgien contemporain de la Grande Guerre. L’ouvrage recèle quelques photographies. Sont cités dans l’ouvrage en notes plusieurs prêtres Vosgiens contemporains dont l’aumônier Gustave, Paul, Henry, né le 31 juillet 1875 à Mattaincourt et mort pour la France le 29 juin 1916 à La Grange-aux-Bois, près de Sainte-Menehould dans la Marne (page 45).
Yann Prouillet,16 avril 2025
Marchand, Rémy (1895-1981)
Les Mémoires d’un poilu d’Aunis
1. Le témoin
Rémy Marchand vit dans une famille de cultivateurs à Boutrit, près de Surgères (Charente-Maritime) lorsqu’il est incorporé (classe 15) en septembre 1915 au 57e RI. Il part pour le front en février 1916 dans l’Aisne, est déployé à Verdun, dans la Somme, puis en Alsace et dans l’Oise. Blessé à Saconin (Aisne) en mai 1918, il revient en ligne en septembre, puis participe à l’offensive au sud de Saint Quentin. Après l’Armistice, il passe par Mulhouse puis participe à l’occupation en Allemagne.
2. Le témoignage
Les Mémoires d’un poilu d’Aunis – Un si long cauchemar, de Rémy Marchand, a été publié aux éditions L’Harmattan (2009, 239 pages). Sa fille Suzanne précise en introduction que son père avait ramené de la guerre des calepins de poche, et qu’il les avait retranscrits sur des cahiers verts les soirs d’hiver. Elle ajoute également qu’il avait rendu de nombreuses visites aux voisins des environs qui avaient perdu un proche à la guerre : « Rémy, si bon et compatissant, nous a aidés à faire le deuil de ceux que nous aimons » ont témoigné ces voisins.
3. Analyse
Ces mémoires d’un soldat paysan charentais, qui en fait sont plutôt des carnets, décrivent l’itinéraire d’un combattant de 1915 à 1918, il note les faits du quotidien, insistant davantage lorsqu’un incident vient briser la monotonie des jours. Il passe rapidement sur ses classes au camp de Souge, évoque sa joie d’endosser l’uniforme militaire (septembre 1915) puis l’ambiance festive et avinée lorsque son train s’ébranle vers le front (février 1916, p. 17) : « Vive le 57ème, vive l’armée ! ».
Rémy Marchand raconte son engagement à Verdun en mai 1916, il est en ligne devant le fort de Vaux, travaillant la nuit à relier entre eux des trous d’obus. Réfugié dans le fort pendant la journée, il insiste sur la violence du bombardement et surtout sur la soif. Il participe à un transport de 80 blessés brancardés dans l’obscurité de Vaux à Tavannes ; ils se perdent « dans la nuit noire », tombant constamment dans des trous d’obus, c’est pour lui l’épreuve la plus dure qu’il ait connue à Verdun. Peut-être y a-t-il ici l’influence de lectures postérieures, car il évoque le commandant Raynal organisant la défense du fort. Il émet aussi une appréciation positive sur sa hiérarchie (p. 36) : «Le colonel et le commandant avaient les larmes aux yeux en voyant les hommes tomber si nombreux.»
Après retrait et temps de repos, il est en ligne en Argonne au Four de Paris. Son régiment fait ensuite à l’automne 1916 (Marne) de nombreux exercices destinés à la formation des officiers (nouveautés tactiques, gaz, canon de 37 mm, p. 53) : « On nous fait faire beaucoup de chemin pour apprendre à nos officiers à commander. » En décembre 1916, les hommes du 57e alternent marches et repos autour de Paris, ils font plus de 250 km de marche, il dit n’avoir jamais su pourquoi. Une note ultérieure (p. 56 note 1) explique pourtant : « J’ai su depuis que nous étions dans la banlieue parisienne comme troupe de secours : on craignait une émeute dans la capitale. »
À partir de janvier 1917, il raconte qu’il a noué des relations avec des « pays » à l’arrière, ce qui lui permet de se faire connaître au train de combat comme capable de conduire les voitures et de soigner les chevaux. Pendant toute la guerre, il sera ainsi une sorte de « titulaire remplaçant », s’occupant des chevaux des officiers en permission, ou prenant temporairement la place de conducteurs absents, ce sont pour lui des postes recherchés car ils lui permettent d’éviter la 1ère ligne et les gardes (p. 75) : « Me voilà en selle sur la route, au milieu de la file de voitures, fouet en main, pipe aux dents. »
Il n’attaque pas avec son unité le 16 avril, étant en ligne en soutien, et fait sa première attaque le 5 mai devant Craonnelle ; c’est une action locale, ils font 14 prisonniers mais ont 18 tués à la compagnie. À l’été 1917, en Alsace devant Altkirch, il effectue divers remplacements (agent de liaison, ordonnance d’un capitaine), continuant à aller souvent visiter les conducteurs (p. 102) « pour avoir la possibilité de venir remplacer ceux qui partent en permission, ce qui m’évite à chaque fois 15 jours de tranchée. » Il apprécie l’Alsace, la vue sur Altkirch, surtout le dimanche où on aperçoit les civils aller à la messe sans qu’un coup de canon soit tiré, et il trouve les Alsaciennes très gentilles, tout en déplorant (p. 108) « qu’elles ne parlent pas beaucoup notre langue. »
En mars 1918, son unité est alertée pour aider les Anglais en repli à Noyon, il y décrit le pillage d’un dépôt anglais abandonné, le problème étant l’incompréhension des étiquettes des conserves : c’est lourd, et cela vaut il le coup ? Pour le rapport poids-valeur, ce sont les boîtes de 500 cigarettes qui étaient les plus intéressantes. Ils manquent d’être encerclés dans Noyon, puis il décrit les combats au Mont Renaud (57e RI, à croiser avec G. Gaudy), avec les attaques allemandes (trois charges d’infanterie en une journée), c’est très sanglant pour les assaillants, avec aussi des pertes sérieuses pour les défenseurs. Après un répit à l’arrière, il est affecté au fusil mitrailleur avec deux camarades (p. 147) : «Cela ne me sourit guère parce qu’en cas d’attaque, il est bien rare que l’équipe d’un fusil mitrailleur (…) ne soit pas atteinte. Cette arme étant redoutée de l’ennemi, on est plus tôt repéré que les autres camarades. » Il raconte une attaque allemande d’infanterie à découvert, avec lance-flamme, en intitulant son sous-chapitre « Une attaque vue de 100 mètres ». Les Allemands sont fusillés en masse, les porteurs de pétrole brûlent avec leur liquide, et les survivants refluent en désordre, on retrouve fréquemment à cette période (mars à mai 1918) le récit de ces assauts allemands compacts très meurtriers pour eux, une fois la ligne de résistance anglaise et française établie (p. 148) : « Si la distance à parcourir par l’ennemi avait été plus grande, nous avions le temps d’en abattre les trois quarts au moins. » Les pertes pour le 57e sont lourdes dans ce secteur de Noyon, et R. Marchand fini par être blessé légèrement de deux balles, à l’assaut de la ferme de Saconin le 30 mai 1918.
Soigné à l’ambulance, il est évacué à la Salpetrière à Paris, raconte la souffrance quotidienne du pansement, et est surtout préoccupé par son manque d’argent car il ne lui reste plus que 2 francs (p. 164) : « une pièce de quarante sous pour faire le garçon à Paris, c’est peu ! » En juin et juillet, il est en convalescence à Menton, il se promène beaucoup, décrit tout ce qu’il voit, et est autorisé à faire une promenade en Italie au-delà de la frontière : on est loin ici des proscriptions à la frontière pyrénéennes, à cause de la crainte des désertions.
Réintégré au 57e en septembre 1918, il retrouve un remplacement de cuistot et il se plaît dans cette fonction, c’est l’occasion de décrire une journée de travail à la roulante, avec les horaires, les préparations, les feux sous les différents contenants, ce sont deux pages (p. 197 et 198) très utiles pour voir comment fonctionne dans le détail une cuisine au front. Malheureusement pour lui, il doit quitter son filon fin octobre pour attaquer, car il est le plus jeune et célibataire. Il est «très ému : la perspective d’une attaque n’a rien de bien gai. » Il réussit à s’en sortir, mais dans son unité très touchée, le moral est mauvais et tout le monde a le cafard. En permission le 4 novembre, il apprend l’Armistice en Charente par les cloches, alors qu’il est à la chasse. À Mulhouse en décembre 1918, il décrit l’Alsace libérée, et la roulante est bien vue, car ils donnent les restes à « une foule de femmes et de gosses de la ville. » Pour l’aspect pittoresque du dimanche mulhousien, il explique dans une salle de danse le « faites passer la monnaie » du bal alsacien (p. 225) : « Chaque séance dure quelques minutes seulement. À mesure que la musique s’arrête, 5 ou 6 garçons de salle en livrée comme des laquais, ramènent tous les couples à la caisse au moyen d’une longue corde, qui ramène ainsi tout le monde. Chaque couple remet un billet pris à l’avance ou 0.25 fr. » Après une longue station dans le sud de l’Alsace, puis en Allemagne du Sud, il est démobilisé en septembre 1919.
Donc un récit assez factuel, souvent monotone, mais un tableau utile de Verdun ou de Noyon, et surtout de la guerre de mouvement à partir de mars 1918, avec le rôle central et meurtrier des mitrailleuses dans ces combats d’infanterie en mouvement. Intéressante et originale est aussi la description de la stratégie personnelle de l’auteur comme remplaçant conducteur, ordonnance ou cuistot, ce qui lui permet d’améliorer grandement son quotidien de poilu du rang.
Vincent Suard, septembre 2024
Grivelet, Maurice (1888 – 1972)
« Mémoires d’un curé : Fantassin, Aviateur, Résistant ».
1. Le témoin
Maurice Grivelet, fils d’un vigneron bourguignon, est vicaire à Sélongey (Côte-d’Or) en août 1914 et sous-lieutenant de réserve. Mobilisé au 44e RI, il est blessé le 8 septembre 1914. Revenu en ligne en mars 1915, il est alors lieutenant au 104e RI jusqu’à août 1916, passant ensuite dans l’aviation. D’abord officier-observateur puis pilote, ce capitaine commande en 1918 l’escadrille So 252 (sur Sopwith). Démobilisé en août 1919, il reprend ses fonctions ecclésiastiques mais effectue aussi des périodes de réserve dans l’armée de l’air. Mobilisé en 1939, il échappe à la captivité ; résistant en Côte d’Or à partir de 1942, il rejoint ensuite la cure de Saulx-le-Duc en 1945.
2. Le témoignage
La Société d’Histoire Tille-Ignon a réédité en 2019 les Mémoires d’un Curé : Fantassin, Aviateur, Résistant (112 pages). Le site EGO 1939 – 1945 signale une première édition « chez l’auteur » en 1970. L’auteur signale que c’est à la demande de son neveu qu’il a écrit ses mémoires, la rédaction en a été faite pendant l’hiver 1964 – 1965. La partie qui concerne la Grande Guerre va de la page 15 à la page 68. Merci pour son aide à Serge Thozet, président de la Société d’Histoire Tille-Ignon.
3. Analyse
Un curé sac au dos et galon au bras
Jeune séminariste, Maurice Grivelet remplit ses obligations militaires de 1909 à 1911 et devient sous-lieutenant de réserve : la vie militaire ne lui déplaît pas. Il entre en Alsace en août 1914 avec le 44e RI de Besançon (entrée dans Altkirch puis Mulhouse), puis évacue la région ; rapidement transporté en Picardie, il évoque les combats des 6, 7 et 8 septembre auxquels il participe (bataille de l’Ourcq) ; revenu au front après blessure en 1915, il raconte les préparatifs de l’offensive de Champagne au 104e RI, avec le creusement des parallèles de départ à 300 mètres devant la première ligne française. Il est dans le bataillon de réserve le matin de l’offensive du 25 septembre, mais le soir, il doit rejoindre seul vers l’avant une compagnie d’attaque du matin qui n’a plus de cadres, et c’est l’occasion (p. 41) d’une description saisissante de l’état de ces hommes épars et épuisés, faite par un officier encore frais.
André Guéné
Le récit comprend auparavant un épisode d’enfant-soldat. Le 2 septembre, le sous-lieutenant Grivelet découvre dans sa section un enfant de douze ans qui a fui de chez lui et qui veut rester avec eux. L’auteur réussit à le confier à un aumônier dans une voiture d’ambulance, mais il faut l’y faire entrer de force, malgré ses pleurs et ses cris. Le soir venu, André qui s’est sauvé et a réussi à les rattraper (p. 22) « Je fus bien obligé d’adopter – provisoirement – ce pauvre gosse. Le moyen de faire autrement ? » Blessé le 8 septembre, l’auteur voit le jeune garçon lui ramener de l’aide sous le feu, ayant prévenu des soldats qui vont le transporter vers l’arrière. L’enfant reste avec lui lors de l’évacuation en train sanitaire, et ils sont logés ensemble à l’hôtel Riva Bella (Calvados) transformé en hôpital (p.31), «un petit lit fut installé pour André dans ma chambre. ». Un député du Calvados, Fernand Enguerrand, qui fait la tournée des blessés, lui demande qui est cet enfant, et deux jours après, l’histoire est dans « l’Écho de Paris » (p. 31) « et je lu, en caractères d’un centimètre, le titre d’un article de deux colonnes en première page : « Un enfant héroïque ». » L’auteur doit rédiger sans notes, puisque l’article (voir site BNF Rétronews), est sur une seule colonne (bas de la Une, 19 septembre 1914) et a comme titre « Un héros de douze ans » : l’essentiel correspond toutefois. Le plus intéressant de cette histoire réside dans ses suites (p. 32) « une énorme correspondance venue des quatre coins de la France : parents, amis, curés, instituteurs, etc… me demandaient des photos, des détails sur l’aventure d’André. « Je ferai ma première classe sur cet « Enfant héroïque » m’écrivait l’un de ces instituteurs. Des cartes postales furent mises en circulation, me représentant la tête bandée, appuyé sur l’épaule d’André, avec en arrière-plan, des obus qui éclataient, des cavaliers qui chargeaient… » Nulle part dans l’article, le député ne dit que M. Grivelet est prêtre. Celui-ci quitte André, dont on ne connaît pas le destin ultérieur, lorsqu’il part en convalescence.
Aviation
L’auteur a fait une première demande pour entrer dans l’aviation à l’automne 1914, sollicitant dans le même temps son autorité hiérarchique religieuse. L’évêché de Dijon lui a répondu (p. 33) « sans vous le défendre, suis d’avis de vous abstenir. » Il obéit, mais signale que « le démon de l’aviation n’était pas exorcisé en lui ». Il souffre de l’hiver en Champagne, « Ville-sur-Tourbe, ce nom dit tout » (p. 42), ne se sent pas d’atomes crochus avec les Normands du 104e RI puis refait une demande pour l’aviation, qui est acceptée en août 1916. « Aviateur! Le rêve de ma vie. » (p. 47). Passé capitaine, il est formé comme observateur au Plessis-Belleville, puis vole à la C 56 (sur Caudron). Il raconte ses missions photo, et évoque l’échec de l’aviation le 16 avril, à cause des mauvaises conditions météorologiques : « Nous ne servions à rien, il ne nous était pas possible d’être utiles à quelque chose, mais il fallait tout de même foncer dans la tempête de neige au ras des sapins, ou de ce qu’il en restait. » (p. 53). Il vole d’abord seulement comme observateur, puis il est formé au pilotage, notamment par Octave Lapize (p. 54), par ailleurs vainqueur du Tour de France cycliste 1910. Ce curé peu conventionnel semble goûter la coquetterie « pilote » (p. 48) « Mais pour être aviateur, il fallait être chaussé de grandes bottes lacées et porter de grands galons en trèfle qui montaient jusqu’au coude. Avec quelques nouveaux arrivants comme moi, nous allâmes donc à Paris acheter bottes et galons. » On sait par ailleurs (témoignage « Trémeau ») que ces bottes sont chères et que les sous-officiers pilotes n’ont souvent pas les moyens de s’en procurer, ce qui est source d’humiliation. Il prend ensuite le commandement de la So 252 sur Sopwith, narre quelques anecdotes dont une évoquant le mépris du général Schmidt (erreur sur la 163 DI, c’est plutôt la 167 DI, p. 57) : « Aviateur ! morphinomane, cocaïnomane, qui dans un accès de folie montez en avion pour faire des pitreries au-dessus des tranchées… » Il fait aussi une description intéressante de la pagaille qui règne lors de la percée des Allemands en mai 1918 au Chemin des Dames (p. 58), l’infanterie française ayant perdu les fanions qui permettaient de reconnaître les unités : « On demanda à l’aviation de situer les lignes d’après la couleur des uniformes, ce qui nous obligeait à descendre très bas. Cela nous coûte cher et le plus souvent, les renseignements obtenus de cette façon, étaient erronés. (…). Des avions signalèrent des troupes françaises en marche sur telle ou telle route, et en réalité, il s’agissait de convois de prisonniers… ». Il évoque enfin un 11 novembre qui (p. 67) « fut plutôt une déception ; nous avions l’impression que cet armistice était prématuré, et que l’armée allemande n’était pas assez vaincue (…). Notre pressentiment n’était que trop justifié. » Il faut s’interroger sur ce type de jugement écrit en 1965, longtemps après l’événement, les autres carnets n’évoquant que très rarement ce type de déception dans leur mention du jour de l’Armistice. Notre capitaine – aviateur – curé est démobilisé le 1er août 1919, et rejoint la cure du village de Saulx-le-Duc qu’il ne quittera plus.
Un curé peu banal
Curieux prêtre que ce truculent militaire, aviateur enthousiaste et par ailleurs grand chasseur de sanglier. Certes les membres du clergé en même temps officiers de réserve ne sont pas rares, et on connait d’autres religieux pilotes, comme le missionnaire Léon Bourjade, chasseur de Drachen en 1918, mais celui-ci se caractérise d’abord par sa réserve, ce qui n’est pas le cas de M. Grivelet, très à l’aise dans ses bottes d’aviateur. La suite des mémoires évoque l’Occupation, avec la résistance de l’auteur du côté gaulliste, et il a à la Libération le grade de Lieutenant-Colonel F.F.I., avec des responsabilités à l’E.M. de Dijon. On ne peut s’empêcher de s’interroger : pourquoi un sujet aussi brillant n’a-t-il desservi pendant toute sa carrière que la petite paroisse du village de Saulx-le-Duc, soit pendant près de 50 ans ? Sa mémoire y est restée populaire, mais ses relations avec son évêque n’étaient pas bonnes, et les renseignements fournis par l’association historique locale montrent que la raison pourrait en être une trop grande proximité, établie sur la durée, avec une paroissienne du lieu.
Vincent Suard, février 2024
Pichot-Duclos, René (1874-1968)
Le témoignage
Le général René Agis Pichot-Duclos (9 mai 1874 – Fort d’Aubervillers (93) – 18 janvier 1968 – Biviers (38)), d’un père officier, présente dans ce fort volume les souvenirs des deux grands temps forts de sa vie militaire, de sa formation (enfance, écoles, premier régiment, Ecole de Guerre, états-majors et temps de commandements) à son affectation au 3e Bureau du GQG de Joffre, ce jusqu’à la fin de l’année 1915. Il y rapporte et dépeint son action comme les dessous du commandement des grandes unités au cours des différentes phases de la guerre jusqu’à son affectation, à la toute fin de 1915, au commandement du 11e BCA (qu’il commandera effectivement du 10 février au 26 octobre 1916). Par ses yeux et son esprit incisif, on entre dans l’intimité des états-majors et il n’élude rien des personnalités, innombrables, qu’il côtoie, parfois juge et critique ou encense avec une liberté de ton indéniable et directe. Très en lien avec les états-majors des grandes unités qui combattent à l’Est sur la ligne de feu, il renseigne très largement sur les actions de commandement et d’organisation des secteurs dirigés par le général Dubail et ses subordonnés dont on retrouve la liste dans une imposante table des noms cités (près de 700 noms) qui témoigne à elle seule de l’intérêt documentaire des souvenirs de ce lien entre le haut commandement et la guerre appliquée sur les différents théâtres d’opérations. L’ouvrage regorge ainsi d’anecdotes ou de chapitres qui partent dans une infinité de directions tant sur la formation militaire que sur différents aspects qu’il touche au fur et à mesure des activités d’analyse et de lien avec l’état-major de Joffre, fournissant ainsi un regard précieux du début de la guerre à toute l’année 1915. Ainsi, il évoque pêlemêle sa genèse d’une vocation aéronautique, les analyses des offensives de 1914 (La Marne et ensuite), l’adaptation à une guerre longue après le rétablissement de septembre, le GAE et les grandes attaques sur les Vosges, les études, recherches, travaux et réalisations, comme ses réflexions, sur de nombreux sujets divers, y compris sur certains fronts extérieurs.
Général Pichot-Duclos, Réflexions sur ma vie militaire. Au G.Q.G. de Joffre. Souvenirs, Paris, Arthaud, 1947, 399 pages.
Commentaires sur l’ouvrage :
Très autocentré bien entendu et donnant le plus souvent la part analytique la plus profonde et effective à ses actions et analyses, ce témoignage, qui allie en effet souvenirs (dont il dit, page 99 « les présents souvenirs sont écrits sans consultation d’une seule note pour l’excellente raison que je n’en ai pris au cours de ma vie que pendant les dix-huit mois vécus au GQG. ») et réflexions, en forme d’autobiographie sur le temps long de sa formation, écrit après la 2e Guerre mondiale, dont il fait parfois, voire souvent référence, est précieux car profond et précis. Eludant peu de noms, y compris sur l’ensemble de sa période très observatrice et rédactionnelle au GQG, il s’érige en témoignage incontournable pour toute étude concernant le haut commandement, son fonctionnement, les hommes qui le composent, concourant à la petite comme à la grande Histoire. Ce fort volume est un livre de souvenirs très documenté et le plus souvent très opportun pour qui veut connaître le « dessous des cartes » de l’Etat-Major de Joffre pour toute la période 1914 et 1915, surtout à l’Est. Il est en effet plus spécialement affecté à la liaison avec la 1ère armée de Dubail, abondamment cité, et dont on peut facilement dégager un portrait. Il y démontre l’extraordinaire complexité de la gestion d’une guerre moderne, avec son infinité d’hommes et de paramètres à prendre en compte. Le livre est également référentiel sur le haut commandement du front des Vosges pour la période du 6 septembre 1914 à décembre 1915. Il l’est aussi en filigrane sur l’aviation de la période 1913-1915, l’auteur ayant occupé une position en lien avec l’organisation de l’arme aérienne militaire et ayant profité de sa fonction à l’entrée de guerre pour tenter de passer le brevet de pilote. Il serait intéressant d’en dégager l’ensemble des passages et de les comparer avec son ouvrage.
L’ouvrage n’est pas iconographié mais comporte quelques cartes, contient très peu d’erreurs et est agrémenté d’une table patronymique et toponymique.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Plusieurs tableaux intéressants dans de nombreux emplois divers dans lequel l’auteur a eu une action, soit en formation, soit comme « observateur », soit dans les prises de décision de commandement ou de critique de celui-ci.
Extrait utile de la table des matières :
Formation : Enfance et écoles, mon premier régiment : Sous-lieutenant (76e RI) à Paris, lieutenant à Orléans, l’Ecole de guerre : chefs, professeurs, choix d’un Etat-major, Etats-majors et temps de commandement : Lyon, ; Grenoble, crises et troubles (dont vinicole), commandant de compagnie alpine (5e Cie du 158e à Lyon), grandes manœuvres (1909).
La Grande Guerre vue du GQG : Avant-guerre et début de l’aviation militaire, à Nancy (garnisons de Nancy et Toul), Genèse d’une vocation aérienne et section d’aéronautique du ministère, direction, organisation à la veille de la guerre
Entrée en campagne : certitude et préparatifs, couverture, appel du 3e bureau et ses conséquences, son rôle avant et après La Marne, exécution du Plan XVII à la 1re Armée, réhabilitation de l’offensive, Dubail et son Etat-major, contrôle parlementaire, l’épreuve de la 2e armée, plans consécutifs à La Marne.
Stabilisation progressive du Groupes des armées de l’Est
Front de Woëvre, officiers de liaison, coup d’œil sur la 4e armée, front mouvant des Vosges en 1914, déplacement présidentiel, front de Lorraine, Rocques et Dubail ; reconstitution et emploi des réserves, opérations sous bois, note du 16 avril 1915 et ses applications, second déplacement présidentiel, offensives des Vosges, Maud’huy, assauts du Linge, Hartmannswillerkopf, mort de Serret, « les cas » Sarrail et Schérer, mutations des grands chefs.
Pendant la stabilisation, études, recherches, travaux et réalisations : unités au repos, reconstitution et instruction, utilisation des ressources et places, recherche et expérimentation de matériels nouveaux, guerre des mines et des gaz, questions de 2e Bureau, rédaction de règlements et codification des enseignements tactiques, enseignements et réflexions tirés de la bataille de Champagne, mesures prises en vue de l’hiver, nuages sur Verdun, conduite progressive de la guerre, un match au sujet d’Alexandrette, l’intervention bulgare, les Dardanelles et Salonique et ses difficulté de commandement, velléités roumaines et plan d’opérations, mainmise de Joffre sur le théâtre balkanique, conférences interalliées et leur préparation, choix d’un adjoint, les distractions de Chantilly et Départ.
Annexe : Voyage dans les Vosges les 10 (Gérardmer), 11 (Epinal, Saint-Amarin, Moosch) et 12 février (Belfort) 1915.
Notes de lecture
Page 14 : Général (non cité) enterré avec son épée
32 : Galon d’Anspessoir (1re classe) donné aux 75 premiers au classement fait à Pâques
33 : Chien vert : dans l’argot de Saint-Cyr, nom donné au Sergent-major
56 : Les premiers 75 distribués en unités circulant en ville recouvert d’une housse sombre pour dissimuler son frein et sa hausse indépendante
83 : Vue des Gros Frères, les Cuirassiers
89 : Sur le système de fortification d’Epinal, réponse à la question
106 : Sur la guerre en montagne
122 : Bruit de la balle, « méthode de calcul des distances basée sur le phénomène de claquement que produisent les balles pendant qu’elles parcourent certaines parties de leur trajectoire »
140 : Sur Andlauer (vap 318)
: Réquisition des véhicules
141 : Lit du général Bailloud placé face à l’Est à Nancy
: Plan des mots de passe à Nancy
153 : Mort d’Edouard de Niéport, dit Nieuport par accident d’avion à Verdun
154 : Ecrit (en 1912 alors qu’il était capitaine) Les Reconnaissances en aéroplane, publié par Imhaus et Chapelot, éléments et chiffres de tirage et de ventes.
173 : Epuration du commandement (vap 206 et 334)
177 : Nombre d’escadrilles en août 14 ; 22 + 3 récupérables
178 : GQG restreint : Pichot-Duclos, Lt-col Buat, Brecard, col Paquette
181 : Habite 7 rue Valentin Haüy le 4 août 14
: Sur le retrait des 10 km
: Foch, 20e Corps (Nancy), Legrand-Girarde, 21e Corps (Rambervillers), leur personnalité dans leur bureau, trajet, temps et conducteurs (Boileau et Rigal, pilotes de course Paris-Belfort)
183 : Sur la rumeur de tranchées allemandes creuses dès le temps de paix en Lorraine
184 : Joffre dit : « J’aime mieux faire commander des divisions par des capitaines que de les laisser aux mains de gens incapables de les conduire ».
: Les stratèges sont les officiers qui ont fait une troisième année à l’Ecole de Guerre
: Veut profiter de sa position pour passer le brevet de pilote ; il dit « le mauvais départ de notre organisation d’aviation, la peine qu’elle avait à se militariser ».
187 : De Goÿs, chargé d’organiser l’aviation turque (en fait avril 1914 par Hirschauer, inspecteur de l’aéronautique militaire)
: Il précise son poste et sa réaffectation après La Marne
189 : Comment l’EM fonctionne à Vitry-le-François
190 : Opinion de Joffre le 6 septembre 1914 dans une école de Bar-sur-Aube : « … dans huit jours nous serons à genoux ! »
: Colonel Pont, chef du 3e Bureau
: Recul prévu un temps jusqu’au… Morvan, opiné par le Général Belin
194 : La Woëvre est censée envahie par la boue (colonel Poindron), mais les Allemands arrivent jusqu’à Saint-Mihiel
196 : (Note) Sur les inconvénients de la carte au 200 000e en deux couleurs, sans nivellement ni zone boisée
199 : Général Bastidon a fait une étude sur la bataille de Sarrebourg à Domptail
201 : Sur le rôle majeur mais sous-évalué de la forêt de Haye (vap 202)
202 : Dubail amputé (d’un pied en mars 1896 à la suite d’une chute de cheval)
203 : Son action sur les conseils de guerre spéciaux (vap 206 son Etat-major) et leur devenir
207 : Sur Saconney qui adapte le Drachen, de meilleure stabilité
22 : Raison du débarquement de Messimy (affaire du 15ème Corps) et devenir (fin 213)
216 : Renseignement récupéré à Coinches sur le moral allemand
226 : Nombre de coups par pièces et par calibres (155 et 120)
: Incident d’Apremont
228 : Sur les officiers de liaison, rôle, contact avec Joffre
233 : Général Gérard menteur, enquête de Pichot-Duclos (mais résultat non dit)
238 : « Le goût de la pioche n’était pas assez répandu dans l’infanterie qui avait en général trop compté sur le génie pour faire les travaux ; seul le colonel Barrard du 91ème s’était constitué une section de pionniers ; exemple à suivre ».
: Organisation du front d’Argonne chiffrée par compagnies d’une division
239 : Garibaldiens, valeur
241 : Front des Vosges
242 : Général Bolgert insuffisant pour « une région où le commandement à la fois compartimenté et distendu par le terrain devait être entre les mains de chefs susceptibles d’autonomie »
243 : Secteur du HWK et Serret
245 : Description du front des Vosges par Dubail : « Les Vosges ne sont pas un pays de montagne, mais un pays coupé et couverte. Sauf exceptions motivées par des vues particulièrement étendues ou intéressantes, les postes n’y sont pas faits pour garder du terrain, mais pour garder des gros »
: Belfort et le Général Thévenet
246 : Voyage de Poincaré dans les Vosges et en Alsace (vap annexe p. 376 à 380)
247 : Tardieu puis de Pierrefeu historiographes officiels des 3 premiers mois de guerre
249 : Poincaré ostensiblement non reconnu par une infirmière alsacienne
: Comment on choisit une infirmière religieuse alsacienne à décorer
251 : Front de Lorraine
258 : Utilise Minenwerfer au lieu de crapouillot
264 : « La crainte de Limoges » influe sur les chefs, et le pourquoi
: Observatoires dans les arbres
268 : Difficulté du combat sous bois et le pourquoi
: Sur les formules creuses des jusqu’auboutistes et qui ils sont
271 : Visite de Poincaré, donner l’illusion de la 1ère ligne et visite dans les Vosges, organisation en partie par Pichot-Duclos
273 : Sur la bataille des Hautes-Vosges de Pouydraguin
274 : Sur l’intervention du pouvoir civil
275 : Sur la mystique
286 : Sur ce qu’est la guerre dans les Vosges, concept de la guerre de montagne
: Sur la mort de Serret, utilisée de manière propagandiste par les Allemands
292 : Sur les chicanes dans les réseaux de fils de fer barbelés
297 : Territoriaux tarés
298 : « On gaspille les projectiles allongés de 90 et de 155 qui sont très précieux pour l’artillerie, en les faisant jeter par les avions ; les aviateurs ne veulent pas les lâcher parce qu’ils se sont entraînés au tir avec ces projectiles ».
: Sur les fusées
: Sur les sections de réparation auto de Lunéville « mal dirigée »
304 : « Je n’admet pas qu’un chef considère que son supérieur n’a pas le droit de lui faire une observation » dit le général Dubail
: Liquidation des places fortes, décret du 5 août 1915
306 : 730 infirmiers à Verdun
307 : Sur le Chauchat, l’histoire de sa mise au point et signification de CSRG (page 309) : Chauchat (colonel d’artillerie), Sutter (officier d’artillerie), Rybeyrol (ingénieur civil), Gladiator (du nom d’une fabrique de bicyclette).
310 : La boue et les armes
: Obus D, portée
313 : Sur le carnet d’explosion de la guerre des mines
314 : Klaksons + clairon + feux puis sirènes électriques pour l’alerte aux gaz et inconvénients divers de son audition
316 : Sur la méconnaissance de l’anglais chez les officiers
318 : Sur les Alsaciens, leur mentalité, leur surveillance
323 : Bruit du canon et compétence des troupes à les identifier
330 : Attaque et calendrier, l’amiral Amet dit : « Avant de fixer la date de vos attaques, que vous faites tomber aux équinoxes, regardez donc que diable votre calendrier ».
331 : Batterie de catapultes vosgiennes à deux pièces et description
332 : Bombes Save utilisée en forêt d’Apremont, à la « Tête de vache », à raison de 175 par jour, arrêtant des travaux de mines allemands (photo existante par aiilleurs)
333 : Charbon de bois fabriqué en forêt de Commercy par les Morvandiaux, utilisé en 1re ligne
: Mort du général Benzino, attribué aux renseignements des Services Spéciaux écoutant les communications allemands
334 : « Nettoyage des cadres »
: Sur les aménagements de tranchées et cantonnements par les généraux (cf. Lebocq pour le Bois-le-Prêtre)
336 : Eléments recueillis sur la préparation de Verdun par les Allemands d’après un renseignement fourni par des … religieuses + destructions de clochers
337 : 2 000 F. donnés pour monter une fanfare par le général Renouard
: Sur l’abus de vin distribué… aux habitants ; 720 litres par familles, qui les revendent aux militaires « pour le plus grand dam de l’hygiène ; de la discipline et de la bourse de ces derniers »
345 : Sur l’échec du débarquement en baie de Suwla (Dardanelles) « qui n’échoua que par l’inconscience tactique absolue des exécutants » (par des troupes) « plus sportives que militaires (qui) prirent d’abord des bains de mer et ne se mirent en marche pour occuper les hauteurs dominantes qu’après avoir laissé aux Turcs le temps de s’y incruster, de recevoir de l’aide et enfin d’ouvrir un feu suffisamment ajusté pour nécessiter l’organisation d’une attaque en règle, de sorte que l’insuccès de cette dernière entraîna l’échec définitif de l’opération »
346 : Sur l’enseigne de Vaisseau Simon, rescapé du Bouvet (coulé par une mine le 18 mars 1915) et qui échappa à Mers-el-Kébir comme capitaine de Frégate, commandant en Second du Dunkerque en 1940
351 : Atlas Stieler et Vidal-Lablache
362 : Idée de déposer par avion des troupes derrières les lignes ennemies
: Sur Saconney et cerfs-volants
: Sur la même invasion en cheminant par les mines s’étendant sous les lignes allemandes, « plan de termites » abandonné car jugé impossible à réaliser
: Sur un débarquement par les côtes par les canaux par bateaux à fond plat
363 : Sur l’invasion par la Suisse (dossier H) et troupes concentrées à Belfort en lien avec ce plan
372 : Comment on décide d’une décoration belge
373 : Sur l’idée d’instaurer la polygamie pour pallier au manque d’hommes
374 : Il passe au 11e BCP (en fait BCA) (il commandera aussi le 363ème RI (cité p. 255)
376 : Vue de Gérardmer, la Schlucht, l’Altenberg avec Poincaré, échanges sur la prospérité des Vosges et plans pour elles, l’Alsace et la Lorraine après la guerre le 10 février 1915
377 : Visite d’Epinal
378 : Hansi présenté au général Mauger
: Vue de Bussang (11 février 1915)
379 : Méthode Berlitz à l’école alsacienne
: Enfants allemands invités à garder leur langue aussi après la guerre
380 : Pains K et KK
Yann Prouillet, juillet 2023