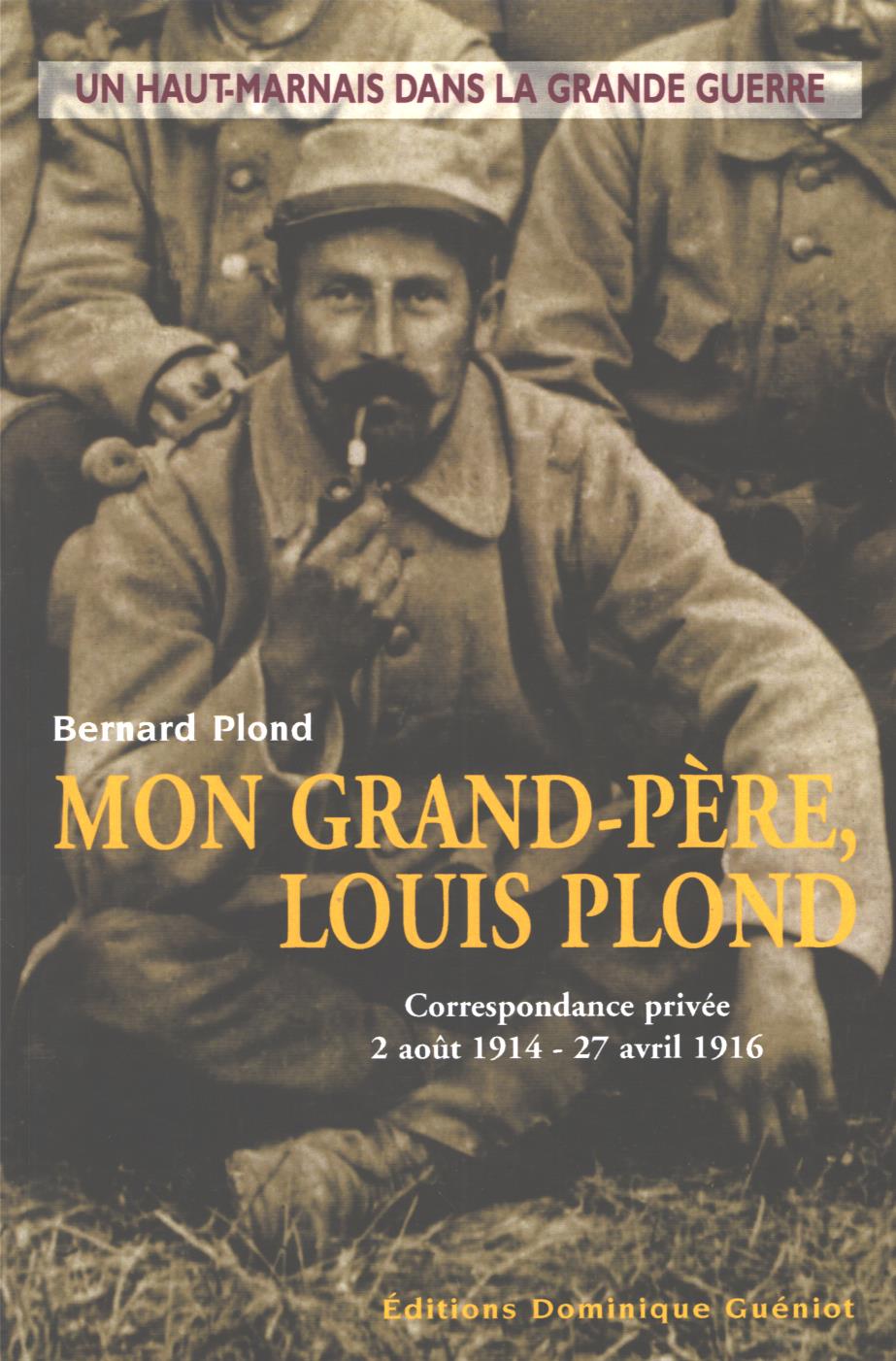1. Les témoins
Jean Bouteille est cultivateur à Yseron (Rhône) au moment de la mobilisation, mais il est aussi le coiffeur du village et occasionnellement tueur de cochon. Il est marié à Jeanne Imbert depuis 1910, et leur fille Yvonne est née en 1912. Il combat en Alsace et dans les Vosges avec le 372e RI de Belfort, puis passe au 407e RI, constitué en mars 1915. Il est tué le 28 septembre 1915 en Artois lors de l’offensive d’automne, à la cote 140 de Givenchy. Au début de la guerre, Jeanne cultive le jardin maraîcher, et a repris les fonctions de coiffeur du village. Après la guerre « Elle a vécu le reste de sa vie dans le souvenir d’un époux tendrement aimé (préface, p. 10) » et ne s’est pas remariée.
2. Le témoignage
Nicole Lhuillier-Perilhon a publié aux éditions « Les passionnés de bouquins » en 2012 Il fait trop beau pour faire la guerre, correspondance entre un soldat au front et son épouse à l’arrière pendant la Première Guerre mondiale, 261 pages. Les lettres ont été trouvées par hasard sous une volée d’escalier, certaines ayant été abîmées par les souris. N. Lhuillier-Perilhon, petite-fille de Jean Bouteille, précise à l’occasion d’un entretien téléphonique (juin 2020) qu’un certain nombre de formules répétitives en fin de lettres ont été supprimées, mais que le souci de fidélité aux courriers a présidé à son travail de retranscription. Elle signale aussi avoir rétabli l’orthographe et une grammaire correcte, surtout pour Jean dont le niveau scolaire était limité. Par contre l’absence fréquente de ponctuation a été respectée quand elle n’altérait pas le sens.
3. Analyse
Ces échanges de lettres racontent la guerre telle qu’elle est ressentie par le mari mobilisé, et l’ambiance au village et dans le petit foyer familial, telle qu’elle est vécue par l’épouse. Le ton de la correspondance est tendre, peut-être plus que la moyenne de ce type de courriers, et est souvent centré sur la petite Yvonne, et sur les relations chaleureuses d’un couple épris.
I. Jean
Jean fait son devoir au front sans ferveur particulière mais avec résolution, et de nature sociable, semble ne pas souffrir de la vie collective ; il entre dans Mulhouse libérée en août 1914, décrit dans ses lettres les souffrances des villages alsaciens du front, et dit sa détestation des Allemands. Il est dans le secteur de Dannemarie à l’automne, et explique « être bien aimé de tous ses camarades et de ses chefs » ; au repos il redevient coiffeur. Sa perception de la culture alsacienne est assez sommaire (4 octobre 1914, p.42) : « Je ne comprends rien ils me font un baragouin épouvantable on dirait qu’ils mangent de la merde, on ne peut s’habituer à ce parler boche. » En mars 1915, il est versé dans un nouveau régiment formé surtout de jeunes de la classe 15, et c’est à partir de ce moment que semblent se conjuguer la lassitude de la guerre, le regret des êtres chers, et un malaise lié à la fréquentation de ces jeunes soldats; lui, qui a 32 ans, en a une très mauvaise opinion (p. 201) : « des pires voyous des bleus de la classe 15 qui n’ont aucun respect pour les anciens qui n’ont jamais que des saletés à la bouche des paroles déplacées car ils n’ont aucune espérance et qu’ils n’ont que le vice dans la tête c’est impossible de les regarder d’un bon œil. » Cette fatigue se traduit aussi par l’évocation du souhait de la paix, et à la même période, il est assez critique envers ses officiers, soulignant (p. 162) « qu’ils gagnent des bons mois ils sont bien mieux à l’abri du danger que nous. Ah je suis sûr que s’ils n’étaient pas payés plus cher que nous et nourris comme nous et bien il y a longtemps que la guerre serait terminée. » Il évoque aussi le souhait de la bonne blessure (« mais pas estropié bien entendu »). Par ailleurs, cette situation de guerre cruelle n’entraîne pas pour lui de « brutalisation » particulière, il l’évoque en plaisantant à propos de la lingère à qui il a donné son linge au repos (p. 147) : « Eh bien j’aimerais bien mieux me battre avec elle qu’avec les boches j’en aurais moins peur. Au lieu de devenir brutal ici on prend toujours plus la guerre en horreur. »
II. Jeanne
Jeanne écrit régulièrement à son mari, lui envoie des colis, et lui raconte les petits soucis de l’arrière, notamment pour les travaux qu’elle ne peut faire elle-même; elle souligne que les journaliers et artisans du village non-mobilisés font payer très cher la tâche, mais heureusement, il y a les blessés en convalescence « qui ne sont pas si exigeants ». Elle tient aussi à rassurer son homme sur le fait qu’elle s’en sort bien globalement (p. 51) : « mon Jean tu me prends pour une bugne (…) Ah, je me débrouille va sois sans inquiétude. Si je te dis toutes ces bagatelles qui m’arrivent c’est afin que tu sois bien au courant de tout ce qui se passe dans ton ménage mais non pour que tu te tourmentes pour si peu de chose. » Jeanne donne régulièrement des nouvelles d’Yvonne, décrit ses progrès et ses mots d’enfant (« elle dit toujours que tu es après tuer les cochons ») ; elle lui décrit, en enjolivant probablement, la petite fille agenouillée apprenant à faire sa prière (p. 84) « Mon Dieu vous m’entendez bien il faut me garder mon Papa je le veux et je vous aimerai bien. ». Souvent Jeanne termine par des formules tendres comme par exemple « De gros mimis bien affectueux de la Jeanne. J’en ai mis un plein mouchoir de baisers», et les réponses de Jean ne sont pas en reste (p. 67) « A mon retour il me semble que je vais vous manger toutes les deux ma pauvre Jeanne je vous ai toujours aimé mais plus ça va au plus je vous aime.» Le couple dialogue aussi sur un ton grivois, parlant du désir par des formules à peines déguisées (en permission, « faire jusqu’à ce que ça ne veuille plus faire »), ou qui viennent directement des métaphores de l’argot de la tranchée ; ainsi lorsque Jean rentrera, il y aura un « corps à corps » terrible, ou le « 75 sera ajusté bien des fois (p. 214) » Jeanne est amusée par ces gauloiseries, et ces passages ont leur intérêt car en général, c’est la pudeur du poilu qui domine dans les sources. Dans la même veine intime (histoire de la sexualité ou pourquoi pas histoire du genre), on dévoilera encore une mention de Jeanne (p. 225, après une permission) : « Je voulais aussi te reparler que j’étais satisfaite de mon poulet…car je te l’avoue franchement à présent j’avais peur et cela gâtait beaucoup la joie de te revoir mais comme je vois que tu te tires assez bien de ça et bien je ne réclame qu’une autre permission. »
III. La religion
Dieu joue un rôle important dans la vie du ménage Bouteille, et ici la religion n’est pas incompatible avec un couple volontiers gaillard comme on l’a vu : ce n’est pas une dévotion puritaine, les domaines métaphysique et domestique sont bien séparés, et Jean qui aime faire la « bombe » dit aussi que lorsqu’il a le bonheur d’aller à la messe, cela le rend heureux. Il évoque au combat la protection du Saint Suaire, tandis que Jeanne s’adresse davantage à la Vierge. Jean mentionne être choqué par l’irréligion des jeunes soldats de la classe 15, et il est furieux lorsqu’en Artois le colonel leur interdit de porter l’insigne du Sacré Cœur sur l’uniforme (p. 178) : « Notre colonel c’est un gros cochon (…) j’espère que le bon dieu en prendra pitié et que pour quelques justes il nous sauvera quand-même. »
IV. La mort
Jean essaie, quand il le peut, de cacher la réalité à Jeanne lorsqu’il stationne dans des secteurs dangereux. Lors de l’offensive de la fin septembre 1915 où le 407e va donner, il a écrit ce qui l’attend à ses beaux-parents (25 septembre, p. 239) : « les cœurs sont gros car l’heure grave est arrivée nous allons entreprendre une besogne bien dure surtout sanglante. Enfin il n’y a rien à faire il faut y aller de bon cœur. (…) ne parlez pas à Jeanne de rien. » Jean est tué le 28 septembre et Jeanne continue de lui écrire jusqu’à ce qu’elle apprenne la funeste nouvelle, probablement le 10 octobre. Elle lui écrit le 5 (p. 242) « Tu ne m’en parlais rien le 25 que vous deviez repartir [en situation exposée] et depuis je n’ai pas de nouvelles (…) j’ai l’âme lacérée par de bien tristes pressentiments (…) Yvonne a aussi le cœur bien gros lorsqu’elle me voit pleurer. Pour elle je suis obligée de me retenir et cela me gonfle davantage car la pauvre petite me fait de la peine. » On dispose ensuite de lettres de camarades, qui décrivent tous, soit une mort immédiate et sans souffrance (une balle dans la tête), soit le fait qu’il était en règle avec la religion ; on lui détaille la cérémonie d’avant l’assaut (p. 249). « Nous avons eu la visite de notre aumônier divisionnaire. (…) L’absolution générale et collective in articulo mortis. La communion, le viatique à 7 heures et demi du soir. Votre Jean était du nombre. » Lorsque, sous le feu, on n’a pu ramener les corps des tués, on trouve en général dans ce type de courrier une formule pour éluder, car il s’agit de consoler les proches ; ce n’est pas le cas ici (p. 250) : « mais après six jours de luttes incessantes lorsque nous avons été relevés il n’avait pu être enterré ni aucun de ses camarades car la mort aurait fauché quiconque aurait voulu le transporter. Il était toujours couché sur le dos la figure sereine les mains ramenées sur la poitrine. » Le livre est clôt par un dernier document, une petite lettre qui a été tenue secrète jusqu’à la mort de Jean (p. 261) ; sur la petite enveloppe est écrite la mention « A remettre à ma femme dans le cas où je serai tué. J’espère que le Dieu me gardera Jean Bouteille.» ; A l’intérieur, une très petite feuille elle-même de 12 cm sur 5, pliée en 4. A la lecture de ce document, avec la familiarité que l’on a acquise progressivement avec cette petite famille attachante, difficile de ne pas éprouver, malgré l’habitude, une brutale mélancolie : en cela ce livre est aussi un excellent biais pour faire « revivre » plus de cent ans après ce qu’a été la douleur de certains deuils, et pour nous communiquer cette expérience de tristesse accablante :
« Septfroid-le-Haut, 30 septembre 1914 Ma chère Jeanne et Yvonne
Quoique n’ayant du tout l’espoir d’être tué j’ai toujours pensé en te quittant te retrouver bientôt seulement il faut tout prévoir personne ne connaît sa destinée. Si par malheur un jour je trouve la mort sur le champ de bataille comme l’ont trouvée plusieurs de mes frères le 24 septembre la nouvelle te serait terrible ma chère Jeanne car je connais d’avance le désespoir que tu éprouverais en recevant la dépêche. J’espère que Dieu te préservera de ce malheur seulement si toutefois malheur arrive raisonne-toi et ne te mets pas malade. Songe à notre petite fille qui resterait orpheline et vis pour elle. Et puis d’ailleurs songe à l’autre monde. Nous nous retrouverons là-haut. Là il n’y aura plus de séparation et ce sera le bonheur éternel. Prie pour moi je prierai pour toi. Au revoir ma chère Jeanne. Console-toi vite et élève ta fille chrétiennement c’est tout ce que je te demande. Dieu nous retrouvera. Ton cher époux J. Bouteille. »
Vincent Suard décembre 2020