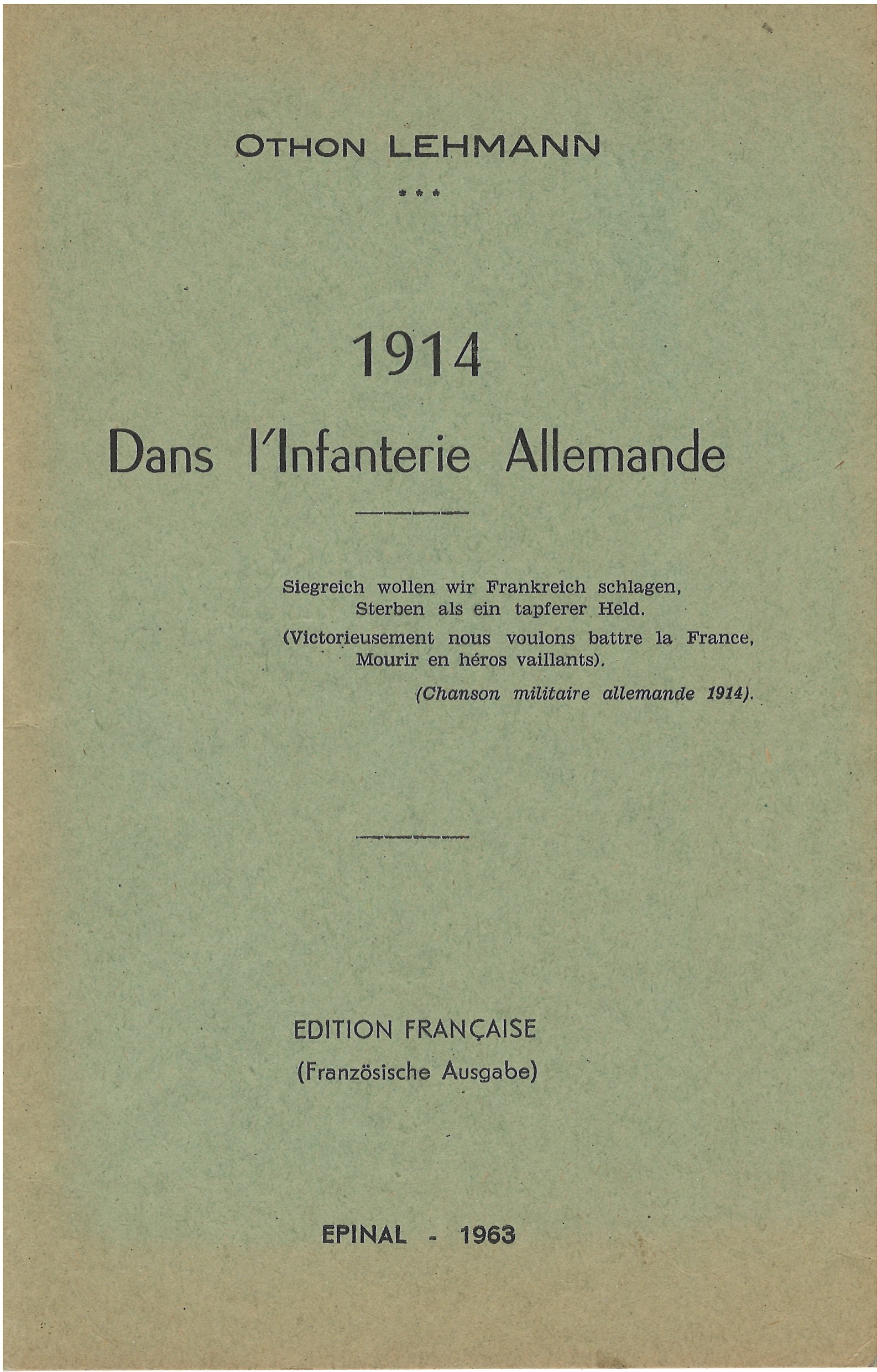Le Fantassin de Kerbruc Jacques Thomé
1. Le témoin
Michel Urvoas est né en 1895 à Plonevez-du-Faou (Finistère). Il appartient à une famille de cultivateurs pauvres du centre Finistère et vient du hameau de Kerbruc, sis à 3 km de la commune de La Feuillée. Au début du conflit il est journalier dans la Beauce. Classe 15, il rejoint en décembre 1914 le 89e RI de Sens à Soligny, et y reste jusqu’en juin 1915, époque à laquelle il passe chez les zouaves à Sathonay. En septembre 1915, il arrive à Souain en Champagne avec le 8e Zouave, et participe à l’offensive au cours de laquelle il est tué.
2. Le témoignage
Jacques Thomé a fait paraître « Le fantassin de Kerbruc », dans la collection Faits et Gestes, en 1992 (Ivan Davy éditeur, 138 pages, avec illustrations et photographies). L’auteur de cette publication commentée des lettres du soldat Michel Urvoas a été inspecteur départemental de l’éducation et est un spécialiste de l’histoire de la région angevine. Si le nom du soldat n’apparaît pas sur la couverture, la page intérieure mentionne : « Lettres d’un paysan breton mort au combat en 1915 ». La fiche matricule de M. Urvoas mentionne qu’il sait un peu lire et écrire, et J. Thomé signale qu’il a réécrit les lettres pour les rendre compréhensibles, tout en gardant «le souci d’en respecter la lettre et l’esprit » (p. 22). Une reproduction en fac-simile nous éclaire sur ce choix (p. 34, juin 1914) :
«(…) javai oblier de dire que jesui Bien Nouri Par œuf et de la soupe traibon
Avoir Cher Per Je vou tanbrase de toute mon ceur. »
Si la réécriture gêne la démarche historienne, il est des fois où elle est inévitable, si l’on souhaite une publication lisible, voire une publication tout court. Le transcripteur signale que le niveau de syntaxe et de lexique de l’auteur s’est nettement amélioré pendant la durée de la correspondance.
3. Analyse
Le témoignage de Michel Urvoas est constitué d’une cinquantaine de lettres assez courtes adressées sa famille. Jacques Thomé les a découvertes et présentées dans ce petit livre soigné : c’est une véritable enquête sur ce jeune soldat breton de la classe 15, sur sa famille paysanne et son environnement dans la campagne isolée des Monts d’Arrée. Le livre est organisé en sept petits chapitres chronologiques, avec à chaque fois quelques pages de présentation et quelques extraits des courriers. L’enquête présente d’abord (« Toile de fond d’un témoignage ») l’offensive de Champagne en septembre 1915 et précise les circonstances de la mort de Michel Urvoas, tué le 10 octobre à l’un des endroits les plus avancés de l’offensive.
J. Thomé évoque aussi Anne-Marie Urvoas, la dernière sœur de Michel, qui est née quelques mois avant la mort de son frère en 1915 : c’est elle qui a été la dépositaire et la gardienne des lettres ; principal témoin encore vivant en 1991, elle a aidé J. Thomé pour la confection de son ouvrage, elle avait alors 76 ans. Le livre est donc aussi un témoignage d’histoire sociale, il évoque la Bretagne pauvre des années 20, avec la migration d’Anne-Marie vers l’Anjou en 1934, pour travailler aux ardoisières de Trélazé ou dans les usines du textile. Cette famille bretonne, qui par ailleurs a été spoliée par un remariage du grand-père, est représentative de cette « existence de prolétaire » des bretons de l’exode rural. Ainsi A. M. Urvoas témoigne (p. 33, situation de 1918 ou 1919) : « On a tué la dernière poule pour le repas de mon baptême. Quand j’ai pu me débrouiller, vers 3 ans, j’allais tendre mon tablier chez les riches pour avoir quelques croûtons de pain dur, comme on donne aux lapins. C’était pour tremper dans la soupe. ».
En revenant au frère aîné, J. Thomé présente ses lettres chronologiquement. Recruté après un conseil de révision en octobre 1914 à Huelgoat, Michel écrit à sa famille que tout va bien, depuis Sens, où il a été incorporé au 89e RI (p. 45, 25.12.14) (…) « J’ai reçu votre lettre et en même temps celle de Marie-Anne. J’en ai eu du plaisir ! Voilà tout ce que j’ai à vous dire de ma nouvelle obéissance. ». Le transcripteur signale la bonne humeur constante du soldat dans ses courriers, la formule « on a du plaisir » revient souvent, c’est ici un bretonisme (« plijadur »), soit « j’ai été content, j’ai passé un bon moment … ». Il apparaît qu’il ne se plaint pas de son sort, celui-ci lui paraissant probablement moins dur que celui de sa condition ordinaire d’ouvrier agricole. Dans ses courriers, il parle de la terre, du village, de la famille (p. 47, 14.01.15) « Chers Père et Mère (…) Mon père, quel métier fait-il ? Si vous voulez mettre un peu de légumes, il est temps de retourner la terre. Car vous savez, quand la terre est pourrie, on a de meilleures choses. Et les filles de la Feuillée, sont-elles mariées ?
Voilà tout ce que j’ai à vous dire de ma nouvelle obéissance.
Vive la France, vive l’armée, bravo à ses soldats. »
Michel se fait photographier en mars 1915. Ce portrait réussi est agrandi et repris pour la couverture du livre. On constate qu’il tarde à partir au front, et qu’il s’en réjouit à de nombreuses reprises : « comme cela la guerre s’avance toujours ». C’est exprimé plus clairement fin avril 1915 : (…) « Plus de la moitié de ceux de la classe 14 sont morts mais je m’en fous si je peux rester. De la classe 15, beaucoup sont partis comme volontaires et presque tous ont été tués. Je ne demanderai pas à l’être, comme cela je resterai ici un bon moment encore. » Il a perdu son insouciance de 1914, et s’il n’est pas malheureux au régiment, il redit à chaque fois qu’il souhaite monter au front le plus tard possible. Arrivé chez les zouaves à Sathonay, il s’y trouve bien et pense peut-être « partir en Turquie » (p. 83) : « Je vous assure quand j’irai avec mon grand jupon et mon chapeau d’évêque vous aurez du plaisir car je suis joli. (…) Ici on est bien (…) Je suis avec un de Bolazec. Nous sommes comme des frères. Vive les zouzous ! » Il est transféré au 8e Zouave comme renfort à l’été 1915, alors que cette unité est au repos après les durs engagements de l’Artois, et l’auteur témoigne dans ses lettres de sa satisfaction, il est bien nourri, il a du vin tous les jours, et autour du 14 juillet, il signale (p. 98) : « Je suis content d’être ici. » Dans ses lettres de l’été, il redit aussi son manque d’enthousiasme pour monter en ligne :
15 août 1915 « J’espère rester quelques semaines ici. Comme cela la guerre s’avance toujours.»
20 août 1915 « [secteur calme] On est en train de faire des tranchées à un kilomètre des boches. Nous sommes comme des frères. On ne se tire pas dessus.»
1er septembre 1915 « Voilà neuf mois que j’ai quitté la maison et jamais je n’ai été aussi heureux. Je n’ai pas vu de boches encore. J’espère rester ici encore un moment avant d’aller les voir. Comme cela je passerai bien la guerre car elle ne durera plus longtemps… »
En présentant l’offensive de Champagne et le secteur devant Souain, avec des cartes de qualité, J. Thomé évoque la toponymie des tranchées allemandes, avec une typologie des appellations données par les Français : appellations orientalistes (tranchées du Harem, des Fatmas, des Eunuques), virilistes (tranchées des Tantes, des Homosexuels d’un côté, puis des Viennoises, des Gretchen ou des Teutonnes de l’autre), mais aussi des victoires napoléoniennes (tranchée d’Austerlitz, etc…). Lors de la grande attaque, l’unité de l’auteur progresse d’abord conséquemment, mais elle est arrêtée en position de pointe sur la 2e ligne de défense allemande. Les combats avancés sont violents autour de la tranchée des Tantes (6-10 octobre), Michel Urvoas y est tué le 10 à 23 heures. Il n’a pas de sépulture connue.
Sa dernière lettre, adressée à sa sœur, à la veille de sa mort, est détachée de la violence environnante des combats (p. 122):
9 octobre 1915 Chère sœur
Je viens de recevoir votre lettre avec beaucoup de plaisir. Chère sœur, pouvez-vous m’envoyer du papier à lettres car je n’en ai plus. C’est la dernière feuille que j’utilise. Envoyez moi aussi les chaussettes si vous les avez finies car il commence à faire froid la nuit. Je ne sais quand je pourrai aller en permission.
Ton frère Michel qui pense à toi.
Ainsi à partir d’un matériau relativement laconique, Jacques Thomé a su rendre compte de l’environnement social et du témoignage de guerre de Michel Urvoas, un jeune homme simple qui – dans ses lettres, en tout cas – a toujours fait preuve de bonne humeur mais a rapidement et constamment témoigné d’un manque d’enthousiasme pour la guerre réelle, à partir du moment où il a compris ce qu’elle représentait.
Vincent Suard, septembre 2023