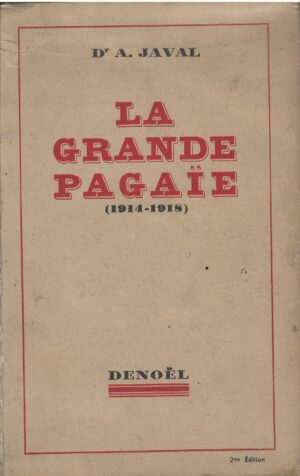Javal, Adolphe, La grande pagaïe, Denoël, 1937, 329 p.
Résumé de l’ouvrage :
La feuille de route de sa mobilisation affecte le docteur Adolphe Javal à l’ambulance n°5 du 5e corps d’armée, qu’il rejoint à Fontainebleau avec 24 heures d’avance, avant même la déclaration de guerre. Se considérant plus comme un administrateur de formations sanitaires que comme un « urgentiste », la narration de sa guerre est dès lors une impressionnante suite d’anecdotes, émaillant ses nombreuses mutations, dans un monde médical du front et de l’arrière-front qui évolue lui-même au fil de la guerre. Il « collectionne » ainsi un nombre impressionnant d’affectations jusqu’à sa démobilisation en 1919, offrant un nombre tout aussi conséquent d’analyses de ces milieux divers et variés.
Eléments biographiques :
Louis Adolphe Javal est né le 11 juin 1873 à Paris (16e arrondissement). Il est le fils du célèbre docteur Emile Javal, membre de l’Académie de médecine et homme politique, et de Maria-Anna Elissen, demeurant un hôtel particulier 5 boulevard de la Tour-Maubourg. Il a deux sœurs, Alice et Jeanne et aura deux enfants (Mathilde et Sabine). Ses travaux en médecine lui font obtenir en 1904 le prix Desportes (thérapeutique médicale). Il écrit dans la presse spécialisée, teintant ses écrits de militance. Il dit : « J’étais tellement écœuré de voir pratiquer ce système, que je fis paraître dans la « Tribune Médicale » du mois de septembre 1915… » (p. 75). Passionné d’agriculture, il possède un château dans l’Yonne, à Vauluisant, ferme de 250 hectares dans laquelle il se rend fréquemment pendant la Grande Guerre, parvenant même à se faire un temps affecter dans des formations proches pour « gérer » le domaine. Son parcours pendant le conflit est particulièrement divers, avant d’être démobilisé le 24 avril 1919. Après-guerre, à plusieurs reprises, il tente une carrière politique, notamment sénatoriale, et écrit de nombreux articles médicaux et au moins deux ouvrages, le plus souvent anecdotiques, notamment sur ses relations ubuesques avec l’administration (26 références à la BNF). Juive, toute la famille (sa fille Mathilde et ses deux filles) est déportée à Auschwitz, en 1943 et 1944. Son nom est inscrit sur un cénotaphe dans le Panthéon parmi les 197 écrivains morts pour la France dans la Deuxième Guerre mondiale.
Commentaire sur l’ouvrage :
La guerre médicale d’un docteur Javal plongé dans le monde sanitaire kafkaïen à la guerre mêle empêcheur d’embusquer en rond et journal de route d’un médecin qui tient parfois plus de l’adjudant de compagnie (même si on doit lui reconnaître en ce domaine une évidente compétence). Il dit d’ailleurs lui-même préférer le rôle d’administrateur (p. 168) que du praticien d’ambulance de front. Aussi, son témoignage est une œuvre finalement très surréaliste mais de référence quant au parcours d’un médecin au sein de différences formations (hôpitaux, ambulances, fixes ou mobiles, centres sanitaires, etc.) dans les différentes phases de la Grande Guerre. Comme d’autres témoins des ambulances hippomobiles de 1914, Javal évoque un certain inemploi, voire un abandon de blessés autour de la bataille de la Marne, notamment pendant ce qu’il appelle le « circuit de la Meuse ». Il synthétise ce sentiment : « Nous parcourûmes environ 500 kilomètres pour fonctionner exactement quatre fois : c’était extrêmement peu pour s’initier à l’art de faire la guerre » (page 45). Son ouvrage, dense et très militant, fourmille, toutefois d’indications sur le milieu médical subordonné au monde militaire, récit souvent teinté de surréalisme voire de truculence.
Particulièrement critique, mais tout aussi lucide, il analyse en permanence et dénonce à chaque fois qu’il le faut, et il ne s’en prive jamais, les situations qu’il vit, dans le détail comme dans le fonctionnement général des services qu’il côtoie ou subit le plus souvent. Resté civil même sous l’uniforme, il ne se conformera finalement jamais à l’omnipotence parfois surréaliste du militaire. Par-delà son caractère polémique (et procédurier), l’ouvrage fourmille d’informations. Il dit : « J’estime le rendement de la main d’œuvre militaire à 25 % au maximum de celui de la main d’œuvre civile à l’heure, et à 10 % de celui de la main d’œuvre civile à la tâche » (p. 35). Il applique d’ailleurs cette sentence peu amène plus loin : « Le rendement du travail d’un militaire, se chiffre, chacun le sait, par un coefficient extrêmement bas. Le chef est désarmé pour améliorer ce rendement, puisque le travail du militaire est, en général, sans sanctions. Il faut truquer pour obtenir quelque chose » (page 245). Il n’est parfois pas moins tendre à l’endroit des fonctionnaires : « Ce petit jeune homme de dix-huit ans avait du sang de fonctionnaire dans les veines » (p. 66). Souvent, il mâtine son récit d’axiomes, de réflexions psychologiques, voire philosophiques, luttant sans cesse contre la démagogie également. Sur l’égalitarisme, il dit : « L’égalité, appliquée à l’espèce humaine, produirait ce que les critiques appellent le nivellement par le bas. Au point de vue de la guerre actuelle, ce principe a causé des désastres irréparables » (p. 94). Plus loin, il avance : « Rien ne ressemble moins en effet à la médecine militaire du temps de paix que la médecine militaire du temps de guerre et, au risque de passer pour paradoxal, j’ose dire que les médecins civils de réserve qui ne connaissent ni l’une ni l’autre et encore moins les règlements, étant exempts de tous préjugés et de toute idée préconçue, faisaient beaucoup meilleure besogne que certains médecins de l’active » (p. 96-97). Aussi, il n’hésite pas cette sentence : « … l’infirmerie est mon domaine : c’est même mon royaume » (p. 189) et en effet, il y fait régner une manière de despotisme éclairé, bien à sa main, avec parfois des luttes pied à pied contre une hiérarchie qu’il épargne rarement. Aussi il fait de son temps militaire un combat incessant contre la hiérarchie, les normes, le fonctionnarisme et l’impéritie. Analyste du quotidien et des mœurs, il explique la haine du gendarme : « C’est par l’intermédiaire de la prévôté que se faisait souvent la liaison entre l’état-major du C. A. et la troupe chargée des travaux de cantonnement, ce qui explique facilement la haine farouche du gendarme qui s’encra rapidement dans le cœur du poilu » (p. 135). L’étude de son récit permet également d’alimenter l’étude de nombreux symptômes de guerre tels la simulation, le gestion de la syphilis (autre stratégie d’évitement parfois), les contagieux, les embusqués, etc. Il aime à dire « je guéris les simulateurs et je débusque les embusqués » (page 243), sport dont il se fait le champion, notamment lors de son séjour à Fontainebleau. De même quelques épisodes cocasses, comme cet accouchement qu’il gère dans son ambulance, générant des débats tout militaires, sont représentatifs de la dichotomie militaire/civil. Il fustige souvent l’administration idiote, par exemple appliquée à la gestion des réfugiés, cas qu’il étudie de près puisqu’il en recueille, et emploie, comme des prisonniers d’ailleurs, dans son château bourguignon (cf. son chapitre sur les réfugiés p. 150 à 158). Il évoque ce qu’on peut appeler des « affaires » comme le pillage de Louppy-le-Petit, la débandade de Vauquois, les typhiques de Bar-le-Duc, estimés à 3 000, l’affaire de Joinville, l’affaire Rabier, etc. Il reporte également parfois intégralement plusieurs rapports, parfois techniques, qu’il rédige soit dans le cadre de ce qu’il pense être de bonne gestion, soit médicaux, soit comme comptes-rendus hiérarchiques, dont certains sont « gratinés » et d’une spiritualité peu militaire. Il participe ainsi à la statistique, y compris rétrospective (comme à Verdun, voir p. 232), et la paperassite qu’il dénonce à longueur d’ouvrage. Il dit : « … la capacité du chef se mesurait au volume de paperasse envoyé à ses supérieurs » (p. 237). Il résume souvent sa pensée, en forme de leitmotiv du livre : « Au début, en août 1914, c’était la pagaïe : mais en janvier 1916, c’était encore la pagaïe avec une différence cependant : le gaspillage d’argent en plus » (p. 177). Il n’est pas tendre non plus sur la classe 17, « élevés dans du coton », considérant leur « gestion » par des auxiliaires ou des territoriaux comme grotesque ! (page 182). Bien entendu, son caractère entier lui vaut jalousies (notamment quand il rentre hebdomadairement dans sa ferme de Vauluisant), inimitiés, y compris politiques (voir page 93) et plaintes, qu’il traite sérieusement sans s’en faire, et avec une certaine routine (voir p. 185). Il rapporte une punition elle-même surréaliste, à la suite de son long chapitre sur sa « question noire », celle de la « température anale » constituant « une grossière inconvenance » (p. 288). Mais en grande partie, l’ouvrage, qui se veut caustique, ne manque pas de finesse d’analyse et est écrit avec un savoureux second degré. Par exemple, pages 189-190, il dresse une liste des maladies qu’il considère comme « contagieuses » : pigritia (paresse), claudication, colique, réformite, auxiliarite (vap 319) ! Il reporte quelques « méthodes », parfois « fermes », pour lutter contre les simulateurs et les maladies arrangeantes pour les tire-au-flanc, ce qu’il appelle les « attitudes vicieuses » (il cite les coxalgies, les ankyloses ou les adhérences par exemple (p.197)). Son livre abonde ainsi en personnages cocasses, surréalistes, qui témoignent d’une réalité entre évitement du front et déviance comportementale qui touchent souvent à la psychiatrie, formant un tableau général de soldats bien loin de l’héroïsme patriotard lisible par ailleurs. Il en débusque souvent et partout, parfois dans l’auxiliaire même, osant cette sentence : « tous ces déchets humains qui ont encombré les dépôts et les formations sanitaires, n’ont produit aucun travail utile et ont coûté très cher » (p. 204-205). Plus loin, il dit même : « Le dépôt fut l’école de la paresse » (p. 226). Pourtant il doit souvent faire des choix qui lui posent cas de conscience. Il dit : « Peut-on concevoir au monde quelque chose de plus injuste que la sélection qu’un médecin doit faire entre les hommes qui auront le devoir de faire la guerre et ceux qui auront le droit de ne pas la faire ? » (p. 205). Plus loin, il dit : « Que les chiffres soient exacts ou faux, utilisables ou non, peu importe ; il y en aura des millions. La médecine militaire est bien plus occupée à compter les malades qu’à les soigner. Personne ne s’occupe d’ailleurs de savoir si la circulaire est exécutable, si les infirmiers ou les thermomètres sont en nombre suffisant. L’ordre est formel : il faut des chiffres » (p. 221 et aussi 316). De forte personnalité, il goûte peu les gens du midi… et les curés et les religieuses, qui transforment son ambulance en « séminaire » et pratiquant des conversions plus ou moins forcées (p. 241 et suivantes) ! Il n’aime pas beaucoup plus la hiérarchie, et assène : « … la pléthore des chefs superposés ne sert qu’à défaire par l’un ce que l’autre à fait » (p. 245). Il a également une analyse singulière de la question noire, qu’il expose dans le chapitre « le tutu des nègres » (page 284). L’armistice signé, qu’il vit à Coulommiers, l’ambiance est particulière. Javal fait une analyse également singulière de son environnement ; il dit par exemple, sur le traitement féminin des rapatriés : « Les dames infirmières n’étaient pas contentes de le nouvelle orientation que prenait mon établissements. Elles voulaient des blessés : elles avaient soif de sang. A la rigueur, elles auraient accepté des malades, mais laver, épouiller et nourrir ces rapatriés ne leur allait pas… » (p. 300). Ses analyses, permanentes, classent cet ouvrage tant dans le domaine du témoignage que dans celui de la réflexion analytique détaillée sur la Grande Guerre sanitaire.
Son parcours est très diversifié ; le 24 avril 1918, il écrit : « né en 1873 et ramené à la classe 1891 par mes deux enfants, j’ai fait deux ans et demi de front ». Le reprendre en totalité est fastidieux ; il est ballotté d’abord dans l’ambulance 5 puis se trouve à Bar-le-Duc le 16 juillet 1916. Le 18 mars 1917, il est nommé médecin-chef de l’ambulance 4/37. Le 1er janvier 1918, il est nommé (par le ministre) médecin-chef de service de groupement des centres (centre de réentraînement d’Estissac et de Cravant), centre de rééducation physique de Pithiviers) de la 5e région. Il monte une station-magasin à Montereau le 23 avril 1918 (« avec 600 hommes à soigner : 200 vieux territoriaux et 400 nègres qu’on avait fait venir du Maroc et qu’on payait 7 fr. 50 par jour ») (il y revient p. 238 et 289 zone d’étape), puis c’est l’hôpital d’évacuation de Vasseny, entre Reims et Soissons (2 août 1917), au camp d’Estissac (2 octobre 1917), à l’hôpital de Sens (11 février 1918), à l’hôpital mixte d’Orléans (29 août 1918), à l’hôpital 92 de Coulommiers, le 5 novembre 1918 par exemple. Après l’Armistice, arrivé à Paris (7 décembre 1918), à la direction du service de santé du gouvernement militaire qui siégeait au lycée Buffon, et avant sa démobilisation le 24 avril 1919, il est un temps affecté au Val-de-Grâce (mais dans les affres de la guerre tout juste finie, ne semble pas y avoir exercé). Le fourmillement de ses affectations a certainement à voir avec son comportement personnel comme ses pratiques professionnelles. Il conviendrait de rependre précisément le déroulé de l’ouvrage pour en retracer le parcours complet daté et localisé.
Les annexes reportées sont intéressantes, surtout la 2ème, intitulée « La Paperassite », sous-titrée (étude bactériologique, clinique et expérimentale), avec comme chapitrage I. Etude bactériologique, II. Formes cliniques, III. Marche – Durée – Terminaison. IV. Complications. V. Traitement (p. 309 à 318). L’ouvrage est enrichi d’un index des noms cités.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 16 : 16 ambulances de Corps d’Armée, 96 médecins
24 : Composition de la colonne
62 : Général Micheler assassinant un soldat car il avait perdu son fusil
64 : Autobus touristique Cook pour visiter Paris
: Chiffres des malades (dysentériques, typhiques, gelures) et blessés fin septembre 1914
66 : Comment il crée la gare sanitaire de Clermont-en-Argonne
70 : Sur la vaccination antityphoïdique
77 : Chambre de sulfuration pour l’épouillage
79 : Notice d’utilisation des douches
85 : Crée un magasin d’occasion distribuant des effets donnés après désarmement des hommes abandonnant leurs vêtements et par les apports des gendarmes (vap 87 les 1 500 fusils qu’il « recycle »)
100 : « Débandade de Vauquois », négociation avec les docteurs, menaces du commandement
103 : Cas de conseils de guerre
106 : Pieds gelés : « malades ou blessés » ? (vap 227, statistiques, 235, nombre)
109 : Vue des Garibaldiens, qui ils sont, but
123 : Douche froide contre les simulations (vap 128 sur ce sujet)
129 : Gère un accouchement, polémique tout militaire
136 : Sur les gendarmes pendus à Verdun
142 : Salvarsan contre la syphilis
154 : Gabegie de l’allocation aux chevaux de réfugiés
164 : Sur les typhiques de Bar-le-Duc
170 : Il couche dans la maison de Poincaré à Sampigny
172 : Chiffres sur la consommation de liquide (café, thé, vin) des troupiers du centre de Condé
173 : Chiffres de l’argent touché par hommes par mandats et bons de poste
178 : Rédige un billet d’hôpital qu’il considère comme efficace, aucun succès
180 : Sur la permission de 24 heures
182 : Comment il traite la classe 17 « élevés dans du coton » ! (vap 189 sur les visites médicales, 220, 222 : « Les bleus de la classe 17 ont acquis, pendant leur séjour au dépôt, un entraînement magnifique à défiler tout nus devant leur médecin : ils me paraissent aptes à partir maintenant pour les camps d’instruction militaire »)
182 : Chasse aux embusqués
195 : Février 1916, entrée des femmes de service embauchées dans les casernes
199 : Scandale de l’avancement des embusqués
200 : Repère sur les pansements pour éviter qu’ils ne soient défaits
206 : Hôpital du Tibre à Fontainebleau pour les malades mentaux
207 : « Ne jamais résoudre une difficulté, mais la repasser au voisin »
208 : Sur l’héroïsme : « Des centaines de mille hommes n’ont pas fait autre chose, pendant la guerre, que le circuit des formations sanitaires, parce que l’administration du service de santé, c’était la pagaïe, du commencement jusqu’à la fin. Et ce sont ceux-là qui crieront le plus fort après la guerre, qui porteront les chevrons, débanderont des décorations et des pensions. Les costauds sont morts et seront vite oubliés »
214 : Pansement Leclerc
215 : Registres et paperasserie (vap 237, 238, 305, 313, qualifié de « torchecul »)
216 : Orléans, hôpital Chataux pour les contagieux
: Problème administratif d’un homme ayant deux maladies contagieuses !
217 : Manques de médicaments, différences entre deux établissements (« affaire » des médecins du fort Saint-Bris)
226 : « Le règlement, c’est comme l’argent, il y en a de deux espèces : le sien et celui des autres »
: Sur l’après-guerre : « Avoir fait la guerre, la vraie guerre, avoir eu l’indépendance, la camaraderie et les initiatives du front, puis, tout à coup, retrouver les brimades de l’intérieur, les règlements de la vie de caserne, non, ce n’était pas supportable »
232 : Ecrit cagnia pour cagna
242 : Antimidi, car « l’ambulance 4/37 était une ambulance de méridionaux. On y parlait beaucoup mais on agissait peu »
: Curés syndiqués
251 : 65 médecins sans malades ni blessés à l’hôpital d’évacuation de Vasseny
257 : Description du camp d’Estissac
258 : Différence entre infirmerie (maladies légères) et hôpital
261 : 100 litres d’essence par mois pour son infirmier-chauffeur d’ambulance (vap 283, crise)
263 : Moniteurs pompiers
277 : Voit des nègres du Maroc, fainéants, nés paresseux
280 : Permission agricole
284 : Grippe espagnole
: Noirs refusant la température rectale (vap 285 polémique, et 292, conférence) et ramadan
: Soviet des nègres
285 : Rôle de l’inspecteur de la main d’œuvre
291 : Il dit, après une sanction : « il est sans exemple que, dans un rapport militaire, un chat soit appelé un chat » !
297 : Désordre gai, dû à la victoire proche, à Coulommiers le 5 novembre 1918
: Hôpital de Coulommiers
298 : Traitement des prisonniers allemands et utilisation civile de la troupe
: Paye des permissionnaires
: 7 signatures pour un sortant
299 : Armistice et ambiance : « Ces hommes avaient fait la guerre pendant si longtemps ! La guerre finie, on ne pouvait plus les tenir dans une caserne »
300 : « Ce n’était plus l’hôpital, ce fut l’auberge » et retour des prisonniers
302 : Perte de clientèle par les médecins
: 17 00 médecins mobilisés
320 : Centres de réentrainement et de rééducation et méthode de Joinville (circulaire ministérielle du 12 décembre 1917) et chiffres
Yann Prouillet, janvier 2026
Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943)
Pierre-Barthélemy Gheusi, Cinquante ans de Paris. Mémoires d’un témoin, (1889 –1938), Paris, Plon, 1939, 505 pages
Résumé de l’ouvrage :
Pierre-Barthélemy Gheusi, journaliste, écrivain et directeur de théâtre à Paris, livre, de 1889 à 1938, ses souvenirs déroulés au fil d’une vie dense et à multifacette dans les domaines du journalisme (il est rédacteur au Figaro), de la musique (il est directeur de l’Opéra-Comique), de la politique et même de la Grande Guerre, occupant, en tant que capitaine, la fonction d’officier d’ordonnance de Galliéni. Ses souvenirs sont distillés dans autant de tableaux chronologiés dans les petits et les grands épisodes de sa vie omnisciente. L’ouvrage se décompose ainsi en trois tiers inégaux ; l’avant-guerre, la Grande Guerre et un après-guerre qui se termine peu avant la survenance de la Deuxième Guerre mondiale.
Eléments biographiques :
Pierre-Barthélemy Gheusi est né à Toulouse, le 21 novembre 1865, de Joseph Antoine, alors employé de banque, cousin de Gambetta, et de Hélène Mimard, sans profession. Il étudie au collège de Castres, où il rencontre Jean Jaurès, puis fait des études de droit à Toulouse. Dès 1887, il collabore à une revue (Le Décadent) et se frotte un temps à la politique. Il devient chef de cabinet du sous-préfet de Reims puis, obtenant une mutation à Paris, demeurant rue de Miroménil puis rue Saint-Florentin, il collabore avec le Gouvernement. Il fait ensuite plusieurs voyages à l’étranger, avec des rôles divers, dont diplomatiques. Il occupe diverses fonctions, comme officier de l’Instruction publique, chargé de mission en Syrie et en Palestine, membre de la commission du Théâtre Antique d’Orange, membre de la commission d’admission et d’installation de l’exposition de 1900, membre de la Société des Auteurs Dramatiques, de la Société des Gens de Lettres, du Comité des Expositions à l’Étranger ou de l’Association des Journalistes Parisiens. Il est ancien chef de cabinet du préfet et du secrétaire général de la Seine, attaché aux Ministères de l’Intérieur et des Travaux Publics. Enfin, il est, pendant la Guerre, officier à l’état-major de l’artillerie territoriale de Paris (cf. Base Léonore). Il épouse en 1894 Adrienne Willems, avec laquelle il a plusieurs enfants, dont un fils, Raymond, artilleur, et Robert, aviateur. Directeur de la Nouvelle Revue, il est promu directeur-administrateur du Figaro après-guerre, avant d’être congédié en 1932. Directeur également de l’Opéra-Comique, il en est renvoyé en 1918 par Clemenceau puis, rétabli dans ses fonctions, contraint à la démission en 1936. Il aura écrit dans sa vie 23 œuvres musicales, œuvres dramatiques ou livrets d’opéra, 12 romans, 8 livres d’Histoire et divers autres livres (source Wikipédia). Il meurt à Paris, à son domicile du 4 rue de Florentin, dans le 1er arrondissement, le 30 janvier 1943.
Commentaire sur l’ouvrage :
L’ouvrage, dense, fouillé et multifacette, est un document incontournable sur la vie politique, artistique, mondaine et militaire (pour la Grande Guerre) parisienne pendant toute la 3ème République. Ami de Jaurès, zélateur de Gambetta (par lien familial), et sectateur-réhabilitateur universel de Galliéni, dont il est l’officier d’ordonnance, et sur lequel il a écrit plusieurs livres, Gheusi est un personnage incontournable. Son livre, qui suit un fil chronologique, tout en reportant peu de dates, en est donc difficile à appréhender dans toutes ses acceptions et subtilités, sauf à être un contemporain du même milieu social ou très fin connaisseur de la période. Œuvrant dans de nombreux domaines liés à ses fonctions et la centralité de ses rôles, il construit son ouvrage par tableaux dans une foultitude de domaines, à Paris, en France, comme à l’étranger. Divisé en quatre grands chapitres (Souvenirs de jeunesse – Avant la guerre – La Guerre et Après la guerre), c’est bien entendu le chapitre consacré à la guerre (pages 223 à 387), et notamment par sa position centrale, en 1914, dans l’entourage de Galliéni, qui forme le cœur de l’intérêt de ces mémoires. Il est donc heureux qu’un index paginé des noms cités soit présent en fin d’ouvrage. Il convient donc de s’y reporter pour toute analyse des données que ce livre contient. Bien entendu, quelque peu auto-promotionnel comme autocentré, le contenu de cet ouvrage demande à être confronté aux témoignages politiques et artistiques de mêmes niveau et ampleur. Gheusi est assez direct, décrivant opportunément le plus souvent les milieux qu’il côtoie, y compris montrant les intellectuels habillés en uniforme pendant la Guerre. Le livre est mâtiné, çà et là, de phrases centrales et frappées du coin du bon sens voire même de descriptions à contre-courant. Ainsi par exemple, il n’est pas tendre sur les « m’as-tu-vue-en-infirmière », assimilant les bénévoles sanitaires mondaines en demi-mondaines (page 228). Tout au long de l’ouvrage, il milite pour Gambetta et Galliéni, martelant bien entendu que ce dernier a sauvé Paris. Il donne également quelques éléments militaires intéressants, ainsi bien sûr que des éléments d’ambiance sur le Paris de la Grande Guerre, dans de nombreux domaines, civils comme militaires, et mondains comme politiques. L’ouvrage est donc bien celui d’un témoin, privilégié par sa position comme par sa centralité. Certes, il parisiannise tout, quitte à faire des erreurs factuelles, comme « l’affaire du Zeppelin Z-VIII – L22 » abattu au-dessus des Vosges meurthe-et-mosellanes, qui selon son témoignage menaçait Paris au point de lui faire passer une nuit d’« insomnie de fièvre et d’attente » (page 232). Sa vision d’une Paris menacée, occasionnant le départ du gouvernement, instructive, notamment pour l’ambiance politique pendant les quatre mois de son absence. Il évoque les « réfugiés en province » invités à partir, les députés « paniquards », ceux qui se plaçaient, pour fuir, sur la liste des otages allemands quand ces derniers seraient entrés dans Paris, évoquant une véritable « phrase-médaille » (page 239), etc. Il décrit l’ambiance militaire des tirs contre avions et de leurs risques pour les parisiens, et rapporte également quelques rumeurs de bourrage de crâne, comme les notables de Senlis assassinés et enterrés les pieds en l’air (page 240). Mais cette partie de son récit, dans les heures pénibles précédant la bataille de La Marne et son issue victorieuse, est intéressante. Témoin privilégié, il rapporte faits et ambiance, jusqu’à affirmer : « Pour donner une idée de l’autorité indiscuté de Galliéni, dès ce jour [3 septembre 1914], dans tous les milieux, rappelons un fait sans précédent en une cité menacée des pires désordres par l’approche de l’ennemi. Pendant quatre mois, malgré la réduction quasi-totale de toute police administrative, dispersée désormais et employée ailleurs, pas un crime et pas un délit n’ont été commis, fût-ce dans une des innombrables maisons abandonnées de la capitale – pas même un vol à la tire. Le « jusqu’au bout ! » du Chef, devenu en une nuit l’idole et l’égide de Paris, a rassuré les bons et terrifié les autres » (pages 241 et 242). Il ajoute plus loin, relativement au départ pour Bordeaux du gouvernement : « Le Ministre de la Guerre, une heure avant de rallier le train furtif, mais gouvernemental, qui allait gagner Bordeaux sans être sûr – autre légende que nous laissions circuler malgré son ânerie – de ne pas être enlevé, vers Villeneuve-Saint-Georges, par les uhlans de Von Kluck (…) » (page 243). Bien que n’ayant pas lui-même suivi les exilés bordelais, il y rapporte une atmosphère empoisonnée (page 276). Évoquant les possibles d’une invasion allemande de Paris, il donne détails intéressants sur la rédaction de la proclamation de Galliéni aux parisiens, où elle a été imprimée, ce que voulait dire son « jusqu’au bout » et conclut : « Nous avions, à tous les degrés de la hiérarchie, la bravoure facile de l’indifférence et de la fatalité » (page 243). Il fait même quelques excursions au front, dont il dresse des tableaux parfois surréalistes. Là encore, il atteste : « Nous avons vécu les journées suivantes dans le sillage de la retraite ennemie. Derrière eux, les Allemands on laissé, de chaque côté de la route, des amoncellements de bouteilles vides. Elles attestent que l’orgie est venue au secours du sol envahi et que les vins du terroir ont, eux aussi, contribué à démoraliser l’envahisseur. Mais il laisse après lui la tenace puanteur de ses excès stercoraires, les profanations sacrilèges de son luthéranisme congénital, la nausée de ses atrocités et de ses crimes » (page 255). Sensible à l’ambiance d’alors du champ de bataille, Gheusi rapporte quelques récits d’espionnite, tel celui du pont d’Epluches, qui n’était que prostatique ! (page 267).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Il convient de se reporter à la table des chapitres (4 majeurs et 12, 16, 15 et 17 sous-chapitres) pour hiérarchiser l’ouvrage, ainsi qu’à l’index des patronymes.
Page 197 : Publie dans La Nouvelle Revue, « deux ans et demie avant qu’elle éclatât » un article sur la guerre inévitable, lequel lui vaut des reproches du Quai d’Orsay
224 : En voyage à Berlin six semaines avant la guerre, et dit : « Toute l’Allemagne pue la guerre »
: Camp de concentration en Bretagne (vap 248 pour y interner l’autrichien Max Nordau, qui considère la France « comme le peuple le plus pourri, le plus faraud, le plus gangrené de toutes les tares latines du vieux monde »)
: Sur les Allemands, il dit : « Ce peuple absorbe la musique comme il absorbe de la bière et de la saucisse. Son avidité musicale se satisfait d’ailleurs de n’importe quels sons, de même que sa gloutonnerie se satisfait de n’importe quelle nourriture »
225 : Mort de la femme de Galliéni, qui le plonge dans la guerre corps et âme
232 : Antiallemand, il dit : « Il ne suffira plus, maintenant, de châtier l’Allemagne ; il faut aussi la déshonorer devant le monde »
239 : Tirs contre avions par les Écossais (vap 240 sur les risques encourus et le tireur d’élite de l’Opéra-Comique)
240 : Maire, M. Eugène Odent, et notables de Senlis fusillés et enterrés les pieds en l’air
242 « Train furtif » gouvernemental pour Bordeaux
250 : Sur l’épisode des Taxis de La Marne
252 : Abattage des chiens errants et achèvement des chevaux, puis leur enterrement par des zouaves et des sapeurs de Paris, après La Marne
255 : Bouteilles vides de la retraite allemande au bord des routes, orgies contributrices à la défaite allemande
255 : Effets de 75
260 : Officiers allemands fuyards exécutés par des officiers allemands
: Sur des dormeurs qui sont en fait des soldats morts !
: Réservistes angevins modèles de terrassiers par leurs tranchées paysannes
274 : Contrôle télégraphique et ses surréalismes pour l’affaire Louis-Dreyfus (fin 283), qui rappelle que l’espionnite, multiforme, ne concernait pas que la zone du front
279 : Ordre en blanc
290 : Sur le retour du gouvernement : « Le Gouvernement rentre dans Paris comme il en est sorti, avec une discrétion qui ne comporte ni tambours, ni trompettes, en sorte que la population ne se sera guère plus aperçue du retour des ministres que de leur départ… »
310 : Spectacle des zeppelins pour les parisiens
316 : Crise des 75
344 : Il adjective tous les ministres (le 4 février 1916)
353 : Chiffres sur l’Opéra-Comique
358 : Textilose pour les décors
363 : Voit Mussolini en 1917
369 : 74 voyages d’artistes dans les cantonnements de repos du front (en 1917)
372 : Vue de Mata-Hari (vap 373 son exécution, par une seule balle l’ayant atteinte !)
Yann Prouillet, 5 septembre 2025
Watkins, Owen Spencer (1873-1957)
Avec les français en France et en Flandre, Owen Spencer Watkins, Berger-Levrault, collection La guerre – les Récits des Témoins, 1915, 114 p.
Résumé de l’ouvrage :
Owen Spencer Watkins, révérend et aumônier du corps expéditionnaire britannique est versé, à Dublin, le 16 août 1914, à la 14e ambulance de 14e brigade de la 5e division. Il débarque en France, au Havre, et le 22 août est embarqué en train pour la région de Valenciennes. Par 9 lettres-tableaux qui se succèdent depuis cette date jusqu’au 31 décembre 1914, l’auteur nous fait vivre successivement la retraite de Mons et la bataille du Cateau (jusqu’au 6 septembre), la bataille de La Marne, celle de l’Aisne, la poursuite vers le nord, la résistance sur la ligne Béthune – Arras – La Bassée, la route de Calais barrée, la bataille d’Ypres – Armentières et la fixation du front préliminaire au premier hiver de guerre. Un appendice, en forme de post-scriptum, révèle, avant l’impression de l’ouvrage (déposé en octobre 1915), le destin de quelques hommes cités, le plus souvent tués dans l’exercice de leur mission.
Eléments biographiques :
L’ouvrage s’ouvre sur une notice biographique des éditeurs qui indique que le révérend Owen Spencer Watkins est né le 28 février 1873 à Southsea, un quartier du sud de Portsmouth (Angleterre). Son père, Owen Watkins, est lui-même révérend, pionnier du champ missionnaire de l’Afrique centrale. Il fait ses études à l’école de Kingswood et au Richmond college. En 1896, à l’âge de 23 ans, il est aumônier wesleyen auprès de la garnison militaire de Londres. Il sert également ailleurs qu’en Angleterre, dans le corps d’occupation en Crète (1897-1899), fait partie de l’expédition du Nil et prend part à la bataille d’Omdurman, qui se déroule le 2 septembre 1898 au Soudan, pendant la guerre des mahdistes. Il fut un des quatre aumôniers qui célébrèrent le service commémoratif du général Gordon, mort le 26 janvier 1885 à Khartoum. En 1899-1900, il se rend dans le sud africain et prend part aux batailles de Lombard’s Kop, de Nicholson’s Neck, au siège de Ladysmith, de Majuba, etc. Ces quatre années de campagnes lui apportent plusieurs citations à l’ordre du jour de l’Armée, la médaille de la Reine et la médaille de l’Egypte, avec plusieurs agrafes. Il attrape manifestement en Afrique une malaria qui le rattrape sur le front. Il parvient toutefois, par ses relations, à éviter l’hôpital de la Base, disant : « Une ambulance n’est pas faite pour s’encombrer de malades » ! Nommé honorary chaplain de 3ème classe le 19 août 1910, il est délégué à la conférence œcuménique de Toronto et aumônier du corps expéditionnaire britannique en 1914, promu à la second classe, ayant rang de lieutenant-colonel. Bien qu’il n’en parle pas dans sa lettre du chapitre V, de l’Aisne au nord de la France, correspondant à la période du 1er au 17 octobre 1914, il est cité à l’ordre du jour par le maréchal sir John French lui-même le 8 octobre. Grand amateur de golf, il a publié avant la guerre plusieurs ouvrages sur son expérience et sa mission africaines. Il réside à la publication du livre, qu’il dédie à sa femme, à Londres, dans le quartier de West Ealing. O.-S. Watkins sera une figure importante dans le développement de l’aumônerie méthodiste et poursuivra sa carrière d’aumônier général. Il quitte l’armée en 1928 et décède en 1957.
Commentaires sur l’ouvrage :
Cet ouvrage est de définition composite, ayant l’apparence d’un carnet de guerre, dument daté, aux noms restitués et au suivi géographique précis, facile à suivre, mais qui indique une suite de tableaux de guerre formés de 9 lettres écrites du 16 août au 31 décembre 1914. L’auteur rejoint l’ambulance de campagne n°14, formée à Dublin, le 16 août 1914, formation sanitaire du Corps Expéditionnaire Britannique (CEB). Embarqué sur le City of Benares, le navire transporte les éléments sanitaires de la Division (entre autres l’hôpital de la Base et son ambulance), il côtoie quatre aumôniers de l’Eglise anglicane et un catholique. Le 22, l’ambulance embarque dans un train à destination de Valenciennes alors que la bataille de Mons est déjà commencée. Mais les marches épuisantes successives vers le nord se heurtent au gros des troupes allemandes qui foncent vers le sud ; c’est la retraite, les premiers secours de l’ambulance à peine déclenchés. La marche vers le sud, par Cambrai, à partir du 26 août, lui fait côtoyer des hommes de toutes armes, agissant au secours des blessés en retraite de Mons ou du Cateau, ce jusqu’au revirement de La Marne, qu’il vit, le 6 septembre, au sud de la rivière, à Saacy. La retraite changeant de camp, la bataille de l’Aisne s’engage suivie d’une remontée effrénée en direction du nord, jusqu’à la Belgique, engagé dans la terrible bataille d’Ypres où le front va finir par se cristalliser à l’entrée de l’hiver. L’ouvrage permet d’entrer dans l’organisation du C.E.B., des différents régiments qui le composent, issu des villes ou des comtés, et des grandes unités qui prennent le nom de leur commandant. Il permet également de toucher du doigt l’action du témoin, sanitaire, médicale mais aussi sacerdotale, même si la diversité des obédiences religieuses anglaises apparaît clairement en filigrane. Mais paradoxalement il exerce peu son ministère, avouant même que la première messe qu’il peut donner au front survient seulement un dimanche de la fin de septembre (p. 47), un mois environ après son départ d’Angleterre. Il s’en ouvre (p. 74) disant : « Quant à l’œuvre d’aumônier, qu’importe ? (…) Peu d’occasions de réunir les hommes en un office solennel ». Peu d’erreurs sont décelées et les épisodes d’espionnite, réelle ou supposée, sont le reflet de la période d’écriture. Il ne sont pas totalement absents toutefois, avec une concentration de multiples cas rapportés (allemands déguisés, signaux lumineux, nuages de fumée ; ailes de moulins, trahison des habitants) (page 81). Existent aussi de rares exagérations (comme ce soldat blessé d’une balle « pénétrant dans la nuque (..) (et) ressorti[e] par la bouche » qui s’exprime aussi héroïquement que sans séquelle !) (page 69) ou ces tireurs allemands embusqués dans les lignes anglaises (p. 86), ne gêne pas fondamentalement le témoignage globalement crédible et opportun. L’ouvrage est titré « avec les français » mais ceux-ci sont relativement peu présents dans le récit qui n’est pas non plus teinté de francophobie exacerbée. Il n’aligne pas non plus les outrances de la « bochophobie », également courante dans les ouvrages ayant cette date d’écriture (1914) ou de publication (1915). Certes le livre met en avant sa « communauté », il dit : « Il n’y a vraiment pas dans l’armée anglaise d’hommes plus braves et plus remplis d’abnégation que les infirmiers et les brancardiers du corps médical » (p. 42). Pendant la bataille de l’Aisne, Owen Spencer Watkins aligne le chiffre des pertes des quatre premières journées de la bataille de l’Aisne : « 13 officiers et 450 blessés passèrent par l’ambulance n°14 ; les aumôniers enterrèrent 2 officiers et 230 hommes. Combien furent accueilli par d’autres ambulances ou inhumés par d’autres aumôniers, il est impossible de le savoir » (p. 46), y revenant quelques jours plus tard, disant, dans le chapitre Béthune – Arras – La Bassée : « Pendant les trois jours de notre présence au front, il ne passa pas moins de 100 officiers et de 3 000 soldats par la 14ème ambulance de campagne, à destination de l’Angleterre ou des hôpitaux de la Base » (page 74 ». Précis sur les lieux cités, le parcours de l’ambulance d’O.S. Watkins (p. 42) est aisé à suivre. Il contient aussi, par son long périple entre Paris et la Belgique, des éléments anthropologiques à noter. Par exemple, il décrit, dans les environs de Villers-Cotterêts : « En beaucoup d’endroits, les villageois veillèrent toute la nuit ; devant leurs maisonnettes, ils dressèrent des tables couvertes de rafraîchissements qu’ils distribuèrent aux troupes qui passaient d’heure en heure – café, thé, pain et beurre, tablettes de chocolat, fruits, cigarettes, gâteaux ; il est probable que tout ce qui pouvait se manger, se boire et se fumer fut consommé longtemps avant le passage de la queue de la colonne » (page 55). L’ouvrage est également intéressant sur le contraste entre l’armée anglaise, non basée sur la conscription universelle, et qui révèle, après la bataille de la Marne, l’absence de renforts due à une armée régulière exsangue dès les premières semaines de guerre (voir pages 89 et 90). Owen Spencer Watkins rend hommage à cette armée et aux sacrifices des soldats du CEB Il dit : « Point de renforts, pas de réserves, rien qu’une mince ligne khaki tenant opiniâtrement en respect des armées allemandes écrasantes » (p. 90) en plein cœur de la bataille d’Ypres en octobre.
L’ouvrage est enrichi d’une carte, d’un portrait de l’auteur et de 6 intéressantes illustrations montrant officiers et personnels de l’ambulance, malades et blessés dans l’église de Dranoutre ou l’ambulance dans un hameau proche du village.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 14 : Respect du drapeau de la Croix Rouge planté sur un tertre près de la gare d’Honnechy (Belgique). Horreur de l’ambulance
15 : Evoque des tranchées dès le 26 août
: Français en retard ou ayant battu en retraite
19 : Voiture hippomobile filtre pour la potabilité de l’eau
25 : Voitures anglaises portant des inscriptions des maisons de commerce
26 : Inscription sur les maisons pour éviter le pillage, parfois respectées par l’ennemi
27 : Bravoure des éclaireurs à moto, étudiants d’Oxford ou de Cambridge
28 : Vision émouvante d’un enterrement et de la participation de la population au traitement du corps en amont (vap 45)
34 : Assainissement du champ de bataille et enterrement des « braves allemands »
37 : Explication du surnom de Tommy : « À une certaine époque, les soldats anglais reçurent un calepin sur lequel ils devaient inscrire leur nom, le numéro de leur régiment et certains détails les concernant personnellement. Une formule imprimée fut jointe au calepin comme modèle à suivre. Thomas Atkins fut le nom hypothétique choisi par l’autorité militaire. Ce nom s’étendit au calepin, puis au soldat lui-même ».
59 : Sur la couleur de l’uniforme anglais : « Notre khaki est sans doute plus pratique, mais paraissait bien terne et bien sale à côté » de celui des cuirassiers
61 : Sur les apports inestimables des véhicules transformés en ambulances par des particuliers
63 : Saccages allemands, consommation des bouteilles et corvée de nettoyage (fin 64)
66 : Croix de Victoria, décoration instituée en 1856, décernée pour haut fait de guerre, avec rente annuelle de 250 francs
80 : Note sur la ceinture Sam Browne, large ceinture de cuir portée par les officiers anglais et imaginée par le général Sam Browne, qui se fit connaître particulièrement à l’époque de la révolte des Cipayes en 1857
80 : Espionnite multiple : allemand déguisé, signaux lumineux, nuage de fumée ; ailes de moulin, trahison des habitants
83 : Autobus londoniens transportant les troupes
86 : Tireurs embusqués dans les lignages anglaises, débusqué pas des gendarmes
88 : Note sur la chanson, sur la route de Tipperary, composée dans les premiers mois de la guerre par Harry Williams et Jack Judge
: Général von Kluck surnommé « Vieux five o’clock », vap 103 « Têtes carrées »
89 : Plaisanterie : « Il y a probablement une armée de Kitchener, mais pas un des pauvres diables qui sont ici ne vivra assez longtemps pour la voir arriver ! »
90 : Premiers froids dans la bataille d’Ypres
92 : Eloignement de l’ambulance (16 kilomètres aller-retour), trajet
96 : On entend le son du canon depuis Folkestone (première permission, 7 jours, du 23 novembre au 1er décembre)
: Visite du roi et du Prince de Galles, remise de décorations
101 : Être « fricassé », être cuit, avoir « du chien », du courage
106 : Foot au front et note sur la différence entre foot-ball Rugby et foot-ball Association
107 : Docteurs soignant gratuitement les nécessiteux, réfugiés et paysans ruinés par la guerre, état sanitaire des hommes
109 : Vue de Noël 1914 anglais
Yann Prouillet, 12 mai 2025
Théry, Gustave (1875 – 1940)
Impressions, réflexions et tribulations d’un GVC pendant la Guerre de 1914 – 1918
1. Le témoin
Gustave Théry (1875 – 1940), originaire de Valenciennes, exerce la profession d’imprimeur. Sportif investi dans la société de gymnastique « l’Ouvrière », il a quarante ans à la mobilisation. Territorial au 2e RIT, il est GVC (garde voie et communication) à Somain. Il réussit à échapper aux Allemands au moment de l’investissement de Lille et à partir de la fin de 1914, il garde des ponts dans le Pas de Calais, puis est muté à Cassel (Nord). Promu sergent en juin 1915, il part vers le sud pour passer presque deux ans dans les différents dépôts de Guéret et de Limoges, à entraîner les jeunes recrues (127 et 327e RI). En 1918, il revient dans le Pas-de-Calais où il retrouve sa fonction de garde-voie sur des viaducs vitaux pour les Anglais. Engagé politiquement à la SFIO, Gustave Théry a été maire de Valenciennes de 1925 à 1927.
2. Le témoignage
Michel Théry, arrière-petit-fils de Gustave Théry, a retranscrit en format word son journal de guerre sous le titre : Impressions, réflexions et tribulations d’un GVC pendant la Guerre de 1914 – 1918. Il a contacté Philippe Guignet, président du Cercle archéologique et historique de Valenciennes et de son arrondissement (CAHVA), et une journée d’étude « Gustave Théry » (action politique, engagement social, témoignage sur la Grande Guerre) a été organisée le 22 mai 2022. Le journal se présente comme une succession de notes quasi-journalières en 1914 et 1915, elles sont un peu plus espacées à partir de 1916. En format word 14, les proportions des cahiers sont de 89 pages pour 1914 – 1915, 51 pages pour 1916, 51 pages pour 1917 et 57 pages pour 1918, soit un total de 248 pages.
3. Analyse
Gustave Théry produit un journal de guerre intéressant, car pourvu d’une grande facilité d’écriture, il rédige un grand nombre de descriptions et fait des remarques originales sur la vie à l’arrière, vécue sous l’uniforme pendant plus de quatre ans.
A. Arrivée des Allemands
En août 1914, garde voie à Somain (Nord), il décrit la densité du trafic, la tension qui monte à la fin du mois (23 août 1914) et leur petit détachement est engagé par les avant-postes allemands le 24 ; après un combat inégal, après avoir fait le mort sur le talus de la voie ferrée, il fuit de nuit et réussit à atteindre Douai. Indécis, il décide finalement de rejoindre les siens à Valenciennes, tout en ayant bien conscience de se jeter dans la gueule du loup. Il y parvient le 26 août, après avoir marché à partir de Bouchain au milieu des convois allemands. Le 9 septembre, il tente avec sa femme et ses deux fils de repartir vers Lille, espérant attraper un tramway, mais ils restent bloqués à Denain. Le 21 septembre, nouvelle tentative, à pied, avec sa femme et sa sœur, et ils réussissent à rejoindre Lille. L’auteur se fait réintégrer par les militaires comme GVC à la gare, et – curieusement – sa femme et sa sœur retournent dans Valenciennes occupée. Il est vrai que les enfants y sont restés, et que personne ne sait que la séparation va durer plus de quatre ans. Depuis la gare de Lille, il évoque les combats dans les faubourgs (Porte de Tournai et Fives le 5 octobre), le bombardement sporadique qui commence, et sa fuite par la porte de Béthune le 9 octobre, juste avant que la souricière ne se referme (voir aussi Henri Depreux). Après 78 km à pied, il réintègre une unité de GVC à Boulogne-sur-Mer le 14 octobre : alternent dès lors pour lui, surveillance d’ouvrage d’art et instruction de la classe 15.
B. solitude morale
G. Théry souffre beaucoup de la séparation d’avec ses proches et de l’absence de nouvelles. En 1915, avec les évacuations qui commencent via la Suisse, ce sont des Valenciennoises qui transmettent des signes de vie (juin 1915 : «cela console un peu, mais quel bien ça nous ferait de nous recevoir une lettre d’eux ! » Le même procédé en décembre 1915 donne plus de « proximité » : « Une dame évacuée de Valenciennes, anciennement femme de ménage à la maison, actuellement dans l’Ariège, m’envoie une carte avec les baisers des miens qu’elle a quittés il y a quelques jours seulement…Quelle joie ! ». Un net mieux intervient avec la possibilité légale d’établir une correspondance (avril 1916), mais le contenu d’une carte est limité à vingt mots. L’éloignement qui dure provoque de longues crises de cafard, et des nouvelles reçues indirectement peuvent accentuer ces phases de dépression, ainsi d’une conversation du début de 1918, avec un Valenciennois récemment rapatrié et rencontré gare du Nord: «Mon deuil est fait, je ne dois plus compter sur l’arrivée de ma femme, mes deux fils sont prisonniers civils, mes biens (mobilier et matériel) sont ravagés. C’est la ruine de mon avoir en même temps que celle de mon espérance. » L’auteur est victime aussi d’une forme d’incompréhension, courante chez les septentrionaux séparés des leurs, restés en zone occupée ; cette douleur est liée au fait de ne pas être compris par ses camarades, issus des autres régions françaises. Dans un train en août 1916, il apprend l’existence des rafles de jeunes gens pour le travail forcé « Cette nouvelle m’épouvante (…) Je veux malgré tout me raidir contre ce nouveau malheur, mais impossible ; exaspéré, je me fâche avec des soldats permissionnaires qui chantent à tue-tête dans mon compartiment pendant que je pleure. Je m’adresse à des brutes inconscientes.» A l’extrême fin du conflit, même révolte contre l’indifférence des camarades ; le 8 novembre 1918, en proie à un cafard insurmontable, il déserte à Boulogne pour prendre clandestinement un train vers Valenciennes et essayer de trouver les siens ; c’est un échec et il doit rentrer piteusement à Boulogne. À son cantonnement il est l’objet de la risée de ses camarades : «Ces bougres s’esclaffent au récit de ma triste odyssée, ne comprenant ni mon geste ni mon chagrin ; car eux voyaient leur femme et leurs enfants chaque fois qu’ils allaient en permission, tandis que moi j’aspirais à cette minute heureuse depuis CINQUANTE-DEUX MOIS! »
C. vie au dépôt
En général, l’auteur est occupé à des tâches routinières qui provoquent à la longue une grande lassitude mentale. Il effectue aussi, au début de la bataille de Verdun, un stage d’entraînement très dur à La Courtine (neige, « journées d’éreintement »…), et, ayant perdu 8 kilos, alors qu’il est un gymnaste entraîné, il déclare que la perspective du front ne l’émeut plus, « il est préférable aux misères du camp de La Courtine. » Très déprimé par l’ambiance de l’arrière, il hésite à demander à partir sur le front, à cause de sa responsabilité de père de famille. Après un nuit d’insomnie et de tourments moraux, il finit par demander à partir (mai 1916) mais sa hiérarchie refuse : il devra rester sergent instructeur à Guéret : « J’encaisse avec sang-froid cette nouvelle déception à la pensée que ce refus me sauve la vie et évitera de faire de ma femme une veuve, de mes gosses deux orphelins. Allons c’est qu’il était écrit que je ne devais pas mourir ; tant mieux ! ». Lorsqu’il n’y a pas de faits qui sortent du quotidien, l’auteur produit la classique revue de presse des diaristes appliqués, et c’est sans surprise la partie la moins intéressante du corpus.
D. Considérations politiques
L’auteur est socialiste, mais ses considérations politiques n’occupent pas une grande place dans son récit ; une fête locale en mai 1915 lui fait penser à la ducasse d’Anzin, et par association d’idée au socialisme : « Anzin, cité socialiste, ton nom me rappelle une grande manifestation « contre la guerre » et quoique l’infernal fléau se soit abattu sur nous avec tant de brutalité et de sournoiserie, l’Idée reste ! Rien n’ébranlera nos convictions ; après comme avant, nous reprendrons notre propagande humanitaire : les peuples se comprendront bientôt ! » Il apprend dans un train, au cours d’une conversation avec deux adjudants coloniaux, comment les troupes noires sont recrutées (novembre 1916) ; lui, le socialiste, il semble découvrir ces faits, ce qui en dit long, dix ans avant Gide, sur l’ignorance ou l’indifférence de l’opinion : « une troupe d’occupation ou plutôt de siège s’amène devant le village, (…) canons et mitrailleuses sont braquées pour empêcher toute fuite, le chef de la tribu est appelé et sommé de fournir pour quelques heures après le nombre d’hommes valides désignés sous peine de bombardement. Les volontaires par force sont amenés en détachement à Marseille après avoir été rassemblés à Alger où chacun de ces malheureux touche une somme uniforme de deux cents francs ; le marché est conclu, l’homme acheté est fait soldat sans comprendre pourquoi (…) A l’occasion d’une autre permission, en juin 1917, il visite Lourdes « par acquis de conscience » et en revient édifié, produisant une savoureuse description critique, « me voilà aujourd’hui fixé sur ce vaste centre d’exploitation catholique où malgré le marbre du progrès, le Veau d’Or et la bêtise sont toujours debout, et pour longtemps encore. »
E. Mention de troubles
Sergent souvent convoqué pour assurer des services d’ordre, l’auteur a une vue globale sur l’arrière, et dès 1916 il mentionne certains troubles ; en février 1916, avant-même Verdun, il évoque des désordres à Guéret, dans les rues et à la gare, lors du départ pour le front d’une compagnie de renfort (13 février 1916) « scènes d’indiscipline, officiers et soldats s’invectivent très durement dans les rues de Guéret et à la gare où une scène de désordre a lieu.» Le 5 janvier 1917, il mentionne à Limoge un spectacle lyrique du ténor Romagno, très applaudi à la salle de la coopérative « l’Union », mais « un conférencier jusqu’au-boutiste qui l’accompagne dans sa tournée, se fait huer par les spectateurs, peu chauvins dans cette région. » En permission en juin 1917 à Cauterets dans les Pyrénées, il est outré car il ne peut pas aller voir le pont d’Espagne et la cascade de Cérisey, les gendarmes laissant les seuls officiers passer : « ordre du général à cause des cas de désertion trop nombreux ». Rentré pour assurer le service d’ordre en gare, il signale encore à la fin du mois de juin 1917 « Ici à Saint Sulpice-Laurière, comme dans toutes les gares où doivent stationner les permissionnaires du front, c’est chaque nuit un vacarme épouvantable et des discussions sans fin entre ces derniers et les officiers et les « cognes » de surveillance sur les quais ; l’attitude des poilus devient parfois menaçante au point que les gendarmes et officiers de service doivent se dérober pour apaiser l’esprit des soldats révoltés. Chaque départ de train est salué par une tempête d’injures envers les embusqués et les cris de « Vive la révolution ! » et « A bas la guerre ! » Que serait-ce si ces poilus exaltés, et il y a de quoi, savaient qu’à quelques mètres d’eux passent et stationnent des trains de soldats révolutionnaires russes ? On n’ose y penser !! » Il apprend ensuite les événements de la répression du camp de la Courtine par des bruits (juillet 1917, « Voici un nouveau secteur de bataille que l’on n’aurait jamais cru connaitre : le front de la Creuse !! ») puis, en octobre 1917, il est de garde à cet endroit pour surveiller des prisonniers russes, et il décrit un camp qui a souffert du bombardement « à coups de 75 ».
L’année 1918 le voit revenu dans le Pas-de-Calais, et il insiste sur l’intensification des bombardements aériens, les Allemands visent les arrières anglais (offensives de 1918) et les victimes civiles sont nombreuses. Après l’armistice, il retrouve sa famille en Belgique, mais sa maison valenciennoise a été complètement pillée. On a donc ici un témoignage original et de qualité.
Vincent Suard, février 2023
Plérieur (ou Plérieux), F.
Ce soldat est l’auteur d’un poème dédié à Pierre Jeukens (1880-1938), grand-père maternel de Jean Robin qui a confié le manuscrit à Guy Durieux (gdurieux07@orange.fr) lequel en a tiré un bref tapuscrit tiré à quelques exemplaires.
On ne sait rien de ce Plérieur, on ne connait pas son prénom, on ne sait pas si son nom est correctement transcrit. On peut seulement dire que son camarade Jeukens appartenait comme maréchal des logis à l’ambulance 12/6.
« Ce petit souvenir d’une nuit noire, avec filet rouge, vécue ensemble » avec Pierre Jeukens concerne la nuit du 24 au 25 août 1914, l’ambulance stationnant au village d’Azannes, à une quinzaine de kilomètres au nord de Verdun.
Tableaux réalistes du champ de bataille. Cris des blessés : « Maman ! » ; « A boire ! » « Tuez-moi car je veux mourir, je souffre trop ! »
Un des derniers passages évoque les « hobereaux » responsables des massacres, qui sont très certainement les junkers prussiens :
De leurs manoirs maudits, ils ont pris leur essor
Et de l’Europe entière ils déchirent le sort.
Rémy Cazals, juillet 2020 (d’après Guy Durieux)
Cols, Albert (1873-1942)
Né le 30 mai 1873 à Graulhet (Tarn) dans une famille aisée. Il devient lui-même géomètre expert, tout en continuant à gérer la propriété de Catougnac, tandis que son épouse tient un magasin de nouveautés, place du Mercadial, toujours dans la petite ville tarnaise spécialisée dans l’industrie de la mégisserie. En 1914, il a 41 ans et le couple a trois enfants. Famille catholique et politiquement conservatrice. On lit L’Echo de Paris ; on admire Albert de Mun. Albert Cols est mobilisé en 1914 et arrive le 15 août au 128e Territorial à Albi. Il constate l’absence d’uniformes, les carences de l’intendance, les difficultés à obtenir du piston. Il part vers le front en février 1915 au 322e Territorial. En octobre, il est nommé téléphoniste à la CHR. En mars 1917, il est détaché à la Poudrerie nationale de Castres.
Son arrière-petit-fils Pierre Austruy, dans le cadre d’une recherche généalogique, a trouvé 78 lettres envoyées par Albert à sa famille, du 15 août 1914 au 13 juin 1918, mais avec de longues périodes de manques. Il les a réunies dans un ouvrage de 162 pages, format A4, en les éclairant par le JMO du 322 : Albert et Anna Cols, 1914-1918, Lettres. Le livre n’est pas commercialisé. On peut en consulter un exemplaire aux Archives départementales du Tarn et à la Bibliothèque municipale de Graulhet. On peut joindre l’auteur à l’adresse paustruy@gmail.com
Dans les premières lettres, écrites d’Albi, il évoque les Prussiens en déroute après la Marne (15 septembre), mais estime que la guerre ne sera peut-être pas finie au 1er janvier 1915. La férocité allemande a causé beaucoup de ruines ; dans l’enfer, les soldats français accomplissent des prodiges, « provoquant l’admiration du monde entier » (9 octobre). « Dans un élan irrésistible les Français font une avance considérable » en Alsace ; « encore quelques jours et nos ennemis seront chassés hors de France » (23 octobre).
En même temps, Albert se préoccupe de la gestion de la propriété agricole car on manque de main d’œuvre. Il donne des conseils précis qui prouvent qu’il connait son affaire. Sa femme lui donne des informations sur la marche des affaires au magasin, qui est très satisfaisante au moins au début.
Le 17 décembre, il s’apitoie sur les jeunes de la classe 15, « chétifs » et qui « paraissent des enfants ». « C’était pitié de les voir. » Mais c’est aussi le moment où il reçoit l’annonce de la mort de son jeune frère Augustin, parti dans l’active avec le 15e RI. Comment avertir une mère ? C’est aussi une dimension à prendre en compte si l’on veut écrire une véritable histoire de la guerre.
Désormais se multiplient les expressions comme « épouvantable guerre », « guerre maudite », tout en souhaitant « une victoire éclatante suivie d’une paix longue et prospère » (31 décembre 1914). Le 5 février suivant, il rédige son testament car son régiment part pour le front, en Belgique et dans la Somme. Les lettres du premier semestre 1915 manquent.
En novembre et décembre 1915, de nombreuses lettres décrivent la boue en des termes qui rappellent ceux de Louis Barthas et de tant d’autres dans la même période, éboulements de tranchées, déluge, enlisements… C’est aussi le moment où Albert critique les embusqués et les journalistes qui « feraient bien de venir ici » (16 décembre). « On envie presque le sort de ceux qui sont tombés, au moins ils ne souffrent plus. » « Oui, ma pauvre amie, je suis bien malheureux, tu peux le croire. Nous nous faisons violence tous, sans quoi on deviendrait fous. » Les soldats, même les « vieux » comme lui, sont maltraités par les chefs. Et pas question de plaider la maladie : « il faudrait être mort pour être reconnu » (30 décembre). Le 7 février 1916, les poux sont désignés par les mots « mes locataires », dont il n’est pas possible de se débarrasser. Le 13 février : « Les hommes n’en peuvent plus et le moral devient de plus en plus déplorable. Tout le monde proteste et en a assez. Malheureusement nous ne sommes pas les maîtres et il faut obéir. »
Le 22 février 1916, il fait de sombres prévisions : « Si les hostilités ne cessent pas bientôt, la vie augmentera de plus en plus et des émeutes sont plus que probables. Je veux bien espérer tout de même que la population ne voudra pas se lancer dans une guerre civile qui serait pire que tout et ferait l’affaire des Allemands. Elle serait la première à en supporter les conséquences. Mais comment faire pour empêcher ceux qui souffrent de se révolter ? Cette perspective ne me rassure pas du tout, car guerre civile veut dire pillage. Il ne manquerait plus que cela, qu’une émeute ait lieu à Graulhet et qu’on te mette le magasin à sac. Comme je te le disais d’ailleurs, si une pareille éventualité se produisait, j’espère bien que les révolutionnaires commenceraient par aller chez les lâches qui font fortune à l’abri pendant que d’autres se font casser la figure. »
Rémy Cazals, juin 2020
Balmelle, Marius (1892-1969)
Les Archives départementales de la Lozère et les éditions Sutton ont publié en 2018 le livre Chroniques de la Lozère en guerre 1914-1918 : Carnets de Marius Balmelle, présentés par Thomas Douniès et Yves Pourcher. C’est le troisième témoignage important sur la vie dans ce département loin du front, après ceux d’Émile Joly et d’Albert Jurquet (voir les notices « Joly » et « Jurquet » dans 500 témoins de la Grande Guerre et dans le présent dictionnaire). Je mentionne mon léger désaccord avec les auteurs de la présentation à propos de Jean Norton Cru (voir la notice « Cru » dans les mêmes ouvrages). On ne peut pas dire que « les seuls témoins qui comptent [pour JNC] sont les combattants, les hommes qui ont connu l’épreuve du feu ». L’objectif du travail de JNC était d’analyser les récits des combattants ; il n’avait donc à se préoccuper que des combattants et pas des autres contemporains, même s’ils pouvaient être des témoins intéressants sur la vie à l’arrière. D’autre part, la référence à l’œuvre de JNC aurait gagné à signaler le grand livre Témoins et non le petit livre Du témoignage, d’ailleurs dans une édition amputée. Cette réserve faite, le livre de Marius Balmelle apporte beaucoup.
Le témoin
Il est né à Mende le 22 septembre 1892. Son père était agent voyer. Il a reçu une bonne éducation qui lui a permis de devenir un érudit passionné par son département natal. Même dans les années de guerre, il en décrit les beautés et il publie son premier livre sur « les richesses du sous-sol et les richesses hydrauliques du département de la Lozère ». Il écrit aussi de la poésie et « un conte moyenâgeux » (p. 231). « Je suis croyant » (catholique), dit-il. Avec le curé de Mende, il se plaint que la guerre « nous prend aussi la vertu des femmes et des filles » (p. 76). Le passage du 18 septembre 1914 sur les missionnaires dont « certains se trouvaient perdus dans les forêts équatoriales au milieu de tribus sauvages parfois anthropophages », qui sont « revenus accomplir leur devoir de Français » est trop long pour être repris ici en entier (p. 56).
Le 12 juin 1915 (p. 88), il décrit ses « cultes » : la famille ; la volonté ; la solitude ; la Nature natale ; l’étude ; les fleurs. On est étonné de ne pas y trouver la patrie, alors que de nombreuses pages stigmatisent la barbarie des Allemands. Les auteurs de la présentation soulignent le fait que, classé service auxiliaire et affecté à Mende, il n’exprime jamais le regret de ne pas combattre.
Le témoignage
Les présentateurs constatent aussi que, chez Balmelle, la guerre n’a pas déclenché l’écriture d’un journal, mais qu’elle lui a donné un nouveau sens. Il a commencé à tenir son journal en 1911 et l’a poursuivi jusqu’en 1948. Le livre ne reprend que les pages allant de Noël 1913 au 31 décembre 1919. Plusieurs feuillets ont été arrachés, des phrases effacées ; on en ignore les raisons. La partie sur 1918-1919 est très brève : lassitude ? coupures ? temps consacré à d’autres formes d’écriture ? Travaillant à l’intendance, il était bien placé pour donner des renseignements sur la vie matérielle en Lozère ; il a aussi tenu compte du récit d’un combattant venu en permission (sur huit pages en janvier 1916). Le journal de Marius Balmelle a été déposé par la fille de l’auteur aux Archives départementales qui ont organisé en 2016 une exposition sur le thème « Marius Balmelle, un érudit au service de la Lozère ».
Contenu
Dès la fin de juillet, les habitants de Mende font des provisions, échangent les billets de banque pour de l’or, retirent leurs fonds de la Caisse d’épargne. La mobilisation s’accompagne d’angoisse et de pleurs. Les soldats affluent et boivent. Le départ se fait dans l’enthousiasme. Marius pense, dès le 6 août, que les Allemands sont des brutes féroces, pires que des animaux. La presse locale aspire au moment « où la bête malfaisante sera écrasée, afin que la menace allemande ne plane plus constamment sur la paix du monde pour enrayer tout envol vers l’idéal, vers la science, vers l’art et la bonté ». Bientôt arrivent des réfugiés, des blessés, des prisonniers allemands. Des hôpitaux doivent être installés dans les établissements scolaires et la rentrée est difficile. Il signale l’espionnite, les lettres anonymes de dénonciation, les rumeurs, une vaccination collective contre la typhoïde, les emprunts de la Défense nationale, la hausse des prix. En 1915, quatre déserteurs sont arrêtés par la gendarmerie (p. 131). Plus loin (p. 141), figure la liste des entreprises qui travaillent, en Lozère, pour la défense, avec mention particulière des mines du Mazel. Il effectue plusieurs voyages, mêlant l’utile (visite des poudreries de Bergerac et de Toulouse) et l’agréable (tourisme archéologique à Cordes, Carcassonne, etc.).
Le livre donne des index (lieux, personnes, thèmes), sources et bibliographie locales, important encart d’illustrations.
Rémy Cazals, décembre 2018
Rama, Auguste (1883-1973)
Le livre d’Auguste Rama, Souvenirs 1914-1919, Une traversée de la Grande Guerre (2018) fait partie des ouvrages produits par la piété familiale. Il est disponible chez ses petits-enfants : cecilerama@laposte.net.
Auguste Rama est né à Quintenas (Ardèche), près d’Annonay, dans une famille paysanne. On comprend qu’il est catholique et qu’il a reçu une certaine instruction qui lui a permis de devenir imprimeur à Romans en 1911, associé avec ses frères. À 80 ans, il a écrit 700 pages de souvenirs ; les p. 433 à 565 concernent la période de la guerre ; ce sont celles qui sont reprises dans le livre. S’il se souvient bien de « la vie quotidienne au front » (titre d’un chapitre), il avoue un trou dans sa mémoire en septembre-octobre 1917 (p. 210) et il place l’offensive de la Somme en février 1917. Sur les mutineries, il écrit : « Le général Pétain eut le mérite de calmer les esprits, de remettre de l’ordre au moindre prix. Mais la période avait été plus que critique. Tous les régiments d’infanterie n’avaient pas été touchés par cette vague de rébellion. Le 99e entre autres avait été épargné. Jamais je n’avais perçu le moindre symptôme. » Or Denis Rolland (La grève des tranchées, Les mutineries de 1917) signale un trouble au 99e RI le 1er juin à Œuilly.
Son mariage, prévu le 8 août 1914, ne put être célébré qu’en février 1916. Il décrit l’angoisse lors de la mobilisation, la pagaille à la caserne du 261e RI à Privas, les départs « à Berlin ». Caporal, son état de santé lui vaut un emploi de bureau jusqu’en juillet 1916 ; il expose ses craintes d’être considéré comme un embusqué.
Il part en juillet 1916 vers le front de Verdun, au 99e RI, et il découvre « un autre monde », celui des tranchées, des bombardements, du gaz. Deux phrases significatives :
– p. 97, sous le bombardement : « cette attente de celui [l’obus] qui va peut-être vous mettre en bouillie » ;
– p. 137, avant de sortir pour une attaque : « ce dernier quart d’heure d’attente est quelque chose d’inhumain ».
Auguste Rama n’aime pas Mangin (« le nom seul de Mangin faisait frémir », p. 104). Il parle d’un « complot de politiciens » qui « manœuvrait pour faire monter Nivelle » au détriment de Pétain (p. 89). Thème repris p. 168 à propos de l’offensive du 16 avril 1917 : « Attaque voulue par le sinistre général Nivelle qui avait, grâce à des influences politiques, remplacé le général Pétain, et qui, par ambition, fit massacrer inutilement une partie de l’armée française, et de ce fait accentua le malaise et le découragement des troupes pour en arriver à la période noire des désertions, des rébellions collectives. »
Rémy Cazals, décembre 2018
Pébernard, Antoine (1886-1975)
Antoine Pébernard est né le 9 avril 1886 à Saint-Hilaire (Aude), d’un père charpentier. Il exerce le même métier. Service militaire au 5e Génie de 1907 à 1909. Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 6 mars 1919. Il se marie à Limoux le 11 décembre 1916. Après la guerre, il est domicilié à Luchon. Il meurt à Salies-du-Salat à l’âge de 90 ans.
Son témoignage de guerre est un manuscrit sur cahier d’écolier (60 pages) conservé aux Archives départementales de l’Aude, cote 3J-1358, transcrit par Guilhem Delon dans son mémoire de maîtrise 1914-1918. De l’arrière au front : l’arrondissement de Limoux dans la tourmente, Université de Toulouse Le Mirail, 1997.
Quelques notes dans l’ordre chronologique sur les activités du 5e Génie qui vit en grande partie dans des trains :
– 2 août 1914 : « Grand enthousiasme. Pleurs. Chants. Cohue dans les gares. »
– 21 août : « Je fais une table pour les officiers. »
– 26 août : dans la retraite, faire sauter un pont.
– 4 septembre : des blessés démunis de tout. « On leur porte nos gamelles. »
– Marche en avant après la Marne. Reims, Soissons.
– 19 novembre : Secteur de Braisnes. Fabrication de fascines, claies, piquets pour les tranchées.
– 17 décembre : construction de radeaux avec des demi-muids.
– 29 février 1915 : en gare de triage de Dijon, construction de voies.
– 12 juillet : première permission.
– 26 juillet : construction d’un voie ferrée à Cuperly
– 1er septembre : Auve. « Les premiers trains de munitions et de ravitaillement sont arrivés, ainsi que de nombreuses troupes. On prépare une offensive. Je travaille à la construction des gares. Plus de cent wagons de bois à employer. »
– 22 février 1916 : Bar-le-Duc. Réparation d’aiguillages et construction de voies de garage pour le Meusien. « On travaille quelquefois jusqu’à 2 h du matin. C’est l’attaque de Verdun et le travail est très pressé. »
– 15 mai : Alsace. Construction d’une ligne « en pays conquis ».
– 29 avril 1917 : « Retour de permission. Le 16 avril a commencé l’offensive prévue, elle n’a pas réussi. Le secteur est devenu très mauvais. On a réparé la voie sur la ligne de Mourmelon à Reims, jusqu’à 1500 mètres des tranchées. »
– 15 mai : « Départ pour Saint-Hilaire-au-Temple. On répare les dégâts que font les avions. »
– 11 août : Vers Daucourt : « 1200 mètres de voie par jour. Nourriture exécrable. »
– 24 janvier 1918 : Même secteur. Capitaine détesté pour sa dureté et ses brimades imposées aux Malgaches qui travaillent avec le Génie.
– 27 mars : Châlons bombardé de nuit par les avions. « Les gens vont tous les soirs passer la nuit dans les champs et rentrent au matin. Et le Génie répare les dégâts et rétablit la circulation.
– 8 août : Vers Montdidier. « Des milliers de prisonniers arrivent par les boyaux. »
– 11 août : Remise en état de la gare de Montdidier. « Le plus beau spectacle de destruction qu’on puisse voir. Tout est pulvérisé. Pas un arbre, pas une maison debout. La gare, immense, n’est qu’une succession d’entonnoirs, quelquefois énormes, obstrués par des traverses déchiquetées et des rails tordus. C’est le vrai chaos. On rétablit les deux voies principales sous un soleil impitoyable et une poussière terrible. »
– 22 août : Vers Daucourt. « Capitaine sérieusement blessé par une mitrailleuse boche, en avant de la ligne. Quelle perte heureuse pour nous ! […] Plus on va, plus le pays est désolé. Les gaz ont brûlé même l’herbe. […] Des cadavres plein les fossés. »
– 16 septembre : Vers Ham, travaux de déminage.
– 6 novembre : Vers Bohain. « La voie du train est minée partout, nous habitons sur un volcan. »
– 11 novembre : « Date mémorable. L’armistice a été signé. Les Anglais manifestent leur joie, feux d’artifice avec les fusées boches qu’on trouve partout. Pour nous, pas de changement. On travaille sur un appareil miné qui peut sauter d’un instant à l’autre. »
– 8 décembre : « A voir le dénuement qu’ils ont laissé, on comprend qu’ils ne pouvaient plus tenir la guerre dans ces conditions. C’est la misère et la famine dans les armées boches qui en ont déterminé l’effondrement. »
– Février 1919 : « J’ai trouvé, le 5, à mon arrivée, mon petit Louis, né la veille. »
Rémy Cazals, septembre 2017
Je remercie Claude-Marie Robion, Archives de l’Aude, de m’avoir communiqué les documents suivants concernant Antoine Pébernard :
– 5E 344-017 Acte de naissance.
– 5E 206-187 Acte de mariage.
– RW 00559-132 Fiche matricule.
Chabos, Henri (1890-1965)
Le livre qui fournit les informations sur ce soldat de 1914-1918 est : Jean-François P. Bonnot & Sylvie Freyermuth, De l’Ancien Régime à quelques jours tranquilles de la Grande Guerre, Une histoire sociale de la frontière, Bruxelles, Peter Lang, 2017, 473 p. (index des noms de personnes, des noms de lieux, index des notions, abondante bibliographie).
Fils de douanier et de couturière, Henri Chabos est né à Saint-Hippolyte (Doubs) en 1890. Le livre retrace d’abord une généalogie d’employés de l’État ayant conservé leurs attaches à la montagne (forêt, élevage, horlogerie) dans une région frontière. Sous le Premier Empire, l’ancêtre Jean Ferréol Chabod, douanier, a fabriqué de faux papiers pour échapper à la conscription et continuer à faire vivre sa famille.
La famille d’Henri est très catholique. Lui-même est classé premier au certificat d’études en 1901. Ses courriers montrent un lexique varié, une maîtrise de la syntaxe. Commis des postes, il épouse Marcelle Laclef, institutrice, le 5 novembre 1917. Les auteurs insistent sur la nécessité de comprendre « l’individu préexistant à la guerre » et approuvent les travaux en ce sens des historiens du CRID 14-18.
Service militaire au 8e Génie, caporal en 1913, sergent en novembre 1918. On n’a pas de témoignage sur les premières années de guerre ; on a des photos sur son séjour à Salonique d’où il est rapatrié pour paludisme. Il est soigné à Nice d’où il envoie des cartes postales à sa fiancée. En février 1918, il écrit de Marseille où il va s’embarquer pour Beyrouth, préférant rester en vie dans l’éloignement à une participation plus active à la guerre. Beyrouth jusqu’au printemps 1919. Il est démobilisé en été. Nommé quelque temps à Paris dans son métier, il revient à Montbéliard jusqu’à sa retraite comme contrôleur principal.
Les lettres d’Henri à sa fiancée, puis sa femme, ont été détruites par leur fille à cause des passages intimes qu’elles contenaient. Mais les cartes postales ont été conservées, considérées comme des images. Le texte au dos est donc resté.
Les auteurs du livre se réfèrent à plusieurs reprises aux travaux des historiens du CRID 14-18. Dès le début (p. 15), ils font référence à la date de la publication de Barthas, importante pour la recherche de témoignages inédits ; référence aussi à 500 Témoins de la Grande Guerre et au dictionnaire en ligne sur le site du CRID 14-18. Ils critiquent les théories excessives (consentement à la guerre, culture de guerre, notion de brutalisation). Pour Henri Chabos, comme pour tant d’autres soldats, la guerre est maudite, l’armée est détestée. Henri Chabos écrit (p. 194) : « J’en veux haineusement à tous les auteurs de la guerre… C’est au régime militaire en entier qu’il faut en vouloir… » Pas de haine pour l’ennemi, pas d’exaltation de la Patrie, mais un attachement à la petite patrie. Jamais de cartes postales patriotiques.
De la petite patrie, viennent les lettres de Marcelle dont Henri a un grand besoin : « Je me demande comment je pourrais vivre sans ma lettre à peu près quotidienne. » Loin de toute brutalisation, il ajoute : « Je deviens sentimental de plus en plus. » La séparation est comblée par des projets de vie familiale dans la paix retrouvée. L’écriture se modifie un peu après le mariage : elle devient plus libre ; Henri n’hésite plus à utiliser des mots d’argot. Il exprime à plusieurs reprises son désir et fait allusion à des « rêves roses ».
On a quelques informations sur ses lectures. Celles d’avant la guerre ont construit un jugement plutôt dévalorisant sur l’Orient. Pas d’allusion à la lecture de livres de guerre. Henri essaie de lire Les Métèques de Binet-Valmer, par ailleurs auteur d’un témoignage analysé par Jean Norton Cru. Mais le livre lui tombe des mains après quelques pages. [Cette mésaventure est arrivée aussi à l’auteur de cette notice.]
Les auteurs du livre ont éclairé le témoignage d’Henri Chabos par une abondante documentation. Puis-je signaler une erreur ? Page 188, ils reprennent à leur compte cette affirmation d’Evelyne Desbois : « La majorité des lettres envoyées par les soldats ne passait pas par la voie réglementaire ; ils trouvaient toujours quelqu’un pour les poster civilement. » Une fréquentation assidue des lettres de combattants montre que le passage par la poste civile était exceptionnel.
Rémy Cazals, juin 2017