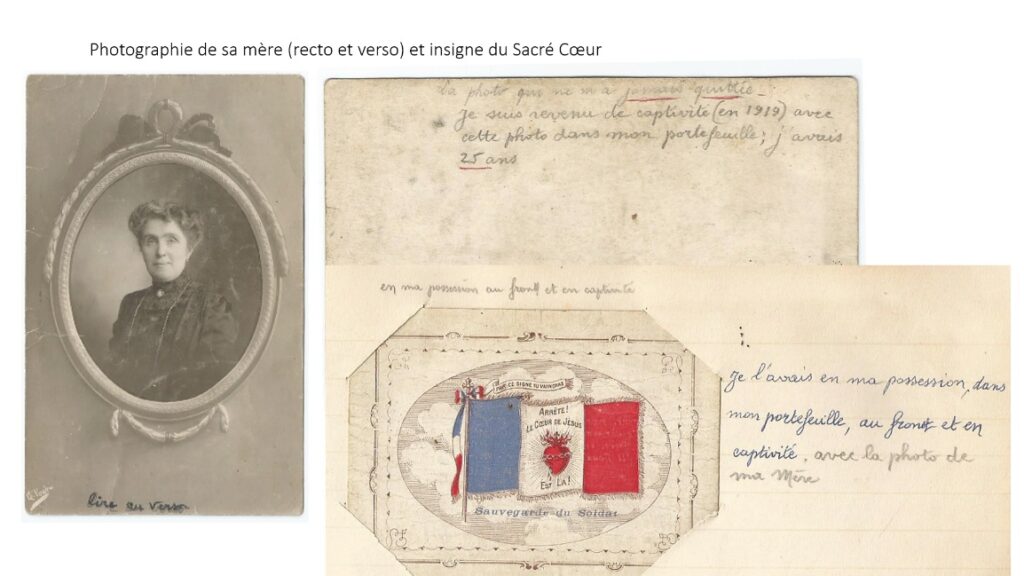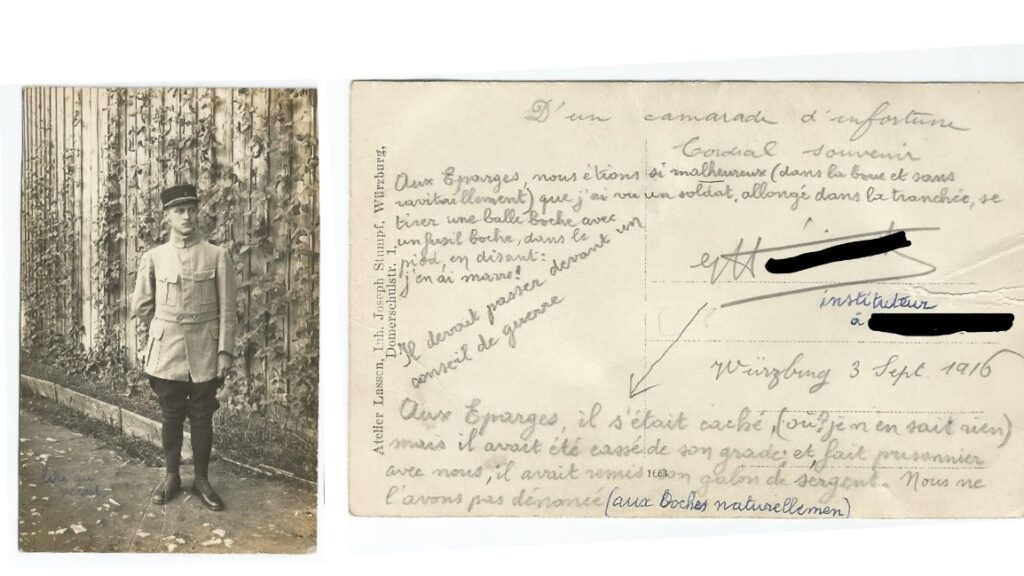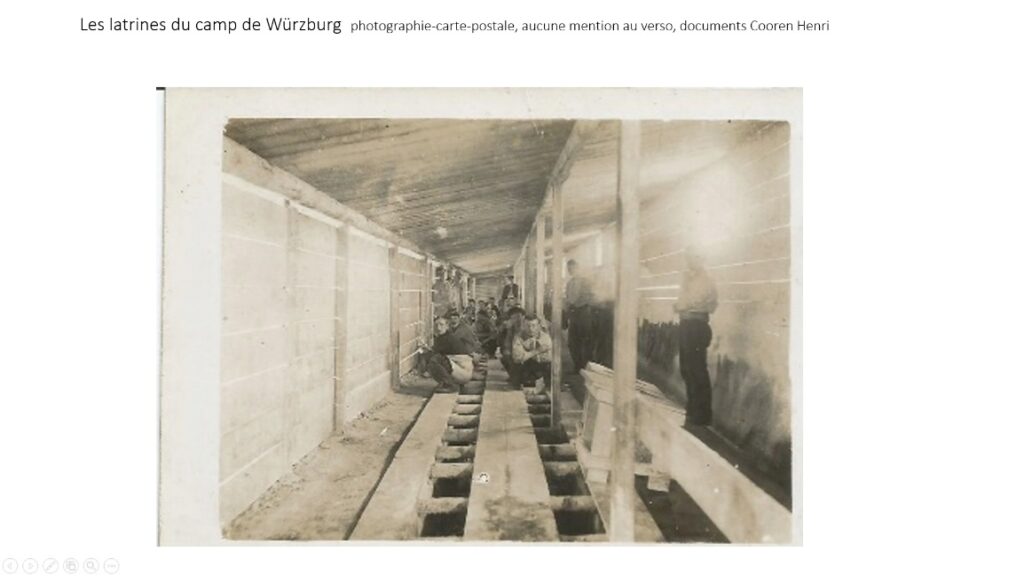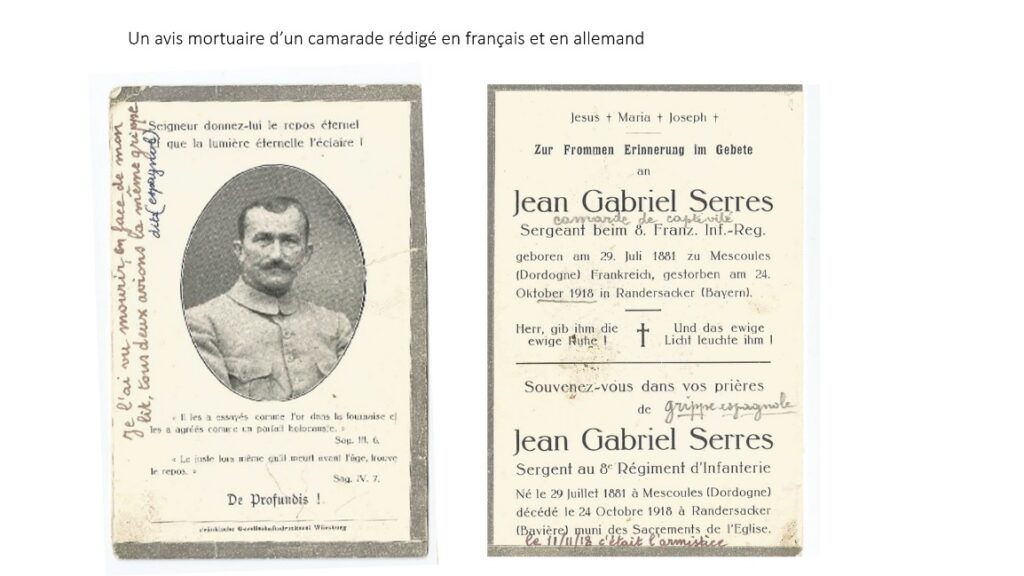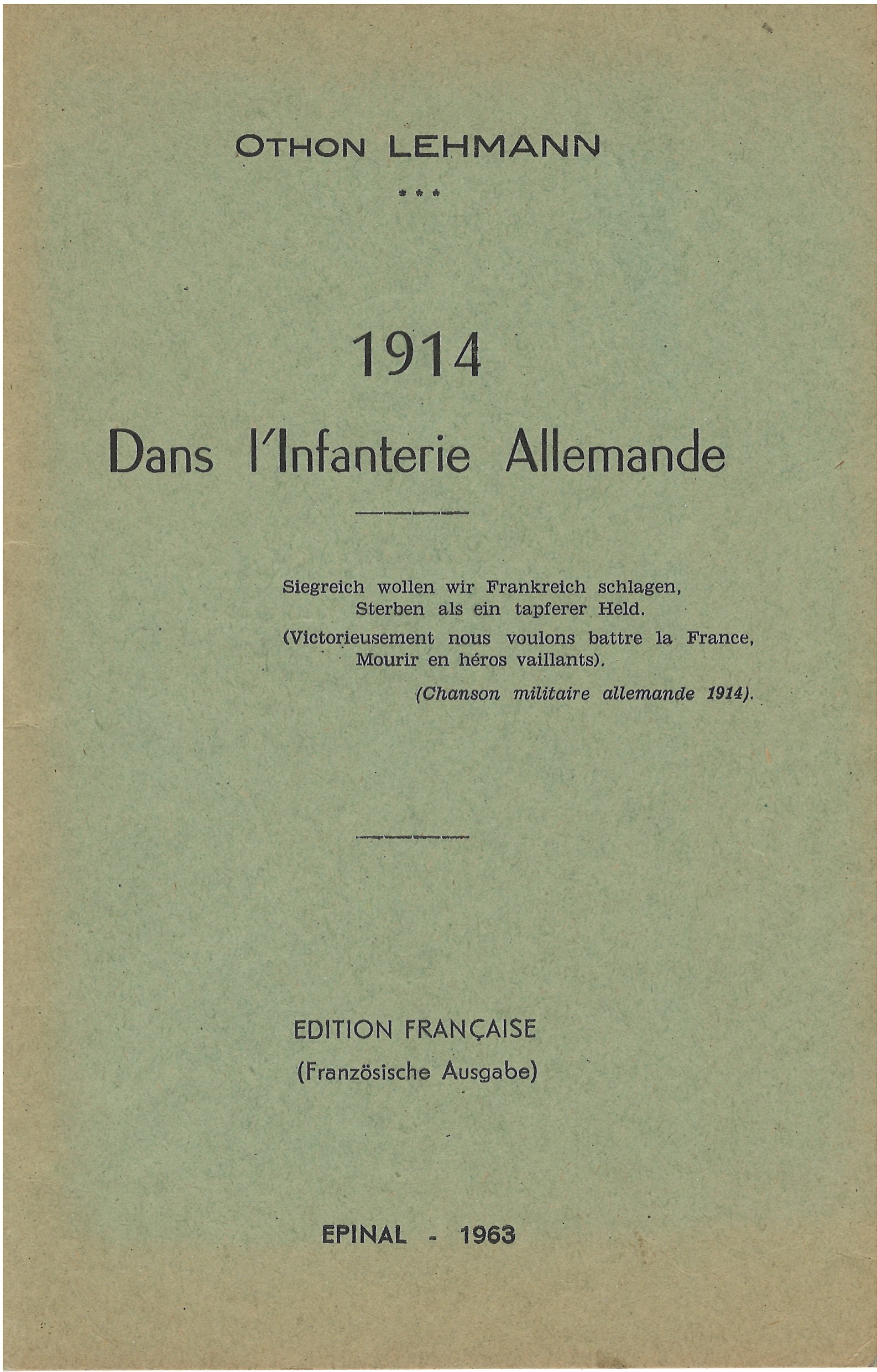Au-dessus de la tranchée – Carnets de guerre d’un chef d’escadrille
1. Le témoin
Georges Villa est un peintre-dessinateur-illustrateur parisien qui publie dans la presse, travaille sur commande pour l’édition et fréquente le milieu artistique montmartrois. Surpris par la mobilisation en Russie, il rejoint le 132e RI où il est blessé en novembre 1914. Il réintègre ensuite son unité aux Éparges et est à nouveau blessé en avril 1915. Accepté dans l’aviation en juillet 1915, il débute une formation de pilote. Affecté à la MF 50 en janvier 1916 avec le grade de lieutenant, il passe ensuite dans un emploi d’état-major à Bar-le Duc pour former l’infanterie à la liaison avec l’aviation. Passé capitaine, et malade au printemps 1917, il est finalement affecté en école d’aviation : directeur-adjoint à Juvisy, chef du personnel à Étampes, il termine la guerre à Châteauroux. Il continue ensuite sa carrière de peintre-dessinateur, se spécialisant notamment dans le thème de l’aviation.
2. Le témoignage
Les carnets de G. Villa, découverts récemment, ont été publiés aux éditions Edhisto, sous la forme d’un texte retranscrit, préfacé et annoté par Christian Wagner (Au-dessus de la tranchée, 2022, 285 pages). Ce beau livre, édité en collaboration avec la Société historique et archéologique de Bourmont (Haute-Marne), contient, outre le texte des carnets, de nombreuses photographies et la reproduction de dessins, caricatures, projets… le tout en provenance du fonds Villa. Le début des écrits raconte le voyage en Russie avant août 1914, puis on passe directement à juillet 1915 en école de pilotage, la période « infanterie » est manquante. La présentation du livre par Christian Wagner, par ailleurs auteur d’une biographie de G. Villa, est très fouillée et nous aide à cerner notre témoin, c’est une mise en perspective biographique, historique et littéraire très stimulante. Le préfacier précise aussi que de nombreuses considérations sur les projets graphiques de l’auteur n’ont pas été reproduites dans ce volume.
3. Analyse
Les journaux de guerre sont en général destinés à la famille ou au public ; avec Georges Villa, il s’agit plutôt de carnets « pour soi-même. » En plus de ses expériences comme pilote et officier, ses écrits intègrent des notes sur son art, ses doutes, ainsi que ses résolutions comme artiste. Il se livre aussi sur sa vie sentimentale, sa relation avec sa marraine de guerre et les péripéties de cette relation tumultueuse. Enfin il évoque sans fard ses faiblesses, sa grave dépression du printemps 1917, et son sentiment de ne pas être reconnu à sa valeur. C’est donc un document à caractère intime, probablement pas destiné à être rendu public, et si cela entraîne pour nous un devoir de responsabilité, c’est bien ce caractère de totale franchise qui fait l’intérêt du document.
Pilote débutant
Les carnets regroupent les remarques d’un lieutenant élève-pilote appliqué, mais qui ne semble pas comme d’autres dévoré par la passion de l’aviation. Ses remarques montrent ses progrès réguliers ainsi que la conscience de ses limites, gage de survie sur ces appareils qui pardonnent peu les erreurs. Le 22 septembre il note : « ça vient. Je ne pense plus, sur l’appareil, au danger que je cours. » Dans l’aviation, l’esprit crâne est de rigueur et il est impossible d’avouer ses appréhensions. Lors de l’obtention de son brevet en novembre 1915, il fait encore preuve de lucidité (p. 72) : « Je suis breveté. Sincèrement, puis-je dire en moi que je sais voler ? Non ! (…) J’ai constaté d’autre part que maintenant, au fur et à mesure que j’apprends, je constate que j’ai encore beaucoup à savoir, et l’assurance de voici un mois fait place à une prudence et à une réflexion de meilleure utilité. » Ce n’est donc pas un pilote d’instinct, mais un pilote réfléchi qui sort de formation pour intégrer la MF 50 (pour avion Maurice Farman).
Pilote de guerre
Il réalise sa première mission au-dessus des lignes le 20 février 1916, et fait ensuite régulièrement du réglage, c’est-à-dire qu’il emmène un observateur qui règle les tirs de l’artillerie au sol. Ces observateurs sont en général de jeunes artilleurs sortant de grandes écoles scientifiques ou de formation d’ingénieur. Revenu au sol il dessine, entretient sa correspondance avec sa marraine, et rumine (p. 100, mars 1916) : « Quand donc irai-je au danger sans une telle appréhension ? Je devrais pourtant m’y habituer. » Il progresse aussi par ailleurs, se forme au vol de nuit, exécutant une mission de bombardement sur Laon. L’aviation en 1916 est encore un petit monde, et il réalise un réglage avec Jean Navarre en protection (mars) puis rencontre Nungesser (août). L’auteur mentionne ses missions, mais il entre peu dans le détail de ses vols.
À l’escadrille
Ses écrits montrent qu’en escadrille il est recherché pour ses dessins, illustrations de menus ou caricatures de camarades, mais aussi qu’il n’est pas complètement intégré (p. 116, juin 1916): « Je m’isole de plus en plus. Pourquoi le contact avec mes compagnons d’escadrille m’est-il si désagréable ? Les observateurs surtout.
1° Ils sont du Midi et vantards
2° Ils sont artilleurs.
3° Ils sont jeunes et de mentalité trop potache, sans discipline.
(…) Un pilote, près d’eux, paraît un vulgaire chauffeur de ces messieurs. »
À 33 ans, il ne se sent pas d’affinité avec ces étudiants attardés et indisciplinés, et alors qu’il a accumulé une importante expérience avant la guerre, il fait un complexe d’infériorité, ayant aussi conscience d’être trop réservé pour ce milieu bruyant. G. Villa vole en mission de guerre durant l’année 1916, puis va en octobre occuper des fonctions de liaison à Bar-le-Duc.
Dépression
Passé capitaine, il est satisfait de son affectation temporaire à Bar pour faire des conférences et des propositions sur la liaison infanterie-aviation. Il pense (p. 144) que c’est une bonne étape pour quitter la MF 50, aller vers une promotion et passer deux ou trois mois d’hiver « plus au confort ». Las, rien ne fonctionne comme il l’espérait : il attend en vain un commandement d’escadrille et finit par être renvoyé à la F 44 comme simple pilote. Arrivé sur place, c’est alors l’effondrement moral et physique rapide, il ne se sent plus capable de rien (p. 175) : « L’écœurement, l’usure, les déceptions et la fatigue physique autant que nerveuse m’ont complètement ôté l’énergie et l’idéal qu’il faut à un militaire actif. » Le médecin du groupe d’aviation de la 2e Armée lui diagnostique une « asthénie très forte, lassitude prononcée, volonté très affaiblie, impossibilité d’un effort physique ou moral soutenu.» Il se soigne, se repose, et sa nomination à Juvisy en juin 1917 comme commandant-adjoint de l’école de pilotage lui permet de reprendre le dessus. On notera que cette mutation, un embuscage qui n’est jamais formulé comme tel, est obtenue grâce à ses relations familiales : son père, décédé en 1903, était général de brigade et sa mère s’est mise en relation avec l’État-major (p. 184).
Juvisy, Étampes et Châteauroux
Dans ces postes administratifs, l’auteur donne satisfaction, et retrouve santé et énergie, tout en récupérant de l’autorité (p. 196) : « ici, c’est le collège où il faut être sévère, punir, faire peur car chacun veut tirer à la corde et ne cherche qu’à carotter. Il faut éviter d’être poire. C’est l’École des pistonnés, Juvisy. Pour y venir, il faut avoir des recommandations. Et les moniteurs ! Brousse, fils de député ; Zévaco, Dalbiez. » G. Villa évoque la vie de bureau, les relations avec les chefs, sa volonté de progresser (organisation du travail) et ses rencontres. Il rationalise et propose des innovations. Dans ses fonctions d’autorité, on peut aussi citer par exemple des incidents à Étampes (p. 233), peu courants en première ligne : « Il y a des drames avec les dames [serveuses-femmes de ménage]. On les pelote de tous côtés et cela, forcément, tourne mal et ce sont des histoires embêtantes. »
Les marraines
Georges Villa, au début de 1916, correspond avec sa marraine de guerre Valentine Brunet ; il déclare le 11 avril : « Je suis amoureux ! Amoureux de ma marraine que je ne connais pas sinon en photographie. » S’il se dit certain que cette relation n’aura aucune suite sérieuse, car elle a trente ans et deux petites filles, sa position évolue rapidement et en juillet, il incline vers le mariage avec « Chou », qui semble avoir un peu de bien. Le divorce n’est toutefois pas une affaire simple, d’autant que le mari mobilisé (« Attila ») ne reste pas passif. L’affaire est traversée d’incertitudes, liées à l’inconstance de Chou, et aux infidélités platoniques de Georges : un soir de spleen, il met une annonce dans la Vie Parisienne, et reçoit en réponse près de 200 lettres de marraines… (p. 160) : « je brûle presque tout. N’ai-je pas Chou mieux que tout cela ? Mais flirteur incorrigible, pour m’amuser, pour la psychologie, je réponds à une vingtaine afin de voir ce que c’est.» Malgré ce marivaudage « industriel », notre couple aviateur-marraine de guerre semble tenir jusqu’à l’Armistice, et, pour nous, il reste la précieuse liste des marraines de la page 161, que C. Wagner a eu la bonne idée de reproduire en fac-simile : si on évoque souvent ces correspondances, on a peu de traces matérielles des stratégies de séduction, et de plus ici, certaines marraines reçoivent une appréciation (2 TB, 6 B…), il y a aussi des zéros et des points d’interrogation. Un nom est rayé avec l’appréciation « sale caractère », et un autre avec « boniche ».
Un anti-héros ?
Christian Wagner suggère dans sa présentation des analogies prises avec Barrès, Huysmans et Radiguet, et compare le narrateur à un anti-héros houellebecquien. En effet, ce qui fait l’intérêt de l’ouvrage, c’est l’apparente contradiction entre les photographies d’un pilote paradant devant sa machine, et le secret, que nous découvrons, de ses prudences en vol ; les dessins hardis d’un caricaturiste corrosif et ses questionnements sur son art ; ses apparents succès féminins et sa fragilité intérieure… Décoré tardivement (9 mai 1916, p. 111), il témoigne : « Ouf ! Quel soulagement. J’ai enfin un signe de gloire à montrer. » Il reste que G. Villa, patriote constant, est redevenu un officier énergique, et il reçoit la légion d’honneur en janvier 1918.
Peu avant que le rideau ne tombe sur ces intéressants carnets, intervient un coup de théâtre : G. Villa tombe sur son dossier personnel (p. 256), « un hasard extraordinaire vient de me permettre de lire mes notes militaires.» Sous-lieutenant, il a été assassiné par son colonel au 132e RI en 1913 « D’après lui, je suis mou, incapable de commander, indifférent, etc. : il y en a presque 15 lignes ». Ses autres notes dans l’infanterie sont seulement un peu meilleures, et elles deviennent convenables dans l’aviation. On comprend alors que sa carrière a été freinée par les notes détestables de ses débuts. Pour lui il s’agit d’une vengeance froide : « souvenirs rappelés, je me souviens qu’il me parlait un jour de papa avec qui il avait été élève à Saint-Cyr ; j’aurais dû me douter, à son ton rageur et moqueur qu’il se vengerait sur le fils de la sévérité du Père. » On comprend ainsi pourquoi blessé deux fois, il quitte l’infanterie sans citation, et attend ensuite en vain un commandement d’escadrille. Alors, héros brimé ou costume d’aviateur trop large ? Certes G. Villa est un privilégié qui peut se mettre à l’abri, mais il est attachant en ce qu’ayant conscience du handicap que constitue son caractère réservé, il se bat pour en surmonter les effets. Combien d’autres pilotes dans ce cas au mess, où tout le monde n’est ni Guynemer, ni Nungesser?
« On comprend combien je me sens seul, ici, à l’escadrille où l’attitude de « je m’en foutisme » est presque de règle, étant donné que se déclarer prudent, c’est presque dire : « j’ai peur ». Je n’ai pour me soutenir, que ma force morale, ma mère et Chou. »
Vincent Suard, décembre 2023