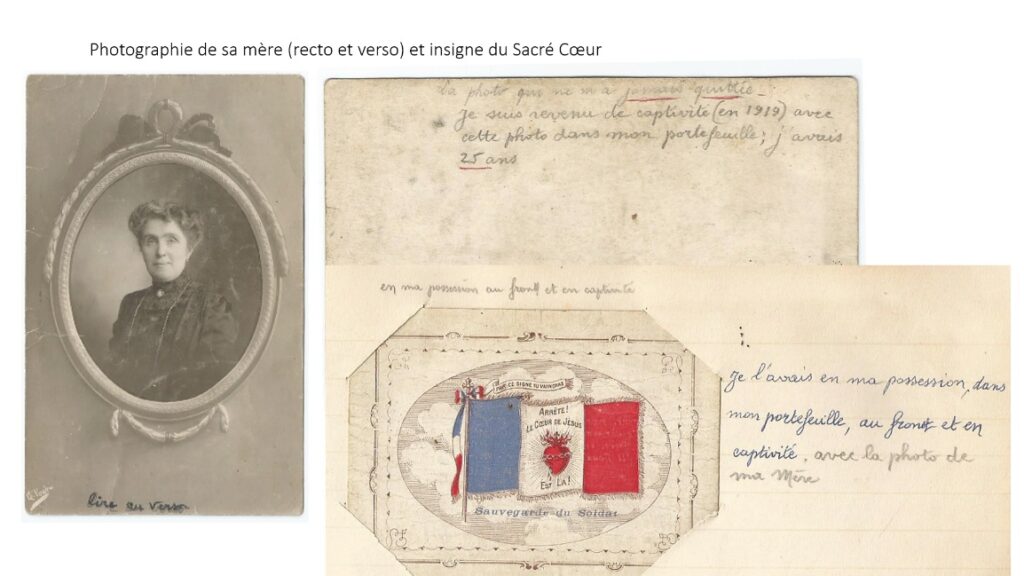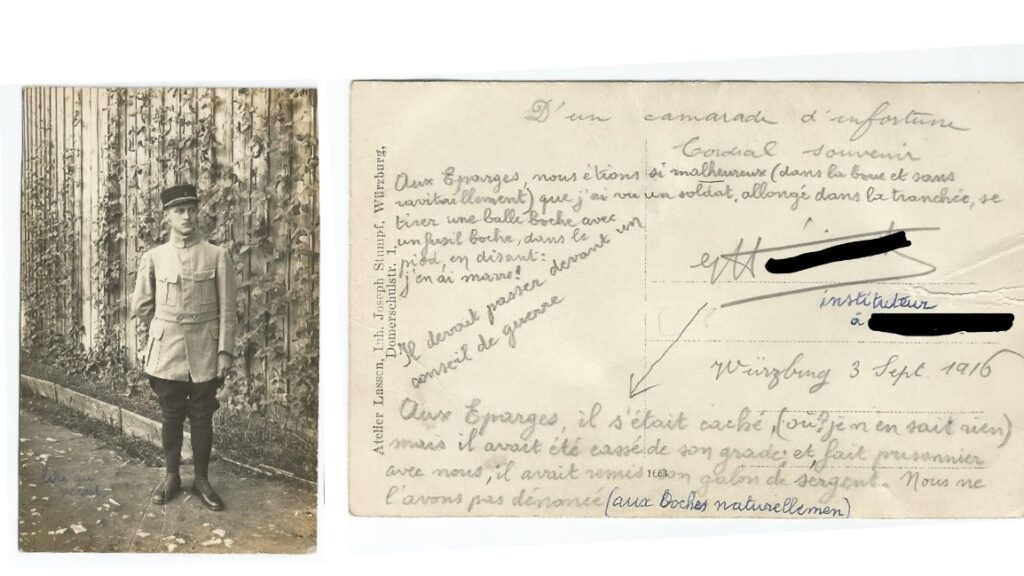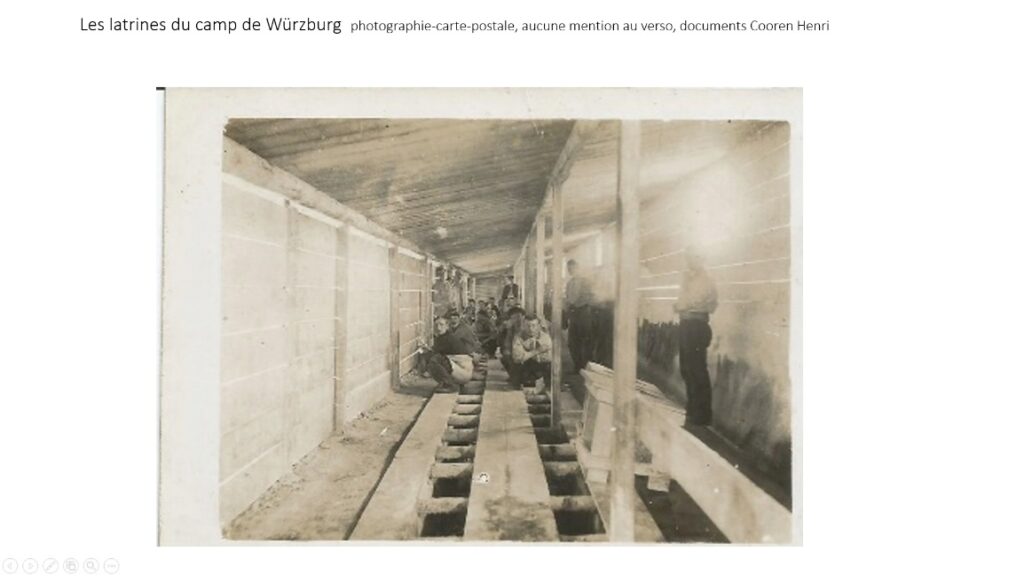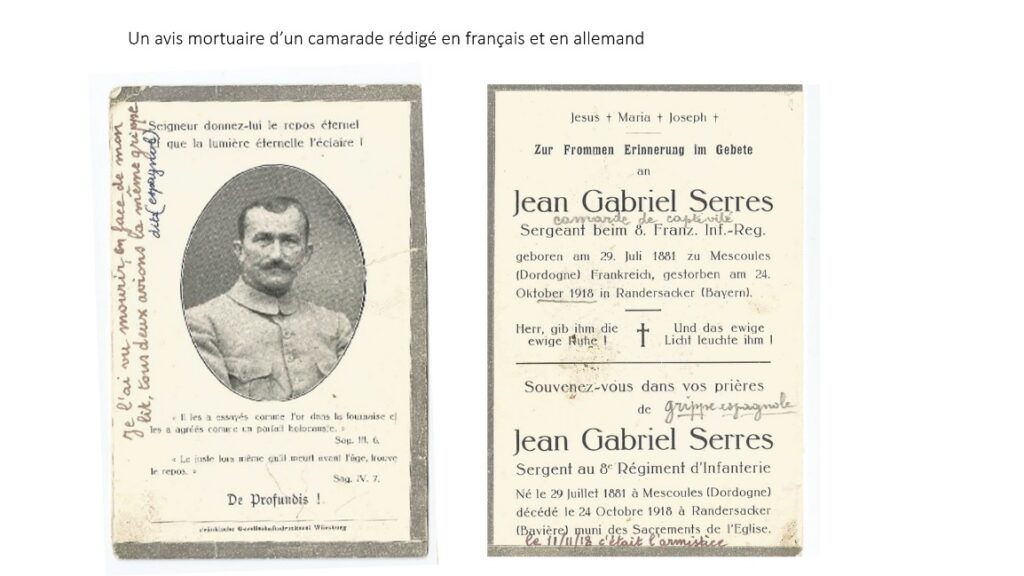À l’instar de la grande majorité de la génération du début des années 1890, Charles de Gaulle est directement concerné par la Première Guerre mondiale. Né à Lille le 22 novembre 1890, le futur chef de la France Libre et fondateur de la Ve République appartient à un milieu de la petite noblesse par son père Henri et de la bourgeoisie du Nord par sa mère Jeanne, née Maillot. Charles de Gaulle est élevé dans un milieu qui allie attachement nostalgique à la monarchie, fidélité à la foi et à l’Église catholique, passion pour la France et son Histoire. « Mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m’en a découvert l’Histoire. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante à l’égal de sa piété religieuse. Mes trois frères, ma sœur, moi-même avions pour seconde nature une certaine fierté anxieuse au sujet de notre pays », écrit de Gaulle au début de ses Mémoires de guerre. Élève des pères jésuites qu’il suit en exil en Belgique à la suite de l’expulsion des congrégations, lecteur assidu de Péguy, Barrès et Bergson, le jeune de Gaulle passe le concours d’entrée à Saint Cyr où il entre comme élève-officier en septembre 1909. Surnommé « Le Connétable » par ses camarades, il est classé 13e de sa promotion sur 211. Un de ses supérieurs, le futur maréchal Alphonse Juin, note : « A été continuellement en progressant depuis son entrée à l’école ; a beaucoup de moyens, de l’énergie, du zèle, de l’enthousiasme, du commandement et de la décision. Ne peut manquer de faire un excellent officier. » Nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1912, il est affecté au 33e régiment d’infanterie d’Arras que commande le lieutenant-colonel Pétain. Après un an de service dans cette unité, il est promu lieutenant.
Au début de la guerre, le 33e RI est engagé en Belgique. Le lieutenant de Gaulle est blessé le 15 août au péroné, sur le pont de Dinant, à proximité de Charleroi. Soigné à Paris, il rejoint son unité stationnée dans l’Aisne en octobre, puis en décembre près de Châlons-sur-Marne. Croix de guerre le 18 janvier 1915, il est nommé capitaine à titre temporaire le 10 février et à titre définitif le 3 septembre. Blessé à la main gauche le 10 mars, la plaie s’infecte ce qui nécessite une évacuation. Il retrouve son régiment en juin, devient un des officiers adjoints du colonel Émile Boud’hors et prend le commandement de la 10e compagnie. Le capitaine de Gaulle est envoyé avec son régiment à Verdun le 28 février 1916, alors que les Allemands ont entamé leur grande offensive une semaine plus tôt. Le 2 mars, il est blessé d’un coup de baïonnette à Douaumont. Fait prisonnier, il est soigné à Mayence avant d’être interné au camp d’Osnabrück en Westphalie, puis à Neisse en Silésie et à Sczuczyn en Lituanie. En octobre, il est transféré au fort d’Ingolstadt en Bavière, puis au camp de Rosenberg en Franconie en juillet 1917 et à nouveau à Ingolstadt en novembre. Il est à nouveau transféré en mai 1918 à Wülzburg en Bavière avant de terminer la guerre aux prisons de Tassau et de Magdebourg. Il est vrai que le capitaine de Gaulle n’est pas un prisonnier facile. Il tente cinq fois de s’évader mais sa très grande taille ne facilite pas le passage inaperçu. Au total, Charles de Gaulle est puni de 120 jours d’arrêt de rigueur pour ses diverses tentatives d’évasion. Libéré à la fin du conflit, il rejoint les siens début décembre 1918.
Charles de Gaulle a un intérêt pour l’historien de la Grande Guerre, non pas tant par sa carrière durant les combats qui est comparable à bien des officiers français, que pour les témoignages et réflexions qu’il a laissés. Grâce aux écrits du jeune officier, nous pouvons suivre son état d’esprit, ses sentiments, ses occupations en particulier lors de sa captivité. Du début des hostilités au 16 août, il tient un carnet de bord. Entré en Belgique le 13 août, de Gaulle note : « Accueil enthousiaste des Belges. On nous reçoit comme des libérateurs. » Le surlendemain, c’est l’épreuve du feu : « À six heures du matin, boum ! Boum ! La danse commence, l’ennemi bombarde Dinant avec fureur. Ce sont les premiers coups que nous recevons de la campagne. Quelle impression sur moi ? Pourquoi ne pas le dire ? Deux secondes d’émotion physique : gorge serrée. Et puis c’est tout. Je dois même dire qu’une grosse satisfaction s’empare de moi. Enfin ! On va les voir ? » Un peu plus loin, il témoigne de sa première blessure. « J’ai à peine franchi la vingtaine de mètres qui nous séparent de l’entrée du pont que je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Les quatre premiers qui sont avec moi sont également fauchés en un clin d’œil. Je tombe, et le sergent Debout tombe sur moi, raide mort. Alors c’est pendant une demi-minute une grêle épouvantable de balles autour de moi. » Il reprend les notes d’un carnet personnel le 15 octobre 1914. Le 20 novembre, Charles de Gaulle écrit : « Un shrapnell éclate juste sur notre tête. Il nous est évidemment destiné. Mais nous voici partis au trot vers le bois, non sans en recevoir encore un autre. Nous entrons dans un abri. Il était temps, une dégelée de 105 s’abat sur la lisière. Ce qui m’ennuie c’est qu’ils ont blessé mon adjudant Dubois. »
Dans le courrier adressé à ses parents, il arrive à Charles de Gaulle d’analyser la situation générale avec une certaine lucidité, en particulier sur les effets d’une propagande quelque peu exagérée. Ainsi dans une lettre du 14 décembre 1914 adressée à sa mère : « L’arrêt des Russes ne doit ni nous étonner, ni nous inquiéter. Si l’on voulait d’après leur Histoire définir leur caractère militaire, on dirait qu’ils sont très lents et très tenaces. Encore une fois leurs ressources sont illimitées et celles de leurs adversaires s’épuisent peu à peu. Je vous accorde qu’on s’est trop hâté de célébrer leur triomphe : cela a causé à l’opinion publique une désillusion inutile. De même que l’on a le plus grand tort de parler de l’héroïsme des Belges, des millions d’hommes que l’Angleterre met soi-disant sous les armes et de la famine imminente en Allemagne. » Il lui arrive également de décrire les conditions de la vie quotidienne dans les tranchées. Ainsi dans une nouvelle lettre à sa mère le 11 janvier 1915 : « Nous sommes ici dans une mer de boue, aussi y a-t-il pas mal de malades. » Le 24 février 1916, alors que les Allemands ont attaqué le front français dans le secteur de Verdun trois jours auparavant, de Gaulle écrit à sa mère son sentiment sur la bataille qui débute. « Ma conviction, au début de la furieuse bataille qui s’engage, est que l’ennemi va y éprouver une ruineuse et retentissante défaite. Sans doute, il nous prendra des tranchées et des positions un peu partout, quitte à les perdre plus tard (…) mais notre succès n’est pas douteux, pour ces bonnes raisons que nous sommes bien résolus à vaincre, quoi qu’il doive nous en coûter, et que nous en avons les moyens. » La rancœur contre le pouvoir politique est également présente. Elle éclate même dans un courrier du 23 décembre 1915. « Le Parlement devient de plus en plus odieux et bête. Les ministres ont littéralement toutes leurs journées prises par les séances de la Chambre, du Sénat, ou de leurs commissions, la préparation des réponses qu’ils vont avoir à faire, la lecture des requêtes ou des injonctions les plus saugrenues du premier marchand de vins venu que la politique a changé en député. Ils ne pourraient absolument pas, même s’ils le voulaient, trouver le temps d’administrer leur département, ou l’autorité voulue pour galvaniser leurs subordonnés. Nous serons vainqueurs, dès que nous aurons balayé cette racaille, et il n’y a pas un Français qui n’en hurlerait de joie, les combattants en particulier. Du reste l’idée est en marche, et je serais fort surpris que ce régime survive à la guerre. »
Les circonstances de la capture ont été racontées par de Gaulle dans une relation écrite. « Notre feu me paraissait avoir dégagé de boches un vieux boyau écroulé qui passait au sud de l’église. N’y voyant plus personne, je le suivis en rampant avec mon fourrier et deux ou trois soldats. Mais, à peine avais-je fais dix mètres que, dans un fond de boyau perpendiculaire, je vis des boches accroupis pour éviter les balles qui passaient. Ils m’aperçurent aussitôt. L’un d’eux m’envoya un coup de baïonnette qui traversa de part en part mon porte-cartes et me blessa à la cuisse. Un autre tua mon fourrier à bout portant. » Sa captivité, entre deux tentatives d’évasion, est surtout faite d’exercices physiques, de lectures, voire de conférences données devant ses compagnons d’infortune. Le 15 juillet 1916, de Gaulle précise non sans humour à son père : « L’interdiction de sortir me détermine à travailler mon allemand et à relire la plume à la main l’Histoire grecque et l’Histoire romaine. »
Dans le premier volume de ses Mémoires de guerre, intitulé L’Appel, Charles de Gaulle ne s’attarde pas beaucoup sur la période de la guerre et sa propre expérience. « Puis, tandis que l’ouragan m’emportait comme un fétu à travers les drames de la guerre : baptême du feu, calvaire des tranchées, assauts, bombardements, blessures, captivité, je pouvais voir la France, qu’une natalité déficiente, de creuses idéologies et la négligence des pouvoirs avaient privée d’une partie des moyens nécessaires à sa défense, tirer d’elle-même un incroyable effort, suppléer par des sacrifices sans mesure à tout ce qui lui manquait et terminer l’épreuve dans la victoire. Je pouvais la voir, aux jours les plus critiques, se rassembler moralement, au début sous l’égide de Joffre, à la fin sous l’impulsion du Tigre. Je pouvais la voir, ensuite, épuisée de pertes et de ruines, bouleversée dans sa structure sociale et son équilibre moral, reprendre d’un pas vacillant sa marche vers son destin, alors que le régime reparaissant tel qu’il était naguère et reniant Clemenceau, rejetait la grandeur et retournait à la confusion. » Tableau de la France, critiques envers le personnel politique de la IIIe République mais pas de détails sur les opérations auxquelles il a participé. Il semble d’ailleurs qu’il ne se soit jamais répandu en public comme en privé sur son expérience de la Grande Guerre. Son fils Philippe témoigne : « Mon père n’a jamais été de ceux qui racontent leurs campagnes. Dans son milieu, comme dans beaucoup d’autres, les hommes qui revenaient du front gardaient le silence sur les souffrances et les horreurs qu’ils avaient vécues pour ne pas choquer les femmes et les enfants. (…) En ce qui concerne les combats, lorsqu’il les évoquait avec ses trois frères Xavier, Jacques et Pierre, avec son beau-frère Jacques Vendroux ou quelques parent ou ami, ce n’était souvent qu’en passant sur quelques péripéties opérationnelle à laquelle ils avaient incidemment participé. »
Par contre, nous disposons d’ouvrages de réflexion historique sur la guerre de 1914-1918 écrits durant l’entre-deux-guerres. Outre une conférence donnée à l’école de Saint Cyr en 1921 sur l’année 1915 qui donne l’occasion à de Gaulle de fournir une analyse militaire, géopolitique, diplomatique et économique de la situation à ce moment-là, il y a d’abord La discorde chez l’ennemi, livre rédigé pendant l’été 1923 et publié chez Plon l’année suivante. Il s’agit d’une étude, sans doute la première du genre, de l’Allemagne en guerre et des raisons de sa défaite. De Gaulle n’y fait pas preuve d’une animosité aveugle envers les Allemands. La première phrase de l’ouvrage est éclairante à cet égard : « La défaite allemande ne saurait empêcher l’opinion française de rendre à nos ennemis l’hommage qu’ils ont mérité par l’énergie des chefs et les efforts des exécutants. » Selon de Gaulle, la défaite allemande s’explique à la fois par la progressive domination du Grand État-Major sur le pouvoir civil, du chancelier voire du Kaiser lui-même. Ainsi, la décision de la guerre sous-marine à outrance du 1er février 1917 est avant tout un choix des militaires qui finissent par l’imposer à un chancelier Bethmann-Hollweg peu favorable. À la suite de la démission de ce dernier, la domination du duo Hindenburg-Ludendorff est totale sur le pouvoir exécutif et mène l’Allemagne à la défaite. Autre leçon de cette étude gaullienne sur la Grande Guerre : l’art militaire n’est pas une doctrine préétablie. « À la guerre, à part quelques principes essentiels, il n’y a pas de système universel, mais seulement des circonstances et des personnalités. »
Ensuite, Vers l’armée de métier, ouvrage publié chez Plon en 1934 au moment où l’Allemagne nazie commence à inquiéter les plus lucides. De Gaulle y défend le développement d’un corps mécanisé susceptible d’agir rapidement au service d’une politique réactive vis-à-vis des éventuelles initiatives allemandes et dans le cadre d’un système d’alliances. Cette stratégie se détache du modèle de celle qui avait permis la victoire en 1918, basée sur une défensive efficace en attendant une supériorité numérique et matérielle permettant d’enfoncer le front ennemi en soutenant l’effort de l’infanterie par les chars d’assaut. Charles de Gaulle prêcha dans un désert et seul Paul Raynaud, dans le monde politique, y prêta une oreille attentive.
Enfin, La France et son armée, livre repris d’un projet jamais abouti demandé par le maréchal Pétain à Charles de Gaulle en 1925 mais que le vieux soldat abandonna. Le travail, amplement remanié, est publié en 1938 malgré l’opposition du prestigieux maréchal à qui celui qui commandait alors le 507e régiment de chars à Metz adresse un courrier respectueux mais ferme. « Du point de vue des idées et du style, j’étais ignoré, j’ai commencé à ne plus l’être. Bref, il me manque, désormais, à la fois la plasticité et l’incognito qui seraient nécessaires pour que je laisse inscrire au crédit d’autrui ce que, en matière de lettres et d’histoire, je puis avoir de talent. » Qu’en termes choisis ceci est dit ! Véritable panorama de l’histoire militaire française, l’ouvrage débute à l’époque médiévale pour aboutir à un hommage appuyé à la France de 1914-1918. « Tandis qu’elle endurait plus cruellement qu’aucun autre peuple les souffrances de la guerre et de l’invasion, hécatombes de ses meilleurs fils, terre blessée jusqu’aux entrailles, foyers détruits, amours sombrées, plainte des enfants mutilés, elle se forgeait un instrument de combat qui, pour finir, l’emporta sur celui de tous les belligérants. Au total, de trois Allemands tués, deux l’ont été de nos mains. Quels canons, quels avions, quels chars, ont valu mieux que les nôtres ? Quelle stratégie triompha, sinon celle de nos généraux ? Quelle flamme anima les vainqueurs autant que l’énergie de la France ? » Sans doute, le de Gaulle de la France Libre se forgea-t-il des certitudes en réfléchissant à la Grande Guerre.
Philippe Foro
Sources et bibliographie.
-Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets (1905-1941), collection Bouquins, Robert Laffont, 2010 ; Le fil de l’épée et autres écrits, Plon, 1990 (cet ouvrage rassemble les écrits de l’entre-deux-guerres : La discorde chez l’ennemi, Le fil de l’épée, Vers l’armée de métier, la France et son armée) ; Mémoires de guerre, La Pléiade, Gallimard, 2000.
-Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père, entretiens avec Michel Tauriac, Plon, 2003.
-Jean Lacouture, De Gaulle. Le rebelle (1890-1944), Seuil, 1984.
-Éric Roussel, Charles de Gaulle, Gallimard, 2002.
–Charles de Gaulle soldat (1914-1918), album de l’exposition de l’Historial de Péronne, 1999.
–Charles de Gaulle : du militaire au politique (1920-1940), colloque des 28 et 29 novembre 2002 à l’École de guerre, Institut Charles de Gaulle, 2004.