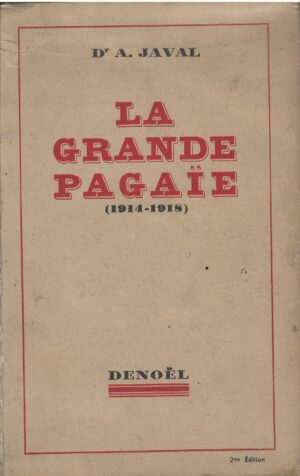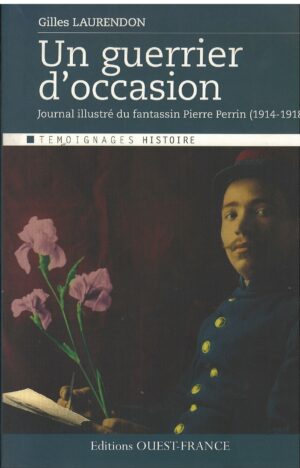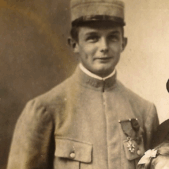Lettres d’un soldat. Août 1914 – avril 1915, Paris, Bernard Giovanangeli, 2005, 191 p.
Résumé de l’ouvrage :
Eugène-Emmanuel Lemercier, né le 7 novembre 1886 à Paris, est d’abord engagé volontaire en 1905 avant d’être rappelé au 106e RI de Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne aujourd’hui), qu’il rejoint dès le 3 août 1914. Il arrive au front dans la Meuse après la bataille de La Marne. Promu caporal le 1er janvier 1915 (page 89, qui lui donne un « devoir social » (p. 108 et 189) puis sergent le 13 mars suivant (p. 146, qui faillit être cité (p. 187 et 189), il disparaît aux Eparges le 6 avril 1915. L’ouvrage publie 140 lettres écrites du front du 6 août 1914 au 21 mars 1915, principalement à sa mère et à sa grand-mère.
Eléments biographiques :
L’auteur naît à Paris le 7 novembre 1886, de Louis-Eugène et de Marguerite Harriet O’Hagan, une famille protestante, dont la branche féminine est d’origine irlandaise. Après la mort de son père alors qu’il n’a pas un an, il est élevé par sa mère et sa grand-mère maternelle, qui créent un lien profond, qui transpire dans la correspondance avec le jeune homme lorsqu’il est au front. Initié au dessin et à la peinture par ces dernières, il a pour mentor le peintre Fernand Cormon (1845-1924) qui lui présente dès ses 11 ans ½ Jacques Humbert (1842-1934). Ce dernier va lui prodiguer une formation artistique qui aboutira à son entrée aux Beaux-Arts dans sa 15e année. Malgré une faiblesse de constitution, il devance l’appel et rejoint le 106e RI de Châlons-sur-Marne en 1905, qu’il quitte l’année suivante, revenant à ses études artistiques. Nombre de ses toiles sont primées mais sa santé s’épuise et il est contraint d’aller se soigner en Suisse. À la déclaration de guerre, il rejoint tout naturellement son régiment, dès le 3 août, et sa première lettre, dès le 6, témoigne de la vie mouvementée et fatigante des premiers jours sous l’uniforme d’un intellectuel plongé dans la guerre. Il arrive en ligne le 12 septembre et est porté disparu, sans que son corps ne soit jamais retrouvé, au combat du 6 avril 1915 aux Eparges, dans la Meuse.
Commentaires sur l’ouvrage :
Artiste et intellectuel, Eugène-Emmanuel Lemercier tient un carnet de guerre et échange surtout une correspondance avec sa mère, adulée, et sa grand-mère. Il dit très peu de la guerre mais intériorise ou philosophe abondamment, ayant conscience de sa classe et de son intellectualisme (volontiers supérieur). Quelques apports toutefois, mais assez peu sur le 106e RI, celui du panthéonisé Genevoix, avec lequel il partage parfois la contemplation de la nature, et des autres témoins que sont André Fribourg, Robert Porchon et Joseph Vincent. Bernard Giovanangeli rappelle dans un avertissement que Lettres d’un soldat est paru sans nom d’auteur chez Chapelot en 1916 puis chez Berger-Levrault en 1924, et Jean Norton Cru, qui lui consacre une longue analyse critique pages 530 à 535 dans Témoins, ajoute à ces références éditoriales une publication partielle préliminaire dans la Revue de Paris les 1er et 15 août 1915.
Il n’est pas étonnant que Jean Norton Cru classe Eugène-Emmanuel Lemercier dans les 27 témoins qu’il place dans la 1re catégorie de son classement tant Lettres d’un soldat est résolument un témoignage intellectualisant son parcours de guerre, même si ténu puisqu’il concerne seulement les 8 premiers mois de guerre. Il s’épanche souvent sur sa condition et, le 1er décembre 1914, il dit : « Et voici qu’à vingt-huit ans, je suis replongé en pleine armée, loin de mes travaux, de mes soucis, de mes ambitions, et jamais la vie ne m’apporta une telle abondance d’émotions nobles ; jamais, peut-être, je n’eus, à les enregistrer, une telle fraîcheur de sensibilité, une telle sécurité de conscience », et il semble jouer quelque peu de ce statut comme il l’avance un peu plus loin : « Mon petit emploi me dispense de la pioche » (p. 83), lui que la guerre ne lui fait pas « renoncer à être artiste » (page 84). Il dit d’ailleurs à ce sujet : « Sans doute, après cette guerre, un art fleurira-t-il de nouveau, mais nous aurons à l’apprendre entièrement » (p. 110). Sa haute condition, qui lui fait se différencier de la plèbe qui l’entoure, lui fait dire de ses camarades : « Leur courage, pour être infiniment moins littéraire que le mien, n’en est que plus pratique, adapté à tout… » (p. 87). Plus loin, il avance même : « … je mène une existence d’enfant au milieu de gens si simples que, même très rudimentaire, mon existence est encore bien compliquée pour mon entourage » (p. 102). Il est de temps en temps descriptif et volontiers poète ; « Tu ne saurais croire ce que les forêts ont souffert par ici : ce n’est pas tant la mitraille que les effroyables coupes nécessaires à nos constructions d’abris et à notre chauffage. En bien ! parmi cette dévastation, il me disait qu’il y aurait toujours de la beauté pour l’arbre et pour l’homme » (page 93). Plus loin, il dit : « Il est de heures de telle beauté où celui qui les embrasse ne saurait mourir alors. J’étais bien en avant des premières lignes, et jamais je ne me sentis plus protégé », vantant les beautés de la nature meusienne (p. 130 et 131). S’il dit qu’il a parfois conscience de se répéter, il ajoute : « Il faut s’adapter à cette existence particulière, à la fois indigente en activités intellectuelles et merveilleusement opulente en émotions spontanées », comparant son métier au moine-soldat (p. 94). Il a peur page suivante de perdre « sa main » de dessinateur. Toujours observateur de son environnement, il a quelques phrases analytiques plus profondes : « Ils blaguent, mais leur blague est l’épiderme d’un magnifique courage profond » (p. 100). Il s’étonne que la vie continue : « Ce qui nous dépasse (mais qui pourtant est bien naturel) c’est que les civils puissent continuer une existence normale alors que nous sommes dans la tourmente » (p. 117). Philosophe, convoquant parfois Spinoza ou Saint-Augustin, il s’interroge sur l’ordre et la violence ; il dit : « L’ordre conduit au repos éternel. La violence fait circuler la vie. Nous avons comme objectifs l’ordre et le repos éternel, mais, sans la violence qui déchaîne les réserves d’énergie utilisable, nous serions trop enclins à considérer l’ordre comme obtenu : un ordre anticipé qui ne serai qu’une léthargie retardant l’avènement de l’ordre définitif » (p. 118). Il teinte le plus souvent ses réflexions de la présence de Dieu. Il se révolte à l’idée de sa mort (la pressent-il ?) ; il dit : « Pourquoi suis-je ainsi sacrifié, quand tant d’autres qui ne me valent pas sont conservés ? (p. 146). Ses analyses sont parfois plus singulières. N’avoue-t-il pas à sa mère : « …pour revenir à ces moments extraordinaires de fin février, je te redirai encore que j’en conserve le souvenir comme d’une expérience scientifique » (p.152). Dès lors, le sous-titre d’une telle œuvre testimoniale aurait pu être « introspection d’un intellectuel à la guerre ».
Car la guerre il la décrit finalement assez peu. Des fois, il dit quand même, sans s’étaler : « Nous sommes en cantonnement après la grande bataille. Cette fois-ci, j’ai tout vu. J’ai fait mon devoir, et la sympathie de tous me l’a prouvé. Mais les meilleurs sont morts. Pertes cruelles. Régiment héroïque. But atteint. Ecrirai mieux » (p. 142). La description plus diserte qui suit fait état d’un tableau épique d’horreur. Il dit : « Voici cinq jours que mes souliers sont gras de cervelles humaines, que j’écrase des thorax, que je rencontre des entrailles » (p.143) et c’est après un temps plus ou moins long qu’il donne ses impressions au spectacle réel de la bataille (voir p. 185 le 14 mars, peu avant sa mort). L’édition de 2005 permet de rétablir les passages censurés dans l’édition de 1916 et notamment celui-ci : « Car on a l’impression que tout le monde y passera. Chaque mètre de terrain coûte trois cadavres » (p. 158). Il a en effet la certitude de sa mort ; quelques jours avant celle-ci, il dit : « Ils m’ont raté, mais malheureusement ce n’est que partie remise, car il ne doit rien rester de notre régiment » (p. 186). Dès lors il ne faut pas rechercher dans le témoignage de Lemercier un réel ouvrage testimonial, bien qu’épistolaire, mais un livre de réflexion. Au final, c’est plus une correspondance dans la guerre qu’une correspondance de guerre. En fait il donne le plus souvent l’impression de n’avoir jamais avoir été soldat ; il semble confondre cagna et casemate (p.165) et avoue même : le « plaisir que j’éprouve de n’avoir pas tiré un coup de fusil » (page 186). Il avance même étonnamment « … avoir rencontré des Allemands nez à nez, mais (…), ces gens-là ont dû pressentir en moi quelque chose de mieux et en tous cas très différent d’un soldat, car ils se sont constitués prisonniers de façon courtoise, ce qui, d’ailleurs leur était dictée par ma façon polie de les aborder » (p.186). Il a pourtant, à la veille de sa mort, été envoyé suivre un cours d’élèves sous-officiers, ce dont il se faisait un certain orgueil. Las, ses derniers morts, qu’il écrit à un ami, sont prémonitoires : « Pense à moi et aie de l’espoir pour moi qui n’ose pas en avoir » (. 187).
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Page 100 : Douille de 75 utilisée comme pot à eau
: « 115 obus pour blesser un homme au poignet »
101 : Noël 1915, ténor allemand dans sa tranchée (rappelle Joyeux Noël de Carion), français répondant par La Marseillaise
108 : Garde sape pour protéger les sapeurs
114 : Nous n’avons plu aucune vision d’une issue quelconque
117 : Apprend le 17 janvier 1915 la mort de Péguy
146 : Proposé sergent et pour une citation (p. 187), non obtenue à cause de la mort de son capitaine
155 : Retour des grues
Yann Prouillet, janvier 2026