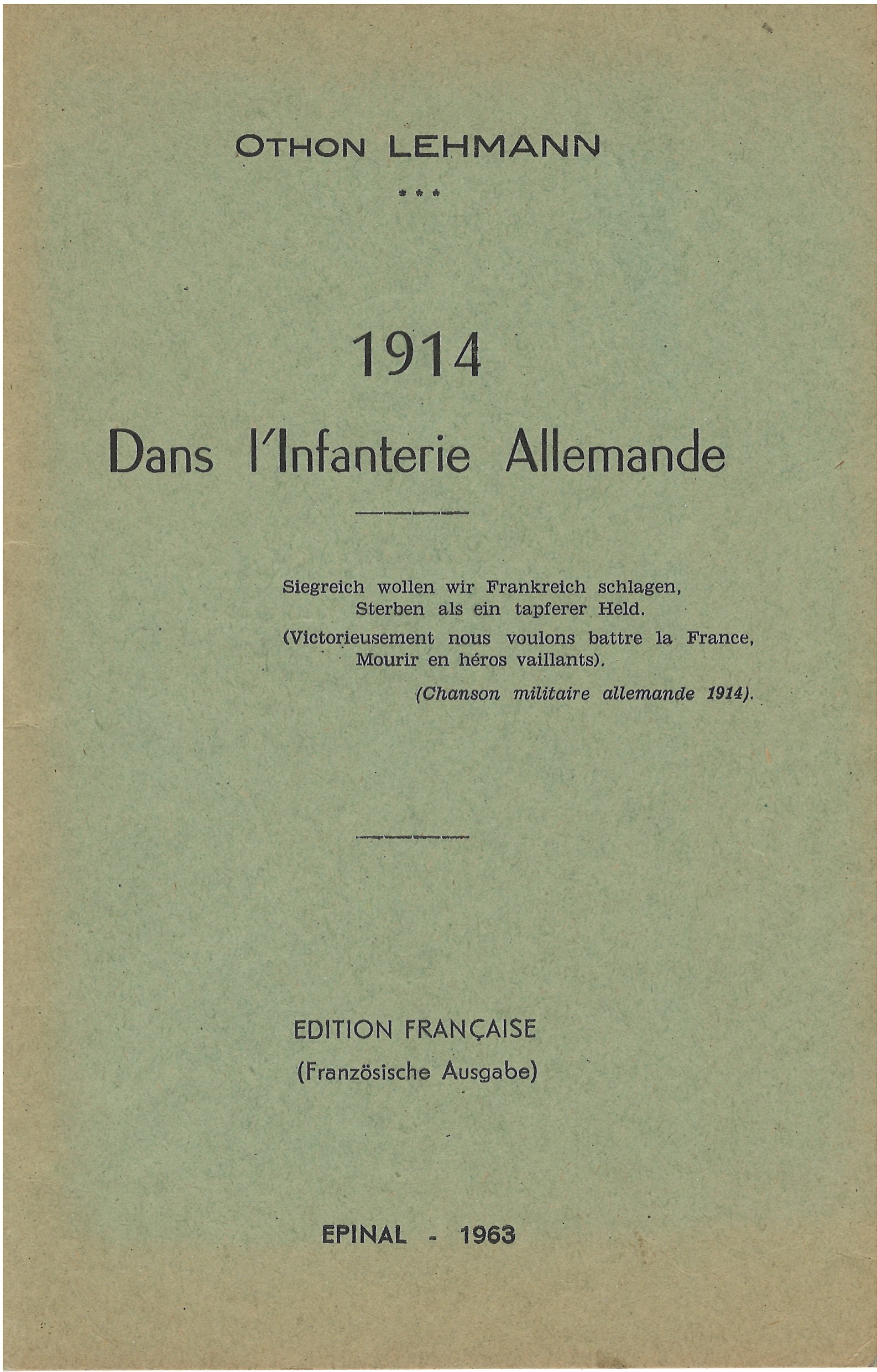Le témoignage
Mathilde Lebrun (1879, Nantes – ?) habitante de Pont-à-Mousson, où elle tient un commerce, est en 1914 veuve d’un militaire (adjudant) décédé en 1908, avec lequel elle a eu trois enfants. La guerre déclarée, et ayant eu une culture militaire qui l’a habitué à côtoyer ce milieu (elle a habité plusieurs années dans des forts, dont à Toul, et a été élevée par un oncle, ancien combattant de 1870), elle monte un débit de boissons ambulant au plus près des troupes, activité qu’elle poursuit alors que la ville est envahie pendant quelques jours entre le 4 et le 10 septembre 1914. Sur sa répugnance à côtoyer « les boches », elle se justifie et dit : « Je domptai mon instinctive répugnance, en songeant que j’avais tout intérêt à approcher ces gens, à les étudier, à les connaître » (p. 39). Elle profite de ce côtoiement pour visiter les organisations de l’ennemi et collecter tout renseignement qui lui semble utile. Le recul allemand et la cristallisation du front font qu’elle pense pouvoir être utile aux français ; elle veut « jouer un rôle », non en s’engageant comme vivandière ou infirmière, mais comme espionne, destination qu’elle se fixe possiblement après avoir désigné un espion présumé en pleine bataille pour défendre la ville, mais peut-être aussi en ayant été désignée elle-même comme telle après la réoccupation de la ville. Le 1er décembre suivant, elle est approchée puis finalement, le 13, recrutée à Nancy par le Service des Renseignements de l’Armée de Lorraine. Son « agent recruteur » la missionne de se rendre à Metz, toute proche, afin d’y collecter tout information utile. Elle dit sur son nouveau « métier » : « On m’apprit mon rôle et je compris que j’étais un peu dans la situation de quelqu’un qu’on jette à l’eau pour lui apprendre à nager ». Laissant à la garde de tiers ses enfants qu’elle a éloignés du front à Contrexéville, et devient alors Simonne autrement surnommée « Tout-Fou ». Sa première mission, le 23 décembre 1914, consiste à passer la ligne de front (à Norroy-lès-Pont-à-Mousson) ce qu’elle fait avec une étonnante facilité. Après plusieurs jours d’enquête, elle est finalement approchée par le capitaine Reibel, puis plus tard le lieutenant von Gebsattel, autrement appelé monsieur de Bouillon. Pour les Allemands, elle devient R2, ou madame Blum, autrement surnommée également « Faim-et-Soif ». Le 4 janvier 1915, elle revient en France par la Suisse, fait son compte-rendu au capitaine de B… sur ce qu’elle a vu et entendu durant les 15 jours en territoire allemand qu’a duré sa mission : « Je pus révéler l’emplacement des batteries de Norroy et les dépôts de munitions, la profondeur des lignes de tranchées, le numéro des régiments. Je signalai l’importance des envois de troupes sur la Belgique. Je ne manquai pas non plus de parler des espions que j’avais rencontrés, travaillant pour l’Allemagne » (p. 99). A partir de cette première mission réussi, Simonne, pendant toute l’année 1915, fait des allers et retours entre Nancy et l’Allemagne, en passant par la Suisse (elle cite successivement Metz, Montmédy, Luxembourg, Mondorf, Trêves, Mayence, Coblentz, Cologne, Francfort et même Berlin, passant par Offenburg, Saverne, Appenweiher, Strasbourg et Sarrebourg dans une liste certainement non exhaustive). En tout, elle réalise 13 voyages entre lesquels, missionnée par l’ennemi, elle se rend dans le sud de la France (Marseille et Nice) afin de contacter des agents doubles françaises dont elle sera à l’origine des arrestations. Ce sont Félicie Pfaadt (agent R17), exécutée le 22 octobre (elle dit août) 1916 à Marseille [voir dans ce dictionnaire la fiche de Jauffret, Wulfran (1860-1942) – Témoignages de 1914-1918 (crid1418.org) qui décrit l’exécution de l’espionne le 22 août, qu’il avait défendue vainement devant le conseil de guerre en mai et dont il témoigne de sa réprobation] et Marie Liebendall, épouse Gimeno-Sanches, également condamnée à mort et emprisonnée dans la même ville. Côté allemand, elle distille des informations fournies par le Service de Renseignements qui, apparemment savamment construits, lui valent même en novembre 1915 la Croix de Fer ! Elle reçoit de côté-là des missions dont l’une des dernières confiées est rien moins que de récupérer la formule des gaz de combat français. Risquant, par ces deux principaux « faits d’armes » d’être « brûlée », c’est-à-dire découverte en Allemagne, elle est « mutée » quelques jours à Tours, revient à Nancy avant de participer aux enquêtes et aux procès Pfaadt et Liebendall puis d’être convoquée, le 16 août 1917 à Marseille pour témoigner dans l’enquête sur le député C[eccaldi], mentionné dans ses rapports, accusé lui aussi d’intelligence avec l’ennemi. C’est très possiblement ce qui lui vaut d’être « rayée du service », teintant son dernier chapitre comme une conclusion amère qu’elle a été mal utilisée et oubliée, tant dans l’honneur que dans la récompense nationale.
Mathilde Lebrun, Mes treize missions, préfacé par Léon Daudet (Député de Paris) Paris, Arthème Fayard, sans date, ca 1920, 285 p.
Commentaires sur l’ouvrage
Ecrit en 1919 et les années suivantes, apparemment publié plusieurs années plus tard (1934), ce récit simple, chronologié, sans réel talent d’écriture et descriptif, mais manifestement sincère peut apparaître comme une curiosité littéraire voire fictionnelle. Pourtant, le livre de Mathilde Lebrun est bien la narration testimoniale d’un parcours d’espionne agent double comme les Services de Renseignements français en ont utilisé de nombreuses pendant la Grande Guerre. Le parcours et les actions de Mathilde, manifestement à la personnalité évidente, se construit et évolue en territoire ennemi avec une apparente facilité et légèreté malgré les risques énormissimes pris par ces femmes particulières qui exercèrent leur patriotisme par des voies aussi dangereuses que volontaires. L’ouvrage n’est pas iconographié et contient quelques erreurs topographique (Noviant pour Novéant) ou points tendancieux qui mériteraient des vérifications plus approfondies pour en confirmer la véracité ou la plausibilité. Par exemple, son premier parcours débute en pleines fêtes de Noël et du réveillon dans la Lorraine envahie de l’hiver 1914 et elle n’en décrit pas une ligne. De même par exemple, elle attribue à ses renseignements l’origine d’une contre-offensive sur le Hartmannswillerkopf (entre le 8 et le 15 mars 1915) qui ne semblent pas correspondre à une telle activité sur le massif. Enfin, sa narration est aussi le prétexte à des tableaux, le plus souvent grotesques voire injurieux des personnages qu’elle croise et qu’elle caricature à l’envi (cf. la famille Rihn à Metz dont elle garde les enfants et dont elle dit par que le père à « une bonne tête… d’abruti »), celui lui permettant d’appuyer sur son patriotisme exacerbé.
Renseignements tirés de l’ouvrage :
Liste des missions effectuées en Allemagne par Mathilde Lebrun
1re mission : Du 23 décembre 1914 au 4 janvier 1915
2e mission : Du 11 au 17 janvier 1915 (avec une erreur de date page 112)
3e mission : Du 27 janvier au 1er février 1915
4e mission : Du 15 au 21 février 1915
5e mission : Du 08 au 15 mars 1915
6e mission : Du 26 mars au 2 avril 1915
7e mission : Du 19 avril au (jour non précisé) avril 1915
8e mission : Du 04 au 22 juin 1915 (dont voyage à Berlin)
9e mission : Entre le 26 juin et le 18 juillet 1915, d’une durée de 18 jours
10e mission : Du 18 au 23 juillet 1915
11e mission : Du 11 au 23 août 1915
12e mission : Du 07 au 09 septembre 1915
13e et dernière mission en Allemagne : Du 3 au 11 novembre 1915
Page 22 : Vue tonitruante et sonore de la mobilisation à Pont-à-Mousson
33 : Distribue des bouteilles de vins en pleine attaque allemande
34 : Décrit Pont-à-Mousson sous attaque
176 : 2 canons de 75 français et 6 belges en trophée à Berlin
: Taux de change 100 pour 87,50 marks
178 : Croix de fer en bois plantée de clous d’or et d’argent achetés (elle en plante un)
219 : Obtient (mais trop tard) un sauf-conduit pour toute l’Allemagne
227 : Manque d’être arrêtée en Allemagne à cause de la Gazette des Ardennes (pas logique)
230 : Doit récupérer la formule des gaz de combat français
233 : Obtient la Croix de fer
Yann Prouillet, juillet 2023