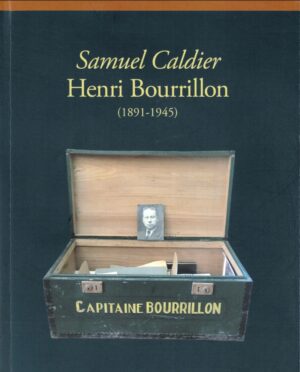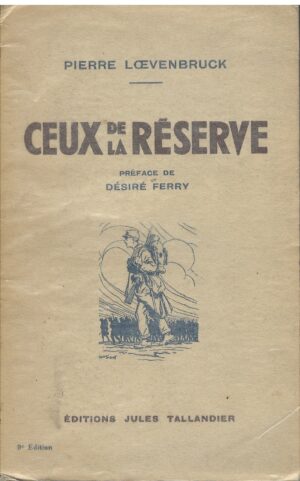Charles T. héros ordinaire
Olivier Taboureux
1. Le témoin
À la mobilisation, Charles Taboureux se prépare à devenir notaire. Scolarisé au Collège Stanislas, puis licencié en droit, il a terminé son service militaire en 1913 et vit à Froissy (Oise). Mobilisé au 72e RI comme brancardier, il devient infirmier en décembre 1914. Participant aux durs engagements de la Marne (Maurupt), de l’Argonne (La Grurie), et du Mesnil-les-Hurlus, il est tué par un obus à Bouchavesnes en octobre 1916.
2. Le témoignage
Olivier Taboureux, petit-neveu de Charles, a publié en 2020 « Charles T. héros ordinaire » aux éditions Sydney Laurent. L’ouvrage, enrichi, a été réédité en 2023 (Nombre 7 éditions, 306 pages). Ce travail méticuleux de retranscription, assisté par les conseils éclairés de Laurent Soyer, spécialiste du 72e RI, fait se succéder des extraits des carnets de l’auteur, de lettres adressées à sa famille, ainsi que des passages des lettres reçues de sa marraine de guerre. Des croquis et des photographies personnelles illustrent les textes, directement en lien avec le propos.
3. Analyse
Ce témoignage est un récit évocateur, à la fois vivant et documenté, des nombreux engagements, vécus depuis la ligne ou le poste de secours, auxquels le 72ème a participé. De par sa position intermédiaire (brancardier puis infirmier), C. Taboureux est bien renseigné. C’est un jeune homme lettré, qui sait écrire et manier l’ironie.
Guerre de mouvement, guerre de tranchée
Le 72e RI d’Amiens plonge rapidement dans les combats de Virton, Cesse, puis surtout Maurupt, à la fin de la Marne ; l’unité est durement éprouvée, et on peut comparer les extraits des carnets personnels aux lettres envoyées (typographie différente dans le livre). Ainsi [avec autorisation de citation] du 21 août 1914, p.20, carnets : « Marche très dure. Pluie torrentielle. (…) » et carte envoyée : « Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. (…) » ou du 26 août (p. 25), carnets : « Tout le monde est vanné et démoralisé. Le commandant du 2e bataillon dit qu’il tuera à coup de revolver les hommes qui resteront à l’arrière. » et aux siens, le 27 : « je vais bien et vous supplie de ne pas vous inquiéter. » Les mentions sont interrompues le 6 septembre à Etrepy, les brancardiers ont dû se retirer sous un déluge de balles ; les carnets ne reprennent que le 13 septembre, après cette période de combats violents, C. Taboureux ayant été submergé par ses tâches sanitaires. Ces combats de Maurupt sont bien décrits par André Delattre (cf notice CRID), qui connait bien C. Taboureux, et que l’on voit sur des photographies en compagnie de l’auteur.
A la Harazée, il décrit de manière intéressante les débuts de la guerre de position. L’espoir provoqué par le recul allemand s’éteint peu à peu avec la fixation de la ligne dans les bois escarpés et touffus d’Argonne. Le ton envers les parents devient plus réaliste, comme par exemple quand il décrit les combats passés (25.10.14, p. 48) « Je risque le coup de vous adresser une lettre un peu plus longue, vous donnant quelques détails. Qu’a été pour nous la campagne ? Très dure. La retraite a été terrible. On s’est battu du 6 au 11 septembre à Blesmes, Étrepy, Saint-Lumier, Maurupt, d’une façon épouvantable. Les Allemands y ont reçu une leçon. (…) La marche en avant nous a montré ce spectacle. Des cadavres étaient partout. On pleurait, tellement c’était terrible. (…) de ma section nous sommes 8. » Il ne redoute pas la censure postale lorsqu’il évoque, par exemple, les pertes en officiers (p. 50) «À la 12e cie, le capitaine a été tué le 6 septembre, le lieutenant le remplaçant le 7, le nouveau commandant de compagnie le 9, et le nouveau lieutenant le remplaçant blessé le 15. » Cette franchise factuelle envers les proches est encore plus nette pour les combats de l’Argonne, à la fin de novembre 1914 (p. 67) « Que de blessés ! Que de tués surtout ! On est à une distance moyenne de 50 mètres de l’ennemi. Toutes les balles portent. Beaucoup sont fous. Je vous écris les nerfs encore secoués et les larmes aux yeux, au seul souvenir de ces heures. »
Un 72e RI très exposé
Encore éprouvé par les combats de décembre-janvier (La Gruerie), le régiment vient participer à la première offensive de Champagne au Mesnil-les-Hurlus. C. Taboureux décrit les opérations depuis le village en ruines, mentionnant par exemple le fait qu’un grand nombre de soldats (p. 103) « appartenant à différents corps restent dans les gourbis du Mesnil, au lieu d’être dans leurs tranchées. » Après un repos, nouvelles attaques le 5 mars, et il mentionne nominalement des officiers tués, sans illusions préalables sur leur destin (« il se savait condamné par les ordres reçus ».) Le 8 mars, nouveau courrier aux siens qui ne censure rien de ce qu’il voit (p.109) : (…) « La plaine est couverte de cadavres. C’est un charnier épouvantable. Les boyaux et tranchées sont pavés de morts sur lesquels on passe et (p. 111) « Je me fais à voir des blessures. Je regarde très bien une tête ouverte, et me promène deux jours au Mesnil avec les mains rouges de sang humain.»
Le 72e donne décidément, et après la dure offensive de Champagne, où il perd beaucoup de monde, les hommes vont aux Éparges dans un secteur très actif : on comprend alors leur désir – assez incompréhensible vu d’aujourd’hui – d’être transportés aux Dardanelles. Il s’en explique (p. 148) : « Ce serait un voyage superbe, sans risque comparables à ceux de notre front. » Mais après un repos en mai 1915, leur train arrive de nouveau aux Islettes : « Quelle désillusion ! À 3 heures du matin (…) Nous voici donc encore dans cette Argonne maudite. Colère de tous. » En février 1916, ce jeune juriste refuse de se porter volontaire pour plaider en conseil de guerre (p. 213) « j’ai formellement refusé de me prêter à une comédie qui a coûté la vie à tant (2 fusillés au 72e par nous en mars 1915). » Il avait toutefois noté en mars 1915 à l’occasion de cette exécution (soldat Rio, p. 114) : « C’est pénible, mais c’est nécessaire. »
Un jeune homme curieux
Charles Taboureux demande aux siens de lui envoyer des cartes d’état-major et un guide Joanne, il est curieux des endroits où il se trouve (nov. 1914, p. 59) « Mes cartes me rendent service. Je sais enfin où nous sommes et comprends quelque chose au pays. » Il lit beaucoup et signale par exemple en avril 1916 « Je suis en train de lire Le Livre de la Jungle, de Rudyard Kipling, c’est épatant. » ou en octobre, lettre à son frère, p. 269) : « Lis-tu Le Feu de Barbusse ? C’est extraordinaire de vérité : l’attaque, le retour du blessé, le poste, la promenade dans la sous-préfecture, c’est épatant ! Plusieurs le lisent ici. Les réflexions sont celles que nous faisons. » Il s’agit ici de la première parution en feuilleton dans le périodique l’Œuvre.
Notre infirmier a une écriture aisée et utilise souvent l’humour ; ainsi par exemple, pour remercier d’une nouvelle vareuse envoyée par la famille (p. 169) : « la vareuse est très bien. Les biches s’arrêtent avec émotion dans la forêt et les laies en oublient de nourrir les marcassins. » Même humour avec le procédé classique de l’acrostiche qui brave la censure pour dire, malgré l’interdiction, où il est positionné (p. 249):
« Comme il est formellement interdit d’
avertir de l’endroit où l’on est, je ne puis que
me répéter : nous ne sommes pas en danger donc
pas de mauvais sang à vous faire (etc…) : acrostiche « Camp de Mailly »
Une marraine de Lyon
Un des intérêts de ce témoignage réside dans les extraits significatifs de lettres de Thérèse, sa marraine de guerre. Cette jeune Lyonnaise de 20 ans écrira 29 lettres entre juillet 1916 et la mort de Charles en novembre. Nous n’avons pas ses lettres à lui, mais on peut déduire des réponses de sa correspondante les sujets abordés, et le soin qu’il a apporté à cet échange. La jeune femme s’était adressée à un inconnu, « qu’une annonce peu prétentieuse m’avait désigné » (p. 234). Il s’agit d’un sous-lieutenant, qui a donné à Charles la réponse de Thérèse. Celle-ci écrit – au moins au début – en cachette de ses parents : (p. 241) « Personne ne sait que j’ai l’audace de bavarder avec un inconnu et la permission m’aurait été refusée si j’avais eu la maladresse de la demander. » Le livre adopte une typographie de type « cursive anglaise » pour reproduire les extraits de Thérèse : c’est une bonne idée, cela produit un effet d’authenticité et de familiarité. La conversation est enjouée et confiante, on aborde de nombreux sujets, vie quotidienne, moral, goûts de lectures… Elle dit par exemple (p. 253) apprécier Cami et « mon Dieu, vous qui lisez Virgile, allez être bien effrayé ! Hélas je ne connais pas le latin et ne demanderais pas mieux que de savoir un tout petit peu ce qu’est Virgile dont la postérité a bien voulu entretenir les générations jusqu’à vous.»
Deuil et mort
Charles Taboureux se réjouissait, à la fin de l’été 1916, d’être transporté dans la Somme, car cela le rapprocherait des siens : la situation découverte sur place le fait rapidement déchanter (Bouchavesnes). Les bombardements sont intenses, et Alexandre Scellier, son meilleur ami au poste de secours, est blessé puis meurt quelques jours après à l’ambulance. L’ambiance est sinistre (lettre à la famille, 16 octobre 1916, p. 263) « Scellier est mort. Enterré à 2 km d’ici. Suis excessivement peiné. N’ai jamais eu un tel chagrin. C’était mon compagnon de tous les instants depuis si longtemps ! Son unique frère avait été tué déjà. (…) nous sommes 3 rescapés. » Il écrit le lendemain à son frère : « Ce n’est pas la bataille, c’est la tuerie, le suicide collectif. » Sa jeune marraine essaie de le consoler (p. 272) « On ne peut se consoler de la perte d’un tel ami, et je sais bien qu’on soulage son cœur en parlant de l’être aimé, je suis aussi votre amie et pour cela je vous prie de ne pas craindre de pleurer près de moi. » C’est peu de temps après cette perte que Charles est tué à son tour le 5 novembre. Frappé par un éclatement d’obus relativement loin de la ligne allemande, il était sorti de l’abri pour regarder la progression du barrage avec un camarade. C’est celui-ci, infirmier au 72e, qui nous donne la classique lettre à la famille décrivant les circonstances du décès (14.11.16, p. 278). Ce type de courrier, d’abord destiné à apaiser la douleur des proches, ne doit pas forcément être pris littéralement ; la mort est décrite comme immédiate, et après avoir enveloppé le corps « sous les obus qui tombaient avec rage tout autour de nous, nous nous sommes agenouillés nous trois, seuls autour du brancard et nous avons dit une longue prière. »Et ce même camarade continue (p. 280) : « Alors mes nerfs m’ont abandonné et moi qui n’avait pas versé une larme lorsque Hurrier et Scellier sont morts, j’ai éclaté en sanglots sur le corps de Charles. Ce fut une crise qui dura je ne saurais dire combien, peut-être une heure, peut-être deux, je ne sais pas. » Plus loin à la fin du livre, on a aussi reproduit la lettre de Thérèse à la mère de Charles – on sait que cette dernière fera le voyage à Lyon pour faire sa connaissance – (15.09.17, p. 295) « Je n’étais qu’une marraine de guerre, mais je l’ai pleuré de tout mon cœur comme si ce lien de parenté eut été vérifiable, et j’ai pleuré avec vous, de votre chagrin de maman. »
Donc une restitution de qualité, pour un ensemble d’un grand intérêt historique et humain.
Vincent Suard, septembre 2025