Les 454 pages du manuscrit de Germain Balard posent la question de la date de l’écriture. L’entrée en guerre constitue l’entrée en matières sur 2 pages qui évoquent l’assassinat de Jaurès et le procès Villain ; la rédaction est donc postérieure à 1919. L’auteur raconte alors sa jeunesse en 76 pages et sa mobilisation à Perpignan en 5 pages. À partir de son départ pour le front, le 10 avril 1915, le récit, parfaitement daté, est une rédaction à partir d’un carnet de notes précises. La guerre (avec ses suites immédiates) occupe jusqu’à la p. 442. Viennent enfin 12 pages de remarques isolées de 1924 et de 1930-32. La dernière phrase est : « Le monde est en train d’évoluer rapidement. »
La longue biographie permet de dire que Germain est né le 3 janvier 1881 à Saint-Juéry (Tarn), de père inconnu. Sa mère a ensuite épousé un sabotier qui donna son nom à l’enfant. Celui-ci fréquenta irrégulièrement l’école, mais réussit à obtenir le certificat d’études et entra en apprentissage à 12 ans pour devenir tailleur de limes. Tant en usine que dans l’agriculture, il fit plusieurs métiers manuels jusqu’à la date du service militaire commencé à Carcassonne, mais non terminé pour raisons médicales. Sa grande chance, en 1906, fut d’être embauché comme livreur par un pharmacien de Toulouse qui l’initia à l’étude des médicaments et l’encouragea à acquérir une culture d’autodidacte. La situation était bonne et Germain se maria en 1909 avec une couturière. Réformé, il fut « récupéré » en décembre 1914 et envoyé comme infirmier à l’ambulance 5/16 en Champagne en juin 1915. À 34 ans, c’était un libre-penseur, anticlérical, un homme curieux de tout, ayant une haute idée des règles morales à respecter et une capacité d’indignation qui allait rencontrer de nombreuses occasions de fonctionner. Ainsi, face à un prêtre chauvin : « Lui qui se dit éducateur d’une certaine jeunesse, est capable de lui enseigner un nombre infini d’erreurs, plus grossières les unes que les autres. Aussi, comme conclusion à cette discussion, je lui conseille de revenir à l’école et de travailler la philosophie. » Il pense qu’il faudrait punir les responsables de la guerre ; qu’il faut lutter contre le « badernisme ». Il critique les profiteurs et les embusqués, la censure et le bourrage de crâne, les absurdités de la vie militaire. Il décrit un des médecins chefs de l’ambulance comme drogué, incompétent, fainéant et despotique.
Après la Champagne, l’ambulance est regroupée avec d’autres pour former un HOE à Landrecourt près de Verdun en août 1916. Là, il voit descendre des survivants : « Le 143e RI descend des lignes, passe près de nous. C’est avec un serrement de cœur très pénible que l’on voit à quel état squelettique sont réduits ses bataillons. Sur 3000 hommes qui étaient montés, il en redescend 700, et dans quel état ! Cependant leurs clairons sonnent et leurs tambours résonnent à la traversée de Landrecourt. Beaucoup d’entre eux se redressent dans un suprême effort d’énergie pour marquer le pas ; mais plus nombreux encore sont ceux que tout laisse indifférents, traînant péniblement ce qu’ils ont pu rapporter de ce lieu infernal, parce qu’ils savent qu’on ne leur demandera pas d’autre effort avant longtemps, qu’on va les prendre en auto à quelques mètres de là. Il n’y a pas quinze jours que ce régiment était monté en ligne au complet. »
En juin 1917, retour de permission, Balard décrit l’effervescence dans les trains où les poilus cassent toutes les vitres et conspuent les gendarmes, « aussi à chaque arrêt y a-t-il des individus qui descendent du train et incitent les autres à descendre et à ne pas revenir au front ». Lui-même n’y participe pas, mais estime que les hommes arrêtés par les gendarmes « auront toujours assez de mal pour se soustraire aux griffes de la justice militaire ». Le 28 octobre 1917, notation originale, il dit entendre la Madelon pour la première fois.
L’offensive alliée en 1918 fait découvrir des territoires dévastés. Ainsi au retour d’une permission, le 3 septembre, dans les parages de Villers-Cotterêts : « Je parcours de récents champs de bataille : des trous d’obus partout, des arbres fauchés par la mitraille tombés un peu partout et n’importe comment, des canons ennemis abandonnés au petit bonheur. J’arrive à Longpont que je connaissais comme petite ville accidentée très coquette et propre ; je ne rencontre plus que des ruines partout ; pas une maison n’a été épargnée. […] Je remarque des tombes un peu partout, sur les bords de la route, dans les champs. Elles sont reconnaissables à la terre fraîchement remuée, un piquet qui supporte un casque ou un sabre, une vareuse ou des restes de capote ; quelques-unes ont une croix avec un nom. […] Là, sur un petit plateau, deux tanks inutilisables. » Et, le 15 septembre, le travail repris à l’ambulance : « Les blessés affluant de toutes parts, je me trouverais débordé sans l’aide de deux prisonniers allemands dont un est particulièrement dévoué. Ils me sont d’un grand secours étant donné que j’ai un seul blessé français – on n’a pas voulu le mettre dans une salle où il aurait été seul – tous les autres sont allemands. »
Le 11 novembre, le mot « armistice » est écrit en lettres capitales : « Pour savoir ce que ce mot représente, il faut avoir vécu la journée d’aujourd’hui parmi les poilus, parmi les civils qui ont quelqu’un de leurs proches sur la ligne de feu, parmi ce qu’il est convenu d’appeler le peuple ! »
RC
*Virginie Auduit, Carnet de guerre d’un ambulancier 1914-1918, mémoire de maîtrise, Université de Toulouse Le Mirail, 1998 (avec 75 pages d’extraits du témoignage).
Guy, Lucien (1890-1975)
1. Le témoin
 Lucien Guy, cliché de studio avant la Grande Guerre
Lucien Guy, cliché de studio avant la Grande Guerre
Lucien Guy naît le 10 juillet 1890 à Bonneville (Haute-Savoie) de Albert et de Dupuis Madeleine. Il est étudiant en droit quand se déclenche la Grande Guerre. Blessé en octobre 1914 et réformé en 1915, il ne retourne pas au front. Il épouse une Suissesse, Louise Andrée Thorens (née en 1902), le 14 décembre 1925 à Collonge-Bellerive (Suisse). Après-guerre, il devient directeur de banque. Erudit, il écrit une histoire de « Bonneville et ses environs », publiée en 1922. Il décède le 28 août 1975 à Thonon-les-Bains.
2. Le témoignage
Guy, Lucien, Souvenirs de la campagne 1914. Mes 90 jours au 97e régiment d’infanterie alpine. Lucien Guy, musicien-brancardier, L’Argentière-la-Bessée, éditions du Fournel, 2007, 127 pages.
L’auteur de ce petit carnet évoquant 90 jours de campagne commence sa guerre comme musicien-brancardier au 97e RIA. La reproduction en frontispice de l’ouvrage de courriers datés de 1912 et 1913, émanant de camarades militaires, semble indiquer qu’il a choisi de faire de la musique pour échapper quelque peu aux rigueurs du dressage militaire durant son service militaire. La guerre déclarée, il suit le régiment dans son entrée en campagne en Alsace, puis son transport dans le nord du massif et du département des Vosges pour participer aux combats de La Chipotte, en août et septembre 1914. Le 15 septembre, au vu des pertes subies, la musique du 97e est dissoute. Après une courte période d’occupation des premières lignes en cours de cristallisation dans le secteur de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), il est déplacé en Artois, où il subit de terribles épisodes de bombardements dans le secteur d’Arras. Très légèrement blessé par un mur qui s’est abattu sur lui, il obtient une journée de repos dans une ambulance du faubourg Saint-Nicolas à Arras. C’est là qu’il est gravement blessé le 23 octobre 1914 par un éclat d’obus au thorax. Déclaré inapte à poursuivre la guerre le 16 février 1915, il est réformé n°2 le 1er septembre suivant et ne retournera jamais au front.
3. Analyse
Lucien Guy est à la caserne du 97e à Chambéry quand se déclenche la guerre. Il voit une ville patriote et surexcitée, fêtant son régiment (page 25), et voit « défiler une longue caravane d’Italiens, vêtus de défroques hétéroclites, portant à la main, dans un linge, quelques hardes constituant leur unique richesse » (page 26). Sa campagne débutée, il glane des balles et des équipements allemands (page 35) et décrit un accueil des Alsaciens qu’il « libère » différent selon les générations : « Tandis que mes camarades préparent le repas dans un verger, je vais causer avec ces nouveaux compatriotes. Les vieux sont restés français et nous voient d’un bon œil. La nouvelle génération nous accueille assez froidement et semble ignorer complètement l’ancienne langue du pays » (page 36). Son baptême du feu à Flaxlanden (Haut-Rhin) est une attaque française au son de la clique (page 38). Musicien, il est aussi brancardier, assainisseur du champ de bataille et cuisinier. Suivent ainsi quelques description intéressantes de l’émotion d’une primo inhumation (page 55), de la vue du premier mort allemand (page 64), ou d’une marche de 60 kilomètres qui égraine les traînards, dont lui, ramassés par des bus (page 81). En Artois, il est pris sous un feu roulant, qu’il décrit destructeur comme une tornade, bombardement qu’il subit avec angoisse sans échappatoire possible (page 92). Sa relation de l’après combat et de l’aspect du champ de bataille est aussi impressionnante (page 96). Comme nombre de témoins, le « tableau grandiose et terrifiant ! » (page 101) d’un bombardement de nuit sur et autour d’Arras atteste du grand spectacle qu’est parfois la guerre.
Yann Prouillet, février 2013
Lambert, Eugène (1876-1956)
1. Le témoin
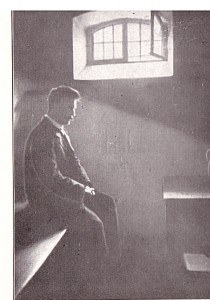 L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein
L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein
Eugène Lambert naît à Mainvilliers (Moselle) en 1876. Marié à Marie, il a trois enfants ; une fille, un fils, Rémi et Suzanne, qui naît en 1914 alors qu’il est en captivité. A la déclaration de guerre, il travaille au journal francophone le Lorrain à Metz. Francophile, secrétaire du comité du Souvenir Français de Noisseville (Moselle), il deviendra après-guerre publiciste, président du Syndicat d’initiative et à ce titre membre fondateur de la Foire d’automne de Metz, ville dans laquelle il est socialement très actif. Conseiller municipal messin, vice-président de l’Amicale des anciens incarcérés politiques d’Ehrenbreitstein, il reçoit le 12 juillet 1935 la médaille d’honneur (vermeil) de la Reconnaissance française pour ses actions de propagande francophile alors qu’il était sous l’uniforme allemand. Il décède à Metz le 7 mai 1956.
2. Le témoignage
Lambert, Eugène, De la prison à la Caserne ! Journal d’un incarcéré politique d’Ehrenbreitstein. 1914-1918. Metz, imprimerie Paul Even, 1934, 234
pages, (tirage limité à 250 exemplaires).
Eugène Lambert, se sachant recherché, est arrêté dans les bureaux du journal Le Lorrain le matin du 1er août 1914 et conduit à la prison militaire de la Place Mazelle, rue Haute Seille à Metz. Il en est extrait dès le lendemain pour être acheminé à la forteresse d’Ehrenbreitstein à Coblence, au bord du Rhin. Il reste incarcéré dans les fameuses casemates comme prisonnier politique, sans jamais connaître la raison de son arrestation. Le 24 septembre 1914, il fonde au sein de la forteresse, avec quelques détenus, « L’Union », « société des détenus politiques d’Ehrenbreitstein » (page 79).
Ayant la confiance des détenus, il est même mandaté pour tenir leurs comptes (page 83). Mobilisable dans l’armée allemande, il est transféré le 25 février 1915 de la prison à la caserne Ravensberg du 66e régiment d’infanterie allemand de Magdebourg (Saxe-Anhalt). Sous-officier, il occupe plusieurs fonctions et est muté dans un régiment territorial (à Quedlinbourg) le 15 mai 1915, suite à sa simulation d’un problème au cœur. Usant, comme beaucoup (voir page 229), de tous les subterfuges pour paraître malade, y compris en perdant anormalement du poids, sa crainte ultime est d’être muté sur le front russe dans un régiment combattant. Il sera d’ailleurs l’un des rares sous-officiers lorrains à ne pas y être affecté. A Magdebourg, affecté au 1er territorial, il est notamment affecté comme geôlier – lui qui a été détenu 7 mois en forteresse – à la garde de prisonniers belges. Surpris à leur parler français, alors qu’il leur fournit des informations, il est déplacé le 15 juin 1915 à Altenbourg (Thuringe) au 153ème régiment d’infanterie d’active. Considéré comme suspect, il y est particulièrement surveillé mais échappe à plusieurs commissions médicales qui veulent l’affecter en Russie. Il a en effet une certitude : « (…) on veut se débarrasser de moi, j’en ai la ferme conviction. Je n’arriverai jamais au front, me dis-je, ou si j’y arrive, je n’y serai pas longtemps. Sans doute, quelque gradé aura mission de me nettoyer de propre façon » (page 139).
Reclus dans son régiment, dans lequel il va rester jusqu’à l’Armistice. Il finit par obtenir enfin une permission en mai 1918 et retourne à Metz où, le
17, chez lui, il déclare paradoxalement : « Pour la première fois depuis la guerre, j’ai entendu le canon » (page 203). A Altenbourg, au fil des mois, il débute une propagande zélée de « doctrines antimilitaristes, antiprussiennes et francophiles [dans une] Saxe (…) foncièrement socialiste » (page 153) et va même jusqu’à fonder le 19 mai 1917 « l’Espérance », « journal manuscrit clandestin à l’image des compagnons d’exil. Paraissant en Barbarie ». Hebdomadaire écrit en français, et destiné à donner des nouvelles aux prisonniers des environs, il paraîtra jusqu’à la fin. Eugène Lambert vit ainsi le lent mais inexorable enfoncement de l’Allemagne dans la crise morale et alimentaire qui va amener à la situation révolutionnaire de l’automne 1918. « Singulier spectacle que ce peuple victorieux et mendiant » dit-il le 18 juillet 1915. Le 11 novembre, « cette fois, c’était bien la délivrance » (page 212) et le seul but qui maintenant le préoccupe est le retour en homme libre dans une Lorraine redevenue française. Il quitte Altenbourg le 17 novembre et, après avoir traversé une Allemagne où « l’anarchie règne en maîtresse » (page 215), Eugène Lambert arrive à Metz le 25 novembre 1918 et retrouve enfin sa famille.
3. Analyse
Deux ouvrages de volumes sensiblement égaux composent ce journal d’un « Malgré nous »[1] ; le journal d’un incarcéré et les souvenirs d’un Lorrain sous l’uniforme allemand. Francophile propagandiste, le témoignage d’Eugène Lambert est forcément partial mais nombre d’informations subsistent sur la vie en prison (pages 17 à 34), en forteresse (pages 35 à 117) comme sur l’ambiance de la caserne de l’armée allemande, la vie à l’intérieur dans le régime de blocus qui ronge le pays et qui va l’amener à la révolution (pages 137 à 214). Débutant son journal le 27 juillet 1914, il nous permet d’appréhender les heures intenses précédant la déclaration de guerre à Metz et son arrestation, le 1er août. Ces quelques pages sont ainsi à rapprocher du journal de guerre de René Mercier qui décrit des scènes semblables à Nancy[2]. Très psychologiquement touché par son incarcération, Eugène Lambert témoignage des affres de sa vie d’interné, craignant d’être fusillé pour ses activités francophiles. Il balance entre obéissance et évasion mais se soumets sous la menace des représailles à sa famille (page 9). L’ouvrage témoigne aussi des difficultés d’une écriture de la claustration tant le confinement et l’absence quasi-totale de nouvelles provenant de l’extérieur ne permettent pas l’enrichissement du témoignage. Il y parvient toutefois, nous parlant des ruses pour obtenir de l’argent par sa famille (pages 55 et 80), et pour le cacher dans des boutons de caleçon (page 80), pour tromper la censure, en écrivant « sous les timbres, dans les doublures d’enveloppes ou avec du jus d’oignon comme encre sympathique » (page 80), sachant que toute correspondance doit obligatoirement être écrite en allemand (pages 63 et 79). Il évoque aussi les mouchards (page 80), la collaboration (page 104) ou les fraternisations avec les gardes (page 97), qu’il appliquera lui-même quand il sera geôlier. Il craint la folie, notamment quand il ne peut plus sortir de sa casemate à cause de la neige : « Nous filons toutes voiles déployées vers la neurasthénie, la folie ! » (page 105) et évoque même le suicide le 27 janvier 1915 (page 106). Libéré pour être encaserné, il fait un court retour sur la sociologie des prisonniers, de tous statuts et de toutes nationalités (page 115).
Vêtu de force de l’uniforme feldgrau, arrivé à la caserne, son témoignage change d’aspect, passant de l’écriture journalière à des souvenirs reconstruits, épisodiques, vraisemblablement basés sur un carnet. Affecté à une unité de réserve (son fusil est russe), il atteste de l’impréparation du soldat allemand au combat : « J’en ai vu partir qui ne savaient pas se servir de l’arme à feu, qui n’avaient jamais tiré un coup de fusil » (page 180) et de la violence du dressage des hommes (page 152), « matériel humain »[3] (…) en voie de s’épuiser (page 177). Observateur privilégié, il assiste à la double déchéance des sociétés allemandes ; la disette de la société civile et « un esprit de lassitude et de défaitisme » (page 164) de la société militaire, dont les conditions de vie matérielles se dégradent inexorablement : « Un ordre prescrit aux soldats de livrer leurs chaussettes pour être conservées dans les dépôts jusqu’au jour où ils partiront en campagne » (page 165). D’ailleurs, Lambert témoignage à partir de 1916 d’une recrudescence des suicides militaires comme civils (pages 168, 169, 171, 178). Il est témoin de la dégradation d’un militaire suite à une automutilation (page 189). La crise économique est telle que « des permissions sont offertes aux Alsaciens-Lorrains qui promettent de rapporter de l’or » (page 179), « les tissus sont tellement rares que les uniformes militaires ne sont plus en drap, mais en une sorte de feutre pressé. Dans les magasins, on vend du linge de corps en papier, la toile et le fil ayant disparu du marché » (page 180) en janvier 1917, « on recommande dans les journaux, de chasser les corbeaux qui s’abattent par nuées sur la région » (page 182). Le pain est « une composition dans laquelle la pomme de terre, la sciure de bois et le son entrent pour une grande part » (page 183) et des troubles éclatent à Leipzig et Altenbourg suite aux pénuries alimentaires. De retour de la seule permission qu’il parvient à obtenir en mai 1918, il constate « les ravages de l’idée révolutionnaire dans les casernes » et que « des incidents très suggestifs se produisent qui révèlent l’état d’esprit de la troupe » (page 208). Ils se traduisent par les premières marques d’irrespect envers les officiers qui dès lors « n’en mènent pas large » (page 208) ; certains « ont même été frappés par les hommes à la moindre observation » (page 209). L’anarchie monte à l’été 1918, « les hommes que l’on envoie au front refusent carrément de marcher (…) arrêtent le train, détruisent les fils télégraphiques et se dispersent dans la campagne » (p.209). C’est le début de la fin qui amène à la « paix de raison (Vernunftsfrieden) »
(page 212) et les jours de novembre, vécus à Altenbourg, sont surréalistes (pages 230 à 233). Son retour à Metz et le défilé des soldats français devant
Raymond Poincaré le 28 novembre 1918 lui suggèrent ces mots en forme de conclusion : « Je défie la plume la plus experte de décrire ce que nous autres Messins avons ressenti ce jour là » (page 220).
Yann Prouillet, février 2013
[1] Terme employé par Eugène Lambert dans sa préface, écrite en juillet 1934, mais non présent dans ses écrits rédigés avant Noël 1918.
[2] Voir sa notice dans le présent dictionnaire ou sur http://www.crid1418.org/temoins/2012/03/28/mercier-rene-1867-1945/.
[3] Cette notion de « Mensch material » ne saurait ici être comparée ou rapprochée de l’application concentrationnaire de l’autre guerre.
Mérand, Emile (1873-1943)
1. Le témoin Emile Alexandre Mérand naît à Venère (Haute-Saône) le 20 mai 1873. Cultivateur, il est appelé sous les drapeaux le 13 novembre 1894 et incorporé au 21e RI de Langres, régiment dans lequel il reste jusqu’au 25 septembre 1895. Le 7 octobre 1907, il est placé dans l’armée territoriale et c’est ainsi qu’il est affecté le 2 août 1914 au 51e RIT de Langres ; il a 41 ans. De retour de la guerre, il reste célibataire et décède à Venère le 23 mars 1943.
Emile Alexandre Mérand naît à Venère (Haute-Saône) le 20 mai 1873. Cultivateur, il est appelé sous les drapeaux le 13 novembre 1894 et incorporé au 21e RI de Langres, régiment dans lequel il reste jusqu’au 25 septembre 1895. Le 7 octobre 1907, il est placé dans l’armée territoriale et c’est ainsi qu’il est affecté le 2 août 1914 au 51e RIT de Langres ; il a 41 ans. De retour de la guerre, il reste célibataire et décède à Venère le 23 mars 1943.
2. Le témoignage
Biagini, Daniel (prés), La Grande Guerre. Témoignage de monsieur Emile Mérand de Venère, Haute-Saône, 1914-1918, Vesoul, ONAC, 2004, non paginé, 69 pages.
Conformément à son livret militaire, Emile Mérand se rend au 2e jour de la mobilisation au dépôt du 51e régiment d’infanterie territoriale de Langres. Il part dès le lendemain dans l’ouest du département des Vosges, secteur de Bulgnéville, où il a pour mission de garder les espions et les
étrangers ; « ramassis de tous les peuples (…) de 19 nationalités » (page 3). Après un bref retour à Langres, il rejoint le front cristallisé dans
le secteur de Saint-Dié (Vosges), ville de l’immédiat arrière-front où, le 6 novembre, il subit un bombardement qui est son baptême du feu. Il va rester dans ce secteur, entre la Chapelotte au nord et le Violu au sud jusqu’à la dissolution du 51e RIT le 2 juillet 1918. Il est alors versé au 1er BTCA (Bataillon Territorial de Chasseurs Alpins) et rejoint le secteur de Moosch (Haut-Rhin) en Alsace, puis il revient à la Chapelotte pour y occuper la fonction de téléphoniste (juillet 1918). Le 10 novembre suivant, il change à nouveau d’affection, est versé au train C de combat pour trois jours et rejoint le lendemain de l’Armistice le 87e RIT. Sur le 11 novembre, il dit : « Il faudrait une plume plus éloquente que la mienne, pour décrire cette journée inoubliable » et note, fait rare dans l’expérience combattante, qu’il voit la fin de la guerre « au lieu même où je l’avais commencée en 1914 » (page 57). Quelques jours plus tard (le 20), il est hospitalisé du fait d’une grippe infectieuse, certainement espagnole, puisqu’il va rester « quinze jours entre la vie et la mort » (page 57), avant d’être démobilisé le 16 janvier 1919.
3. Analyse
Particulièrement représentatif d’un soldat de l’armée territoriale, Emile Mérand occupe de nombreuses fonctions au sein de cette unité aux tâches multiples, tour à tour gardien de camp, ouvrier, voltigeur signaleur, observateur, brancardier, téléphoniste, il s’initie également à la télégraphie. Clérical patriote d’origine plébéienne, Mérand, un peu botaniste et artiste, offre un témoignage utile du fait de son emploi, dans un régiment, le 51ème territorial, et un secteur, l’Ormont, dans les Vosges, tous deux sous évoqués par la littérature testimoniale. Toutefois, on ne sait à qui attribuer les multiples imprécisions de ce récit tant il est desservi par une transcription et une présentation confinant à l’impéritie, qui auraient pu être aisément corrigées à la lecture d’une simple carte d’état-major. Les toponymes sont erronés, les patronymes parfois fantaisistes (cas du « brave » soldat Kalferdings (page 24), devenu « Volferding, traitre, fusillé au col d’Hermanpère » (page 27) puis enfin « Roi de Kalferdings, tué le 23 septembre 1915 à la ferme de Hermonpère » page 63) et la typographie déplorable. De même, les présentateurs de l’ouvrage indiquent qu’il est capitaine (page 61) alors qu’il s’agit d’un homonyme d’une compagnie voisine qu’Emile Mérand cite lui-même, page 46. Malgré ces approximations très préjudiciables à la publication, ce témoignage, augmenté encore par des croquis intéressants, revêt pourtant pour l’historien de la zone décrite, un remarquable attrait. Certes, il rapporte des faits inexacts, tels ces « 180 soldats français que l’on avait fusillé [sic] pour avoir fui devant l’ennemi », dont il voit la fosse commune à Vomécourt (Vosges) en septembre 1914 (page 5), ou contemple des « débris humains à demi-calcinés » des Allemands ayant « jeté leurs morts pour les brûler » dans l’église de Mandray (page 6), mais confronté à la réalité du front, son témoignage se précise et gagne en crédibilité. Comme la plupart des soldats, il teinte de mysticisme le fait d’être encore en vie après son baptême du feu : « Le 3 mars [1915] a été pour nous une terrible journée, mais je remercie la divine Providence qui m’a préservé de tout mal. Le matin de ce jour, j’avais reçu la Sainte communion à l’église de Ban de Lavelines [sic] au milieu des rires des camarades, mais cela m’a porté bonheur » (page 17), il y revient en ces termes page 57, attribuant à cette divine Providence d’avoir vu la fin de la guerre. Mais il confesse : « Je suis bien familiarisé avec les choses de la guerre et c’est cette certitude qui est mon ressort et ma chance. Cette même certitude nous pénètre tous » (page 25). Il évoque, le 20 juin 1915, une rébellion due à l’alcool lors de la revue d’un général (page 20), la guerre par le feu de forêt (page 24), spécifique aux Vosges, et évoquée dans d’autres témoignages. Il y côtoie des figures de femmes peu amènes : « Nous logeons dans un grenier chez une espèce de gouipe (!). Nous l’appelons la grande Nina. Si dans ma vie j’ai rencontré une salope, c’est celle là. Passons » (page 31) et fustige les officiers : « Le 8 mars 1917, nous avons la joie d’apprendre le départ du lieutenant Burtey, notre commandant de compagnie. C’était le type de la brute. Officier sans valeur et sans éducation, il n’a pas laissé un seul regret à la compagnie. Il n’était bon qu’à faire un garde champêtre et un mauvais » (page 40), et la bêtise militaire : « Pendant le jour, nous allons travailler à la cime du Spitzemberg à la vue de l’ennemi. Le colonel est un misérable d’exposer aussi bêtement des hommes pour faire des travaux idiots et stupides qui ne serviront jamais à rien mais c’est la bêtise militaire. Il ne faut pas chercher à comprendre » (page 40).
Yann Prouillet, février 2013
Barthès, Emile (1883-1939)
Né à Castres dans une famille très catholique, prêtre en 1908, Émile Barthès était professeur de philosophie au grand séminaire d’Albi lorsqu’il fut mobilisé comme brancardier au GBD 31 du 16e corps. Après la Lorraine, l’Yser et la Champagne, il passa au 9e RAC où il chercha principalement à jouer un rôle de prêtre, son chef lui reprochant de négliger ses devoirs de brancardier. Il faisait de la photo, ce qu’il considérait comme un moyen de gagner la confiance des soldats, et circulait beaucoup, « commis voyageur du bon Dieu ». Même s’il n’a pas connu les combats de première ligne, il fallait pouvoir tenir plus de quatre ans, et l’écriture fut un moyen. À partir de 25 carnets, sa nièce dactylographia un texte intitulé Memorandum, 7 volumes, 2456 pages illustrées de 601 photos et 63 cartes postales. Après la guerre, il soutint une thèse de doctorat sur Eugénie de Guérin et contribua à la publication de ses œuvres. Il devint vicaire général, puis évêque auxiliaire d’Albi en 1932.
RC
*André Minet, « Émile Barthès, « curé de campagne en costume d’artilleur » », in Revue du Tarn, n° 196, hiver 2004, p. 659-672.
Amalric, Adrien (1892-1917)
1) Le témoin
Né le 21 octobre 1892 à St Sulpice la Pointe (Tarn). Les parents sont des « cultivateurs aisés », des « propriétaires », possédant plusieurs métairies. Leur maison compte 9 pièces, ils disposent d’un pigeonnier et d’un « grand chai » contenant vins en fût et eaux de vie. Adrien passe par l’Ecole normale, devient instituteur. A 22 ans, il est déjà (selon l’éditeur de son journal de route) inspecteur primaire.
Mobilisé à Castelnaudary (Aude) dans le 143e RI, il part sur le front de Lorraine et devient agent de liaison dès le 9 septembre 1914. Le 9 octobre, il part vers l’Ouest et accompagne la « course à la mer ». Le 31 octobre il arrive près de Calais et se trouve pris dans les combats sur l’Yser.
Au début de 1915, il quitte la Belgique, combat en Champagne, en Argonne. En 1916, il passe au 70e RI, se retrouve à Verdun et finit l’année à Mourmelon le Grand, au lieu-dit « le camp russe ». 1917 le voit d’abord sur l’Aisne, puis à Abbeville, puis dans la Marne et, en juin, à Lavoye (Meuse) près de Verdun. Il passe alors dans le 35ème RIC et s’embarque pour Salonique sur le Parana, un ancien vapeur devenu transport de troupes. Il périt en mer le 24 août près de l’île grecque de l’Eubée, le Parana ayant été atteint par un sous-marin allemand.
2) Le témoignage
Adrien Amalric, dès le 1er août 1914 a noté chaque jour en 1914 (sauf le 7 novembre) ses observations sur un carnet ou « cahier de poche ». Il a écrit plusieurs carnets et seul le dernier a disparu après le torpillage du Parana. Les carnets jusqu’au début de 1917 ont été conservés par la famille. Seul le contenu du carnet tenu en 1914 a été édité, en 2006, par M. Adrien Bélanger de Domérat (Allier), auteur de plusieurs ouvrages, à diffusion limitée, sur la guerre de 14. La BNF conserve un exemplaire de l’ouvrage intitulé C’était 14. Les événements et, parallèlement le carnet de guerre d’Adrien Amalric. Auto-édité, cet ouvrage de 303 pages a été imprimé chez Chaumeil à Clermont-Ferrand. Il est préfacé par Aline Torchassé, petite-nièce d’Adrien Amalric.
Adrien Bélanger a disposé du tapuscrit établi par M. Jean-Claude Planès mais aussi, semble-t-il des carnets eux-mêmes. Il publie l’intégralité du texte, jour après jour, se contentant de modifier la graphie de certains toponymes (Mülhwald au lieu de Mulevalde). Il assortit le texte d’exposés sur l’évolution générale de la guerre et de commentaires personnels, bien intentionnés, parfois utiles, parfois discutables voire hors-sujet. Adrien Bélanger ne donne aucune précision sur l’état de conservation des carnets, sur leur aspect matériel. Il ne donne aucun extrait des carnets à partir de 1915 et se contente de donner en quelques lignes les indications sur les étapes de la guerre d’Amalric indiquées ci-dessus.
3) Analyse
Instruit, Adrien Amalric écrit avec netteté, dans un style sobre mais non exempt par moment d’une sensibilité maîtrisée. Il trouve le temps d’observer à l’occasion la beauté de la région traversée. Ainsi après Château-Thierry : « les villages de ce coin de France avec les aiguilles de leur clochers sont très coquets. A les voir de loin au milieu de la nature jaunissante, ils font penser à des hameaux miniature ». Il ne compare pas avec son Tarn natal, qu’il n’évoque jamais.
Bélanger note très justement qu’Adrien Amalric porte sur ce qu’il voit un « regard d’inspecteur ». Agent de liaison, il saisit les attitudes du commandement et observe bien le mouvement des troupes. La description de l’offensive en Lorraine en août 14 est précise et vivante, et plus encore la débâcle à partir du 21 août, entraînant aussi les civils (un « exode à grande échelle »).
Instituteur de la jeune génération très laïque du début du XXème siècle, Amalric est indifférent en matière religieuse, contrairement à sa mère. Patriote à la manière républicaine (il est heureux d’envoyer à sa sœur une carte postale de Valmy, le jour anniversaire de la fameuse bataille de 1792), il n’est pas patriotard. Il estime que la retraite de Lorraine à la fin août est « une honte ». La brutalité de certains officiers le révulse. Ainsi l’odieux lieutenant-colonel Bertrand qui en Flandre, le 17 décembre, invective ses hommes : « il paraît que quelques hommes d’une compagnie auraient manifesté leur fatigue ce matin par des propos qui auraient immédiatement mérité la peine de mort (…) Les soldats qui se plaignent hautement sont des lâches. Ils mériteraient que les bons Français leur crachent à la figure. Ce sont des gens qui mériteraient d’être émasculés pour que leur race de pleutres et de lâches ne se reproduise plus ».
Adrien Amalric note les exactions commises par les « Alboches » (expression employée dès le 27 août) : pillages (par exemple de l’école des Eaux et Forêts de Nancy), cadavres jetés dans les puits pour les infecter etc. Mais lors de l’offensive en Lorraine il est impressionné par les tombes individuelles des Allemands, avec casques alignés au-dessus : « des couronnes de grains et de fleurs ont été placées sur les croix ; c’est dire s’ils ont les morts en grande vénération tandis que chez nous les morts sont mis en grand nombre dans des fosses avec du gazon sur le corps ce qui a pour effet d’infester l’air. Par ailleurs les Boches soignent aussi bien les blessés qu’ils enterrent leurs morts ».
Amalric est peu effusif et pas du genre à se plaindre sans cesse (« il ne se plaint jamais », note A. Bélanger). Mais il vit pleinement l’horreur de la guerre. Le 3 novembre, il note : « avec l’ennemi qui nous cerne et cette pluie torrentielle et glacée, la nuit devient tragiquement angoissante. Comment ne pas avoir cette impression de terreur tant est grande la brutalité des hommes ? »
Lucide et humaniste, tel apparaît Adrien Amalric. Le 20 août 1914, lors de la bataille de Dieuze Morhange, il surprend un officier allemand blessé qui a essayé de tuer d’un coup de pistolet l’officier français qui venait de lui planter sa baïonnette dans le corps : « loin de mettre fin à ses jours, je lui retire l’arme de la main et je laisse là ces deux blessés jadis ennemis et maintenant frères dans le malheur ». D’ailleurs, note Amalric, cet officier français « ne valait pas cher non plus ». Amalric aspire implicitement à la paix et au dialogue entre les nations. Rencontrant des aviateurs « britanniques » à l’Est de Soissons, où ils disposent d’un mini-aéroport, il observe qu’ils ont chipé quelques fruits dans un verger et déplore de ne pas pouvoir parler avec eux ; mais lui et ses compagnons d’armes couchent à leurs côtés « comme si nous étions de la même nation, de la même patrie ».
Jean Faury
Cantié, Marius (1884-1917)
Sa famille a conservé de lui des notes prises entre août 1914 et juillet 1916, lorsqu’il était sergent dans le groupe de brancardiers de la 31e division. Commençons par les lire. Ce Méridional est surpris par le climat lorrain comme le montre son récit de la nuit du 15 au 16 août : « Nous devons coucher sur le champ avec 5 cm d’eau, on réussit cependant à s’abriter tout mouillés dans ou sous les voitures d’ambulance et nous passons ainsi une nuit glacée à grelotter dans nos effets mouillés, car impossible de se changer, le sac étant tout trempé aussi. Les officiers de l’ambulance avaient fait monter une tente Tortoise pouvant abriter 50 hommes, mais ont mis tout le monde à la porte et ont supporté d’y coucher seuls sur un brancard, quand les infirmiers n’avaient aucun abri. » D’une façon générale, les officiers gestionnaires, qui ne combattent pas, qui ne soignent pas, sont épinglés pour leurs brimades. En janvier 1915, par exemple, Marius est puni pour avoir fait son service alors qu’il en était exempt ! En février 1916, la popote des sergents est supprimée parce que les officiers veulent prendre le cuisinier à la leur. Aussi, lorsque la formation est disloquée, tout le monde est content « dès l’instant que l’on doit vivre loin de l’officier d’administration ».
Ramasser les blessés, enterrer les morts
Les premiers combats, en Lorraine, sont terribles : « Les blessés arrivent en si grand nombre qu’on est stupéfait. On voit des plaies ignobles, on entend des râles et les cris déchirants des blessés, que le cœur se serre d’angoisse. Le 142 est décimé, le colonel tué, ainsi que le 81, le 96 et le 122 [voir Ferroul]. Les Allemands étaient retranchés dans des fossés profonds et ne craignaient rien de notre artillerie ainsi que de l’infanterie. Les nôtres étant à découvert étaient décimés. » C’était le 18 août, et le lendemain ceux qui restent du 142 et du 122 sont relancés à l’attaque des « Prussiens » fortifiés et se font anéantir : « On les mène autrement dit à la boucherie. » Les brancardiers participent à la retraite, puis à la course à la mer. Le 21 novembre 1914, Marius décrit la ville d’Ypres : « À 8 h les Boches bombardent Ypres avec leurs grosses marmites, brisent le clocher de l’hôtel de ville et l’incendient. Les halles brûlent aussi et le feu se communique à la cathédrale. La ville n’est qu’un immense foyer ardent, et à la nuit c’est tout à fait lugubre. En ville, on ne trouve pas âme qui vive, tout est désert, les rues sont encombrées d’un amoncellement de ruines, les maisons éventrées ou calcinées, des objets épars, çà et là quelque poutre qui fume encore. On dirait qu’un fléau est passé là et a emporté toute la vie avec lui, et n’a laissé qu’une vaste nécropole. »
En février 1915, déplacement vers la Somme (près d’Amiens, « un marchand de vins du Midi nous fait boire tous et remplit nos bidons à titre gracieux »), puis vers la Champagne (« dans des wagons à bestiaux ayant contenu des chevaux et non désinfectés, ayant encore l’odeur et la trace des déjections »). La nuit du 29 mars, près de Mesnil-les-Hurlus, est un bon exemple de ce qui attend les brancardiers après les combats : « D’espace en espace on y rencontre des casemates boisées sur les côtés ayant servi sans doute d’abris aux gradés boches, car tout ceci est un travail boche, et ce n’est pas une petite affaire. En approchant de la ligne de feu, le boyau a, sur tout le long, des niches en terre servant d’abri aux troupes. Nous passons devant la guitoune du général et enfin nous entrons dans les boyaux abandonnés. Tout y est bouleversé, les trous d’obus se touchent et tous les morts qui sont à côté y sont enfouis. Certains forment de véritables murailles. Ils sont là, entassés pêle-mêle, et recouverts de la boue calcaire du pays. Elle a fait prise, et les morts restent là dans ce mortier, oubliés et perdus. Quelquefois on aperçoit un pied ou une main qui dépasse, semblant nous dire : « Je suis là, donnez-moi donc une autre sépulture ! » On trouve aussi des membres épars, des corps sans tête ou à moitié déchiquetés. C’est horrible. La lune de son disque brillant éclaire ces scènes funèbres. Les fusées éclairantes projettent encore leur vive lumière et viennent parfois retomber jusque chez nous. Les balles sifflent toute la nuit, un peu haut il est vrai, mais de nombreux ricochets font voler la poussière autour de nous. »
Les combats et leurs suites
Le 10 juin 1915, Marius Cantié mentionne un épisode comme il y en eut tant : « On annonce qu’hier au soir les Boches ont tenté de reprendre au 96e et au 322e la tranchée du Trapèze. Ils y ont réussi mais une contre-attaque les en a délogés. Une 2e tentative réussit encore mais une vive contre-attaque de nous les en chasse définitivement. Les blessés sont nombreux. Plus de 300 et une quarantaine de morts. » En septembre, du côté de Valmy, il faut faire face aux gaz ; le 1er décembre, « on commence à avoir des évacués pour gelure des pieds ». Des prisonniers allemands passent : « Tous sont contents de s’en tirer ainsi et sont gais, quelques officiers seuls ont l’air maussade et ennuyés comme des rats qui se voient pris. » La lecture des citations à l’ordre de la division ne suscite que ce commentaire : « Quelle blague !!! » En décembre, le 96 refuse de monter à l’assaut, « alléguant que le 81 avait perdu la tranchée et n’avait qu’à la reprendre ». La nuit de Noël, quelques brancardiers « ont fêté un peu trop le mousseux » et bousculent les officiers qui veulent intervenir.
La boue reste un ennemi implacable. « Plusieurs cuisines roulantes restent en panne dans les grands trous de la route avec des roues cassées et des essieux faussés. Il est formé un projet d’évacuer les blessés par le petit chemin de fer à voie étroite. Nous allons passer chefs de gare. » Mais cette proposition du 16 novembre, réitérée le 2 décembre, ne reçoit pas de réponse. Il faut atteler 4 à 5 chevaux à une voiture faite pour un seul. « Il pleut toujours, les cagnas s’effondrent dans les tranchées et même chez nous. Les routes sont des lacs de boue. »
À la recherche de l’auteur
Le carnet de Marius Cantié, peu fourni pour 1916, ne dépasse pas le mois de juillet de cette année. La famille a retenu de lui qu’il était originaire du Pays de Sault, que son père avait été nommé gendarme à Narbonne et que lui-même était employé de banque dans cette ville. La famille avait encore la date et le lieu du décès : 14 septembre 1917 au Bois des Caurières (Meuse). La consultation du site « Mémoire des Hommes » donne la date de naissance du sergent Cantié Célestin Marius Achille, le 27 décembre 1894 à Roquefort-de-Sault.
RC
Anonyme du 329e RI
Campagne 1914-1915 au 329ème R.I.,
Bretagne 14-18, 2002, 37 pages 21×29,5. ISBN : 2-913518-15-X
Reliure souple, peu d’iconographie.
1 – L’auteur.
Nous ne le connaissons nullement. Nous savons juste qu’il était ouvrier au Havre, réserviste au 329e RI, qu’il fit la guerre de la mobilisation au 22 novembre 1915, date à laquelle il quitta le front pour rejoindre une usine, comme affecté spécial.
2 – Le carnet.
Peu de choses à dire de ce petit carnet banal sur lequel le réserviste havrais jetait sommairement et quotidiennement quelques notes. Le document fut conservé par la famille avant de nous être confié. Son auteur n’avait jamais dû envisager une quelconque publication.
3 – Le témoignage.
Certains combattants ont laissé trace de leur expérience de guerre, dans leurs lettres, dans des carnets, dans des journaux, dans leurs mémoires. Mais il ne s’est agi, la plupart du temps, que de lettrés, souvent officiers. Dans ce petit document, c’est un soldat de 2e classe, un simple ouvrier qui nous offre de courtes chroniques. Rédigé souvent de façon télégraphique, sans effet de style ou apprêt littéraire, ce témoignage nous montre une guerre sans fard, dans tous ses aspects, des plus terribles aux plus ordinaires. Il ne cèle rien de ce qu’il a vécu, ne détaille pas, ne se met aucunement en avant, loin s’en faut. Les banalités horribles du combat sont décrites lapidairement. Point de sentiments exprimés, compassions, regrets ou glorioles. Nous sommes au plus près de ce que fut cette guerre, sans concession et sans guère d’humanité.
René Richard
Mahé, Charles (1875-1915)
Le capitaine Charles Mahé au 48e régiment d’infanterie de Guingamp,
Carnets et lettres de guerre (août 1914 – 9 mai 1915),
Bretagne 14-18, Juin 2006, 59 pages 21×29,5, ISBN : 2-913518-38-9
Reliure souple, iconographie.
L’auteur.
Charles Mahé était un officier issu du corps, engagé volontaire comme simple soldat en 1893, à l’âge de 18 ans, promu capitaine en 1913. Il était parti au front dès le 5 août 1914 comme commandant de compagnie au sein du 48e régiment d’infanterie de Guingamp et avait participé ou assisté aux offensives de Belgique des 21 et 22 août 1914, avant de subir la retraite. À Lemé, le 29 août, pendant la bataille de Guise, il est blessé et évacué. Il rejoint son régiment le 20 octobre, pas sur le Rhin comme il l’espérait mais dans le dispositif de défense d’Arras. Il va y vivre la guerre de tranchée qui « pourrit les hommes » pendant de longs mois, jusqu’à la fatidique offensive du 9 mai 1915. À l’est de Roclincourt, dans le secteur de la ferme de Chantecler, il tombait et disparaissait à la tête de sa 11e compagnie. Son corps ne fut pas retrouvé, malgré les interrogations de sa famille pendant la guerre et les recherches de son beau-frère, le lieutenant Jean-Baptiste Belleil, après la guerre. Il est considéré comme disparu et ses restes reposent probablement dans une fosse commune de la nécropole de N.D. de Lorette ou d’un des nombreux cimetières militaires de cette région d’Artois. Et pourtant, ce corps fut identifié par des Allemands dans les lignes desquels il était tombé, et ses papiers furent conservés par eux. En effet, après la guerre, son carnet de guerre fut restitué à la famille dans des conditions assez étonnantes que nous narre Pierre Belleil, son neveu, dépositaire et gardien des archives de Charles Mahé.
Le témoignage.
Dans le petit ouvrage a été repris intégralement le carnet du capitaine Mahé. Celui-ci le remplissait chaque jour, d’une écriture fine et nerveuse. Le 8 mai 1915, le crayon à papier trace quelques dernières lignes plus grossières, ponctuées par un point d’interrogation et 4 points d’exclamation. Inquiétude sûrement, prémonition, nous ne le savons.
Outre la relation journalière de la guerre, rédigée de manière souvent télégraphique, sans souci de style ou de forme, on y trouve l’énumération des cadres et des hommes de sa compagnie, section par section, et même, au début de la guerre, escouade par escouade (avec même la profession » utile » et le sort de certains de ces soldats). Il lui servait aussi de manuel d’allemand avec une transcription de mots, de phrases et de règles grammaticales. Quelques relevés comptables et même de petits essais rimés ( » Ainsi que des petits canetons/ Sans répit nous barbotons/ Depuis 12 à 15 semaines/ Plus souvent couchés que debout, dans la boue… »).
Nous avons placé en encadré, entre les chroniques quotidiennes du carnet, des lettres envoyées à la famille et conservées par celle-ci. Nous voyons ainsi le décalage entre la lettre, où il ne faut pas tout décrire pour ne pas inquiéter … ou être censuré, et le carnet, confident discret de toutes les heures, sombres ou plus gaies, et de toutes les rancoeurs ou critiques.
À la fin du carnet, ont été ajoutés divers documents : l’échange de correspondances entre la famille inquiète sur le sort du capitaine et sa hiérarchie régimentaire, l’émouvant petit » testament « , griffonné à la fin du carnet et qui a sans doute permis de retrouver la famille, les états de service de Charles Mahé, une relation historique du combat du 48e RI à Chantecler où le capitaine Mahé est cité.
René Richard
Escande, Mathieu (1877-1929)
Né à Escoussens (Tarn) le 10 avril 1877, il est issu d’une dynastie de charpentiers-apiculteurs. Surnommé Albigeois l’Ami du Trait, Mathieu fait son tour de France de compagnon, puis le service militaire comme télégraphiste à El Goléa (dans l’édition, les lettres du Sahara précèdent le journal de 14-18). Il se marie en 1906 et il a un fils et une fille avant la guerre. Son petit-fils a édité son journal à partir de 7 cahiers d’écolier, texte qui comporte de fortes lacunes pour les premières années de guerre. En effet, mobilisé à Montpellier au 2e Génie, Mathieu reste à l’arrière, Angoulême et Chinon, jusqu’au printemps 1917, à travailler le bois, par exemple à fabriquer des caillebotis pour les tranchées. Au cours de cette vie monotone et sans danger, il y a peu à raconter en dehors des gaspillages et absurdités de l’armée, des cuites des camarades, de l’animosité entre soldats du Nord et du Midi, de discussions politiques au cours desquelles Mathieu s’oppose aux socialistes. Il part pour l’arrière-front en mai 1917, étonné que le paysage de Verdun, désertifié par les bombardements, lui rappelle celui du Sahara. Là aussi, il travaille le bois, réalisant des coffrages pour abris, construisant un établissement de douches (et même, exception, faisant les vendanges pour Moët et Chandon). Il appelle les bleus « les enfants » ; il critique le bourrage de crâne ; il transcrit un rêve (29-11-17) : « Cette nuit j’ai rêvé que j’étais avec le Kaiser et le Kronprinz, que ce dernier m’a assuré que la guerre serait encore longue. » En 1918, Mathieu est promu maître ouvrier. Dans l’Aisne, il décrit le repli lors de l’offensive allemande sur le Chemin des Dames. De retour dans sa région en 1919, il reprend à Labruguière son activité de charpentier dans le civil.
*Jean Escande, Le journal de Mathieu, La guerre de 14 vue par un charpentier de Labruguière, sapeur au 2e Génie, Castres, 1986, plaquette de format A4, 80 p.