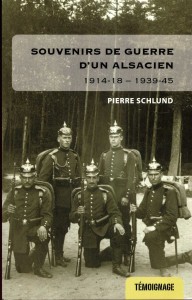Louis Molinet naît de parents alsaciens le 31 octobre 1883 à Wengelsbach, une annexe de Niedersteinbach, en Alsace du Nord. A la fin de sa scolarité, il est employé à la carrière de Pirmasens (Palatinat), puis aux aciéries de Rombas et de Hayange (Moselle), et enfin comme charbonnier. D’octobre 1905 à septembre 1907, il effectue son service militaire au 9e régiment d’infanterie rhénan à Diez-an-der-Lahn. En novembre 1909, il épouse Madeleine Spill ; le couple s’installe à Lembach. De leur union naissent quatre enfants, dont trois avant 1914. Au début de la guerre, il est mobilisé dans le 60e régiment d’infanterie de réserve et participe aux combats sur le front de Lorraine. Il passe près d’une année, entre juillet 1915 et juin 1916 dans le secteur d’Avricourt-Amenoncourt. De juillet à novembre 1916, il alterne les séjours à l’hôpital pour soins dentaires et les permissions pour travaux agricoles et forestiers. Cette période à l’arrière prend fin le 22 novembre, jour de son départ pour le front oriental (en Volhynie, Galicie et Bucovine). A la mi-mai 1917, l’ensemble de son régiment retourne sur le front ouest, à l’exception des Alsaciens-Lorrains. Transféré dans un autre régiment, Molinet est alors formé au tir de mortier, poste auquel il est désormais affecté. Il passe l’été 1917 entre le front et l’arrière. En septembre, son régiment rejoint le front balte, et il y participe notamment à la conquête des îles estoniennes. Il est décoré de la Croix de fer 2e classe le 20 novembre 1917. Suite à une hospitalisation au début de janvier 1918, il est muté dans un bataillon de réserve et demeure dès lors à l’arrière. Il obtient deux permissions d’un mois en juin (suite au décès de son frère Alfred au front), et en septembre. Le 9 novembre, il adhère au comité de soldats de son régiment. Il est ensuite démobilisé le 16 janvier 1919. De retour, il est employé comme mineur aux puits de pétrole de Pechelbronn, où il travaille jusqu’à sa retraite en 1939. Le 1er septembre 1939, comme tous les habitants de Lembach, la famille Molinet est évacuée à Droux en Haute-Vienne. A leur retour, l’Alsace est à nouveau allemande, mais cette fois sous le régime nazi. Leur maison est détruite par un obus américain en décembre 1944 et n’est reconstruite qu’en 1955 grâce aux dommages de guerre. Louis Molinet décède en septembre 1979 à l’âge de 96 ans. Tout au long de sa vie, son expérience de la Grande Guerre demeura un souvenir fort, qu’il se plaisait à raconter (selon le témoignage de son petit-fils Jean-Claude Fischer, que nous remercions pour ses nombreuses précisions).
Publié sous une forme traduite (« Le carnet de Louis Molinet. Un habitant de Lembach raconte sa guerre de 14-18 », in l’Outre-Forêt, n°109, 2000, p.21-36), ce journal de guerre est à l’origine rédigé par Louis Molinet au fur et à mesure des évènements, au crayon et en allemand, sa langue maternelle, dans un petit carnet de poche. Celui-ci contient en outre un certain nombre d’informations usuelles : des listes d’adresses (les siennes, successives, ainsi que celles d’amis, camarades ou parents), des listes de courriers ou colis reçus, les dates auxquelles il a communié, la signification des signaux lumineux, les dates et le montant versé aux emprunts de guerre, ainsi qu’une liste de mots courants français traduits et transcrits phonétiquement. L’ensemble s’apparente donc à un carnet de route recueillant les informations que l’auteur a jugé utile de conserver auprès de lui. Dans ce carnet, le récit ne commence qu’en juin 1915, sans aucune référence aux mois précédents, ce qui laisse supposer qu’un premier carnet contenant les mois d’août 1914 à juin 1915 a dû être perdu.
Louis Molinet y livre un récit chronologique très détaillé de ses mouvements, stipulant consciencieusement les dates, horaires et lieux de destination. Il s’agit souvent de l’essentiel de l’information relatée. Il ne s’attarde pas sur certaines périodes comme ses séjours à l’hôpital ou ses permissions, ni sur l’année 1918 passée essentiellement à l’arrière. Les descriptions des évènements vécus ne tiennent souvent qu’en quelques mots, jugés sans doute suffisamment évocateurs pour pouvoir lui rappeler les faits le moment venu. C’est le cas pour les moments de la vie quotidienne comme pour les combats successifs. Certaines batailles, notamment celle où il échappa de peu à la mort, et certains évènements exceptionnels sont un peu mieux renseignés, comme les tentatives de fraternisations russes en avril 1917 ou la désertion de deux soldats français le 9 mai 1916 : « vidant une grenade à main, ils y ont mis un billet signé avertissant de leur venue dans la soirée (…) ils sont arrivés comme prévu » (p.26). Quand il revient plus longuement sur des épisodes, il garde un certain détachement : il décrit ainsi, sans émotion, comme trop habitué à ce genre de spectacle, les derniers moments d’un camarade alsacien mourant, qui en plus est en parenté avec sa femme : « Jambes et entrailles arrachées, il ne mesurait plus que 80 cm, mais vivait encore (…) puis il a rendu l’âme » (p.29). Ses impressions personnelles, plutôt rares, sont aussi succinctes. Elles portent cependant autant sur les horreurs (le 8 octobre 1915 : « c’est terrible à voir (…) C’est en fait la journée la plus terrible que j’aie vécu jusque-là »), les difficultés (liées au froid et à la neige par exemple : « je n’ai jamais vu ça de ma vie », p.29), que sur les moments plus agréables (le 14 mai 1917, après un repas copieux et une séance de cinéma, représente sa « plus belle journée en Russie »). De la même manière, il nous laisse entrevoir ses préoccupations de soldat, qu’il s’agisse de sauver sa peau et de survivre aux épreuves de la guerre (la religion tient une place importante à cet égard), de la nourriture qui manque parfois cruellement, notamment sur le front oriental (« nous souffrons beaucoup de la faim », p.30), ou de l’attente impatiente du courrier et des colis de sa famille.
Contrairement à certains témoignages d’Alsaciens ou de Lorrains, le carnet de Louis Molinet ne contient aucune considération politique, ni formes de critiques à l’égard du militarisme allemand. Certes, il peut exister une forme d’autocensure, l’auteur pouvant être soucieux de ne rien écrire qui puisse se retourner contre lui dans le cas où le carnet se perde. Il ne fait par exemple aucun commentaire lorsque tout son régiment, à l’exception des Alsaciens-Lorrains, retourne sur le front occidental. Cependant, il semble qu’il ne remette pas en cause son service dans l’armée allemande et qu’il effectue sa tâche avec un certain sens du devoir. Peut-être est-ce lié à la transmission de valeurs militaires par un père qui connut le service de 6 ans et la guerre de Crimée dans l’armée de Napoléon III. En tout cas, tandis que Louis est décoré de la Croix de fer en novembre 1917, son frère Pierre est élevé au rang de caporal. Par ailleurs, Louis évoque avec déférence ses généraux (« Son Excellence le général en chef Falkenhausen », p.22 ; « son Excellence le lieutenant général Von Estorff », p.30), et quand son camarade alsacien décède au front, c’est en « donnant ainsi sa vie pour la patrie » (p.29). Loyal pour le régime impérial, il ne semble pas pour autant vouer de haine particulière à l’égard des Français. Ceux-ci sont simplement les adversaires d’en face, contre qui « nous déployons (…) nos mitrailleuses devant les barbelés et vengeons nos camarades qui viennent de tomber » (p.22). Cela ne l’empêche pas de noter plus loin : « nos fusils crachent le plomb sur ces pauvres Français (…) Les pauvres camarades Français tombent comme fauchés ». Dans cette guerre qui divise les hommes en deux camps, Molinet reste à la place qui lui est attribuée, et projette ses espoirs sur les moments préservés du danger du front : il apprécie ainsi la période de formation au tir de mortier « car là nous sommes en paix, bien tranquilles à l’arrière du front » (p.30). De même, il n’hésite pas à contrevenir au règlement quand il s’agit de rejoindre se femme lors de cantonnement à Sarrebourg (p.25).
Raphaël GEORGES, mars 2013
Lambert, Eugène (1876-1956)
1. Le témoin
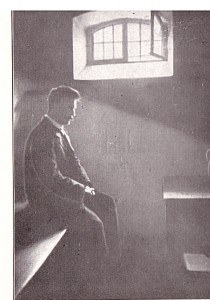 L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein
L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein
Eugène Lambert naît à Mainvilliers (Moselle) en 1876. Marié à Marie, il a trois enfants ; une fille, un fils, Rémi et Suzanne, qui naît en 1914 alors qu’il est en captivité. A la déclaration de guerre, il travaille au journal francophone le Lorrain à Metz. Francophile, secrétaire du comité du Souvenir Français de Noisseville (Moselle), il deviendra après-guerre publiciste, président du Syndicat d’initiative et à ce titre membre fondateur de la Foire d’automne de Metz, ville dans laquelle il est socialement très actif. Conseiller municipal messin, vice-président de l’Amicale des anciens incarcérés politiques d’Ehrenbreitstein, il reçoit le 12 juillet 1935 la médaille d’honneur (vermeil) de la Reconnaissance française pour ses actions de propagande francophile alors qu’il était sous l’uniforme allemand. Il décède à Metz le 7 mai 1956.
2. Le témoignage
Lambert, Eugène, De la prison à la Caserne ! Journal d’un incarcéré politique d’Ehrenbreitstein. 1914-1918. Metz, imprimerie Paul Even, 1934, 234
pages, (tirage limité à 250 exemplaires).
Eugène Lambert, se sachant recherché, est arrêté dans les bureaux du journal Le Lorrain le matin du 1er août 1914 et conduit à la prison militaire de la Place Mazelle, rue Haute Seille à Metz. Il en est extrait dès le lendemain pour être acheminé à la forteresse d’Ehrenbreitstein à Coblence, au bord du Rhin. Il reste incarcéré dans les fameuses casemates comme prisonnier politique, sans jamais connaître la raison de son arrestation. Le 24 septembre 1914, il fonde au sein de la forteresse, avec quelques détenus, « L’Union », « société des détenus politiques d’Ehrenbreitstein » (page 79).
Ayant la confiance des détenus, il est même mandaté pour tenir leurs comptes (page 83). Mobilisable dans l’armée allemande, il est transféré le 25 février 1915 de la prison à la caserne Ravensberg du 66e régiment d’infanterie allemand de Magdebourg (Saxe-Anhalt). Sous-officier, il occupe plusieurs fonctions et est muté dans un régiment territorial (à Quedlinbourg) le 15 mai 1915, suite à sa simulation d’un problème au cœur. Usant, comme beaucoup (voir page 229), de tous les subterfuges pour paraître malade, y compris en perdant anormalement du poids, sa crainte ultime est d’être muté sur le front russe dans un régiment combattant. Il sera d’ailleurs l’un des rares sous-officiers lorrains à ne pas y être affecté. A Magdebourg, affecté au 1er territorial, il est notamment affecté comme geôlier – lui qui a été détenu 7 mois en forteresse – à la garde de prisonniers belges. Surpris à leur parler français, alors qu’il leur fournit des informations, il est déplacé le 15 juin 1915 à Altenbourg (Thuringe) au 153ème régiment d’infanterie d’active. Considéré comme suspect, il y est particulièrement surveillé mais échappe à plusieurs commissions médicales qui veulent l’affecter en Russie. Il a en effet une certitude : « (…) on veut se débarrasser de moi, j’en ai la ferme conviction. Je n’arriverai jamais au front, me dis-je, ou si j’y arrive, je n’y serai pas longtemps. Sans doute, quelque gradé aura mission de me nettoyer de propre façon » (page 139).
Reclus dans son régiment, dans lequel il va rester jusqu’à l’Armistice. Il finit par obtenir enfin une permission en mai 1918 et retourne à Metz où, le
17, chez lui, il déclare paradoxalement : « Pour la première fois depuis la guerre, j’ai entendu le canon » (page 203). A Altenbourg, au fil des mois, il débute une propagande zélée de « doctrines antimilitaristes, antiprussiennes et francophiles [dans une] Saxe (…) foncièrement socialiste » (page 153) et va même jusqu’à fonder le 19 mai 1917 « l’Espérance », « journal manuscrit clandestin à l’image des compagnons d’exil. Paraissant en Barbarie ». Hebdomadaire écrit en français, et destiné à donner des nouvelles aux prisonniers des environs, il paraîtra jusqu’à la fin. Eugène Lambert vit ainsi le lent mais inexorable enfoncement de l’Allemagne dans la crise morale et alimentaire qui va amener à la situation révolutionnaire de l’automne 1918. « Singulier spectacle que ce peuple victorieux et mendiant » dit-il le 18 juillet 1915. Le 11 novembre, « cette fois, c’était bien la délivrance » (page 212) et le seul but qui maintenant le préoccupe est le retour en homme libre dans une Lorraine redevenue française. Il quitte Altenbourg le 17 novembre et, après avoir traversé une Allemagne où « l’anarchie règne en maîtresse » (page 215), Eugène Lambert arrive à Metz le 25 novembre 1918 et retrouve enfin sa famille.
3. Analyse
Deux ouvrages de volumes sensiblement égaux composent ce journal d’un « Malgré nous »[1] ; le journal d’un incarcéré et les souvenirs d’un Lorrain sous l’uniforme allemand. Francophile propagandiste, le témoignage d’Eugène Lambert est forcément partial mais nombre d’informations subsistent sur la vie en prison (pages 17 à 34), en forteresse (pages 35 à 117) comme sur l’ambiance de la caserne de l’armée allemande, la vie à l’intérieur dans le régime de blocus qui ronge le pays et qui va l’amener à la révolution (pages 137 à 214). Débutant son journal le 27 juillet 1914, il nous permet d’appréhender les heures intenses précédant la déclaration de guerre à Metz et son arrestation, le 1er août. Ces quelques pages sont ainsi à rapprocher du journal de guerre de René Mercier qui décrit des scènes semblables à Nancy[2]. Très psychologiquement touché par son incarcération, Eugène Lambert témoignage des affres de sa vie d’interné, craignant d’être fusillé pour ses activités francophiles. Il balance entre obéissance et évasion mais se soumets sous la menace des représailles à sa famille (page 9). L’ouvrage témoigne aussi des difficultés d’une écriture de la claustration tant le confinement et l’absence quasi-totale de nouvelles provenant de l’extérieur ne permettent pas l’enrichissement du témoignage. Il y parvient toutefois, nous parlant des ruses pour obtenir de l’argent par sa famille (pages 55 et 80), et pour le cacher dans des boutons de caleçon (page 80), pour tromper la censure, en écrivant « sous les timbres, dans les doublures d’enveloppes ou avec du jus d’oignon comme encre sympathique » (page 80), sachant que toute correspondance doit obligatoirement être écrite en allemand (pages 63 et 79). Il évoque aussi les mouchards (page 80), la collaboration (page 104) ou les fraternisations avec les gardes (page 97), qu’il appliquera lui-même quand il sera geôlier. Il craint la folie, notamment quand il ne peut plus sortir de sa casemate à cause de la neige : « Nous filons toutes voiles déployées vers la neurasthénie, la folie ! » (page 105) et évoque même le suicide le 27 janvier 1915 (page 106). Libéré pour être encaserné, il fait un court retour sur la sociologie des prisonniers, de tous statuts et de toutes nationalités (page 115).
Vêtu de force de l’uniforme feldgrau, arrivé à la caserne, son témoignage change d’aspect, passant de l’écriture journalière à des souvenirs reconstruits, épisodiques, vraisemblablement basés sur un carnet. Affecté à une unité de réserve (son fusil est russe), il atteste de l’impréparation du soldat allemand au combat : « J’en ai vu partir qui ne savaient pas se servir de l’arme à feu, qui n’avaient jamais tiré un coup de fusil » (page 180) et de la violence du dressage des hommes (page 152), « matériel humain »[3] (…) en voie de s’épuiser (page 177). Observateur privilégié, il assiste à la double déchéance des sociétés allemandes ; la disette de la société civile et « un esprit de lassitude et de défaitisme » (page 164) de la société militaire, dont les conditions de vie matérielles se dégradent inexorablement : « Un ordre prescrit aux soldats de livrer leurs chaussettes pour être conservées dans les dépôts jusqu’au jour où ils partiront en campagne » (page 165). D’ailleurs, Lambert témoignage à partir de 1916 d’une recrudescence des suicides militaires comme civils (pages 168, 169, 171, 178). Il est témoin de la dégradation d’un militaire suite à une automutilation (page 189). La crise économique est telle que « des permissions sont offertes aux Alsaciens-Lorrains qui promettent de rapporter de l’or » (page 179), « les tissus sont tellement rares que les uniformes militaires ne sont plus en drap, mais en une sorte de feutre pressé. Dans les magasins, on vend du linge de corps en papier, la toile et le fil ayant disparu du marché » (page 180) en janvier 1917, « on recommande dans les journaux, de chasser les corbeaux qui s’abattent par nuées sur la région » (page 182). Le pain est « une composition dans laquelle la pomme de terre, la sciure de bois et le son entrent pour une grande part » (page 183) et des troubles éclatent à Leipzig et Altenbourg suite aux pénuries alimentaires. De retour de la seule permission qu’il parvient à obtenir en mai 1918, il constate « les ravages de l’idée révolutionnaire dans les casernes » et que « des incidents très suggestifs se produisent qui révèlent l’état d’esprit de la troupe » (page 208). Ils se traduisent par les premières marques d’irrespect envers les officiers qui dès lors « n’en mènent pas large » (page 208) ; certains « ont même été frappés par les hommes à la moindre observation » (page 209). L’anarchie monte à l’été 1918, « les hommes que l’on envoie au front refusent carrément de marcher (…) arrêtent le train, détruisent les fils télégraphiques et se dispersent dans la campagne » (p.209). C’est le début de la fin qui amène à la « paix de raison (Vernunftsfrieden) »
(page 212) et les jours de novembre, vécus à Altenbourg, sont surréalistes (pages 230 à 233). Son retour à Metz et le défilé des soldats français devant
Raymond Poincaré le 28 novembre 1918 lui suggèrent ces mots en forme de conclusion : « Je défie la plume la plus experte de décrire ce que nous autres Messins avons ressenti ce jour là » (page 220).
Yann Prouillet, février 2013
[1] Terme employé par Eugène Lambert dans sa préface, écrite en juillet 1934, mais non présent dans ses écrits rédigés avant Noël 1918.
[2] Voir sa notice dans le présent dictionnaire ou sur http://www.crid1418.org/temoins/2012/03/28/mercier-rene-1867-1945/.
[3] Cette notion de « Mensch material » ne saurait ici être comparée ou rapprochée de l’application concentrationnaire de l’autre guerre.
Heek, Hermann van (1894-1980)
1. Le témoin
 Hermann van Heek photographié à Karlsruhe en mai 1915
Hermann van Heek photographié à Karlsruhe en mai 1915
Hermann van Heek nait le 7 avril 1894 à Uedem en Allemagne, dans la région de Clèves, sur la rive gauche du Rhin. Il est le huitième d’une famille paysanne de onze enfants. Plus tard, son père travaille comme aiguilleur aux chemins de fer. Ses frères deviendront artisans et ses sœurs femmes au foyer. Aidé financièrement par un riche citoyen, Hermann est le seul enfant de la famille à suivre des études universitaires. Après l’école privée d’Uedem, il fait des études au séminaire de Gaesdonck puis au lycée d’Emmerich et enfin au séminaire théologique de Münster car il se destine à devenir prêtre. Appelé sous les drapeaux en avril 1915, interrompt ses études. Après une formation d’artilleur à Karlsruhe, il est affecté au 15. Landwehr Feldartillerie Regiment d’artillerie de réserve et part début octobre 1915 sur le front français. Son fils, Karl Heinrich van Heek, qui introduit ce témoignage, nous éclaire sur la suite de son parcours après 1916. D’avril 1917 à janvier 1919, Hermann se bat en Galicie, en Crimée et dans le Caucase. Survivant à la guerre, il commence en mars 1919 de nouvelles études, d’économie, et obtient son diplôme en 1924. Quatre frères, Peter, Heinrich, Josef et Karl, sont également sous l’uniforme : les deux derniers cités ne reviendront pas de la guerre.
2. Résumé
Collectif, Un soldat allemand dans le Noyonnais. Hermann van Heek. Mon journal de guerre 1915-16. Moyenmoutier, Edhisto, 2007, 101 pages. Cet ouvrage est publié en version bilingue français-allemand.
A la suite de sa formation au 14e régiment d’artillerie à Karlsruhe, il reçoit l’ordre de rejoindre le front français le 13 octobre 1915. Ainsi débute son journal de guerre, qu’il va tenir jusqu’au 16 septembre 1916. Par Metz, la Meuse et le nord de la Marne, il rejoint l’Aisne et installe une position d’artillerie à proximité d’une creute à Ostel sur le Chemin des Dames. Mi novembre, il quitte se secteur pour celui de Noyon, installe sa pièce à Larbroye, à l’ouest de la ville et investit le débit de boissons Masson. Après des travaux de terrassements pour l’installation des officiers, il va rester à Larbroye, son château et ses environs, occupant la fonction de téléphoniste, jusqu’à la fin de son journal. Alors qu’en 1916, deux batailles sont déclenchées successivement dans la région de Verdun et dans la Somme, le Noyonnais reste un secteur relativement calme, seulement animé par quelques coups de main tel celui de la nuit du 29 au 30 avril 1916, qu’il évoque sommairement.
3. Analyse
Ce journal, publié dans le cadre d’un projet mené en histoire et en allemand par deux enseignants avec des élèves d’une classe de troisième du collège Paul Eluard de Noyon. couvre la période du 13 octobre 1915 au 16 septembre 1916, est en fait tenu sur deux carnets ; un cahier de 18×11,5 cm, terminé le 5 mars 1916, dans lequel sont listées les unités auxquelles il a appartenu. Le 6 décembre 1915, Hermann commence une autre version du journal, un carnet, d’un plus petit format, 8×13 cm, dont les entrées sont sensiblement les mêmes que dans le cahier mais plus courtes, s’apparentant à un rendu au propre de ce qui avait été écrit spontanément dans le premier cahier. Il y restitue d’abord les occupations précises d’un combattant versé dans l’artillerie et qui exerce principalement la fonction de téléphoniste. Hermann ne se contente pas de décrire ses activités militaires. Il évoque les liens qu’il établit avec les populations civiles occupées et particulièrement avec certains habitants de Larbroye. Celles-ci sont très éclairantes sur le rapport occupants/occupés et les difficultés pour vivre et s’alimenter. Le 23 novembre 1915, il dit : « Ce qu’ils mangent, vraiment je ne le sais pas. En tous les cas, ils prennent avec gratitude ce que nous leur donnons. Ils ont un triste sort, et comparés à eux, nous vivons dix fois mieux » (page 17). Cette perception peut être utilement mise en perspective avec la vision de Félix Chauvet [1] qui demeure à Passel, commune immédiatement limitrophe vers le sud. Il raconte la longueur de sa guerre, atténuée par des promenades ou encore par des parties de cartes. Il insiste aussi sur « les béquilles » qui l’aident à traverser le conflit : le soutien de la religion (on se souvient qu’il est catholique très pratiquant puisque se destinant à la prêtrise), la correspondance familiale – qui lui apprend aussi pendant son séjour dans le Noyonnais le décès d’un second frère à la guerre – et la joie de pouvoir parler le dialecte de la région de Clèves lorsqu’il rencontre des camarades du même « pays ». Au détour, de certains passages, il livre aussi ses réflexions sur la guerre.
Yann Prouillet, janvier 2013
[1] Voir son témoignage dans le présent dictionnaire in http://www.crid1418.org/temoins/2013/01/07/chauvet-felix-1860-%E2%80%93-1926/
Jacques, Antoine (1877-1973)
1. Le témoin
Antoine Jacques naît le 29 juin 1877 à Halstroff, petite commune de la Lorraine annexée à proximité de la frontière sarroise, où ses parents tiennent une auberge. Il effectue son service militaire à Cologne comme ordonnance d’un officier. Menuisier-ébéniste dans son village, il s’investit aussi dans sa paroisse en tant qu’organiste et chantre. Le 7 janvier 1907, il se marie avec Catherine Mathis. Le couple a déjà six enfants au moment de la déclaration de guerre. En août 1914, lors de la mobilisation générale, il est temporairement affecté comme garde au bureau de recrutement pendant la mobilisation des réservistes. Dès le 10 août il peut rentrer chez lui, où il reste jusqu’au 6 septembre. Il est alors affecté comme caporal dans la 5e compagnie d’un régiment du Génie (son régiment est ensuite dissout pour former le 52e bataillon du Génie, dont le nombre de compagnies est lui aussi bientôt réduit à trois au début de 1915 : il se retrouve alors dans la 3e compagnie). Elle est cantonnée au fort de Guentrange et y est employée à des travaux de consolidation ainsi qu’à l’abattage d’arbres dans la forêt de Thionville. Antoine Jacques devient ordonnance et garçon de cuisine dans les bureaux de la compagnie situés dans une villa voisine, avant de passer le mois de décembre dans un détachement chargé de la mesure du bois abattu. Après avoir fêté la nouvelle année en famille, il est employé au service de l’approvisionnement de la compagnie pour toute l’année 1915. En septembre 1915, sa compagnie déménage dans un quartier de Thionville jusqu’au 8 avril 1916, date à laquelle elle prend route en direction du front, à Etain dans la Meuse. Promu sergent, il s’occupe bientôt d’encadrer une équipe chargée d’entretenir la chaussée dans le bois de Tilly, régulièrement endommagée par des tirs d’artillerie. En mars 1917, il est rattaché au parc des Pionniers. En mai, il est décoré de la croix de fer 2e catégorie. Fin juin, sa compagnie part pour l’Argonne, à nouveau sur la zone de front, où son travail consiste à creuser des mines. Antoine Jacques échappe rapidement à cette tâche dangereuse car il est nommé sergent de cuisine le 4 juillet. Puis il obtient en octobre son transfert dans les Ardennes et intègre la 6e compagnie du 60e bataillon de Génie qui s’occupe de travaux d’abattage d’arbres. En juin 1918, on lui accorde son affectation au parc hippomobile de Thionville. A l’automne de la même année, à la faveur de la déroute de l’armée allemande, il peut enfin prendre congé définitivement de ses obligations militaires. Il rejoint sa famille dès le 13 novembre et reprend rapidement ses activités d’avant-guerre. Il est élu maire de Halstroff en 1922, un mandat renouvelé jusqu’en 1959 avec une seule interruption, au cours de la Seconde Guerre mondiale : en 1939, sa famille est évacuée dans la Vienne et ne peut revenir qu’en octobre 1940, dans une Lorraine désormais administrée par l’Allemagne nazie. Pour opposition à ce régime, il est déporté avec sa famille dans les Sudètes de janvier à août 1943, puis interdit de séjour dans sa commune jusqu’à la fin de la guerre. En 1953, il est élevé au grade de chevalier de la Légion d’Honneur.
2. Le témoignage
Antoine Jacques, Carnets de guerre d’un Lorrain 1914-1918, Colmar, Do Bentzinger, 2007, 221p.
L’édition de ces carnets est bilingue : la traduction française est présente en vis-à-vis du texte original en allemand. Il en est de même pour les cartes postales ajoutées en annexe. A l’origine, les deux carnets ont été rédigés par Antoine Jacques pendant la guerre, pas quotidiennement mais plutôt avec quelques semaines voire mois de décalage. Depuis, ils ont été conservés dans la famille ; sa petite-fille, Chantal Kontzler, est à l’origine de leur publication (elle signe un avant-propos riche en informations complémentaires). Préfacée par Jean-Noël Grandhomme, maître de conférence à l’Université de Strasbourg, l’édition comprend en outre un appareil de notes, deux poèmes (d’auteurs inconnus), des cartes permettant de situer les lieux cités dans le témoignage, un tableau d’équivalence des grades entre l’armée allemande et l’armée française, et surtout l’ensemble de la correspondance de guerre sauvegardée dans la famille de l’auteur (25 cartes postales) ainsi qu’un « album souvenir » compilant photographies familiales et dates importantes.
3. Analyse
Antoine Jacques a 37 ans au moment de la déclaration de guerre. Père de famille nombreuse, il est mobilisé dans une unité non combattante du Génie, et pourra bénéficier d’affectations le préservant en théorie des postes les plus exposés aux dangers de la guerre. Il exerce ainsi diverses activités au cours des quatre années de conflit, qu’il s’agisse de travaux forestiers (abattage d’arbres et mesure du bois), de travaux de fortification, de voirie, d’aménagement de baraquements, de creusement de mines, ou encore du service d’approvisionnement de sa compagnie. Ses conditions de vie sont donc plus favorables que celles des soldats des tranchées, et varient en fonction des lieux de cantonnement (il préfère être logé chez l’habitant que de vivre dans des baraquements moins confortables). N’étant pas directement en première ligne, il offre néanmoins une description lointaine des batailles autour de Verdun (p. 48-60), en insistant sur le grondement continu des tirs d’artillerie (p. 55), les éclairs et la fumée provoqués dans le ciel (p. 62). Il est surtout un observateur privilégié de l’occupation allemande en Meuse et dans les Ardennes, attentif aux difficultés des populations locales victimes autant des réquisitions et des pillages que des destructions (p. 104, 121-126, 130, 135). Il note également la grande misère des prisonniers de guerre russes et des prisonniers civils belges (p. 97, 102).
Sa principale préoccupation est ailleurs : il s’agit de sa famille. Antoine Jacques vit très mal la séparation imposée par la guerre. Aussi, il demande et obtient de nombreuses permissions qui lui permettent de passer du temps avec les siens aussi souvent que possible (il en est question à maintes reprises, voir p. 27, 33, 40, 45, 65, 75, 106, 114, 128 et 136). Certains de ces moments revêtent une importance particulière, qu’ils soient heureux (la naissance de son fils ou certaines fêtes religieuses) ou douloureux (assister son épouse souffrante). Les conditions de vie en Lorraine annexée, et plus particulièrement à Halstroff, le préoccupent beaucoup, si bien que l’on trouve de nombreux renseignements sur la vie du village. Les réquisitions (p. 21, 36, 48), la main d’œuvre fournie par les prisonniers russes pour les travaux agricoles (p. 35), l’état des récoltes (p. 35, 37, 117) et surtout le prix des denrées alimentaires (p. 36, 38, 46, 66, 75, 107) occupent une place conséquente dans ses carnets, notamment à chaque permission. Il se montre très tôt impatient de voir la guerre s’achever afin de pouvoir rejoindre sa famille. C’est sans doute pour cette raison qu’il suit avec attention les évènements révolutionnaires en Russie (p. 99, 101, 112, 125, 127, 129), comme beaucoup de soldats allemands qui y entrevoient un nouveau tournant dans la guerre, avec un reflux possible des troupes de l’Est à l’Ouest. Cependant, chaque espoir déçu renforce son amertume face au conflit et à ses responsables désignés : les grands officiers. Face à cette guerre qui dure et qui en plus l’éloigne progressivement de sa région natale, au gré des déplacements de sa compagnie, il entreprend de se rapprocher par ses propres moyens de la Lorraine en demandant plusieurs fois son transfert. C’est donc avec une grande satisfaction qu’il se voit affecté au parc hippomobile de Thionville en été 1918.
La religion tenant une place importante dans la vie d’Antoine Jacques, il n’est pas surprenant d’en trouver de nombreuses allusions dans ses carnets. Il prie souvent (par exemple p. 55, 63, 71), assiste à la messe dès que possible (p. 60, 64, 65, 68, 100, 106, 132) et, à l’occasion, invoque Dieu pour qu’il fasse cesser la guerre (p. 64). Empli de morale chrétienne, il s’élève autant contre le relâchement des mœurs de certain(e)s civil(e)s (p. 30, 50) que contre les profanations de lieux sacrés (p. 57, 60, 96, 131) commises par les troupes allemande. Fort de ses valeurs, et à mesure que s’éloignent les perspectives de paix, Antoine Jacques se montre de plus en plus critique à l’encontre du militarisme prussien (p. 76) et surtout de ses représentants : « ces égoïstes ambitieux qui massacrent les gens heureux par leurs desseins maléfiques » (p. 50), « ces massacres menés par quelques meurtriers présomptueux » (p. 64). Il s’élève aussi contre les injustices engendrées par la guerre, dénonçant les embusqués (p. 39) et surtout les profiteurs et les privilégiés : les officiers aux revenus très conséquents qui non seulement font porter la pression des emprunts de guerre sur les simples soldats (p. 117), mais en plus peuvent manger à leur faim en période de disette (p. 72, 94, 105), sont à nouveau visés. Plus globalement, l’Allemagne tout entière semble le décevoir, tant par la dictature militaire imposée en Alsace-Lorraine (« on ne croirait pas que nous sommes citoyens allemands », p.48), que par l’occupation dans les Ardennes (« l’Allemagne sème ici les graines d’une haine inextinguible », p. 125).
En dépit de ces critiques, pourtant, Antoine Jacques semble exécuter son devoir de soldat jusqu’au bout, sans le contester. Il est d’ailleurs élevé au grade de sergent (p. 64) et décoré de la croix de fer pour avoir mené avec courage certaines missions sous le feu de l’artillerie (p. 103). Bien intégré dans l’armée allemande, il éprouve un profond respect à l’égard de certains de ses supérieurs (p. 69), et une grande amitié pour ses camarades (p. 119). Son origine lorraine ne semble pas lui causer de tort ; au contraire, ses maigres connaissances en français lui facilitent parfois ses rapports avec la population locale (p. 120). Une seule fois dans son récit il fait référence à la suspicion d’un de ses supérieurs à son égard, qui lui reproche d’être pro-français (p. 132). Pourtant, il ne lui échappe pas que les soldats alsaciens-lorrains attisent souvent la méfiance des autorités militaires allemandes (p. 33, 59-60), ni que l’Alsace-Lorraine est au cœur des tractations de paix dès 1917 (p. 118, 128). On se trouve ainsi face à cette identité particulière des soldats alsaciens-lorrains, engagés sous uniforme allemand mais dont les liens avec la France sont à la fois omniprésents et en perpétuelle redéfinition. Dès l’été 1917, Antoine Jacques dévoile un certain pessimisme à l’idée d’une victoire allemande (« la majorité ne croit plus en une victoire allemande », p. 115). Un peu plus d’un an plus tard, fin novembre 1918, il semble accueillir avec enthousiasme les soldats français dans sa Lorraine natale : « vive les bienvenus ! » (p. 140).
GEORGES Raphaël, janvier 2013
Jolidon, Paul (1892-1984)
1. Le témoin
Paul Jolidon naît le 14 octobre 1892[1] à Jungholz, village alsacien de l’arrondissement de Guebwiller, dans une famille nombreuse dont le père est fonctionnaire des postes. Avide d’aventure, il s’engage dans la marine impériale en 1908. En 1909-1910, il effectue sa première croisière en Méditerranée sur le navire-école Hansa. En juillet 1912, il embarque à bord du paquebot Gneisenau à destination de Sydney en Australie. A son arrivée, il est affecté sur le croiseur Condor pour la durée de sa campagne du Pacifique. Il est de retour en Allemagne dans sa base d’origine à Kiel en juillet 1914, à la veille de la mobilisation générale qui le conduit à bord d’un croiseur naviguant en mer Baltique, l’Undine.
Au début de l’année 1915, il nécessite une hospitalisation à la suite de laquelle on décide de ne pas l’envoyer tout de suite en mer pour lui éviter une rechute. Il est donc nommé formateur pour les nouvelles recrues. Il trouve bientôt le moyen d’échapper à cette vie jugée trop monotone en s’engageant sur un croiseur auxiliaire, le Vienna (rebaptisé par la suite Meteor). C’est ainsi que débute son expérience de corsaire qui le mène essentiellement en mer du Nord et en mer Blanche. Elle prend fin moins d’un an plus tard le 29 février 1916 quand, lors d’une mission à bord du Rena, il est fait prisonnier avec ses autres camarades rescapés d’une bataille navale désastreuse pour l’équipage allemand. Il connaît alors la captivité dans différents camps britanniques puis des conditions de détention plus favorables en Hollande à partir d’avril 1918. En novembre 1918, les évènements révolutionnaires puis l’armistice permettent son retour à Kiel et enfin en Alsace en mars 1919[2]. Dès le mois de juillet 1919, il entre dans l’administration française des douanes en Sarre, en qualité de préposé. Il épouse l’année suivante une jeune femme de Mulhouse avec qui il aura deux enfants[3]. En 1929, après sa réussite au concours de commis des douanes, il obtient un poste à Apach en Moselle, puis à Merzig en Sarre, où il demeure au moment de la publication de son ouvrage.
2. Le témoignage
JOLIDON Paul, Un Alsacien avec les corsaires du Kaiser, Hachette, 1934, 254 pages.
L’ouvrage de Paul Jolidon appartient à cette nouvelle vague dans la production de témoignages de la Grande Guerre qui sont publiés à partir de la fin des années 1920 et qui trouvent à nouveau un public. Lors de sa publication, il semble même connaître un certain succès à l’échelle nationale, auréolé du prestige d’avoir remporté le 1er Prix du Roman du Temps pour l’année 1934. Le quotidien national, ancêtre du Monde, en fait un large écho dans ses colonnes en publiant une partie de l’ouvrage sous la forme d’un feuilleton quotidien entre le 21 décembre 1933 et le 18 janvier 1934. Dès lors, d’autres journaux s’en font les relais, et la publicité pour l’ouvrage dépasse les frontières jusqu’en Belgique par exemple, où la Revue belge offre à ses lecteurs un chapitre de l’ouvrage dans son numéro du 1er avril 1934, ou encore en Allemagne où il est traduit et publié en allemand[4]. Ainsi, contrairement à la plupart des alsatiques, c’est-à-dire des livres concernant l’Alsace, sa diffusion est nationale avant d’être régionale[5].
Bien qu’ayant été primé du « prix du Roman », il s’agit bien du récit de son expérience de guerre. Les qualités littéraires de l’auteur, parmi lesquelles une écriture limpide, en rendent la lecture aisée et bien souvent captivante quand on suit ses missions de corsaire. On peut cependant regretter le manque de repères chronologiques, surtout dans la seconde partie de l’ouvrage consacrée à sa captivité.
Quand commence son récit, en juin 1914, il est rapatrié avec 1800 autres marins allemands vers l’Europe à bord du paquebot Patricia. C’est au passage du canal de Suez qu’ils apprennent l’attentat de Sarajevo. Le navire arrive à destination après 37 jours de voyage, le 17 juillet 1914. Jolidon rejoint sa base d’origine à Kiel, mais la mobilisation générale du 1er août intervient avant qu’il ne puisse profiter de son congé pour entamer son retour en Alsace. Il est d’abord affecté à Dantzig sur l’Undine, un croiseur employé à des missions de reconnaissance des positions russes (notamment dans le golfe de Riga) ou à la surveillance de l’Øresund afin d’empêcher l’accès du détroit aux sous-marins anglais. Le navire est ensuite immobilisé quelques mois à Kiel pour subir des transformations puis reprend ses activités au début de janvier
1915. Cependant, Jolidon nécessite une hospitalisation pour soigner des fièvres récurrentes. Il passe ainsi 18 jours dans un hôpital de Kiel, au terme desquels on décide de ne pas le renvoyer tout de suite en mer, à son grand regret, mais plutôt de l’affecter au dépôt de la première division navale de Kiel afin d’y former les jeunes recrues. Résolu à retourner en mer, il se présente au bureau du personnel pour faire partie d’ «un navire marchand (…) mystérieusement armé » (p.31), du même type que les « forceurs de blocus » qui l’attirent beaucoup (p.32). Au début d’avril 1915, il parvient ainsi à être intégré à l’équipe du Vienna, un navire marchand transformé en croiseur auxiliaire. A son bord, Jolidon est chargé du canon de tribord. Fin mai, après les dernières mises au point, le navire prend le large dans la mer du Nord. Rebaptisé Meteor, il doit atteindre la mer Blanche et barrer l’accès au port d’approvisionnement russe d’Arkhangelsk en y déposant au large une barrière de mines. Sur le trajet du retour, tous les navires civils rencontrés et suspectés de ravitailler l’ennemi sont coulés. A leur retour vers la mi-juin, la mission ayant été achevée avec succès, une partie de l’équipage est décorée de la croix de fer, dont Jolidon, puis un congé leur est accordé. Il peut enfin entreprendre un retour en Alsace après quatre années d’absence. Au début du mois d’août, il participe à la nouvelle mission du Meteor qui consiste à larguer des mines au large d’une base navale britannique dans le Moray Firth (au nord-est de l’Ecosse). Accomplie avec
succès, le retour est cependant moins aisé que lors de la première expédition. En effet, ils sont très vite rattrapés par une force navale britannique nettement supérieure, ce qui décide le commandant von Knorr à évacuer l’équipage du Meteor sur un voilier intercepté en chemin puis à saborder son navire. Cela a permis d’éviter une bataille navale perdue d’avance pour les marins allemands, rentrés finalement sains et saufs. N’ayant plus de navire d’affectation, Jolidon est à nouveau employé à l’instruction des recrues jusqu’en février 1916. Il reçoit alors une nouvelle affectation en tant que sous-officier sur le croiseur auxiliaire Greif (rebaptisé ensuite Rena). Fin février, celui-ci part en mission en mer du Nord mais ne peut échapper cette fois à une bataille navale fatale contre des croiseurs auxiliaires britanniques. Le Rena finit par sombrer et seuls 117 rescapés, parmi lesquels Paul Jolidon, sont recueillis, faits prisonniers puis débarqués à Edimbourg avant d’être dirigés vers le camp de Handforth, près de Liverpool. Il transite ensuite à Altrincham puis est employé pour travailler au camp de Bramley en tant que sergent fourrier à partir de la fin de l’été 1917. Son séjour à Bramley est écourté par l’annonce du transfert de tous les prisonniers gradés en Hollande. Le départ est cependant différé à plusieurs reprises, si bien qu’avec ses pairs, Jolidon doit passer l’hiver dans un dernier camp britannique, celui de Brocton. Le 2 avril 1918, à sa grande satisfaction, il est enfin transféré à Rotterdam. C’est dans cette ville, où il jouit d’une
semi-liberté, qu’il termine la guerre sans trop se soucier des évènements militaires. A la faveur de l’agitation révolutionnaire qui gagne la ville de Rotterdam, puis de l’armistice, sa captivité prend fin de fait et il peut retourner avec ses camarades à Kiel. Il y participe à la révolution des marins qui selon lui correspond davantage à un ras le bol contre l’autorité des officiers qu’à un mouvement révolutionnaire communiste (p.244-245). Dans ce contexte troublé, n’ayant pu obtenir satisfaction de l’ensemble de leurs revendications légitimes (vêtements civils, rappel de solde,…), il décide finalement avec un autre Alsacien de prendre le chemin du retour vers une Alsace désormais française.
3. Analyse
Le témoignage de Paul Jolidon est tout d’abord l’œuvre d’un marin passionné dont la soif d’aventure et de voyage le conduit à s’engager comme volontaire dans la marine impériale avant la guerre. Revêtir la tenue de marin représente alors « la réalisation de notre rêve d’enfant » (p.105). Sa campagne dans le Pacifique est une expérience profondément marquante dont il garde longtemps un bon souvenir (empreint d’une grande nostalgie quand il se retrouve prisonnier, p.100) et à laquelle il revient ponctuellement au cours de son récit. D’ailleurs, pour lui, un des seuls intérêts que suscite sa fonction occasionnelle de formateur est de pouvoir transmettre sa passion aux nouvelles recrues et leur conter le récit captivant de ses aventures passées (p.105-108). Les descriptions qu’il nous livre des paysages (émerveillement devant des paysages littoraux, p.16), des contrées traversées et des populations rencontrées (les « indigènes » de Port-Saïd, p.7-8) agrémentent le récit de ses opérations militaires et apparentent maintes fois son témoignage de guerre à un récit de voyage. Marin passionné, il trouve dans l’engagement au sein de la marine de guerre un moyen d’échapper à l’armée de terre et à ses officiers méprisants. Il nous rend ainsi compte des rivalités pouvant exister entre ces deux composantes de l’armée (p.57, 58), et du cloisonnement existant entre les marins et les autres soldats (p.191). Entré dans la marine de guerre par passion des océans plus que des armes, il n’en demeure pas moins fier de porter cet uniforme et assiste admiratif aux grandes manœuvres des monstres d’acier qui constituent les flottes allemande (p.10) ou anglaise (p.36). Son goût de l’aventure l’empêche de se satisfaire de rester à quai comme beaucoup de ses camarades (« le service à terre ou la discipline de fer sur les vaisseaux de ligne immobilisés sont sans attrait pour moi » p.98). Ainsi, il préfère être à bord d’un croiseur que sur « un de ces grands cuirassés, condamnés à attendre on ne sait quoi » (p.68), et fait le choix de s’engager comme corsaire pour échapper à la formation des recrues. Il nous livre ainsi un témoignage inédit sur la guerre de course allemande. Les renseignements abondent sur le déroulement des missions auxquelles il participe, l’équipement des croiseurs auxiliaires ou les ruses employées pour éviter de croiser des ennemis (le secret autour des missions, le camouflage des armes, le changement de nom des navires. (Voir par exemple p.121 à 125 pour le Greif). Il témoigne également des difficultés de la vie à bord de ce type de navires, notamment des peurs ou des craintes liées en particulier au transport d’énormes quantités d’explosifs (les mines), très risqué surtout en cas d’attaque ou de tempête, suivies du soulagement général une fois le largage accompli. Les récits des batailles navales, moments forts du témoignage, en renforcent l’originalité par rapport aux publications majoritaires des combattants des tranchées. En une dizaine de pages, l’auteur revient par exemple sur les combats à l’issue fatale qui opposent le Rena à deux croiseurs auxiliaires anglais, l’Alcantara et l’Andes (p.127-138). Il y décrit l’intensité des combats, les dégâts collatéraux puis la détresse à bord quand la défaite devient certaine : « sans mot dire, quelques marins découragés se jettent à la mer » (p.134), « chacun cherche le salut comme il peut, et abandonne ce brasier sinistre » (p.135). De son côté, Jolidon quitte le navire avec un de ses hommes sur la porte des toilettes, arrive à rejoindre un peu plus loin un radeau, puis affronte l’attente angoissante de se faire recueillir (« les appels des mourants nous glacent le sang », p.141).
Le second apport de cet ouvrage est de nous renseigner sur les conditions de captivité dans les camps britanniques puis en Hollande. En effet, suite au désastre naval du Rena, les rescapés sont recueillis par leurs adversaires britanniques et conduits à Edimbourg où ils sont d’abord détenus dans un gymnase puis dans une forteresse. Les conditions de détentions y sont bonnes et les prisonniers entretiennent même des rapports amicaux avec leurs gardiens. C’est le temps des interrogatoires individuels (p.152) pendant lesquels les Anglais tentent de récolter le maximum d’informations sur la guerre de course allemande. Ils sont ensuite dirigés vers le camp de Handforth (p.157), près de Liverpool, qui compte environ 3000 prisonniers de guerre allemands, dont beaucoup sont rescapés de navires de guerre ou de sous-marins. A partir de l’été 1916, il accueille aussi des combattants de la Somme qui arrivent dans un triste état : « leurs visages, gravés par la vie terrible du front, disent mieux que des mots les souffrances qu’ils ont endurées » (p.163). Dans les dortoirs, il devient alors fréquent que certains d’entre eux se lèvent la nuit en hurlant et fuyant « devant des lance-flammes imaginaires » (p.175). Après environ une année passée à Handforth, il est transféré au camp d’Altrincham (sans doute au printemps 1917), puis dans un camp à Bramley vers la fin de l’été, et enfin un dernier à Brocton en hiver 1917. Pour chacun de ces camps, il livre une description du fonctionnement et des conditions de vie, dont les pires sont à Bramley : le camp, encore inachevé à son arrivée, est construit sur une terre argileuse collante, les dortoirs n’ont ni portes ni fenêtres et des grillages de fer avec de la paille font office de lit (p.187). Pour tous, la vie dans ces camp est très monotone, les seuls moments agréables sont les sorties dans la campagne. Outre le petit artisanat qui occupe la plupart des prisonniers, la principale distraction de Jolidon est la lecture de la presse française et anglaise. Cela lui permet de consolider ses connaissances en français, d’apprendre l’anglais, et aussi de se tenir informé de l’actualité. Il occupe par la suite les fonctions de sergent fourrier au camp de Bramley (il s’occupe du stock des vêtements et des ustensiles divers destinés aux prisonniers), puis d’aide-cuisinier à Brocton. Pour les soldats gradés qui, comme Jolidon, sont transférés à Rotterdam en avril 1918, les conditions de vie s’améliorent nettement : en semi-liberté, installés dans des maisons confortables, ils sont seulement astreints à passer la nuit dans leur maison et à se présenter à l’appel quotidien. Des cours leurs sont dispensés le matin, le reste de la journée étant libre.
Enfin, ce témoignage illustre toute l’ambiguïté du cas des Alsaciens-Lorrains pendant la Grande Guerre, partagés pour la plupart entre une expérience militaire dans les rangs de l’armée allemande et des sentiments francophiles plus ou moins prononcés. Bien que l’ouvrage soit rédigé des années après la guerre, ce qui en conditionne forcément l’écriture, on peut tout de même en dégager certains aspects. Paul Jolidon semble parfaitement intégré dans la marine allemande, dans laquelle il s’est engagé volontairement dès 1908. Il y a tissé des relations d’amitié fortes avec ses camarades, dont beaucoup se retrouvent avec lui sur l’Undine au début de la guerre, ce qui rend la séparation d’autant plus difficile quand il les quitte pour être hospitalisé au début de l’année 1915 (p.19). En bon soldat allemand passé par l’école puis par le service militaire, il cultive la mémoire de « héros » militaires allemands comme le « pionnier Klinke » (p.23)[6] ou son ancien lieutenant, le courageux Harren (p.25). Son propre courage lors de la première mission du Meteor lui vaut d’être décoré de la croix de fer puis d’être promu sous-officier. Pourtant, cette carrière exemplaire ne l’empêche pas d’entretenir des liens d’affection pour la France qui semblent assez forts et lui font écrire : « si nous faisions la guerre contre la France seule, je me ferais hospitaliser pour paludisme » (62). Il a cependant conscience de sa position ambiguë : il sait qu’il combat indirectement contre la France, mais il s’en justifie ainsi : « il faut s’être trouvé dans les foules enthousiastes de soldats, avoir été fasciné et bouleversé à la fois par leur exaltation, pour comprendre ces tourments intimes. Nous aimons la France et voudrions qu’elle ne fût pas du côté des ennemis de l’Allemagne » (62-63). Pour lui, les vrais ennemis sont les Anglais. Déjà avant la guerre, il avait remarqué le « caractère fier et un peu méprisant des marins anglais » (p.61), à l’opposé du bon souvenir qu’il garde des marins français rencontrés dans les ports du Pacifique. Par ailleurs, comme beaucoup de soldats alsaciens-lorrains, il subit les différences de traitement qui leur sont réservés. Jolidon y est surtout confronté au moment de profiter de son congé pour rentrer en Alsace. En effet, son domicile étant proche de la zone de front, les autorités allemandes établissent d’abord une « enquête de loyauté » pour s’assurer qu’il ne soit pas tenté de déserter une fois rentré (p.56). On peut cependant noter une forme de résignation face à ce que certains considèrent comme une grande injustice. En effet, par souci de loyauté et pour ne pas éveiller sur lui des soupçons de désertion, Jolidon n’osait pas demander de permission (p.22). Rester loyal sans laisser paraître ses sentiments francophiles, ni s’offusquer contre des injustices, c’est accepter son sort d’Alsacien et ne pas compromettre son avenir en cas de victoire allemande. On en trouve l’illustration lors de sa captivité, quand sa sœur lui conseille de demander d’être transféré dans un camp en France au titre d’Alsacien : il réfléchit et rejette finalement l’idée car il craint que son engagement volontaire dans la marine lui soit reproché (p.189). De plus, à ce moment il envisage encore une carrière d’officier dans la marine marchande allemande, et craint ne pas pouvoir réaliser une telle carrière en France. Pourtant, il semble bien que la captivité change son regard sur l’Empire allemand, notamment à la lecture régulière de la presse française et anglaise. Il se forge alors une opinion nouvelle de l’Allemagne et de ses dirigeants, et dresse un portrait de l’Allemand (p.177), différent des Alsaciens : « je n’ai aucun enthousiasme pour ce qu’ils appellent la patrie. (…) Ma grande patrie de marin, c’est la mer ; ma petite patrie terrestre, c’est l’Alsace » (p.178). Au final, il semble ravi du nouveau destin français de l’Alsace-Lorraine, avec la « certitude que nous avons tous conservé ou retrouvé l’amour de la France » (254).
Raphaël GEORGES, août 2012
[1] Son acte de naissance est consultable en ligne : http://www.archives.cg68.fr/Services_Actes_Civils_Affichage.aspx?idActeCivil=2975&Image=149&idCommune=157&idTypeActe=2&idRecherche=1&anneeDebut=1892&anneeFin=
[2] Information extraite d’un article lui étant consacré dans le quotidien Le Temps, en date du 20 décembre 1933 (p.8).
[3] C’est du moins sa situation familiale en décembre 1933, telle qu’elle apparaît dans l’article du Temps mentionné ci-dessus.
[4] Paul Jolidon, Mit deutschen Kaperschiffen im Weltkrieg: Erlebnisse eines elsässischen Matrosen auf deutschen Blockadebrechern, Berlin, 1934.
[5] Il remporte le 3e prix ex aequo de l’ « Alsace littéraire » en 1936.
[6] Karl Klinke, soldat prussien s’étant illustré en sacrifiant sa vie lors de la guerre des Duchés contre le Danemark en 1864.
Hitler, Adolf (1889-1945)
Les éditions Perrin viennent de publier la traduction française (par Michel Bessières) du livre de Thomas Weber, La Première Guerre d’Hitler (518 p., illust.), qui revisite le « témoignage » d’Adolf Hitler sur sa participation à la Première Guerre mondiale et le rôle fondateur qu’elle aurait eu dans l’élaboration du nazisme. Le texte de Mein Kampf a été construit en fonction des idées d’Hitler en 1923-24 et de l’utilité politique de se présenter comme combattant des tranchées, forgé par son expérience de guerre et la camaraderie du front au sein de son régiment. Cette version a été ensuite relayée par la propagande nazie, par les « témoins » choisis pour défendre la version Hitler dans des procès contre ceux qui tentaient d’apporter des informations divergentes. Après la prise du pouvoir, les nazis firent disparaître des témoignages et des témoins gênants et exagérèrent encore la légende des états de service exceptionnels et des risques affrontés par le futur Führer. Un article du Völkischer Beobachter du 14 août 1934, par exemple, consacré au « soldat de première ligne Hitler », exalte la camaraderie des tranchées qui a « engendré l’aspiration à un socialisme allemand » et affirme que « le sang et la mort sacrificielle de nos camarades sont apparus comme la preuve de la sainteté de nos convictions ». Sans aller jusqu’à ces outrances, les historiens ont accepté l’idée que l’expérience de guerre dans le régiment List avait engendré Hitler. Thomas Weber, professeur à l’université d’Aberdeen, prouve dans son livre que ce n’est ni la guerre de 14-18, ni la camaraderie au sein du régiment qui ont produit Hitler. L’auteur n’hésite pas à critiquer certains historiens du nazisme bien « établis ». Plus largement, il récuse les théories culturalistes sur la brutalisation, privilégiant toujours les explications par le concret. Ce qui le lui permet, c’est l’énorme travail de recherche documentaire accompli dans de multiples dépôts d’archives, en particulier en Bavière, mais encore aux Etats-Unis et aux Archives départementales du Nord, tandis que de nombreux fonds privés lui ont également été ouverts. Thomas Weber peut conclure (p. 428) : « Une fois assemblées, élément après élément, toutes les données subsistantes, a émergé une image nette : celle d’un homme [Hitler] tenu à distance par la grande majorité des soldats de première ligne et considéré par eux comme un « cochon de l’arrière », celle d’un personnage encore plongé dans la confusion idéologique, en 1918, au moment où la guerre s’achevait. Le régiment List figuré comme un groupe solidaire dont Hitler aurait été le héros est une œuvre de la propagande nazie et n’a aucun fondement. La Première Guerre mondiale n’a pas « fait » Hitler.[…] Le constat vaut aussi pour les hommes de son régiment. Dans leur majorité, ils n’ont pas suivi la pente d’une brutalisation et d’une radicalisation politique. De retour dans leur ville, leur village, leur hameau, ils ont renoué avec les attaches politiques et la vision du monde qui étaient les leurs avant la guerre. »
Certes, Hitler est resté dans un régiment du front d’août 1914 à novembre 1918, en tenant compte, évidemment, des périodes de permissions, de soins, de stage. Mais, lors du baptême du feu du régiment List, lorsque celui-ci connaît de lourdes pertes, Hitler sert dans une compagnie peu éprouvée. Dès le 9 novembre 1914, il devient estafette de régiment, vivant à proximité du QG, en arrière, et chargé de porter des messages aux commandants de bataillons sans avoir à se rendre en première ligne. « La réalité de la vie dans les tranchées comme la camaraderie du front lui étaient étrangères », écrit Thomas Weber. Plus tard, le régiment échappe à Verdun et Hitler lui-même aux journées les plus dures de la Somme puisque, le 5 octobre 1916, il est blessé à la cuisse par l’éclat d’un obus qui est tombé sur l’abri des estafettes : ce n’est ni une blessure au visage, ni dans un abri de première ligne. Au tournant de la guerre en 1918, il se trouve en stage du 21 août au 27 septembre, puis il est atteint par les gaz, le 14 octobre, ce qui justifie son évacuation. Mais, des témoignages et des rapports médicaux, Thomas Weber conclut à une cécité psychosomatique. Hitler avait craqué et fut soigné pour symptômes hystériques.
Le soldat de première classe Hitler (car « Gefreiter » ne peut se traduire par « caporal ») n’exerça pas le moindre commandement. Refusant toute promotion qui aurait pu le rapprocher des tranchées, il « tenait à ne pas quitter la relative sécurité que lui procurait son affectation au quartier général ». Celui-ci constituait également pour lui « une famille de substitution ». L’attribution de la croix de fer de 2e classe reflétait les relations entretenues avec les officiers du QG devant lesquels, d’après les témoins fiables, Hitler se montrait d’une déférence ostensible. Plus rare pour un soldat du rang, la croix de fer de première classe reflétait « moins son courage que sa situation particulière et la longévité de son service au quartier général du régiment ». Il est utile de remarquer que l’intervention décisive pour la lui faire obtenir fut celle d’un officier juif, ce qui laisse entendre qu’Hitler ne se répandait pas alors en propos antisémites, et qui permet de comprendre que l’auteur de Mein Kampf ne se soit pas étendu sur ce fait. La guerre finie, Hitler chercha à rester dans la « famille » du QG, mais elle se dispersa et il en découvrit une nouvelle, le Parti ouvrier allemand, auquel il adhéra le 12 septembre 1919 avant d’en changer le nom en NSDAP.
Mais que fit Hitler entre l’armistice et cette adhésion ? Ses idées étaient encore loin d’être fixées ; « sa réflexion, encore confuse, s’appuyait sur des éléments hétérogènes susceptibles de se combiner de différentes manières ». Dans ce parcours incohérent, il y eut même une proximité avec la république des Conseils de Munich, ce que le chef nazi occulta dans Mein Kampf et dont il essaya de faire disparaître toute trace. Thomas Weber remarque : « Au sein du Parti ouvrier allemand, Hitler trouva un nouveau foyer » et : « A l’évidence, la stratégie de survie la plus payante pour quiconque avait été lié à la république des Conseils consistait à s’afficher aux côtés de ses opposants les plus déterminés. »
Les archives bavaroises et les récits des témoins fiables montrent le vrai régiment de List très différent de sa représentation par Hitler et les nazis. D’abord il ne s’agit pas d’un régiment de volontaires ; ceux-ci ne furent qu’une minorité. Ensuite, le régiment était mal considéré, mal équipé, mal entraîné. Un aumônier remarquait dès décembre 1914 que « tout le monde » souhaitait la paix. Le refuge dans la religion, important au début, évolua : d’une part, on ne comprenait pas que Dieu ait voulu ces horreurs ; d’autre part on ne supportait pas que les aumôniers fassent de la propagande patriotique. En période chaude, les automutilations, les refus d’obéissance et même les désertions se multipliaient, ces dernières ayant la complicité des autres soldats. Vis à vis de l’ennemi, principalement britannique, alternaient les actes de brutalité et de générosité. Le régiment de List participa à la trêve de Noël 1914 ; il pratiqua, lorsque c’était possible, le « vivre et laisser vivre ». Si la trêve de Noël 1915 eut moins d’ampleur, ce n’est pas du fait d’une hypothétique brutalisation des combattants, d’une diabolisation de l’ennemi, c’est que les hiérarchies, des deux côtés, avaient tout fait pour l’empêcher. Avec les populations occupées, les relations étaient complexes [comme l’ont montré de nombreux témoignages, côté français]. Certes, il y eut des viols. Mais il n’est pas nécessaire de théoriser sur la volonté d’humilier les femmes ennemies : « Tel qu’il a existé, le phénomène ne reflète pas une brutalisation des conduites, spécifique à la Grande Guerre. Le viol est, hélas, un crime récurrent dans le cadre d’un conflit. » A l’intérieur du régiment bavarois, même si l’égoïsme l’emportait souvent sur la camaraderie , il n’y avait pas d’hostilité entre communautés religieuses, catholiques, protestants, juifs. Il y avait plutôt des sentiments antiprussiens qu’Hitler ne pouvait pas connaître puisqu’il ne fréquentait guère les premières lignes. Enfin, après 1918, la grande majorité des hommes du régiment d’Hitler n’eurent pas d’engagements extrémistes. Comme l’avait montré Benjamin Ziemann , ils aspiraient à la paix et à vivre tranquillement de leur travail dans leur famille. Peu d’entre eux adhérèrent au parti nazi. Non, le régiment de List n’a pas été le creuset de l’hitlérisme.
Plus largement, le livre de Thomas Weber montre que l’histoire de l’Allemagne ne la prédestinait pas à la victoire du nazisme et que la brutalité spécifique au temps de guerre n’a pas été transférée sur le plan intérieur. On ne rappellera jamais assez que le parti nazi avait moins de 3 % des voix aux élections de 1928, et que la république de Weimar a été emportée par la crise de 1929.
Rémy Cazals
Schlund, Pierre (1890–1984)
Pierre Schlund est né le 8 février 1890 à Buhl dans le Haut-Rhin, de parents, industriels alsaciens d’origine bretonne, ayant une usine à Guebwiller et farouchement francophiles. D’un milieu bourgeois – il fréquente Bartholdi, des militaires français et de grands industriels – il fait ses études primaires au collège de la ville, ainsi qu’à Metz afin de préparer un avenir destiné à « l’industrie textile et plus particulièrement à la construction de machines pour cette industrie » (page 17). Etudiant, il poursuit ses études en Angleterre mais doit avant cela accomplir son service militaire. Il choisit de se porter volontaire dans l’armée du Kayser afin de n’accomplir qu’un an, au lieu de trois, et, bachelier dispose du choix de son unité ; il intègre le 113e régiment d’infanterie badois de Fribourg et est inscrit d’office au peloton des officiers de réserve. Bon soldat, il est même gratifié du titre de tireur d’élite de sa compagnie mais, Alsacien, fiché, il ne peut dépasser le grade de sergent. Son temps effectué, il est renvoyé à la vie civile à l’automne 1912. Ayant achevé des stages dans l’industrie alsacienne, il poursuit son cursus à Bradford en Angleterre et obtient son diplôme d’ingénieur. En juillet 1914, après un voyage d’études auprès des industries linières d’Ulster, dans une Irlande du Nord elle-même en pleine tourmente, il revient en Alsace alors que les bruits de guerre se font plus précis.
Après-guerre, Pierre Schlund épouse à Aubenas Marie-Louise Gendre, le 8 septembre 1921, avec laquelle il aura cinq enfants. Il décède en mars 1984 à Morschwiller-le-Bas où il s’était retiré après une vie militaire et industrielle particulièrement bien remplie.
Schlund, Pierre, Souvenirs d’un Alsacien, 1914-18 – 1939-45, Montréal, Mille-et-une-vies, 2011, 257 pages.
Mandé par son père de ne pas rentrer en Alsace et de se constituer « prisonnier des Français » avant même la déclaration de guerre, il décide à la mobilisation de rejoindre sa caserne allemande pour y faire ce qu’il qualifie être « son devoir ». Le 28 juillet 1914, il est incorporé au 170e IR d’Offenburg et entre en guerre en Alsace, à Mulhouse. Là, le 10 août, au premier engagement avec les troupes françaises, près d’Illzach, il met son plan à exécution et déserte à la première occasion. Il se rend alors aux premiers soldats français rencontrés qui ne sont autres que ceux du 35ème R.I., le régiment commandé par son cousin, le chef d’escadrons Leyrault. Débute alors l’incroyable parcours de guerre d’un Alsacien, déserteur assumé qui va successivement au cours de la campagne occuper les fonction d’infirmier à Roanne, participer à la mise sur pied du camp d’Alsaciens-Lorrains de Saint-Rambert-sur-Loire, être interprète, intégrer le dépôt du 6e RAC puis enfin pouvoir se porter volontaire dans l’armée française, au 1er zouaves d’Alger. Il y apprend à être un soldat français mais, grâce à un piston au 2e bureau, il parvient à être affecté, au printemps 1918, à une unité spéciale appelée le « Centre d’Interrogatoire Spécial des prisonniers de guerre (C.I.S.). Par l’infiltration des groupes de prisonniers, dans les hôpitaux ou les camps au plus près du front, en uniformes allemands, que ce centre improvise, il parvient à collecter de multiples renseignements auprès des prisonniers de guerre allemands, gagnant leur confiance en se faisant passer pour un des leurs. Obtenant ainsi des renseignements de première importance, il y gagne ses galons de sous-lieutenant et une citation, et collabore ainsi de manière singulière à la victoire. L’Armistice survenu, après une courte mission d’interrogatoire des prisonniers français de retour d’Allemagne, il se voit confier une mission au Service Industriel d’Alsace, avec la mission notamment de faire rapatrier le matériel industriel volé par l’ancien occupant en France. A la fin de 1919, il quitte enfin l’uniforme et se voit confier la direction de la cuivrerie Vogt &.Cie, à Niederbruck, dans la vallée de Masevaux.
La suite de ses souvenirs rapporte cet entre-deux-guerres industriel, les affres de l’autre guerre, sous le joug nazi, dans laquelle Pierre Schlund parvient à conserver une activité manufacturière continue en pays annexé puis, après la victoire, son action prépondérante dans la reprise industrielle et l’occupation économique d’une Allemagne vaincue, divisée par les quatre grands vainqueurs.
3. Résumé et analyse
Les souvenirs de Pierre Schlund sont ceux, plus rares, d’un alsacien issu d’une famille industrielle francophile, voire française : « mon père, désireux d’annihiler chez moi l’influence allemande, ne cessa de m’inculquer la nostalgie de la patrie perdue » (pages 15-16). Il fait toutefois son service militaire allemand avec le souhait assumé de s’ « instruire au mieux dans l’art militaire avec la secrète arrière-pensée que cet acquis pourrait bien, qui sait ?, (…) servir plus tard du bon côté » (page 23). C’est le 6 août 1914, lors d’une revue par le général Deimling, qui ordonne « Chargez vos fusils ! Nous entrons en pays ennemi » qu’il confirme son dessein d’avant-guerre : « Je compris ce qu’il me restait à faire ! » (page 31). Il prend donc la décision, mûrement réfléchie malgré des risques multiples, de déserter, ce qu’il fait au premier engagement.
Le témoignage de Pierre Schlund est ainsi en cela le contre témoignage de Dominique Richert (in Cahiers d’un survivant. Un soldat dans l’Europe en guerre. 1914-1918. Strasbourg, La Nuée Bleue, 1994) qui ne parvint à ce même dessein qu’en juillet 1918, après avoir passé la quasi-totalité de sa campagne sur le front russe et ayant subi cet exil du fait d’un trop grand nombre de désertion des soldats alsaciens, dont Schlund, au début de la campagne. Hélas le témoignage de Pierre Schlund, bien que d’un parcours de guerre considérablement plus riche et diversifié que Richert, ne s’érige pas au niveau du plébéien dans l’intérêt narratif et descriptif. En effet, à plusieurs reprises, Schlund, qui regroupe ses souvenirs sur une période allant de 1896 à 1947, occulte les phases d’intérêt de son parcours de guerre par de trop nombreux et inappropriés « il serait trop long de s’étendre ici sur… » (page 70) ou telles situations « mériteraient d’être relaté[e]s » (page 90). Dès lors, son rôle en captivité à Saint-Ramber, son apprentissage d’ancien sous-officier allemand comme soldat français, ses informations sur le Service industriel de récupération économique et surtout son emploi singulier au sein d’une C.I.S. sur laquelle peu de choses ont été écrites par ailleurs ne sont pas malheureusement pas décrits au-delà de l’anecdote. Ses souvenirs sont également peu datés, nuisant ainsi à la précision du suivi du parcours du témoin.
Plusieurs éléments d’intérêt sont toutefois présents dans l’ouvrage tels : les conditions de réalisation du service militaire allemand pour un Alsacien (page 21), l’implantation et l’usage de la TSF avant-guerre (page 25), la séparation obligatoire des prisonniers allemands et alsaciens en camp (page 40) et le fait qu’ils aient été vêtus d’uniformes bleus de la police anglaise (page 48), l’affaire des graves altercations avec les prisonniers chinois à Fraisses (près de Saint-Ramber) faisant de nombreux morts dont 17 Chinois (page 49), la répartition des 12 000 prisonniers alsaciens à Saint-Ramber : la moitié « était répartie dans divers détachements dans toute la métropole et l’autre moitié servait au front et dans les colonies d’Extrême-Orient – sans oublier tous les mobilisés dans les usines de guerre » (page 51), le « Centre d’Interrogatoire Spécial des prisonniers de guerre » (C.I.S.), son étendue et ses méthodes (pages 70, 74 et 75) et le fait que les prisonniers allemands ne discutent pas près des clôtures barbelées, réputées être munies de micros (page 79).
Ecrits en 1974, ces souvenirs sont rédigés pour le lecteur (page 73) et agrémentés pour la partie deuxième guerre mondiale, du carnet de la sœur du témoin, Marie-Odile Schlund. Quelques très rares erreurs de retranscription (Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin) est confondu avec Saint-Blaise, hameau de Moyenmoutier, (Vosges), page 44) sont compensées de notes opportunes rendant la présentation de qualité. L’ouvrage est illustré de nombreuses photographies de famille d’une qualité de reproduction hélas très médiocre.
Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012
Bouillon, Eugène (1886-1966)
1. Le témoin
Eugène Bouillon naît en 1886 à Wintzenheim (en Alsace-Lorraine annexée) dans une famille qui cultive le souvenir de la France. Son père, un ancien combattant français de 1870, l’emmène par exemple assister au défilé du 14 juillet dans la ville de Belfort, restée française. De plus, Eugène passe une partie de sa scolarité en France comme interne au Collège des frères de Marie à Saint-Dié (Vosges). Il baigne donc depuis son enfance dans un milieu familial francophile et francophone.
Sa guerre commence en octobre 1915 quand il est enrôlé dans la garde impériale de Berlin. Après un séjour au camp militaire de Döberitz, il rejoint son cantonnement à Weissensee, un quartier de Berlin. Tombé malade, il passe quelque temps à l’hôpital avant que son bataillon ne se fixe finalement à Cöpenick. Le 14 juillet 1916, il part pour le front russe. Après des haltes dans les villages de Novo Vileisk (Lituanie) et Novozvenziani, il finit par débarquer à proximité du front à la station de Soly (actuelle Biélorussie). Il ne reste que trois mois sur le front russe et, au début de novembre, il est dirigé sur le front occidental dans le Nord de la France. Le 7 décembre il arrive à Hellemmes-les-Lille, puis est affecté dans la réserve au camp de Sainghin. Là, il participe à la construction d’une position de réserve à 18 km du camp. En février 1917, à son retour de permission, il est envoyé sur le front face aux Anglais à Liévin, à proximité de Lens. A nouveau porté malade, il bénéficie de quelques jours à l’infirmerie, puis rejoint un quartier de repos à Noyelles-sous-Lens avec toute sa compagnie, où ils sont astreints à de nombreux exercices. De retour au front, il occupe un temps une position d’avant-poste, avant d’avoir la chance d’être recruté comme interprète dans le village de Drocourt. En plus de cette fonction, il doit aussi s’occuper du cimetière des soldats. En avril 1917, une offensive victorieuse de l’armée anglaise oblige les Allemands à céder du terrain, ce qui conduit sa compagnie jusqu’à Courtrai en Belgique. Là, il saisit deux opportunités qui se présentent à lui : il est d’abord admis à une formation de chauffeur de camion, puis devient cuisinier du parc automobile de Roubaix (sans doute vers l’été 1917). Peu de temps avant l’armistice, il est même nommé chef cuisinier d’un casino des officiers à Bruxelles. C’est là qu’il assiste au mouvement révolutionnaire qui touche l’armée allemande au début de novembre 1918, puis qu’il partage avec les Belges la liesse populaire consécutive à l’annonce de l’armistice. Le conseil de soldats (Soldatenrat) proclame sa démobilisation et organise la retraite générale vers l’Allemagne. Une longue colonne de camions se met alors en route, de laquelle il trouve l’occasion de s’échapper, jugeant le moment opportun pour prendre congé définitivement de l’armée allemande. Il rejoint alors la ville de Liège et trouve à loger chez des hôtes très généreux qui l’hébergent durant trois semaines au cours desquelles il assiste au long défilé des troupes allemandes en retraite. Il quitte enfin Liège pour Paris avec neuf autres déserteurs alsaciens-lorrains à bord d’un train rempli de prisonniers français libérés. Après avoir transité au centre de triage du Grand Palais, les dix sont conduits au camp pour Alsaciens-Lorrains de Villeneuve-Triage. Il y est employé pendant trois semaines à charger et décharger des marchandises à la gare de Charenton, avant d’être enfin libéré et de pouvoir rentrer en Alsace. Il s’établit comme exploitant viticole à Wintzenheim et exerce à deux reprises le mandat de maire. En 1940, l’Allemagne nazie victorieuse annexe de fait le territoire de l’ancien Reichsland perdu en 1918. Notre auteur, Eugène Bouillon, tout comme une partie de la population jugée indésirable, en est expulsé et doit se réfugier avec sa famille dans le Lot .
2. Le témoignage
Eugène Bouillon, Sous les drapeaux de l’envahisseur. Mémoires de guerre d’un Alsacien ancien-combattant 1914-1918, imprimerie Messager de Colmar, 1934, 120 p.
Il semble que le témoignage, écrit après les faits, repose davantage sur des souvenirs que sur des notes prises au cours des évènements. Toutefois, celles-ci ont peut-être existé, comme nous le laissent penser les quelques dates précises qui ponctuent le récit. Malheureusement, dans l’ensemble, la chronologie des évènements manque de précision.
3. Analyse
L’intention de faire de cet ouvrage une œuvre de propagande pour servir la cause française en Alsace n’est pas dissimulée. Au contraire, Eugène Bouillon donne le ton dès le titre : « sous les drapeaux de l’envahisseur », l’envahisseur désignant l’Empire allemand qui a eu la main sur l’Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918. Puis il débute sa préface en précisant : « ces mémoires seront un témoignage de fidélité de l’Alsace à la France ». Par ailleurs, sur la carte jointe à l’exemplaire qu’il offre au sénateur du Haut-Rhin Sébastien Gegauff, on peut lire : « Cher Sénateur, veuillez accepter ce livre à titre de propagande pour la bonne cause. » Après ces avertissements, le lecteur ne s’étonnera pas de lire un récit teinté d’une francophilie très prononcée, voire d’une vision manichéenne des évènements. Le vocabulaire utilisé est évocateur : « l’envahisseur » (p.17), les « boches » (p.18, 60), les « enragés » (p.18), « nos bourreaux » (p.18), « la bête apocalyptique » (p.89) désignent tour à tour les Allemands ou l’armée allemande, même si, bien plus encore que l’ensemble des Allemands, ce sont les Prussiens et leur caractère belliqueux qui attisent la haine de l’auteur (p.23, 25, 26). En outre, le témoignage est ponctué de commentaires sur les méfaits commis par les soldats allemands dans les régions occupées, que ce soit en Lituanie (p.46, 47), dans le nord de la France (p.51, 61, 66, 67, 69) ou en Belgique (p.82). On y trouve aussi un enthousiasme à peine voilé quand il s’agit de décrire l’infériorité matérielle de l’armée allemande (p.58-59), ses défaites et ses replis (p.92, 99) qui deviennent autant d’occasions de vanter l’armée française et plus généralement la nation française (p.86-87). En tant qu’Alsacien francophile revêtu de l’uniforme feldgrau, Eugène Bouillon ne manque pas de sympathie pour les prisonniers de guerre français (p.27), ou les Polonais et les Russes subissant l’occupation allemande (p.35-36), c’est-à-dire pour toutes les personnes rencontrées qui comme lui sont hostiles aux Allemands. Il tente toujours d’entretenir de bonnes relations avec les civils, notamment dans le nord de la France (p.62) et en Belgique, où il célèbre le 14 juillet 1918 dans une maison bourgeoise de Roubaix et trinque avec ses hôtes en l’honneur d’une victoire française prochaine (p.91).
L’ouvrage est donc partial, mais non dénué d’intérêt. On y suit le parcours d’un soldat à l’expérience originale, qui porte un regard curieux sur les régions qu’il traverse. La religion tient une place importante dans sa vie et son récit est ponctué de références de nature biblique (p.62, 71, 85, 97). Dès qu’il en a l’occasion il va prier dans une église ou assister à un office (p.48, 50, 54), non seulement pour trouver un réconfort personnel mais aussi plus largement pour le Salut de la France (p.37, 41, 42, 43, 50, 78).
Surtout, ce témoignage permet de mieux comprendre l’extrême complexité du cas des soldats alsaciens-lorrains de l’armée allemande. D’un point de vue identitaire, la minorité nationale qu’ils forment est loin d’être homogène : l’éventail est large entre ceux qui considèrent défendre leur patrie dans l’armée allemande et d’autres comme Eugène Bouillon qui, à l’inverse, ont l’impression de trahir leur nation (la France) en combattant avec l’uniforme feldgrau. L’expérience combattante qui en découle est donc tout aussi variée. Dans ce témoignage à charge contre l’armée allemande, l’auteur ne manque pas de dénoncer la suspicion, voire le mépris des officiers à l’égard des soldats alsaciens-lorrains. Il semble y avoir été particulièrement sensible, autant en Allemagne (p.28) que sur les fronts russe (p.38, 44, 45) et français (p.63), allant jusqu’à prétendre l’existence d’une propagande diffusée dans l’armée allemande pour stigmatiser les Alsaciens-Lorrains (p.45). Le sentiment d’être des soldats de second rang est partagé par de nombreux compatriotes qui vivent plus ou moins bien les différences de traitement dont ils font l’objet : ces soldats se voient par exemple écartés de certaines missions ou bien retirés de la première ligne pour être affectés dans une compagnie de pionniers (p.74). Eugène Bouillon lui-même passe du front à l’arrière en tant que traducteur, chauffeur puis cuisinier d’un parc automobile. Ses conditions de vie s’en trouvent très améliorées, étant donné sa moindre exposition à la mort et le confort dont il peut jouir (notamment en matière d’alimentation et de repos). Pourtant, selon l’auteur, cette mise à l’écart pose la question du sens à donner à la mobilisation des Alsaciens-Lorrains dans cette armée : Guillaume II, le « dieu allemand » (p.61), aurait opéré un mauvais choix en décidant de les envoyer au front (p.82). Il explique, en parlant des soldats alsaciens-lorrains comme « les honnis, les parias du peuple allemand » (p.97) que ceux-ci n’avaient pas « l’élan » que pouvaient avoir la grande majorité des soldats allemands (p.120). Au contraire, en les employant, l’Empire allemand les a obligés à une « lutte fratricide » (p.120) contre leurs frères français : « le boche me met le poignard en main pour me faire tuer mes frères » et « trahir mon sang » (p.34). Ce constat le décide assez tôt à déserter. Il y songe dès son départ pour le front russe (p.34) et plus sérieusement encore à son retour sur le front français (p.55, 58). Il élabore même un plan pour s’enfuir en direction des lignes adverses tenues par les Canadiens ; il le met à exécution mais est contraint d’abandonner au dernier moment (p.59). Ce n’est qu’avec la déroute militaire et la situation révolutionnaire de novembre 1918 qu’il peut enfin concrétiser ce vœu.
Au final, la rédaction puis la publication d’un tel témoignage semble avoir pour but d’offrir à la France une preuve de patriotisme, ce qui peut ressembler à une tentative pour se justifier d’un passé militaire dans l’armée allemande vécu comme un complexe lourd à assumer depuis la réintégration de l’Alsace-Lorraine à la France.
Raphaël Georges
Lechner, Jean (1893-1955)
1. Le témoin
Jean Lechner naît à Strasbourg le 14 juin 1893, d’un père alsacien et d’une mère allemande originaire de Düsseldorf. Cet exemple d’union mixte n’est pas inhabituel à cette époque en Alsace-Lorraine, surtout dans les grandes villes du Reichsland qui ont accueilli le plus grand nombre de migrants allemands au cours de l’Annexion. Né allemand, il poursuit sa scolarité jusqu’à l’obtention de l’Abitur, équivalent du Baccalauréat. Contrairement à la plupart des jeunes de son âge, il parle couramment français. Dès août 1914, à l’âge de 21 ans, il est mobilisé dans un régiment d’artillerie de l’armée allemande. Durant ses premiers mois de formation d’artilleur, il tire tous les bénéfices de sa bonne condition physique liée à une pratique régulière de la natation avant la guerre. Il rejoint le front de Champagne en février 1915 et y demeure jusqu’en avril, avant d’être transféré vers le front oriental en Pologne. En août, il est affecté aux équipes de téléphonistes. A sa grande satisfaction, sa campagne russe prend fin en septembre de la même année, quand il est redirigé vers la Champagne. Après avoir connu des combats très meurtriers dont il sort indemne, il est promu caporal le 20 octobre 1915. Un mois plus tard, il change de secteur pour celui de Verdun où il participe au début de la grande bataille en février 1916, avant d’obtenir sa première permission à Strasbourg le 1er avril. Là, il est affecté auprès d’une batterie de réserve à Schiltigheim afin de former les jeunes recrues. Il est par ailleurs cité à l’ordre de l’armée et décoré de la croix de fer 2e classe. Il repart au front à Verdun le 24 juin 1916. Ensuite, les permissions dans sa famille sont plus fréquentes et il connaît des promotions successives : le 1er janvier 1917 il est promu maréchal des logis, puis le 3 juillet lieutenant de réserve. Parallèlement, il intègre une formation d’officier d’artillerie qui lui permet de quitter le front régulièrement pour des périodes variables. A chaque fois, ces périodes sont accueillies avec beaucoup de soulagement, comme autant de jours de répit loin du front (p.115). Après une dernière formation sur la logique de guerre entre le 25 juillet et le 8 septembre 1918, il rejoint le front dans les Ardennes. Bien que la guerre ne laisse plus aucun espoir de victoire du côté allemand, cet Alsacien est encore décoré de la croix de fer 1ère classe le 5 novembre. Malgré quelques difficultés rencontrées au passage du Rhin avec les troupes françaises, il peut enfin retrouver sa famille au début du mois de décembre 1918. Réintégré dans la nationalité française, il se marie en 1922 puis s’installe avec sa femme à Colmar, où il obtient un poste de fonctionnaire à la préfecture. Son passé militaire sous l’uniforme allemand le rattrape en 1940 quand l’Alsace est annexée de fait par l’Allemagne nazie. Les nouvelles autorités en place tentent alors de se rallier cet ancien officier de l’armée impériale, mais en vain car malgré les pressions et les menaces d’expulsion, celui-ci demeure hostile au IIIe Reich. Redevenu français en 1945, il s’éteint 10 ans plus tard, en décembre 1955.
2. Le témoignage
« Journal de la guerre 14/18 du soldat Jean Lechner », in Catherine Lechner, Alsace-Lorraine. Histoires d’une tragédie oubliée, Séguier, Paris, 2004, p.13-176.
Jean Lechner a rédigé son journal de guerre en allemand et semble avoir mis un point d’honneur à le tenir le plus régulièrement possible, depuis sa mobilisation jusqu’à son retour des armées. Ce n’est cependant pas la forme originale de ce journal qui a été éditée ici, mais la version traduite en français par les propres soins de son auteur. En effet, une fois la guerre terminée Jean Lechner entreprend de traduire son journal. Cela lui semble être un « bon exercice » linguistique au moment où le français redevient la langue officielle dans sa région natale (p.167). Il décide ensuite de brûler le journal original en allemand, comme pour effacer un peu d’un passé devenu controversé dans le contexte d’effervescence tricolore qui suit la réintégration de l’Alsace-Lorraine à la France. Cela rend donc impossible toute confrontation entre la source originale et sa traduction. Catherine Lechner, qui est à l’origine de sa publication, n’y a apporté aucune modification.
3. Analyse
Le premier intérêt d’un journal de guerre est d’offrir à l’historien une multitude de détails sur la vie quotidienne des soldats. Outre les qualités littéraires de Jean Lechner, la longueur de son service (52 mois) et la variété des théâtres d’opération sur lesquels il a été engagé font de son témoignage un outil remarquable pour appréhender les difficiles conditions de vie au front. Le froid (p.133), la boue (p.33, 39), les poux et plus généralement la mauvaise hygiène (p.34, 39, 52) sont des thèmes omniprésents, tout comme les préoccupations quotidiennes du soldat en dehors des combats : la faim, la soif et l’alimentation (voir notamment p.54, 102) occupent une place importante, de même que l’épuisement, la fatigue (p.85, 102), l’attente du courrier et la joie lors de son arrivée (p.45, 58, 78), ou encore la participation aux offices religieux (p.39, 110, 113, 127, 131, 139).
Ce témoignage permet également de suivre le parcours d’un soldat qui commence comme artilleur et finit la guerre comme officier. Les spécificités de la condition d’artilleur apparaissent au fil des pages, avec les changements réguliers de position, les longues marches, les travaux pour l’installation et le camouflage des pièces d’artillerie, puis les bombardements (l’auteur s’applique souvent à noter le nombre d’obus tirés), le bruit assourdissant qui occasionne des maux de tête, des vertiges, ou des saignements du nez et des oreilles (p.40). Pour Jean Lechner, à force de répéter sans cesse les mêmes gestes, la « guerre devient un métier » (p.63). Bien que moins soumis aux assauts de l’infanterie ennemie, l’artilleur craint des bombardements souvent meurtriers. Par ailleurs, Lechner est parfois désigné pour faire le guet en première ligne, ce qui constitue pour lui des moments où « la tension est à son comble » (p.57). Il connaît également l’épreuve du feu en première ligne en tant que téléphoniste, une fonction qui nécessite d’assurer les réparations des lignes lors des assauts. Cependant, malgré les risques encourus, il effectue son travail consciencieusement. Cela lui vaut de monter en grade et d’obtenir ainsi de meilleures conditions de vie, avec des heures de repos régulières, le confort d’un lit, une meilleure nourriture, une meilleure solde, et plus de temps libre qu’il peut mettre à profit pour ses loisirs (promenades à cheval, natation, théâtre, concerts ou casino).
Le style assez personnel d’un journal de guerre permet de pouvoir suivre l’évolution du moral de son auteur. Ici, le « cafard » et l’angoisse de la mort sont deux sentiments qui reviennent sans cesse. Dès août 1914, Jean Lechner fait part de ses réticences face à la guerre : « nous sommes jeunes et ne demandons qu’à vivre, à faire du sport, à poursuivre nos études et fonder une famille » (p.24). Puis, à partir de son baptême du feu en février 1915, il transcrit régulièrement et sans pudeur dans son journal la peur qui l’agite (p.34). Cette angoisse de la mort est très étroitement liée à sa profonde envie de vivre et/ou survivre à cette épreuve (« je ne veux pas mourir » est une formule qui revient souvent). Tandis qu’à certains moments il veut croire à la bonne étoile qui l’a maintenu en vie quand ses camarades tombaient à ses côtés (p.74, 79), à d’autres sa désillusion est si grande qu’il se résigne à attendre une mort qui lui semble aussi certaine que prochaine (« J’ai un fort pressentiment. Cette fois je ne reviendrai pas », p.69. Voir aussi p.87-88). Ainsi, après la mort de ses plus proches camarades en septembre 1915, il n’attache plus aucune importance à sa vie et se porte volontaire pour des missions hautement dangereuses, qu’il s’agisse de faire le guet dans des postes d’observation pris pour cible par l’ennemi, ou bien d’aller réparer des lignes téléphoniques sous le feu de la mitraille. Il en sort pourtant à chaque fois indemne, et ses actes désespérés sont perçus par sa hiérarchie comme autant de preuves de courage et de bravoure qui lui valent une promotion au grade de caporal (p.89). Cependant, même avec les améliorations successives de sa condition, son fatalisme reprend régulièrement, notamment à partir de son arrivée à Verdun (« je vais mourir (…) je ne reviendrai jamais de là », p.99). De la même manière, le cafard ne le quitte jamais longtemps et, même en permission auprès des siens, il a du mal à retrouver le calme intérieur auquel il aspire (p.58, 106, 150). Une forte lassitude se développe chez lui au cours de l’année 1918 devant une guerre qui ne se termine pas, accompagnée d’une amertume profonde envers les décideurs (« je hais ceux qui ont fait cette guerre » p.149, à nouveau p.162).
Enfin, l’intérêt principal de ce journal est de nous offrir un bon exemple de la complexité du cas des Alsaciens-Lorrains au cours de la Grande Guerre. Même s’il ne porte pas un grand intérêt aux affaires politiques de sa région natale, Jean Lechner semble être de tendance autonomiste, dans une famille dont le père et le frère sont francophiles et la mère allemande de naissance. Aussi, il est très vite confronté à un questionnement identitaire et s’interroge souvent sur le sens à donner à cette guerre. A la veille de son départ au front, il note : « Je n’ai pas de haine pour l’ennemi. Qui est l’ennemi, au juste ? Les Français aux côtés desquels certains de mes amis sont allés se battre ou les Allemands, les fils du pays de ma mère ? » (p.31). Cependant, les combats meurtriers auxquels il participe l’éloignent temporairement de ces réflexions, et il semble alors exercer son « travail » de soldat sérieusement et loyalement, sans jamais penser à déserter pour rejoindre les lignes françaises, ni hésiter à les combattre. Le 25 mars 1915, sur le front français, il écrit : « nous prenons des centaines d’obus sur la tête, j’en ferai prendre autant à mes ennemis (…) il faut tuer pour vivre » (p.41). Arriver à finir la guerre en vie et sans mutilation le préoccupe davantage que l’avenir politique de l’Alsace-Lorraine, qui fait pourtant l’objet de grands débats à l’arrière (p.107-108, et p.125 : « nous, Alsaciens, sommes les soldats oubliés de cette guerre (…) si plus tard je devais rester allemand ou devenir français, que m’importe »). Pourtant, les victoires alliées de l’été 1918 réactivent les questions d’identités et de sentiment d’appartenance : « beaucoup d’Alsaciens voudraient redevenir Français. Je le voudrais bien aussi » (p.159). Grâce à l’Armistice et à la démobilisation rapide de l’armée allemande, Jean Lechner arrive en gare de Kehl (première ville à l’est de Strasbourg, de l’autre côté du Rhin) le 4 décembre 1918. Impatient de retrouver les siens, il se heurte cependant aux contrôles des troupes françaises stationnées à la frontière. Ce n’est qu’après de longues heures d’interrogatoire qu’il peut enfin retrouver ses proches. Comme beaucoup d’Alsaciens-Lorrains rentrés de l’armée allemande défaite, il vit mal la méfiance dont il fait l’objet à son retour dans la région natale, autant celle des nouvelles autorités françaises en place que celle d’une population devenue hostile à tout ce qui rappelle l’Allemagne (« nous rentrons chez nous où notre population maudit les soldats allemands » p.166). Son malaise se poursuit les journées suivantes, quand toute la ville est plongée dans une euphorie tricolore à laquelle il se sent étranger : « je me sens très fatigué devant cette effervescence, ce déploiement d’enthousiasme. (…) Les cafés sont bondés de gens qui crient leur haine de l’Allemagne. Je ne crois pas qu’aucun soldat alsacien revenant du front puisse s’exclamer de la sorte. Nous sommes avant tout heureux d’être vivants. Des voisins à mes parents s’interrogent sur mon indifférence devant la victoire des Français et me soupçonnent presque d’être germanophile » (p.167). Trouver une place dans la nation du vainqueur après avoir combattu dans les rangs du vaincu : ce passage exprime très bien la difficulté que ces soldats rencontrent à partir de leur retour pour se réintégrer dans une société alsacienne-lorraine qui a radicalement changé depuis leur départ.
Raphaël GEORGES, août 2011.
Jünger, Ernst (1895-1998)
1. Le témoin
Enfance et jeunesse :
Ernst Jünger est né le 29 mars 1895 à Heidelberg. Son père, chimiste dans un laboratoire d’analyse est aussi expert auprès du tribunal de Hanovre avant de devenir pharmacien. À l’école, le jeune Ernst se montre inattentif, rétif à la discipline mais se révèle aussi grand amateur de lectures, féru des œuvres de Conan Doyle, de Hackländer, des romans d’aventures de Karl May ; il lit les grands classiques comme Robinson Crusoë de Defoe, Don Quichotte, Don Juan de Byron, Roland furieux de l’Arioste, Le Comte de Monte Cristo de Dumas.
À l’occasion d’un échange scolaire, durant l’été 1909, un séjour en France près de Saint-Quentin lui permet de perfectionner son français. Jünger tient déjà un journal. En 1911, il s’inscrit au Wandervogel, mouvement de jeunesse proche du scoutisme mais mixte et non confessionnel. En 1913, Ernst Jünger, fortement impressionné par la lecture des récits de l’explorateur Henri Morton Stanley commence à rêver d’aventures en Afrique au point de s’enrôler dans la Légion étrangère française au bureau de recrutement de Verdun avec l’intention de déserter pour pouvoir pénétrer au cœur de l’Afrique. Incorporé le 3 novembre, il subit une courte période d’instruction à Sidi-Bel-Abbès, puis déserte. Il est repris. Pendant cet épisode, son père effectue des démarches pour le récupérer, arguant de son jeune âge. L’armée libère alors Ernst qui intègre la classe de première au lycée de Hanovre. Suite au décret de mobilisation du 1er août 1914, il s’engage à Hanovre au 73e Régiment de fusiliers (régiment de Gibraltar). Le 21 août, il passe en urgence une session exceptionnelle du baccalauréat et croyant en une guerre courte, s’inscrit à l’Université de Heidelberg. Le 6 octobre, il rejoint son régiment et subit trois mois de formation. Lorsqu’il rejoint le front de Champagne, on est déjà le 27 décembre. Il n’a donc pas connu la guerre de mouvement du début de la guerre. Il est blessé une première fois aux Éparges, le 25 avril 1915, presque en même temps que Maurice Genevoix, son vis-à-vis.
Pendant l’été 1915, il suit une formation d’élève-officier à Döberitz dans le Brandebourg. En septembre, il retrouve la guerre de position à Monchy (tranchées) et Douchy (repos) en tant qu’aspirant. Il est lieutenant le 27 novembre 1915. En avril 1916, E. Jünger suit un nouveau stage de formation à Croisilles ; après des heurts avec un colonel, il demande sa mutation dans l’aviation qui lui est refusée. Blessé une deuxième fois en août, il est soigné puis rejoint son régiment dans le secteur de Saint-Vaast. Le 12 novembre, troisième blessure. Le 16 décembre, il reçoit la Croix de fer de 1ère classe. Le 18 décembre, il commande la 2e compagnie de son régiment.
À partir du 17 janvier 1917, E. Jünger subit quatre nouvelles semaines d’instruction au camp de Sissonne, près de Laon. Il s’oppose alors à son père qui se montre soucieux de le voir trouver un poste moins exposé. On retrouve ici l’expression des stratégies de protection familiale. En mars 1917 : il prend part à la retraite de la Somme. Avril, combats dans le secteur de Fresnoy ; juin : combats d’escarmouches contre des troupes hindoues ; juillet, combats autour de Languemarck ; à cette occasion, il sauve la vie de son frère grièvement blessé. Une nouvelle demande d’être versé dans l’aviation lui est refusée, ce que ne mentionne pas son journal publié. Août, secteur de Regniéville ; 17 octobre, Flandres ; 15 novembre, double bataille de Cambrai contre les troupes britanniques. Le 9 décembre, il est blessé à la tête ; il obtient une permission pour Noël et il est fait chevalier de l’Ordre de la Maison de Hohenzollern.
Les trois premiers mois de 1918 sont consacrés à la préparation de la grande offensive. Le 19 mars, sa compagnie est presque entièrement anéantie par un obus. Ernst Jünger sort profondément traumatisé par cette expérience, ce dont il témoignera particulièrement dans Orages d’acier et Feu et sang. Le 21 mars commence la grande offensive pendant laquelle Ernst reçoit deux nouvelles blessures qui lui valent un séjour dans les hôpitaux militaires d’Allemagne. De retour sur le front le 4 juin dans le secteur de Vraucourt, il participe aux ultimes tentatives menées pour contenir les poussées anglaises. Des combats acharnés se déroulent notamment autour du Boqueteau 125 (qui donnera le titre d’un de ses livres de guerre), près de Bapaume. Le 25 août, une blessure sérieuse au poumon reçue près de Cambrai met un terme à la guerre d’Ernst Jünger.
L’après-guerre :
Le 22 septembre 1918, il reçoit la plus haute distinction militaire de l’armée allemande : « l’Ordre pour le mérite ». Au terme de sa convalescence, il intègre au printemps 1919 la nouvelle Reichswehr au 16e RI, sous les ordres du capitaine Oskar Hindenburg. En mars 1920, il se trouve engagé dans la répression du putsch de Kapp. Compte tenu de son expérience en tant que chef de groupe de choc, il est alors chargé au ministère de la guerre à Berlin de rédiger le nouveau règlement de l’infanterie ; ce dernier est publié en 1922.
En septembre 1923, bien que n’appartenant pas au N.S.D.A.P., il publie un article dans la revue du parti nazi Révolution et idée. En septembre, E. Jünger accepte d’être responsable pour la Saxe des Corps francs de Gerhard Rossbach mais trouvant ses camarades bien peu révolutionnaires, il en démissionne dès le mois suivant.
En 1924, il entame des études de zoologie à Leipzig. En 1925, il se marie, et, adhère au Stalhelm, association paramilitaire d’anciens combattants refusant l’humiliation du traité de Versailles. Jünger est alors considéré comme un journaliste politique actif de la droite allemande radicale qui se proclame révolutionnaire. Il rejoint un groupe de jeunes extrémistes hostiles à la République de Weimar dans lequel figurent entre autres, son frère Friedrich Georg, et l’écrivain Werner Beumellung. Son ouvrage Feu et sang est publié aux éditions du Stalhelm.
À partir de 1927, tout en éprouvant une certaine sympathie à l’égard du mouvement d’Hitler, il tient néanmoins à s’en démarquer et repousse les avances de Goebbels. En avril il collabore à la revue d’Ernst Niekisch, Widerstand. Zeitschrift für sozialistisches und national-revolutionäre Politik (Résistance. Revue pour une politique socialiste et nationale-révolutionnaire). Cette revue s’oppose alors à la République de Weimar comme elle s’opposera ensuite à la politique d’Hitler, même après son accession au pouvoir. Le 1er juillet 1927, il repousse une offre de devenir député national-socialiste.
Erich Maria Remarque fait l’éloge d’Orages d’acier et du Boqueteau 125 dans l’hebdomadaire Sport im Bild du 18 juin 1928. Jünger publie l’année suivante sa première œuvre prenant une distance avec l’expérience de la Première Guerre mondiale : Cœur aventureux. Notes prises de jour et de nuit.
Bien qu’invité, il ne se rend pas au Congrès du parti nazi qui se tient à Nüremberg en août 1929. Le 1er septembre, il soutient l’action terroriste du mouvement paysan du Schleswig-Holstein condamnée par les Nazis ; Jünger critique alors le légalisme de ces derniers et « leur nature foncièrement bourgeoise ». Le 27 octobre, Jünger est violemment attaqué par Goebbels dans le journal du parti nazi, Der Angriff (l’Attaque). Fin 1929-début 1930, il fait la rencontre de Carl Schmidt ; puis publie deux ouvrages assortis de près de 300 photographies, Le Visage de la guerre mondiale. 1. Expériences vécues sur le front par les soldats allemands. 2. La parole est à l’ennemi. Expériences vécues à la guerre par nos adversaires (voir l’étude de Nicolàs Sanchez Durà, Ernst Jünger, técnica y fotografia, Univ. De Valence, 2000.)
En 1933, son domicile est perquisitionné par la police ; il refuse de siéger au Reichstag en tant que député national-socialiste, et le 16 novembre, d’entrer à l’Académie de poésie.
2. Le témoignage
Composée après-guerre, à partir des notes consignées dans un carnet tenu pendant la guerre, Orages d’acier est un témoignage et une œuvre littéraire peu ordinaire en ce qu’elle vit, évolue, se façonne et se refaçonne pendant 60 années, au gré des rééditions successives, au prix d’un travail de réécriture permanent. Bien qu’écrit après la guerre, le récit proprement dit intègre des notes consignées dans le carnet de guerre (ex. p. 45-46), ainsi que d’autres documents (lettres, témoignages de camarades, ex. p. 96 ; de son frère Fritz p. 157).
La première édition d’Orages d’acier sort en octobre 1920 à compte d’auteur. Puis, en 1922 paraît une édition légèrement revue, chez l’éditeur Mittler & Sohn à Berlin, en même temps que Le Combat comme expérience intérieure composé l’année précédente. En 1924 paraît une troisième version d’Orages d’acier dotée d’une coloration plus nationaliste (extrait de la préface de 1924 : « […] Nous ne sommes pas d’humeur à rayer cette guerre de notre mémoire, nous en sommes fiers. Nous sommes indissolublement liés par le sang et le souvenir. Et une nouvelle jeunesse plus hardie vient déjà combler nos vides. Nous avons besoin, pour les temps à venir, d’une génération de fer, dépourvue de scrupules. Nous échangerons de nouveau la plume pour l’épée, l’encre pour le sang, la parole pour l’action, la sensiblerie pour le sacrifice – nous devons absolument le faire, sinon d’autres nous piétineront dans la boue. […] Puisse nous guider au-dessus de toutes les bassesses notre grande idée claire et communautaire ; la patrie, conçue au sens le plus large. Pour elle, nous sommes tous prêts à mourir… », p. 274). La même année paraît le Boqueteau 125 (octobre). En 1934 paraît une quatrième version d’Orages d’acier expurgée des passages ultranationalistes susceptibles d’être exploités par les nazis. L’année suivante paraît une cinquième version accentuant l’orientation de 1934. Au total, ce sont sept versions d’Orages d’acier que Jünger aura publiées (4 du Boqueteau 125 et 5 de Feu et sang).
La première traduction française d’Orages d’acier paraît en 1930, réalisée et présentée par le lieutenant-colonel Grenier ; cette traduction est conforme à la troisième version du texte, celle de 1924, non expurgée.
Une remarquable dernière édition française d’Orages d’acier vient d’être publiée sous l’égide de Julien Hervier dans la collection de la Pléiade (Gallimard), dans la traduction d’Henri Plard publiée en 1970 (chez Christian Bourgeois Éditeur, à partir de l’édition allemande de 1961 publiée chez Ernst Klett Verlag de Stuttgart), traduction revue par Julien Hervier pour Gallimard, en 2008. Toutes les informations d’ordre biographique ci-dessus sont empruntées à la présentation fort bien renseignée de Julien Hervier : Jünger, Journaux de guerre, 1914-1918. Une introduction situe historiquement l’action pour chacun des chapitres. Ce dispositif est complété par les différentes préfaces ayant accompagné les éditions de 1920, 1922, 1924, 1934 ; préfaces aux traductions anglaise de 1929 et française de 1960. Notons encore que dans ce volume, Orages d’acier est suivi des trois autres journaux de guerre : Le Boqueteau 125, Feu et sang, La Déclaration de guerre de 1914 ainsi que d’autres récits sur la Première Guerre mondiale : Le combat comme expérience intérieure, Sturm.
3. Analyse.
L’œuvre de Jünger constitue une véritable mine de renseignements à plus d’un égard : concernant le fonctionnement des petits groupes de soldats ; les mécanismes de cohésion, le conformisme aux normes et aux valeurs du groupe, le rôle et les postures des chefs d’unités, le combat rapproché ; les relations avec les civils en zone occupée ; le rapport aux corps et aux cadavres…
Motivations du départ : D’après Jünger, son propre départ, et le départ de nombreux jeunes allemands, furent avant tout motivés par une soif d’aventures, de prise de risque, l’idée de ne pas rater un événement exceptionnel : la guerre… : « […] Ah, surtout, ne pas rester chez soi, être admis à cette communion ! » (p. 3 : N.B. toutes les pages indiquées dans cette notice sont celles de l’édition en Pléiade). En même temps, la guerre est perçue comme une épreuve de virilité. Mais à peine arrivées sur le front, les jeunes recrues enthousiastes sont vite dégrisées : premiers obus, premiers blessés… (p. 4-5) ; les anciens assaillent les nouveaux de questions et essaient d’obtenir des informations du pays : « On nous demanda ce qui se passait à Hanovre, et si la guerre n’allait pas bientôt finir » (p. 6) ; Jünger note également que les nouveaux, qui sont en outre des engagés volontaires, ne sont pas très bien accueillis par leurs camarades plus anciens et simples mobilisés : « Les anciens ne laissaient passer aucune occasion de nous ?mettre en boîte? de la belle manière, et tous les empoisonnements, toutes les corvées imprévues tombaient tout naturellement sur les ?enragés volontaires?. Cet usage […] disparut d’ailleurs après qu’une première bataille subie en commun nous eut donné le droit de nous considérer comme des anciens » ; l’expérience partagée du danger, l’épreuve du feu soudent les groupes primaires.
La guerre réelle ne correspond pas aux attentes formées depuis l’arrière par les recrues : « Un court séjour au régiment avait suffi à nous guérir de nos illusions premières. Au lieu des dangers espérés, nous avions trouvé la crasse, le travail, les nuits sans sommeil, tous maux dont l’endurance exigeait un héroïsme peu conforme à notre naturel. Mais le pire, c’était l’ennui, plus énervant pour le soldat que la proximité de la mort. Nous espérions une attaque… » (p. 10)
Les Éparges : 23 avril 1915, premier combat (p. 19).
Notations sur le commandement, la conduite de la guerre et des hommes : En première ligne, il ne peut être question de repos ; ni le jour, ni la nuit, du fait des gardes et des travaux divers et incessants ; Jünger évoque la « torpeur » dans laquelle tombent de nombreux soldats. Les périodes dites de « repos » ne sont d’ailleurs pas plus reposantes ; là encore, les travaux se succèdent (p. 8). Le surmenage est également mis sur le compte d’un commandement qui n’a pas encore pris l’exacte mesure des exigences de la guerre de position. Jünger critique également l’aménagement d’abris profonds et confortables qui « crée la manie de s’accrocher au dispositif de défense, un besoin de sécurité auquel on a ensuite du mal à renoncer » (p. 11) ; « Ces brefs coups de main, durant lesquels il fallait serrer les dents, était un moyen de s’endurcir le courage et de rompre la monotonie de l’existence dans les tranchées. Il faut avant tout que le soldat ne s’ennuie pas » (p. 79) ;
Discipline : Un soldat puni est envoyé monter la garde en poste avancé muni seulement d’une pioche (p. 12). Le vandalisme, le pillage sont nuisibles à la cohésion et à la discipline : Cf. destructions lors de la retraite sur la ligne Siegfried (Hindenburg) au printemps 1917 ; son commentaire vis-à-vis de ces destructions a varié : « Ce fut la première fois où je vis à l’œuvre la destruction préméditée, systématique, que, plus tard dans ma vie, j’allais rencontrer jusqu’à l’écœurement ; elle est sinistrement liée aux doctrines économiques de notre temps, rapporte au destructeur lui-même plus de tort que de profit et ne fait aucunement honneur au soldat » (p. 114-115) [Une note précise : « ce paragraphe est un ajout assez tardif ; les destructions sont décrites sans commentaire dans les versions de 1934 et 1935. De 1920 à 1924, le commentaire était le suivant : ?la légitimité morale de ces destructions est très contestée, mais sur ce point, les réactions de colère et de tristesse chauvines me semblent plus compréhensibles que les applaudissements satisfaits des guerriers en chambre et des scribouillards des journaux. Quand des milliers de personnes pacifiques sont dépouillées de leur patrie, le sentiment complaisant de notre puissance doit se taire./ Naturellement, en tant qu’officier prussien, je ne doute pas un instant de la nécessité de ces actes. Faire la guerre, cela veut dire essayer d’anéantir l’adversaire en déployant sa force sans restriction aucune. La guerre est le plus rude des métiers, ses maîtres d’œuvre ne doivent ouvrir leur cœur aux sentiments d’humanité que dans la mesure où celle-ci ne risque pas de leur nuire./ Quant au fait que ces destructions qui répondaient aux exigences de l’heure n’étaient pas belles, il ne changeait rien à l’affaire? » (note 5, p. 730)] ; « […] à la découverte des réserves de vin rouge, le village, déjà pris sous le feu de l’ennemi, était devenu le théâtre d’un débridement bachique qu’il avait eu le plus grand mal à réfréner. […] nous prîmes l’habitude, les fois suivantes, de fracasser à coups de pistolet les dames-jeannes et autres récipients de même calibre » (p. 118).
La force de l’exemple : Postures de chefs et de meneur d’hommes : (p. 20) ; « À 3 heures de l’après-midi, mes guetteurs de gauche arrivèrent et me rapportèrent qu’ils ne pouvaient plus tenir, leurs trous étant démolis par les obus. Je dus déployer toute mon autorité pour les renvoyer à leur poste. Il est vrai que je me trouvais à l’emplacement le plus dangereux, et c’est là qu’on dispose de la plus haute puissance de commandement » (p. 89.) ; « La méthode d’approche [patrouille] que je viens de mentionner consistait à faire alternativement ramper en avant chaque homme de la patrouille, sur un terrain où nous pouvions à chaque instant nous heurter à l’ennemi. […] Je prenais naturellement mon tour dans cette fonction, bien que ma présence dans la patrouille eût été mieux indiquée ; mais à la guerre, les considérations tactiques ne sont pas toujours les seules décisives » (p. 130) ; « Je fus le dernier à quitter le petit fortin… » (p. 152) ; (p. 171).
Obtenir l’obéissance : « […] les jeunes de ma section s’étaient déjà enquis une bonne de douzaine de fois de savoir si je n’étais pas encore revenu. Cette nouvelle me toucha profondément et m’emplit de force ; elle m’apprit que dans les jours brûlants qui nous attendaient, je pouvais compter sur plus encore que la seule obéissance due à mon grade, et que je disposais aussi d’un crédit personnel » (p. 80) (21 août 1916) ; « En avant ! En avant ! Des hommes s’abattaient soudain dans leur course et nous les cinglions de menaces pour les forcer à tirer de leurs corps épuisés leurs dernières énergies » (p. 86) ; (p. 92) ; (p. 123) ; « Comme notre petit groupe était très réduit, je tentai de le renforcer à l’aide des nombreux hommes qui battaient le terrain sans chef. La plupart déférèrent de bonne grâce à nos sommations, […], tandis que d’autres poursuivaient leur course après s’être arrêtés un moment, surpris, quand ils avaient vu qu’il n’y avait rien à gagner chez nous. Dans ce genre de situation, il n’y a pas de ménagement qui tienne. Je les fis mettre en joue » (p. 151) ; idem p. 152 ; « [patrouille] ne connaissant pas le chemin […]. Tout en me hâtant de passer, je le demandai à un sous-officier inconnu qui se tenait à une entrée de cave. Pour toute réponse, il se fourra les mains dans les poches et haussa les épaules. Comme je n’avais pas de temps à perdre au milieu des projectiles, je bondis sur lui et lui arrachai les renseignements nécessaires en lui mettant mon pistolet sous le nez.
Ce fut la première fois où je rencontrai au combat un homme qui me fit des difficultés, non par frousse, mais, de toute évidence, par pur dégoût de la guerre. Bien que ce dégoût se fût naturellement accru et généralisé dans ces dernières années, une telle manifestation, en pleine action, n’en restait pas moins très insolite, car la bataille lie, tandis que l’inaction disperse. Au combat, on est sous le coup de nécessités objectives. C’est au contraire lors des marches, au milieu des colonnes revenant de la bataille de matériel, qu’on pouvait le plus ouvertement observer la manière dont la discipline s’effritait » (p. 175-176) ; (p. 185)
Altercation avec des soldats de l’arrière : (p. 125)
Alcool : « on nous versait en abondance une gnôle d’un rouge pâle […] qui avait un franc goût d’alcool à brûler, mais qui par ce temps humide n’était nullement à dédaigner » (p. 10) ; « duels bachiques, selon la bonne vieille tradition allemande » à Douchy (p. 31) ; conduites déviantes, inconscientes du danger sous l’effet de l’alcool (p. 58) ; « Le 17 [mars 1917] au matin, nous remarquâmes qu’une attaque devait être imminente. Dans la tranchée anglaise de première ligne, fortement embourbée et vide à l’ordinaire, on entendait le clapotis de multiples bottes. Les rires et les cris d’une troupe nombreuse révélaient que nos gaillards avaient aussi dû s’humecter sérieusement le gosier » (p. 116)
Corps : on ne trouve pas de trace d’aseptisation chez le témoin Jünger : [après un bombardement] « Nous attrapâmes les membres qui sortaient des décombres et tirâmes les cadavres. L’un avait eu la tête arrachée : le cou était planté sur le tronc comme une grosse éponge sanguinolente… […] Je dressai la liste des objets de valeur que nous trouvâmes sur les corps. C’était un travail lugubre. […] mes hommes me tendaient les portefeuilles et les objets d’argent comme s’ils observaient un rite sombre et mystérieux. La fine poussière jaune des briques s’était déposée sur le visage des morts, lui donnant la rigidité de masques en cire. Nous jetâmes des couvertures sur leurs restes et nous hâtâmes de quitter la cave, après avoir emmailloté notre blessé dans une toile de tente » (p. 122). « L’odeur de décomposition, dans cet air lourd, avait crû jusqu’à devenir presque intolérable. Nous arrosâmes les morts de chlorure de chaux que nous avions emporté dans des sacs. Les taches blanches luisaient dans l’obscurité comme des suaires » (p. 139). D’autres soldats se montrent moins respectueux des morts ; certains pillent les cadavres (p. 22) et (p. 204) ; (p. 145) ; (p. 172)
Tranchées constituées dans des charniers : (p. 46), (p. 88) ; (p. 154) ; Inhumation (p. 76) ; pendant la bat de la Somme : « Des blessés tombaient, appelaient à l’aide, sans que personne y prît garde, de droite et de gauche, dans les trous d’obus, les yeux rivés à l’homme de devant, le long d’un fossé qui ne nous venait qu’au genou, fait d’une chaîne de gigantesques entonnoirs où les morts se suivaient à la file. Le pied écrasait avec dégoût les corps flasques qui cédaient sous lui ; l’obscurité dérobait leurs formes aux yeux. Le blessé qui tombait en travers du chemin n’était pas moins destiné à être piétiné par les bottes de ceux qui poursuivaient en hâte leur route. » (p. 86-87)
Tirs amis : (p. 148-149) ; p. 152 ; p. 171 ; p. 219 ; p. 243-244
Peur : Jünger est surpris de voir que les artilleurs se montrent plus impressionnés par le sifflement des balles que par celui des obus (p. 12) ; « Le feu d’artillerie, en terrain aussi découvert où l’on peut se mouvoir librement, n’a ni la même puissance matérielle ni le même effet moral que dans les agglomérations ou les tranchées » (p. 71) ; « Nous nous égaillâmes d’un bond et nous plaquâmes dans les entonnoirs. Je tombai le genou dans le produit de la frousse d’un prédécesseur et, en hâte, je me fis nettoyer au couteau, vaille que vaille, par mon ordonnance » (p. 253).
La force des normes sociales dominantes : « Un froussard se plaqua au sol sous les rires un peu contraints de ses camarades » (p. 19). Orgueil du groupe : « Le colonel a souvent voulu nous affecter à un secteur plus calme […] mais chaque fois, la compagnie demandait comme un seul homme de pouvoir garder son secteur C » (p. 45) ; « Le 8 novembre [1916]. […] Ce capitaine de cavalerie logeait avec quatre officiers chefs de patrouille, deux officiers-observateurs et son adjoint dans le vaste presbytère, dont nous nous partageâmes les pièces. Dans la bibliothèque, l’un des premiers soirs, une longue discussion s’engagea au sujet des offres de paix allemandes, qui venaient d’être publiées. Böckelmann y mit fin d’une phrase : chaque soldat devait s’interdire de prononcer seulement le mot de paix, tant que durait la guerre. » (p. 101)
« Nous devions nous infiltrer en deux points dans la tranchée ennemie et tâcher d’y faire des prisonniers. […] Quand je demandais des volontaires, j’eus la surprise de voir – car nous étions tout de même à la fin de 1917 – se présenter dans presque toutes les compagnies du bataillon près des trois quarts de l’effectif. […] Quelques volontaires en surnombre pleurèrent presque lorsqu’ils furent refusés. […] Les casse-cous les plus cinglés du 2e bataillon avaient fait équipe.
Dix jours durant, nous nous exerçâmes au lancer de grenades et répétâmes notre coup de main contre des défenses qui reproduisaient notre objectif. […] A part cela, nous étions dispensés de service… » (p. 166-167).
Gestes de solidarité : Encouragements mutuels (p. 23) ; « En franchissant la route, nous rencontrâmes la 2e compagnie. Kius avait été mis au courant de notre situation par des blessés et, tant de son propre mouvement que sur les instances de ses hommes, il s’était mis en route pour nous sortir de ce mauvais pas. Il l’avait fait sans ordre. Cela nous émut et nous emplit d’une exubérance joyeuse, un de ces états d’âme où l’on voudrait arracher des arbres » (p. 152). « De temps à autre, l’un de nous disparaissait dans la boue jusqu’aux hanches, et si ses camarades ne lui étaient pas venus en aide en lui tendant la crosse de leurs fusils, ils s’y seraient immanquablement noyé » (p. 180) ; à l’occasion de sa dernière blessure, ses hommes se sacrifient pour le ramener au poste de secours « […] Cet exemple peu encourageant n’empêcha pas un second sauveteur de risquer une nouvelle tentative pour me tirer d’affaire… » (p. 259-260)
Hindous : p. 134-135
Jünger témoigne de ce qu’un soldat peut tuer sans haine ; on note chez lui un profond respect pour l’ennemi ; même s’il n’hésite pas à tuer en cas de danger : « Les Français avaient dû tenir des mois auprès de leurs camarades abattus, sans pouvoir les ensevelir […] « Dans ce désordre gisaient les corps des braves défenseurs, dont les fusils étaient encore appuyés aux créneaux… » (p. 21-22); « Alerté par un guetteur, Eisen accourut avec quelques hommes et lança des grenades, contraignant l’adversaire à se retirer en laissant deux hommes sur le terrain. L’un d’eux, un jeune lieutenant, mourut aussitôt après, l’autre, un sergent, était grièvement blessé au bras et à la jambe. Nous apprîmes par les papiers de l’officier qu’il s’appelait Sokes et appartenait au 2e fusiliers, le Royal Munster. Il était très bien habillé, et son visage convulsé par l’agonie avait des traits intelligents et énergiques. Son calepin contenait une foule d’adresses de jeunes filles, à Londres ; ce détail m’émut. Nous l’ensevelîmes derrière notre tranchée et lui plantâmes une croix sans ornement, où je fis marquer son nom avec des clous de soulier. Cet incident me fit voir que toutes les patrouilles ne se terminaient pas aussi heureusement que les miennes, jusqu’à présent du moins. » (p. 111-112) ; « Cette chasse à courre dans le marais était totalement exténuante » (p. 181) ; « […] nous vîmes les premiers Anglais venir vers nous, les bras en l’air. L’un après l’autre, ils contournèrent la traverse et débouclèrent leurs armes ; menaçants, nos fusils et nos pistolets étaient braqués sur eux. […] La plupart montraient par leur sourire confiant qu’ils ne s’attendaient pas à des atrocités de notre part. D’autres essayaient de se concilier nos bonnes grâces en nous tendant des paquets de cigarettes et des tablettes de chocolat. Je vis avec la joie croissante du vrai chasseur que nous avions fait une prise considérable ; […] J’arrêtai un officier et l’interrogeai sur la suite du tracé de la position et sur les effectifs qui la tenaient. Il me répondit très poliment ; qu’il se mit par surcroît au garde-à-vous, c’était totalement superflu. […] il me conduisit au commandant de compagnie, un captain blessé, qui se trouvait dans un abri voisin. J’y fis la connaissance d’un jeune homme d’environ vingt-six ans […] qui s’appuyait au châssis de galerie, le mollet traversé d’une balle. Quand je me présentai, il porta à sa casquette sa main où brillait une gourmette d’or, me donna son nom et me tendit son pistolet. Ses premières paroles me montrèrent que j’avais affaire à un homme : ?We were surrounded about?. Il se sentait obligé d’expliquer à son adversaire pourquoi sa compagnie s’était si vite rendue. Nous nous entretînmes en français de choses et d’autres. Il me raconta qu’une série de blessés allemands, que ses hommes avaient pansés et ravitaillés, étaient étendus dans un abri voisin. […] Lorsque j’eus promis de le faire ramener à l’arrière, ainsi que les autres blessés, nous nous serrâmes la main et nous séparâmes » (p. 189-190) ; « Nous passions à la hâte devant des corps encore chauds, robustes, sous les kilts courts desquels luisaient des genoux vigoureux, ou nous rampions par-dessus eux. C’étaient des Highlanders, et l’allure de leur résistance montrait bien que nous avions affaire à de vrais hommes » (p. 223) ; « J’eus une vive empoignade avec le chef du train des équipages, qui voulait faire jeter en bas de la voiture deux Anglais blessés, alors qu’ils m’avaient soutenu durant la dernière partie de notre trajet » (p. 230)
Réduction de la violence, trêves tacites : « En maints endroits de la position […] les sentinelles sont à trente mètres à peine l’une de l’autre. Il s’y noue parfois des relations personnelles […]. De brèves apostrophes, qui ne manquent pas d’un certain humour primitif, volent d’une ligne à l’autre. ?Hé, tommy, t’es toujours là ? – Ouais ! – Alors, planque ta tête, je vais tirer !? » (p. 39-40) ; « L’infanterie des deux côtés s’en tenait, par convention tacite, au fusil, et l’emploi d’explosifs provoquait un tir de représailles deux fois plus intense » (p. 58) ; ces trêves ne sont pas réservées aux premiers mois de guerre : « Ce jour–là, je vis de petits groupes de brancardiers, drapeaux de la Croix-Rouge déployés, se mouvoir à découvert dans la zone des feux d’infanterie, sans qu’un seul coup fût tiré contre eux. De telles images ne se montraient au combattant, dans cette guerre souterraine, que dans les cas où la détresse avait atteint un paroxysme insoutenable » (p. 183, octobre 1917, Flandres)
Scène de fraternisation en décembre 1915, secteur de Quéant provoqué par l’inondation des tranchées : « Les occupants des tranchées des deux partis avaient été chassés par la boue sur leurs parapets, et il s’était déjà amorcé, entre les réseaux de barbelés, des échanges animés, tout un troc d’eau-de-vie, de cigarettes, de boutons d’uniforme et d’autres objets… » (p. 49-51) ; « […] un ton où s’exprimait une estime quasi sportive… » (p. 50) ; l’artillerie accompagne et signale la fin de l’entretien (p. 51) ; le soir de Noël 1915 : les Allemands entonnent des chants que les Anglais « étouffèrent sous les salves de leurs mitrailleuses. Le jour de Noël, nous perdîmes un homme de la troisième section, atteint par ricochet d’une balle dans la tête. Juste après, les Anglais firent une tentative de rapprochement amical en hissant sur leur parapet un arbre de Noël, que nos hommes furibonds, balayèrent en quelques coups de feu, auxquels les tommies répondirent à leur tour…. » (p. 51)
Un blessé se lamente de devoir quitter définitivement le front ; cela surprend Jünger ; nous sommes au début de la guerre (p. 28) ; cas inversé en mai 1917 : « […] l’un de mes hommes attrapa une balle de shrapnel qui lui resta dans la fesse droite. Quand, alerté, j’accourus au lieu de l’accident, je le trouvai déjà tout réjoui, attendant les brancardiers, assis sur sa fesse gauche, en train de boire le café accompagné d’une gigantesque tartine de confiture » (p. 127).
L’amour du pays : Jünger est évacué en Allemagne après sa première blessure reçue aux Éparges : « Le train nous déposa à Heidelberg. Quand je vis les collines du Neckar couvertes de cerisiers en fleur […]. Comme ce pays était beau, et bien digne qu’on versât son sang et qu’on mourût pour lui ! » (p. 28)
Les rapports avec la population civile occupée sont nombreux et apparemment cordiaux : septembre 1915 (p. 30) ; Douchy est la base de repos du 73e : « La population française était cantonnée à la sortie du village, du côté de Monchy. Des enfants jouaient sur le seuil. […] Nous n’allions voir les habitants que pour leur apporter notre linge à laver ou pour leur acheter du beurre et des œufs » (p. 31-32) « […] adoption de deux petits orphelins français par la troupe… » (p. 32) ; le village ruiné de Monchy-au-Bois (p. 32) ; relation avec une jeune fille de 17 ans du village de Croisilles (p. 60) ; civils de Douchy inquiets des gaz demandent au colonel allemand des masques ; ils sont évacués vers l’arrière (p. 74) ; cantonnement à Brancourt : flirts et amourettes entre soldats et femmes françaises (p. 99-100) ; cantonnements successifs à Cambrai chez la famille Plancot : « mes hôtes, un couple d’orfèvres très aimable, les Plancot-Bourlon, laissaient rarement passer un déjeuner sans m’envoyer dans ma chambre quelque bon morceau. Nous occupions nos soirées ensemble devant une tasse de thé, à jouer au trictrac et à bavarder. Bien entendu, une question épineuse revenait souvent sur le tapis : pourquoi faut-il que les hommes se fassent la guerre ?… » (p. 141) ; « Je retrouvai M. et Mme Plancot, qui m’avaient si bien hébergé l’année précédente, et à qui ma visite fit le plus grand plaisir…» (p. 250) ; « [Jünger blessé, août 1918] […] M. et Mme Plancot m’envoyèrent une lettre aimable, une boîte de lait condensé dont ils s’étaient privés à mon intention, et le seul melon qu’eût produit leur potager » (p. 261) ; octobre 1917, cantonnement à Roulers/Roeselaere en Flandre : bombardements de l’aviation anglaise (p. 173-175) ;
Description d’une tranchée de première ligne (p. 34-36) ; une journée de tranchée-type (p. 37-39)
TUER. Chef d’un groupe de choc, Jünger est très explicite sur la pratique de la violence interpersonnelle, les différentes façons d’éliminer son ennemi, les coups de main et les combats rapprochés: (p. 42) ; (p. 46) ; « Ils contemplent avec une volupté de connaisseurs les effets de l’artillerie sur la tranchée ennemie… » ; « Ils aiment tirer des grenades à fusil et des mines légères contre les lignes adverses, au grand mécontentement des timorés […]. Mais cela ne les empêche pas de réfléchir constamment à la meilleure manière de projeter des grenades avec une espèce de catapulte de leur invention… » (p. 42) ; « Devant le secteur de la première section, deux ravitailleurs anglais apparurent à la tombée du jour : ils s’étaient égarés. Ils s’approchèrent le plus paisiblement du monde : l’un tenait à la main une grande gamelle ronde, l’autre un long bidon plein de thé. Tous deux furent abattus presque à bout portant. […] Il n’était guère possible de faire des prisonniers dans cet enfer : comment aurait-on pu les ramener à travers la zone d tirs de barrage ? » (p. 91) ; « Schmidt, le premier survivant peut-être des défenseurs du chemin creux, entendit des pas qui annonçaient l’approche des assaillants. Aussitôt après, des coups de feu retentirent à ras du sol, et des éclatements de charges explosives et de grenades à gaz : on nettoyait l’abri. » (p. 98-99) ; [combat dans une tranchée] (p. 112) ; « j’arrachai le fusil des mains du guetteur le plus proche, mis la hausse à six cents mètres, visai soigneusement, un peu en avant de la tête, et pressai la détente. Il fit encore trois pas, tomba sur le dos… » (p. 112-113) ; « Un tirailleur isolé se montra à l’orée du bois et marcha vers nous. Un homme commit l’erreur de lui crier : ?Le mot de passe !?, sur quoi il s’arrêta, indécis, puis fit demi-tour. Un éclaireur, bien entendu.
?Descendez-le !?. Une douzaine de coups de feu ; la forme s’écroula et glissa dans l’herbe haute » (p. 133) ; « C’était le moment voulu pour foncer dans le tas. Baïonnette au canon, en poussant des hourras furieux, nous montâmes à l’assaut du petit bois. Des grenades volèrent à travers les broussailles denses, et en un rien de temps nous eûmes reconquis notre avant-poste sans avoir réussi, à vrai dire, à saisir notre souple adversaire » (p. 134) ; Suit le ramassage de trois blessés hindous. « Nous bloquâmes sans tarder leur avance, bien qu’ils arrivassent avec une supériorité numérique considérable. Nous tirions rapidement, mais en visant. Je vis un gros soldat de première classe de la 8e compagnie appuyer avec le plus grand flegme le canon de son fusil sur une souche déchiquetée ; à chaque coup, c’était un assaillant qui tombait » (p. 153) ; « J’avais fait le choix d’un vêtement de travail conforme à la tâche que nous nous proposions d’accomplir » ; Jünger emporte deux pistolets et différents types de grenades… « Nous avions décousu les pattes d’épaule et le ruban de Gibraltar, pour ne pas donner à l’ennemi d’indications sur notre corps. Comme signe de reconnaissance, nous portions à chaque bras un brassard blanc » (p. 167-168) ; « Kienitz me raconta en hâte qu’il avait chassé à coups de grenades, dans la première tranchée, des Français occupés au terrassement, et qu’en poursuivant son avance, dès le début il avait eu des morts et des blessés, dus au tir de notre propre artillerie » (p. 171) ; « Le lendemain matin, le colonel von Oppen vint voir une seconde fois les hommes de la patrouille, distribua des Croix de fer et donna à chacun des participants quinze jours de permission. » (p. 172) ; corps à corps : « Domeyer se heurta à un territorial français à la barbe de fleuve qui à sa sommation : ?Rendez-vous !?, répliqua avec fureur : ?Ah non !? et se jeta sur lui. Au cours d’un duel acharné, Domeyer lui tira un coup de pistolet à travers la gorge et dut, comme moi, revenir sans prisonniers » (p. 173) ; une forme de bouclier humain… « Juste après l’attaque, le chef de ce petit fortin, un adjudant, avait repéré un Anglais qui ramenait trois Allemands prisonniers. Il abattit l’Anglais et renforça de trois hommes son effectif. Lorsqu’ils furent à bout de munitions, ils placèrent devant la porte un Anglais soigneusement pansé afin d’empêcher d’autres tirs, et une fois la nuit tombée, ils réussirent à battre en retraite sans se faire repérer.
Un autre fortin bétonné, où commandait un lieutenant, fut sommé de se rendre par un officier anglais ; pour toute réponse, l’Allemand bondit au-dehors, saisit l’Anglais au collet et le traîna à l’intérieur sous les yeux de ses hommes médusés » (p. 182-183) ; « Un avion allemand descendit en flammes une saucisse anglaise dont les observateurs sautèrent en parachute. Il exécuta encore quelques évolutions autour de ces Anglais suspendus en l’air et les arrosa de balles traçantes – signe que la violence impitoyable de la guerre s’aggravait » (p. 186) ; Combats à la grenade (p. 193-195) ; « Entre tous les moments excitants de la guerre, aucun n’est aussi fort que la rencontre de deux chefs de troupes de choc, entre les étroites parois d’argile des positions de combat. Plus question alors de retraite ni de pitié ! » (p. 195) ; Un face à face : « Nous nous aperçûmes au moment où je débouchai d’un tournant. […]. Ce fut une délivrance de voir enfin concrètement l’adversaire. Je posai le canon de mon arme contre la tempe de l’homme paralysé par la peur, l’empoignant de l’autre main par sa vareuse d’uniforme qui portait des décorations et les insignes de son grade. Un officier ; […] Avec un gémissement, il porta sa main à sa poche, pour en tirer, non pas une arme, mais une photo qu’il me tint sous les yeux. Elle le montrait sur une terrasse, entouré d’une nombreuse famille. Ce fut un appel magique […]. J’ai par la suite considéré comme un grand bonheur de l’avoir épargné en poursuivant ma course en avant » (p. 211) ; « Le défenseur n’était donc plus qu’à une longueur de bras de nous. Cette immédiate proximité de l’ennemi constituait notre sauvegarde. Elle constitua aussi sa perte. Une buée brûlante montait de l’arme. Elle devait avoir fait déjà beaucoup de victimes et continuait à faucher. […]
Je fixai, fasciné, ce bout de fer brûlant et vibrant qui semait la mort et me frôlait presque le pied. Puis je tirai à travers la toile. Un homme se dressa près de moi, l’arracha et balança une grenade dans l’ouverture. Une secousse et la fumée blanche qui jaillit nous en apprirent l’effet. Le procédé était brutal, mais sûr. Le canon ne bougeait plus, l’arme se tut » (p. 212-213) ; « Ce fut la première fois à la guerre où je vis se heurter des masses humaines. […] Je sautai dans la première tranchée ; […] je me heurtai à un officier anglais à la vareuse déboutonnée, dont pendait la cravate par laquelle je l’empoignai pour le plaquer contre un parapet de sacs. Derrière moi apparût la tête chenue d’un commandant qui me hurla : ?Abats ce chien !?
C’était inutile. Je passai à la tranchée inférieure, qui grouillait d’Anglais. On se serait cru au milieu d’un naufrage. Quelques-uns lançaient des ?œufs de cane?, d’autres tiraient avec des colts, la plupart s’enfuyaient. Nous avions désormais l’avantage. Je pressais comme en rêve la détente de mon pistolet, alors que depuis longtemps, je n’avais plus de balles dans le canon. Un homme à côté de moi, jetait des grenades parmi les fuyards. […] Le sort du combat fut réglé en une minute. Les Anglais sautèrent hors de leur tranchée et s’enfuirent à travers champs. De la crête du remblai, un feu de poursuite furieux éclata. […] en quelques secondes, le sol fut couvert de corps étendus. C’était le mauvais côté de ce remblai.
Des Allemands, eux aussi, étaient déjà sur le glacis. Debout près de moi, un sous-officier, bouche bée, contemplait la mêlée. Je lui pris son fusil et tirai sur un Anglais engagé dans un corps-à-corps avec deux Allemands. Ceux-ci restèrent un instant stupéfaits de ce secours invisible, pour poursuivre leur avance aussitôt après. […] Chacun courait droit devant lui. […] Nous formions une meute… » (p. 214-215) ; « Une entrée d’abri m’attira. J’y jetai un coup d’œil et aperçus un homme assis en bas […]. De toute évidence, il n’avait encore aucune idée des changements de la situation. Je le pris tranquillement au bout du guidon de mon pistolet, mais au lieu de l’abattre aussitôt, comme la prudence l’ordonnait, je lui criai : ?Come here, hands up !? Il se leva d’un bond, me fixa d’un air ahuri et disparut dans l’ombre de l’abri. Je balançai une grenade derrière lui. » (p. 215) ; « Les bras en l’air, les Anglais se hâtèrent de fuir vers nos arrières, pour échapper à la fureur de la première vague d’assaut […]. J’assistai, pétrifié par l’attention, au premier choc, qui eut lieu tout près du bord de notre petit retranchement. Je vis ici qu’un défenseur qui, jusqu’à cinq pas, tire ses balles presque à bout portant sur son assaillant ne peut espérer que ce dernier lui fera grâce de la vie. Le combattant qui, pendant l’attaque, a eu un voile de sang devant les yeux, ne veut pas faire de prisonniers ; il veut tuer » (p. 216) [note 10 p. 745: « de 1920 à 1924, avec quelques variantes mineures, ce début de l’assaut donne lieu à un développement différent : ?De tous les trous d’obus surgissaient maintenant des formes brandissant des fusils, qui, les yeux révulsés et la bouche écumante, montaient en hurlant de terribles hourras à l’assaut de la position ennemie d’où les défenseurs sortaient par centaines en levant les bras. / On ne faisait pas de quartier […] Une ordonnance de Gipkens en abattit une bonne douzaine […]. / Je ne peux pas en vouloir à nos hommes de ce comportement sanguinaire. Assassiner un homme désarmé est une bassesse. À la guerre, personne ne m’était aussi odieux que les héros de café du commerce […]. / Par ailleurs, qui tire ses balles sur l’assaillant jusqu’à six pas de lui doit en supporter les conséquences. Durant l’assaut, un voile de sang flotte devant les yeux du combattant, ensuite il ne peut changer d’humeur. Il ne veut pas faire de prisonniers, il veut tuer. Il n’a plus d’objectif devant les yeux, il est entièrement sous l’emprise de violents instincts originels. C’est seulement lorsque le sang a coulé que se dissipent les brouillards de son cerveau ; il regarde autour de lui, comme s’éveillant d’un rêve profond. Alors, seulement, il redevient un soldat moderne, capable d’assumer une nouvelle mission tactique?. Modifié et abrégé en 1934 et 1935, ce passage trouve sa forme définitive en 1961 ».] « Comme il persistait, en dépit de mes sommations, […] nous mîmes fin à ses hésitations de quelques grenades et poursuivîmes notre route. […] J’en abattis un au moment où il bondissait hors du premier abri » (p. 218) ; « Le nettoyage à la grenade se déroula lentement, comme devant Cambrai » (p. 223) ; « Quand nous eûmes ainsi gagné cent mètres environ, la pluie toujours plus dense de grenades à main et à fusil nous contraignit de nous arrêter. La situation menaçait de s’inverser, elle commençait à ?sentir mauvais? ; j’entendis des apostrophes nerveuses : ?V’là les Tommies qui contre-attaquent !? […] ?Gare, mon lieutenant !? C’est justement dans les corps-à-corps de tranchées que de tels retournements sont redoutables. Une petite troupe de choc s’élance en tête, tirant et lançant ses grenades. Quand les grenadiers bondissent en avant, puis en arrière, pour échapper aux effets destructeurs de leurs propres projectiles, ils se heurtent aux suivants, qui suivent en masses trop compactes. Il n’est pas rare alors que le désordre se mette chez l’assaillant. Quelques-uns tentent peut-être de se replier à découvert et s’écroulent sous le feu des tireurs d’élite, ce qui aussitôt encourage considérablement l’adversaire » (p. 224) ; Combats à la grenade p. 246 ; « La scène s’animait de plus en plus. Un cercle d’Anglais et d’Allemands nous entourait, nous invitant à jeter nos armes. […] J’exhortai d’une voix faible mes voisins à poursuivre leur résistance. Ils fusillaient amis comme ennemis. […] À gauche, deux colosses anglais fourrageaient à coups de baïonnettes dans un bout de tranchée d’où s’élevaient des mains implorantes.
Parmi nous, on entendait aussi des voix stridentes : ?Cela n’a plus de sens ! Jetez vos fusils ! Ne tirez pas, camarades !? Je lançai un coup d’œil aux deux officiers, debout à côté de moi dans la tranchée. Ils me répondirent d’un sourire, d’un haussement d’épaules, et laissèrent glisser à terre leurs ceinturons » (p. 258) ; « Il ne me restait plus que le choix entre la captivité ou une balle. Je rampai hors de la tranchée et marchai d’un pas vacillant vers Favreuil. […] La seule circonstance favorable était peut-être la confusion, telle que d’un côté on échangeait déjà des cigarettes, tandis que de l’autre on continuait à s’entr’égorger. Deux Anglais, qui ramenaient un groupe de prisonniers du 99e vers leurs lignes, me barrèrent la route. Je plaquai mon pistolet sur le corps de l’un d’eux et appuyai sur la détente. L’autre déchargea son fusil sur moi sans m’atteindre » (p. 258-259).
Corps à corps : ? « L’un de ces intrus devait être un risque-tout. Il avait bondi sans se faire voir dans la tranchée et avait couru derrière la ligne des postes de guetteurs, d’où les hommes surveillaient les approches. L’un après l’autre, les défenseurs, que leurs masques à gaz empêchaient de bien voir, furent assaillis par derrière : après en avoir abattu un bon nombre à coups de matraque ou de crosse, il retourna, toujours inaperçu, jusqu’aux lignes anglaises. Quand on déblaya la tranchée, on retrouva huit sentinelles à la nuque fracassée » (p. 75).
Esprit de vengeance : après qu’un territorial terrassier, père de 4 enfants, ait été abattu : « Ses camarades sont restés longtemps encore aux aguets derrière les créneaux pour venger le sang versé. Ils pleuraient de rage. Ils semblaient considérer l’Anglais qui avait tiré la balle mortelle comme leur ennemi personnel » (p. 48).
Patrouilles dans le no man’s land : pistolet, grenades et poignards serrés entre les dents (p. 63) ; non utilisés dans ce cas. Une seconde sortie pour rien le lendemain (p. 64)
« En un rien de temps, nous nous glissâmes en tapinois jusqu’aux obstacles de l’ennemi […] ; quelques Anglais se montrèrent et se mirent à y travailler, sans repérer nos corps plaqués dans les herbes.
Me souvenant des mésaventures de la dernière patrouille, je soufflai aussi bas que possible : « Wohlgemut, balancez-leur une grenade. – Mon lieutenant, je trouve qu’on devrait les laisser d’abord un peu travailler. – C’est un ordre, aspirant ! »
[…] Mal à mon aise, comme qui s’est embarqué dans une aventure scabreuse, j’entendis auprès de moi le craquement sec du cordon qu’on tire et vis Wohlgemut, pour se découvrir le moins possible, lancer sa grenade comme une bille à ras du sol. Elle s’arrêta dans les broussailles, presque au milieu des Anglais, qui semblaient ne s’être aperçus de rien. Quelques secondes d’extrême tension passèrent. « Crrrac ! » Un éclair illumina des formes vacillantes. Braillant ce cri de guerre : « You are prisoners !« , nous bondîmes comme des tigres au sein de la nuée blanche. En quelques fractions de seconde, il se déroula toute une scène sauvage. Je braquai mon pistolet sur un visage qui luisait devant moi […]. Une ombre tomba à la renverse avec un hurlement nasillard, dans les barbelés. C’était un cri hideux […]. À ma gauche, Wohlgemut déchargeait son pistolet, tandis que Bartels, dans son énervement, lançait au petit bonheur une grenade au milieu de nous » (p. 79) ; au total donc, peu de baïonnettes ou de poignards en action…
La guerre comme travail : « Quand le fil téléphonique était coupé, j’étais chargé de le faire réparer par mon détachement d’intervention. Je découvris en ces hommes, dont j’avais à peine remarqué jusque-là l’activité sur le champ de bataille, une espèce particulière de « Travailleurs inconnus » dans la zone mortelle. […] rattacher deux bouts de ligne téléphonique : tâche aussi périlleuse que sans éclat » (p. 105-106).
Le plaisir du travail bien fait : « Notre grand orgueil était notre activité de bâtisseurs, où intervenaient peu les ordres de l’arrière… » (p. 56).
Crises de nerfs de Jünger : (p. 79) ; (p. 92) ; « […] l’obus s’était abattu juste au milieu de nous. A demi assommé, je me relevai. Dans le grand entonnoir, des bandes de cartouches de mitrailleuses, allumées par l’explosion, lançaient une lumière d’un rose cru. Elle éclairait la fumée pesante où se tordait une masse de corps noircis, et les ombres des survivants qui s’enfuyaient dans toutes les directions. […] Moi qui, une demi-heure auparavant, était encore à la tête d’une compagnie sur le pied de guerre, j’errais maintenant avec quelques hommes complètement abattus à travers le lacis des tranchées […]. Je me jetai à terre et éclatait en sanglots convulsifs, tandis que les hommes m’entouraient, l’air sombre » (p. 202-203).
Gaz : effets : p. 72-74 ; (p. 102).
Faim : (p. 107-108) ; (p. 162).
Boue : « Ce fut une matinée pitoyable. J’y pus constater une fois de plus qu’aucun tir d’artillerie n’est capable de briser la volonté de résistance aussi radicalement que le froid et l’humidité » (p. 155)
Notes psychologiques : (23 août 16) « […] un chauffeur s’écrasa le pouce en mettant son auto en marche. La vue de cette blessure me causa, à moi qui ai toujours été sensible à ce genre de spectacles, une espèce de haut-le-cœur. Si j’en fais mention, c’est qu’il est d’autant plus curieux que j’aie été capable de supporter dans les jours suivants la vue de graves mutilations. Cet exemple montre que dans la vie, le sens de l’ensemble décide des impressions particulières » (p. 81) ; « Il flottait au-dessus des ruines, comme de toutes les zones dangereuses du secteur, une lourde odeur de cadavres, car le tir était si violent que personne ne se souciait des morts. On y avait littéralement la mort à ses trousses – et lorsque je perçus, tout en courant, cette exhalaison, j’en fus à peine surpris – elle était accordée au lieu. Du reste, ce fumet lourd et douceâtre n’était pas seulement nauséeux : il suscitait, mêlé aux âcres buées des explosifs, une exaltation presque visionnaire, telle que seule la présence de la mort toute proche peut la produire » (p. 83) ; « C’est là, et au fond, de toute la guerre, c’est là seulement que j’observai l’existence d’une sorte d’horreur, étrangère comme une contrée vierge. Ainsi, en ces instants, je ne ressentais pas de crainte, mais une aisance supérieure et presque démoniaque ; et aussi de surprenants accès de fou rire, que je n’arrivai pas à contenir » (p. 83) ; « À partir de 7 heures, la place et les maisons voisines reçurent à des intervalles d’une demi-minute des obus de 150. Beaucoup d’entre eux n’éclatèrent pas : leur choc bref, énervant, secouait la maison jusqu’à ses fondations. Et pendant tout ce temps, nous restâmes dans notre cave, assis dans des fauteuils recouverts de soie, autour de la table, la tête entre les mains, à compter les intervalles des explosions. Les blagues devinrent plus rares, et pour finir, les plus intrépide eux-mêmes se turent » (p. 85) ; « Sous l’effet de violentes douleurs dans la tête et les oreilles, nous ne pouvions nous entendre qu’en braillant des mots sans suite. La faculté de penser logiquement et le sens de la pesanteur semblait paralysés. On était en proie au sentiment de l’inéluctable, de la nécessité absolue, comme devant la fureur des éléments. Un sous-officier de la troisième section devint fou furieux. » (p. 85).
Bat de la Somme, Combles (août 1916) (p. 83) civils ensevelis sous les décombres : « Une petite fille gisait devant un seuil au milieu d’une flaque rouge » (p. 84) « Un endroit violemment bombardé était le parvis de l’église détruite, en face de l’entrée des catacombes, de très anciennes galeries souterraines parsemées de niches où logeaient entassés presque tous les états-majors des unités combattantes. On racontait que les habitants avaient dégagé à coups de pioche, dès le début des bombardements, l’accès muré qu’ils avaient caché aux Allemands pendant tout le temps de l’occupation » (p. 84).
Grippe espagnole : (p. 238-239).
Volontaires de 1918 : « […] le volontaire de 1918, fort peu modelé, de toute évidence, par la discipline, mais brave d’instinct. Ces jeunes casse-cou aux tignasses farouches, en bandes molletières, se prirent violemment de querelle à vingt mètres de l’ennemi par ce que l’un d’eux en avait traité un autre de dégonflé… » (p. 242).
Frédéric Rousseau, mai 2010.