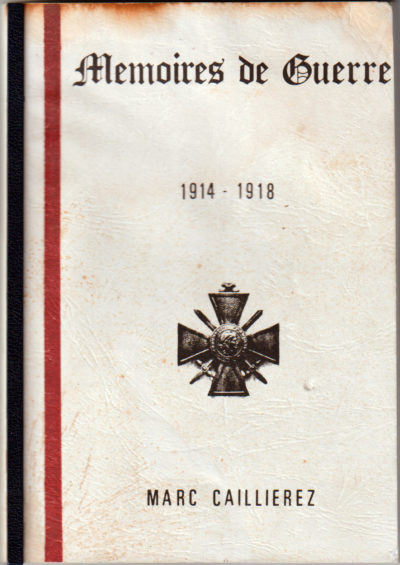Mémoires de Guerre, 1914-1918 – Quelques souvenirs de 1914 à 1919, sans indication d’éditeur ou d’année, 95 p.
(Tampon en page de garde : Ceux de Verdun – 1914-1918 – Amicale d’Arras)
Ces souvenirs se présentent comme un tapuscrit relié, il s’agit d’un document familial, diffusé également dans le cercle associatif ancien-combattant local. Le témoin se présente comme suit en fin d’ouvrage : « CAILLIEREZ Marc – Ex-chef de la première pièce de la 5e batterie du 26e RAC – secteur postal 70 ». Son grade le plus élevé est maréchal des logis.
Il s’agit de souvenirs mis en ordre très postérieurement à la guerre, vraisemblablement au cours des années 1970 comme permet de le déduire l’avertissement en page de garde : « Certains des faits que je vais essayer de relater datant de quelques soixante ans, je n’ai pas la prétention de toujours en garantir la date exacte ». Malgré cette précaution imputable certainement à la modestie de l’auteur, on a clairement affaire, à la lecture du texte, à un témoignage de bonne tenue, très factuel et dont la rigueur chronologique est tout à fait satisfaisante, quoique parfois implicite ou indirecte.
Le livre se divise en 19 petits chapitres, j’ai relevé et cité les passages présentant un intérêt singulier.
— « Période 1914-1915 » (pp. 5-14)
L’auteur a 17 ans au moment de l’entrée en guerre, il vit dans une région rurale dans le canton de Beaumetz-les-Loges (Pas-de-Calais). Il raconte les conditions particulières des travaux agricoles de l’été 1914, mais aussi la perception progressive du passage de la guerre de mouvement à la guerre de positions au cours de l’automne : « des réfugiés nous apprennent que les Allemands [autour d’Arras] n’avancent plus », « à partir du mois d’Octobre, les conducteurs vont ravitailler les pièces et conduire des matériaux pour construire des abris et des tranchées, l’on sent que la guerre de mouvement est arrêtée ». Il faut bien sûr ici faire la part de la vision très rétrospective des choses qui est celle de l’auteur au moment où il écrit : rédigeant en toute connaissance de la suite des événements, il a tendance à les organiser dans un déroulement cohérent.
En avril 1915 il signale son recensement au titre de la classe 1917. Fait très intéressant, il va devancer l’appel pour bénéficier du droit donné aux engagés volontaires de choisir leur arme d’incorporation. Cette démarche qui entre dans le registre des stratégies d’évitement car elle permet d’éviter d’être versé dans l’infanterie où les pertes sont les plus lourdes, est ici décrite de façon tout à fait limpide. Son père étant incorporé comme maréchal des logis dans le 26e RAC de Chartres, il lui fait savoir dans un courrier début juillet 1915 « que le 26e recrute encore des engagés pour la durée de la guerre, et que son capitaine, un ingénieur des mines de Lens lui conseille de me faire venir à Chartres car la classe 1917 sera appelée en grande partie dans l’infanterie ». (p. 13)…
— « Arrivée au 26e RAC » (pp. 15-21)
— « Départ pour le front – Main de Massigues » (pp. 22-23)
— « 1er séjour du 26e RAC à Verdun » (pp. 24-26)
— « 2e séjour du 26e RAC à Verdun » (pp. 27-34)
— « 3e séjour du 26e RAC à Verdun » (pp. 35-38)
— « 4e séjour à Verdun » (p. 39)
— « 5e séjour à Verdun » (p. 40-44)
— « Position entre Verdun et les Éparges » (pp. 45-47)
Caillierez se retrouve sur le front après une année passée à l’arrière à faire ses classes et à apprendre le métier d’artilleur. Son régiment est envoyé dans le secteur de Verdun en juillet 1916, où il participe notamment à la reprise du fort de Douaumont en octobre 1916. Divers éléments sont très intéressants dans son récit, en commençant par son récit de l’explosion d’une pièce d’artillerie : « le 17 [septembre 1916] à neuf heures du matin, la 3ème pièce qui a tiré toute la nuit comme les autres, est choisie par le capitaine pour régler le tir parce qu’elle est la plus récente de la batterie (9 000 coups ; elle éclate en plein milieu avec le 7ème obus que je venais de charger, alors que j’étais prêt à en charger un autre ; je reçois des éclats de fer et de boulons, mais sans mal. Par chance, sans doute parce qu’elle était en plein air, il n’y ni tué, ni blessé, ce qui a rarement été le cas quand les pièces éclatent sous abri – ce qui ne nous empêche pas de trembler « comme des feuilles » après coup. La culasse qui pèse dix-huit kilos est passée au-dessus de nos têtes et s’est enfoncée dans le sol, elle n’a pas été retrouvée ; l’obus, quant à lui, allait éclater à quelques mètres devant la pièce » (p. 25). L’auteur relate ici un moment périlleux, mais pas seulement : ce qui apparaît aussi, c’est la volonté de montrer les dangers encourus par les artilleurs, de fait moins exposés que les fantassins. Ces derniers leur reprochant souvent de mal ajuster leurs tirs et de les frapper ainsi involontairement, il s’agit de se justifier : « nous avons maintenant sur le front de Verdun, de l’artillerie de tous calibres et de l’aviation, pour remplacer le plus possible de poitrines. Si, pour la préparation, nos officiers s’efforcent d’atteindre les objectifs, pour l’attaque proprement dite, tous les calculs sont faits d’avance par le capitaine. À l’heure H, les chefs de pièce sont appelés et reçoivent une feuille de tir, leur donnant le nombre de coups à tirer par minute, et par bonds de 50 ou 100 mètres suivant la marche ; en principe, nous ne voyons plus les officiers. Il arrive encore que, par moments des coups tombent trop près des vagues d’assaut, quand par exemple l’infanterie ne rencontrant pas de résistance, a tendance à vouloir arriver plus vite sur son objectif, d’où les coups tirés trop courts, et reproche est fait à l’artillerie ! » (p. 37)
— « Position de Sept-Sault » (pp. 48-55)
— « Séjour en Belgique » (pp. 56-61) [mai-juillet 1918]
Durant la dernière offensive allemande du printemps 1918, les combats augmentent en intensité, ce qui donne à l’auteur l’occasion d’évoquer la question des citations et décorations, soit la reconnaissance officielle, cruciale pour le soldat-citoyen du devoir accompli : « chaque fois que la division avait subi un coup dur, comme c’était le cas en Belgique, il y avait quelques citations, d’abord pour les morts et les blessés. Pour la batterie, il en restait une, les lieutenants et l’aspirant étaient d’accord pour me proposer au capitaine, car chef de la première pièce, j’avais été souvent plus exposé que les autres en réglant le tir de la batterie, mais celui-ci a décidé que j’attendrais parce que je lui avais mal répondu (…) ce n’était pas trop grave pour moi, puisque j’avais déjà la croix [de guerre], surtout gagnée à la bataille de Verdun ». Le témoin explicite ici une sorte d’échelle de légitimité combattante, la croix de guerre gagnée à Verdun lui permettant de faire fi de l’arbitraire et des humeurs de son supérieur. Il ajoute ensuite cette remarque aigre-douce : « il fallait autant que possible, essayer de ne pas avoir la croix de bois, et l’on était encore loin, au mois de juillet, d’apercevoir la fin de la guerre. Il n’empêche que c’est comme cela que l’on écrivait déjà l’histoire ».
— « Reprise de la guerre de mouvement » (pp. 62-67)
— « Reprise de l’offensive » (pp. 67-69)
« Le 19 [juillet 1918], nous commençons à allonger le tir et bientôt il faut déménager pour aller de l’avant, les Allemands reculent. Peut-on se figurer ce que ces trois mots représentent pour nous, après avoir été à deux doigts d’être faits prisonniers (…) Quel changement, malgré la fatigue et le danger ! Le moral est beaucoup meilleur (…) Cette fois c’est bien la guerre de mouvement. Nous repartons en avant, éclairés maintenant par les incendies des villages qu’ils allument avant de partir ».
— « Derniers combats » (pp. 70-71)
— « 11 novembre 1918 » (pp. 72-79)
[À Sedan] : « accueil délirant de la population, les femmes embrassent nos chevaux, l’on se demande d’où sortent tous les petits drapeaux qui flottent aux fenêtres puisque la ville a été occupée pendant toute la guerre ; c’est une journée inoubliable » (p. 72)
— « Champ de destruction des Ardennes » (pp. 80-85)
— « Départ des Ardennes » (pp. 86-87)
Après l’armistice, au printemps 1919, Caillierez est chargé de détruire des obus dans les obus (« entre quarante-cinq et cinquante-mille obus de tous calibres »). Le principe est d’en disposer plusieurs centaines dans un grand trou de telle sorte qu’ils puissent tous exploser simultanément. C’est évidemment un travail assez dangereux, mais dont il semble bien s’accommoder en attendant sa démobilisation : « ce métier devait durer un long mois. Dans toute la vallée on m’appelait le destructeur (…) De nombreux habitants de plusieurs villages se plaignaient au capitaine que je faisais casser leurs carreaux, et celui-ci me les envoyait. Bien que je leur expliquais que je mettais toujours la même charge et que je ne pouvais faire autrement, quand ils « rouspétaient » trop, je menaçais de mettre 50 obus de plus le lendemain ».
— « Rentrée du régiment » (pp. 88-94)
— « Démobilisation » (p. 95)
« Après avoir passé une journée à Paris en revenant, et une à Douai pour me faire démobiliser, je suis rentré – comme l’on dit – « dans mes foyers ». Voilà comment s’est terminée ma campagne. J’avais passé quatre ans et quarante-cinq jours sous les drapeaux – de 18 à 22 ans – à tel point que je me suis toujours demandé si j’avais eu vingt ans. Tout le monde n’en a pas fait autant, le tout était d’en sortir ».
François Bouloc, septembre 2021