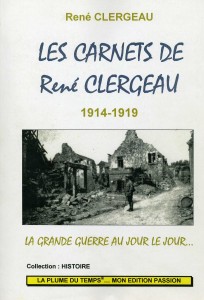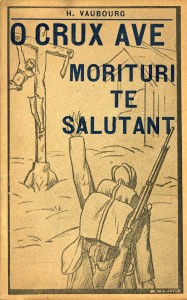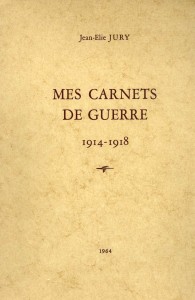Les 454 pages du manuscrit de Germain Balard posent la question de la date de l’écriture. L’entrée en guerre constitue l’entrée en matières sur 2 pages qui évoquent l’assassinat de Jaurès et le procès Villain ; la rédaction est donc postérieure à 1919. L’auteur raconte alors sa jeunesse en 76 pages et sa mobilisation à Perpignan en 5 pages. À partir de son départ pour le front, le 10 avril 1915, le récit, parfaitement daté, est une rédaction à partir d’un carnet de notes précises. La guerre (avec ses suites immédiates) occupe jusqu’à la p. 442. Viennent enfin 12 pages de remarques isolées de 1924 et de 1930-32. La dernière phrase est : « Le monde est en train d’évoluer rapidement. »
La longue biographie permet de dire que Germain est né le 3 janvier 1881 à Saint-Juéry (Tarn), de père inconnu. Sa mère a ensuite épousé un sabotier qui donna son nom à l’enfant. Celui-ci fréquenta irrégulièrement l’école, mais réussit à obtenir le certificat d’études et entra en apprentissage à 12 ans pour devenir tailleur de limes. Tant en usine que dans l’agriculture, il fit plusieurs métiers manuels jusqu’à la date du service militaire commencé à Carcassonne, mais non terminé pour raisons médicales. Sa grande chance, en 1906, fut d’être embauché comme livreur par un pharmacien de Toulouse qui l’initia à l’étude des médicaments et l’encouragea à acquérir une culture d’autodidacte. La situation était bonne et Germain se maria en 1909 avec une couturière. Réformé, il fut « récupéré » en décembre 1914 et envoyé comme infirmier à l’ambulance 5/16 en Champagne en juin 1915. À 34 ans, c’était un libre-penseur, anticlérical, un homme curieux de tout, ayant une haute idée des règles morales à respecter et une capacité d’indignation qui allait rencontrer de nombreuses occasions de fonctionner. Ainsi, face à un prêtre chauvin : « Lui qui se dit éducateur d’une certaine jeunesse, est capable de lui enseigner un nombre infini d’erreurs, plus grossières les unes que les autres. Aussi, comme conclusion à cette discussion, je lui conseille de revenir à l’école et de travailler la philosophie. » Il pense qu’il faudrait punir les responsables de la guerre ; qu’il faut lutter contre le « badernisme ». Il critique les profiteurs et les embusqués, la censure et le bourrage de crâne, les absurdités de la vie militaire. Il décrit un des médecins chefs de l’ambulance comme drogué, incompétent, fainéant et despotique.
Après la Champagne, l’ambulance est regroupée avec d’autres pour former un HOE à Landrecourt près de Verdun en août 1916. Là, il voit descendre des survivants : « Le 143e RI descend des lignes, passe près de nous. C’est avec un serrement de cœur très pénible que l’on voit à quel état squelettique sont réduits ses bataillons. Sur 3000 hommes qui étaient montés, il en redescend 700, et dans quel état ! Cependant leurs clairons sonnent et leurs tambours résonnent à la traversée de Landrecourt. Beaucoup d’entre eux se redressent dans un suprême effort d’énergie pour marquer le pas ; mais plus nombreux encore sont ceux que tout laisse indifférents, traînant péniblement ce qu’ils ont pu rapporter de ce lieu infernal, parce qu’ils savent qu’on ne leur demandera pas d’autre effort avant longtemps, qu’on va les prendre en auto à quelques mètres de là. Il n’y a pas quinze jours que ce régiment était monté en ligne au complet. »
En juin 1917, retour de permission, Balard décrit l’effervescence dans les trains où les poilus cassent toutes les vitres et conspuent les gendarmes, « aussi à chaque arrêt y a-t-il des individus qui descendent du train et incitent les autres à descendre et à ne pas revenir au front ». Lui-même n’y participe pas, mais estime que les hommes arrêtés par les gendarmes « auront toujours assez de mal pour se soustraire aux griffes de la justice militaire ». Le 28 octobre 1917, notation originale, il dit entendre la Madelon pour la première fois.
L’offensive alliée en 1918 fait découvrir des territoires dévastés. Ainsi au retour d’une permission, le 3 septembre, dans les parages de Villers-Cotterêts : « Je parcours de récents champs de bataille : des trous d’obus partout, des arbres fauchés par la mitraille tombés un peu partout et n’importe comment, des canons ennemis abandonnés au petit bonheur. J’arrive à Longpont que je connaissais comme petite ville accidentée très coquette et propre ; je ne rencontre plus que des ruines partout ; pas une maison n’a été épargnée. […] Je remarque des tombes un peu partout, sur les bords de la route, dans les champs. Elles sont reconnaissables à la terre fraîchement remuée, un piquet qui supporte un casque ou un sabre, une vareuse ou des restes de capote ; quelques-unes ont une croix avec un nom. […] Là, sur un petit plateau, deux tanks inutilisables. » Et, le 15 septembre, le travail repris à l’ambulance : « Les blessés affluant de toutes parts, je me trouverais débordé sans l’aide de deux prisonniers allemands dont un est particulièrement dévoué. Ils me sont d’un grand secours étant donné que j’ai un seul blessé français – on n’a pas voulu le mettre dans une salle où il aurait été seul – tous les autres sont allemands. »
Le 11 novembre, le mot « armistice » est écrit en lettres capitales : « Pour savoir ce que ce mot représente, il faut avoir vécu la journée d’aujourd’hui parmi les poilus, parmi les civils qui ont quelqu’un de leurs proches sur la ligne de feu, parmi ce qu’il est convenu d’appeler le peuple ! »
RC
*Virginie Auduit, Carnet de guerre d’un ambulancier 1914-1918, mémoire de maîtrise, Université de Toulouse Le Mirail, 1998 (avec 75 pages d’extraits du témoignage).
Vuillermet, Charles (1890-1918)
1. Le témoin

Charles Vuillermet photographié en atelier à Belley à la veille de la Grande Guerre (page 30)
Charles Vuillermet naît le 12 janvier 1890 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) d’une famille franco-suisse dont nombre de membres sont des artistes reconnus. Son grand-père est photographe, comme son père, Constant Vuillermet, qui a épousé épouse une Thononaise, Marie Chavanne qui a repris l’atelier familial. Le couple aura cinq enfants : André en 1879, Catherine en 1881, Antoinette en 1886, Charles en 1890 et Joseph en 1896. Ce dernier, 2e classe au 3e zouaves, est tué le 26 octobre 1918 dans les Ardennes. Evoluant « des deux côtés du lac » Léman dans un milieu cultivé et bourgeois, Charles est initié au dessin et à la peinture dans une éducation stricte. Il fait ses études au collège Saint-Joseph de Thonon puis se destine lui aussi à la photographie. Il voyage beaucoup ; en 1910, il a un atelier à Lausanne puis vit à Vichy puis Paris où, en 1911, il est rattrapé par ses obligations militaires. Le 9 octobre de cette année, il est incorporé à 133e RI de Belley (Ain). Promu caporal le 12 avril 1912 et sergent le 25 septembre suivant, l’artiste en devenir change de voie et s’engage dans la vie militaire comme sous-officier le 17 avril 1913. Il se spécialise alors dans l’emploi des mitrailleuses et est affecté à la section du 2e bataillon. En juin 1914, le régiment est en manœuvres lorsque survient la mobilisation générale. Il est donc avec son homologue de la 82e brigade d’infanterie, le 23e RI immédiatement prêt à rejoindre la frontière comme régiment de couverture. C’est ainsi qu’on le retrouve au sein de la 41e division sur les cols vosgiens dès le 5 août 1914. A la suite des combats pour la reprise de la Fontenelle (Vosges) en juillet 1915, Vuillermet est nommé sous-lieutenant à titre temporaire (le 28) et adjoint au commandant de la 2e compagnie de mitrailleuses en mars 1916. Il passe lieutenant à titre temporaire en octobre 1916 puis à titre définitif, commandant la 1ère compagnie de mitrailleuses, au 1er juillet 1917, après l’affaire de la mutinerie des 1er et 2 juin à Ville-en-Tardenois (Marne). C’est à ce grade qu’il est tué le 2 juin 1918 à Bussiares dans l’Aisne lors de la retraite de l’Ourcq au Clignon.
2. Le témoignage
Perrier, Michel, Charles Vuillermet (1890-1918). Carnets et dessins d’un officier savoyard dans la Grande Guerre, Annecy, Le Vieil Annecy, 2012, 207 pages.
Charles Vuillermet est engagé dans la carrière militaire à la déclaration de guerre, avec la spécialité de mitrailleur. Son parcours est donc celui d’un sous-officier qui monte les grades par sa valeur militaire au sein d’un même régiment. Il occupe dans un premier temps les cols vosgiens et l’Alsace et la cristallisation du front à l’Est l’amène à « tenir » le secteur de la Fontenelle d’octobre 1914 à juin 1916. C’est la majeure partie de la couverture chronologique contenue dans le carnet de guerre de 96 pages qu’il tient du 1er août 1914 au 30 septembre 1916. L’affaire de la mutinerie de juin 1917 va entraîner pour le 133e de nombreuses sanctions, dont la dispersion des officiers considérés comme fautifs. Lui va hériter de cette situation du commandement d’une compagnie de mitrailleuses. Ayant abandonné son carnet à cette date, l’empreint documentaire effectué par Michel Perrier, le présentateur du legs de Charles Vuillermet, retrace son parcours par des courriers échangés avec sa famille et son frère Joseph. Dès lors, les quelques éléments que Charles donne dans ses écrits sont confrontés au JMO, aux historiques divisionnaire et régimentaire et à d’autres témoins du « Régiment des Lions » tels Joseph-Laurent Fénix ou les officiers que sont les docteurs Joseph Saint-Pierre, Frantz Adam, André Cornet-Auquier ou Louis de Corcelles [1], afin de combler les vides dans le témoignage de Vuillermet. L’ensemble est ponctué de dessins et de photographies de l’auteur, formant un corpus assez large de représentations issus du témoin.
3. Analyse
La première lettre permettant de sonder la vision de la guerre de Charles Vuillermet est datée du 12 septembre 1914, dans laquelle il confie : « Depuis la déclaration de guerre nous n’avons cessé de combattre. (…) Je vous assure que la guerre est une chose horrible, il y a des choses qui ne peuvent s’écrire, mais celui qui combat passe par des transes inexprimables quand les obus et les balles pleuvent de tout côté, et que l’on voit tomber ses camarades et cela pas un jour mais 8 ou 10 jours de suite et sans recevoir de troupes fraîches. Enfin je n’espère qu’une chose, avoir le bonheur d’en réchapper (…) » page 40. Confronté à la violence et à sa mort possible, il revient sur ce sentiment : « (…) si j’ai le bonheur de finir la guerre j’espère éclaircir bien des choses à mon sujet. Malgré tous les dangers que nous encourrons chaque jour je conserve bon espoir de revoir Thonon » (page 45) et estime la guerre à encore quelques mois en octobre 1914. Il s’aguerrit au feu et dénonce même la monotonie d’un front cristallisé à l’hiver 1914-1915, espérant obtenir rapidement « l’écrasement de ces vilains teutons » (page 48). Au fur et à mesure des mois, il abandonne la consigne de discrétion et ses courriers, plus intéressants que son carnet, se font alors plus descriptifs, notamment pour la guerre des mines ou les grandes affaires auxquelles le bataillon prête son concours en 1915 comme la reprise de Metzeral (juin), de La Fontenelle (juillet) en 1915 ou l’attaque sur Cléry-sur-Somme (carnet, le 30 juillet 1916). Hélas, ayant abandonné son carnet à la fin de 1916, il ne s’exprime pas sur la mutinerie massive de son régiment, se bornant le 6 juillet 1917 à signaler qu’elle lui a vraisemblablement donné du galon, celui de lieutenant : « on vient de me donner le commandement d’une compagnie juste au moment où nous remontions en ligne. (…) Je suis content de commander réellement, c’est la perspective du troisième ! » (page 139). Officier ayant une responsabilité importante, il semble qu’il ait alors de plus en plus remplacé l’écrit par le dessin, multipliant les représentations des paysages et les scènes de cantonnement avec un réel talent d’artiste, qu’il proposera d’ailleurs à l’Illustration, qui ne retiendra pas ses esquisses.
Yann Prouillet, janvier 2013
[1] Voir leur notice dans le présent dictionnaire.
Cuvier, Georges (1894-1987)
Quelques mystères à éclaircir
Nous tenons, dans ce dictionnaire, à définir le témoin avant de résumer son témoignage. Ici, nous ignorons les dates de sa naissance (vraisemblablement vers 1894 ou 1895) et de son décès. D’après plusieurs indices, il semble originaire du Bordelais (Marmande ? Langon ?), d’une famille qui a pu lui donner une solide instruction (il fait des citations en latin ; il lit Pascal, Bossuet, Chateaubriand).
Compléments en janvier 2018 grâce aux informations venant de Janine Hubaut : il est né le 29 août 1894 à Langon, fils et petit-fils de pharmaciens.
Il avait commencé des études de médecine, mais n’en était qu’au tout début puisqu’il a servi comme téléphoniste au 162e RI et non dans le service de santé. Il a repris et terminé ses études après la guerre puisque, dans un avertissement, il remercie son confrère le docteur Henri Bernard, auteur des quelques dessins illustrant le livre, et que l’exemplaire entre mes mains porte une dédicace « à Monsieur le Docteur de Nabias, bien confraternel hommage et témoignage de vive gratitude pour l’appui précieux qu’il m’apporte dans cette nouvelle « guerre sans galon », entreprise contre le cancer, sur le terrain biologique ». On apprend encore que la mère de Georges Cuvier a été infirmière à l’ambulance 1/38 pendant la guerre. Cela suffirait à définir l’auteur, mais cette notice lance un appel à tous ses lecteurs : peut-on en savoir plus sur la biographie de Georges Cuvier ? pourrait-on découvrir une notice nécrologique le concernant ? Un mystère de plus tient à la date de publication du livre : La guerre sans galon, À l’aventure avec le Cent-Six-Deux : des Révoltes, à la Victoire, Paris (80, rue de Bondy), Éditions du Combattant, sans date, 281 p. Des bibliographies proposent 1920, mais plusieurs arguments laissent penser à une date plus tardive : d’abord, le fait que le livre est publié alors que l’auteur a terminé les longues études de médecine commencées vraiment en 1919 ; ensuite le prix du volume broché de petit format, 12 francs, ce qui paraît excessif en 1920. N’oublions pas que J. Norton Cru ne le cite dans aucun de ses deux livres, pas plus que Ducasse dans son anthologie de 1932. Dernière interrogation : il dit avoir fait la Champagne et la Somme, mais pourquoi son livre, dont le contenu est très intéressant, ne commence-t-il qu’avec l’offensive d’avril 1917 ?
1. L’Aisne (avril-mai 1917)
L’offensive se prépare, énormes tanks, coloniaux, troupes russes ; curieux sentiment « fait du désir d’en finir avec ce long cauchemar, fait de confiance aussi, dans une issue victorieuse. Le moral de toutes les troupes est très haut. D’ailleurs l’accumulation des moyens mis en œuvre permet bien des espoirs. » Le pilonnage par l’artillerie française est effrayant, mais sera-t-il suffisant ? Les cavaliers sont prêts pour la poursuite, mais, le soir, « mornes et détrempés », ils reviennent, en même temps que passent les autos sanitaires bondées de blessés. C’est l’échec. Une fois de plus, la piétaille a payé pour « les nobles élans des gens huppés aux sentiments élevés, restés, eux, bien à l’abri. (p. 16). L’auteur décrit alors le nouveau modèle de masque à gaz, le barda qui pèse 32 kg, le bled aux abords de la ferme du Choléra, la cagna des téléphonistes (p. 31) : « une simple niche perpendiculaire à la tranchée, de la longueur d’un homme couché, recouverte de quelques planches, camouflées par des pelletées de terre ». La relève conduit à une sorte de « paradis » où on attendrait bien la fin de la guerre.
2. En révolte (mai-juin 1917)
Les « causes » de la révolte sont, d’après Cuvier, l’échec de l’offensive, « cruelle déception » venant après bien d’autres, l’impression que des erreurs ont été commises, le manque de permissions, l’exaspération devant le bourrage de crâne… Certains se vantent d’avoir reçu des mots d’ordre de Paris. Les hommes du Nord et du Pas-de-Calais, en forte proportion dans le régiment, sont particulièrement sensibles à « un avenir assombri » par l’échec et par la défection des Russes. « Tout est âprement critiqué », les gradés, la nourriture, les promesses de repos non tenues… Le drame éclate un soir au Foyer du Soldat (date non précisée, mais le tableau dressé par Denis Rolland montre qu’il s’agit du 21 mai, à Coulonges), à la veille de la remontée en ligne : cris, menaces, « chasse aux renards », interminables palabres avec le colonel. « Il y a bien un millier de Poilus rassemblés » (300 d’après le tableau de D. Rolland). Cela dure plusieurs jours. Georges Cuvier dit comprendre ses camarades, avoir cessé d’être cocardier, n’aspirer qu’à une chose, la paix, mais il ne peut pas participer, pas plus que « s’opposer au débordement actuel ». Le refus du gouvernement d’accorder des passeports aux députés socialistes pour se rendre à Stockholm, « cette nouvelle tombe comme un coup de massue. Le rêve de paix entrevu par beaucoup s’écroule brusquement. […] Le Poilu est de nouveau rivé à sa lourde chaîne. » Permissions, améliorations diverses et période de repos ramènent le calme. Le colonel Bertrand ne dénonce personne (aucune condamnation d’après le tableau de D. Rolland). Parti en permission, Georges Cuvier décrit encore les cris et chants séditieux dans les gares, le matériel vandalisé.
3. Verdun rive droite (juillet-août 1917) et 3bis (septembre 1917)
Secteur dur à tenir : « Assez ! Assez de cette sauvagerie ! À quoi donc tout cela rime-t-il ? » Mais (p. 85), « le bassin de Briey continue sans inquiétude à façonner les obus dont nous serons arrosés. Par quel mystère troublant n’anéantit-on pas tout cela ? Nous en avons la rage au cœur ! »
4. En Lorraine avec les Sioux (octobre 1915-mai 1918)
Les Sioux sont évidemment les Américains, « fêtés partout, riches comme Crésus ». Mais la guerre continue (« il y a bien eu la guerre de cent ans ») : « Quelle monstrueuse responsabilité pèse sur ceux qui ont provoqué tant de souffrances et fait faucher les meilleurs, les plus utiles de notre génération ! »
5. En avant de Compiègne : la ferme Porte (juin 1918)
Une scène de pillage (p. 174) ; une attaque où les Allemands se sont enfuis avant le contact à l’arme blanche (p. 178) ; un poème de Cuvier en l’honneur du colonel Bertrand (p. 191) ; une définition du « vrai front » allant « du premier Fritz au premier gendarme (p. 200).
6. Reprise de Soissons (juillet-août 1918)
En permission, « le moral du Sud-Ouest n’est pas brillant », mais les prisonniers allemands sont gras et prospères : « En voilà pour qui la guerre est finie ! » Retour au front, il faut marcher « comme des bêtes de somme », retrouver les spectacles horribles (p. 216), souffrir à nouveau de la soif, se protéger des nappes de gaz. Mais on avance : « Quelle joie de conquérir tout cela ! »
7. Du plateau de Crouy aux abords de Laffaux (fin août-septembre 1918)
Les bleus arrivent en renfort ; il faut « se redresser » devant eux (p. 241). Les prisonniers allemands « sont squelettiques, sales, hébétés, affamés. On leur donne quelques vivres […]. Il n’y a aucune haine de la part des Poilus, c’est presque une fraternisation dans la douleur. Ces pauvres bougres sont conduits à force de « bourrage de crâne », aussi n’est-ce point tant après eux que nous en avons, mais contre la caste qui les mène. » Les tanks sont de la partie, mais tombent en panne (p. 261). L’élan des Poilus est désormais irrésistible.
8. Le chemin du retour
« Vive la vie ! », conclut Georges Cuvier.
Rémy Cazals, avril 2016
Janvier 2018 : Janine Hubaut nous signale qu’une courte biographie de Georges Cuvier se trouve dans la thèse de Marie Derrien, « La tête en capilotade ». Les soldats de la Grande Guerre internés dans les hôpitaux psychiatriques français (1914-1980). Thèse de l’université de Lyon, en ligne : appeler « Marie Derrien – Cuvier ». Georges Cuvier s’est marié en 1922 ; il a monté à Bordeaux un laboratoire d’analyses, puis s’est beaucoup intéressé aux anciens combattants internés à l’asile de Cadillac, et, de là, au problème pour l’ensemble de la France. Il est mort à Paris en 1987.
Tropamer, André (1893-1968)
Ce simple soldat est issu d’une famille bordelaise de magistrats, ce qui lui vaut d’être accueilli à la popote d’un commandant de sa parenté, et de disposer d’un appareil photographique. Il a constitué après la guerre un recueil de 200 tirages sur papier (photos prises en secteur calme) complété par un texte intitulé « Itinéraire », rédigé sur 18 feuillets, qui décrit brièvement les conditions de vie d’un agent de liaison. Le fonds, qui appartient à Bernard Sargos, est présenté avec trente reproductions par Damien Becquart dans La Lettre du Chemin des Dames, n° 25, 2012.
Le 14 mars 1915, André Tropamer rejoint le 127e, un régiment du Nord où il est mal accueilli ; son baptême du feu date du 5 avril en Woëvre. Il se trouve ensuite en Champagne, dans l’Aisne, à Verdun et dans la Somme : « Que de places vides dans nos rangs », constate-t-il, le 9 septembre 1916. Au début de 1917, son régiment approche du Chemin des Dames. Le 16 avril, il ne livre que des notes laconiques, mais évocatrices : « Les deux premières lignes boches sont aisément franchies mais nous sommes arrêtés, avec de lourdes pertes, sur la troisième, à 600 m. à peine de notre base de départ – Désordre et confusion inouïs parmi les morts, les blessés râlants et les tirailleurs sénégalais, nos voisins de gauche, qui courent en tout sens, ayant perdu la tête dans le vacarme – Liaison des plus dures et des plus périlleuses à assurer. » Une précision, le 22 avril : « Neige et pluie abondante qui transforme le terrain en un lac de boue où l’on enfonce au-dessus des genoux. Pour assurer la liaison – et combien lentement – je dois retirer avec les mains chaque jambe, l’une après l’autre, de la boue, et cela sous des rafales d’obus. »
Dès que possible, il revient à des préoccupations pacifiques : écouter le chant des rossignols, photographier ses camarades, apprivoiser une pie, un geai… Au printemps 1917, il n’occulte pas les mouvements de révolte des Russes qui hurlent « Nicolas kaput », mais aussi des Français : « Au camp de Mailly, manifestation quasi-révolutionnaire parmi les troupes qui s’y trouvent. Aucune répression. J’en suis stupéfait ! » Et lorsqu’il revient de permission en train, le 21 juin, il se tient à l’écart du mouvement contestataire en précisant qu’il le désapprouve.
Rémy Cazals
Payen, Maurice (1885-1964)
1. Le témoin
Né à Méricourt-Corons (Pas-de-Calais) en 1885 dans une famille de mineurs. Assiste à onze ans aux événements qui accompagnent la catastrophe de Courrières (10 mars 1906, 1099 morts). A treize ans, il est galibot puis chargeur, et à dix-sept à la veine. Il fuit l’arrivée des Allemands dans la région de Lens en octobre 1914 et est incorporé (classe 15) au 127e régiment d’infanterie (Guéret) en décembre 1914. Entraîné au camp de la Courtine (Creuse), il monte au front avec le 409e RI en avril 1915 et occupe des secteurs calmes dans l’Oise. Malade, il est hospitalisé à Montdidier en décembre 1915. Première permission et retour (janvier 1916). Prêté au 2e Génie (mineur volontaire) pour la guerre de mines dans la Somme. Départ pour Verdun et montée en ligne le 28 février 1916, relève le 9 mars. Repos dans l’Oise puis réserve dans l’Aisne, puis secteur Berry-au-bac. De fin août à octobre 1916 dans la Somme (Soyécourt /Ablaincourt) avec attaques. Compagnie hors-rang pour des travaux de pionnier jusqu’en juin 1917. Volontaire pour l’Armée d’Orient, versé au 2e puis 4e Régiment de zouaves. Grèce – Serbie – Bulgarie d’août 1917 à mars 1919. Démobilisé en août 1919.
2. Le témoignage
Maurice Payen, Mille-feuille, carnets inédits d’un poilu du Nord, Bouvignies, les Editions du Nord Avril, 2007.
Le texte est un récit de vie (« Mille-feuille de souvenirs ») depuis sa naissance jusqu’à son expérience de la Grande Guerre. Constitué de carnets racontant le quotidien et les événements marquants de sa guerre, l’ensemble est publié par son petit-fils Bernard Léonard-Payen ; il contient des carnets manuscrits, rédigés avec soin, illustrés de croquis et des lettres envoyées du front. Le récit se termine en 1920.
La rédaction des carnets, postérieure au conflit, est précise sur les lieux et les dates. Le récit se compose de scènes classiques (tranchée, bombardement, relève, repos…), mais aussi d’éléments plus rares dans les témoignages courants, avec par exemple l’évocation de vols, d’Allemands achevés ou de la sexualité des infirmières de l’hôpital militaire de Gumendzé (Macédoine grecque) ; ainsi ce récit parfois picaresque pose la question de la réécriture : la narration des faits dans le texte définitif diverge parfois de ce qui est donné dans les lettres à la famille, envoyées immédiatement après ces événements. Outre la véracité de certains faits (exagération ? enjolivement?), le texte, non publié du vivant de l’auteur, est parfois d’une tonalité qui nous mène plus vers J. N. Cru (traquer les tartarinades) que par exemple vers l’auto-minoration de la violence du témoin. Si d’un autre côté le récit est tenu pour vrai, il est tout aussi intéressant.
Le témoignage est aussi utile car il évoque le destin d’un homme jeune (« ses ennemis lui avaient saboté sa jeunesse » [introduction]) avec la mentalité et la culture ouvrière qui est la sienne : il nous montre un soldat qui a passé presque 5 ans sous les drapeaux, qui a fait la guerre des mines, Verdun et la Somme, vu une mutinerie en 1917 et eu une expérience du front d’Orient, lui le mineur qui n’avait jamais voyagé.
3. Analyse
Maurice Payen est un jeune homme (classe 1915) mais son expérience de mineur de fond, métier commencé à treize ans, en fait un soldat débrouillard. Courageux mais turbulent, blessé, il est cité mais aussi puni de prison (« notre lieutenant de compagnie ne me gobait pas parce que j’étais rouspéteur » p. 185), c’est le témoignage d’un soldat du genre « loustic », très attaché à sa famille et aux camarades de la région de Lens qu’il se fait pendant le conflit.
M. Payen déteste les Allemands (« cette bande d’assassins » p. 80, « ces sales boches » p. 78) et ne semble pas politisé : p. 151 « un jour de la fin avril en 1917, nous fûmes appelés pour réprimer un début de révolte que les 107e et 172e RI avaient fomentée. C’était, disait-on, une répercussion de la révolution russe. Il n’y a eu aucun coup de feu et tout rentra dans le calme après plusieurs heures de pourparlers. »
Payen évoque des tensions graves avec les mineurs étrangers ressortissants de l’Alliance du bassin de Lens lors de la déclaration de guerre (fin juillet-début août 1914)
p. 42 « À Méricourt – Corons, les joyeuses agitations des étrangers devinrent inquiétantes. Ils nous provoquaient en se promenant dans nos rues, en chantant avec des accordéons. Notre indignation fut prompte et une décision rapide fut prise. (…) Le 2 août, tous les hommes valides se formaient par groupes et une battue monstre était organisée pour arrêter tous les étrangers. La chasse à l’homme commençait. Tous les étrangers étaient arrêtés chez eux ou dans les rues, mis en lieu sûr, puis incarcérés à Saint-Etienne. Deux Autrichiens récalcitrants, armés de haches, étaient attrapés à la fosse 3, au moment où ils voulaient couper les câbles de chanvre des cages de la fosse. L’un d’eux fut tué à coups de pavés en grès sur la tête, sous les yeux de sa femme et de ses enfants. L’autre était très malmené et recevait bon nombre de coups. »
Agé de 19 ans, Payen est réfugié en octobre 1914 à Saint-Valéry-sur-Somme, il est convoqué (classe 15) et évoque le conseil de révision en temps de guerre – novembre 1914. Pour ces jeunes gens, l’ambiance fait encore penser au temps de paix
p. 49 « Quel triste conseil, pour nous, qu’aucun parent n’accompagnait. J’avais eu un bien gros cœur de voir les jeunes gens du pays s’amuser, chanter et danser en compagnie des leurs. J’étais reconnu « bon » pour le service armé, ainsi que mes compagnons d’infortune, sauf Ch. Landas qui était ajourné et qui pleurait de mécontentement de ne pouvoir nous suivre dans les pérégrinations qui nous attendaient. »
Au front (Oise 1915), les relations avec les Allemands sont parfois verbales (et hostiles)
p. 59 « On entend une vive fusillade qui semble durer très longtemps, entre les « boches » et les Français. Lorsque la fusillade s’arrête, on saisit des cris de part et d’autre. C’était des injures que chaque camp s’envoyait. » ou
p. 80 « Un soir, vers cinq heures, les boches se sont mis à crier et toutes les voix faisaient un vacarme épouvantable. On nous alerte… Et nous voici tous à nos postes de combat. Nous écoutons… Quelques boches nous insultent en langue française. Certains disent les pires bêtises. Nous sommes obligés de croire qu’ils savent qu’ils ont en face d’eux un régiment de « gars du Nord », puisque toutes leurs sottises ne s’adressent qu’à ceux de chez nous. Nos chefs nous défendent de répondre, mais c’en est trop. Nous les insultons par les mots les plus grossiers que nous trouvons afin de blesser leur amour propre. »
Les relations avec les civils peuvent être mauvaises (novembre 1915, Ressons-sur-Matz)
p. 82 « Ce village n’est pas hospitalier. Les gens ne sont guère aimables envers nous. Avant que nous arrivions, les cordes des puits avaient été enlevées par les habitants pour nous empêcher de boire.
Et
p. 83 « Je demande un jour, d’une façon aimable, à une femme qui est sur le seuil de sa porte, si elle veut me donner un chou pour faire de la soupe !? Elle me répond qu’elle aimerait mieux donner ses choux aux boches plutôt que de m’en vendre un… Que nous sommes une bande de brigands…et bien d’autres ! J’ignore pourquoi… Et je l’ignore encore. Mais ce qu’il y a de certain, c’est que le lendemain, la bonne femme n’avait plus de choux dans son jardin…Oh ! Quelle trombine, elle faisait ! »
Evocation de l’hygiène corporelle
p. 86 le soldat Hérault est dénoncé avec une tunique sur laquelle « il y avait plus d’un millier de poux, à l’envers comme à l’endroit ». Sa tunique est brûlée et il est conduit aux bains douche à l’infirmerie. « Il gelait et la neige tombait. Hérault revenait alors au cantonnement habillé à neuf. Personne ne voulait le laisser entrer: – Va camper tout seul et ailleurs qu’avec nous ! lui disait-on. Il n’avait le droit d’entrer que pour manger la soupe près de la porte. Quinze jours après, il était encore plein de poux.
On l’appelait « le pouïeu » (pouilleux). Il se laissait aller et ne se nettoyait pas assez. »
Chapardage cruel – au cantonnement – des comportements de « garnements » ?
p. 107 « Un matin, mon camarade Gheyssens venait m’aviser qu’il avait attrapé le chat du curé et qu’il allait le tuer pour améliorer notre ordinaire. J’assistais en spectateur à cette mise à mort qui avait lieu sous un hangar. » le chat est pendu, « gigote en se baladant dans tous les sens », est achevé à la pelle-bêche mais la corde casse « le chat, blessé à mort, fit des bonds formidables et dans toutes les directions… tant que tous, nous nous sauvâmes. » le chat est enfin mort « Je m’en suis bien régalé et, en temps de crise, j’assure que le chat remplace avantageusement le lapin. Même s’il ne se tue pas de la même façon. »
Guerre de mine, Payen est « prêté » comme mineur volontaire aux travaux de sape
p. 107 extrait d’une lettre à ses parents 24 janvier 1916 « C’était les boches qui avaient fait « buquer » une mine contre nous. (…) Nous savions qu’ils allaient faire sauter à cet endroit, alors personne n’y travaillait. Nous avions bourré la voie avec des sacs de terre, de sorte que la mine, au lieu d’esquinter notre galerie, elle en fit un canon et en abîma la leur. Il faut leur faire voir que les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sont aussi malins que les mineurs de Westphalie. Votre fils Maurice. »
comportement lorsque les Allemands font sauter la mine
p. 108 « Dans notre affolement, on culbutait les vieux « pères » territoriaux, et on passait dessus pour nous sauver plus vite. Ils avaient leurs raisons de nous appeler « sauvages ». Il fallait de bonnes jambes pour s’éloigner d’un lieu d’asphyxie, exposé généralement à sauter d’une seconde à l’autre. Mais malheureusement, les territoriaux y mettaient une lenteur qui ne nous plaisait guère. »
conditions de travail des sapeurs-mineurs
p. 108 « Le lendemain, je vais travailler au chantier pour réfectionner les fronts de la galerie éboulée. Au bout de cinq minutes, on remonte Lecomte à moitié asphyxié… Cinq minutes après, c’est mon tour d’être tiré par une corde attachée à la ceinture et ainsi de suite… A tour de rôle ! Et sitôt revenus à nos sens, on recommence.»
Verdun
Le récit montre les traces du tout début de la bataille
p. 117 « Nous arrivons enfin dans le village (Vaux 28 février). Il était encore habité civilement lorsque l’offensive allemande se déclencha. Aussi, certains civils avaient trouvé la mort chez eux. Au lendemain de notre arrivée, j’ai vu, allongée au milieu de la route, une femme tuée en face d’une épicerie, près d’un trou d’obus de gros calibre qui devait être l’effet d’un 380 ou 420. J’ai vu également une grand-mère, morte dans son fauteuil auprès de la cheminée. C’est dire que les habitants avaient été surpris par l’attaque brusque et déclenchée avec violence par les Allemands.
Une anecdote qui suscite la perplexité, mais qui a pleinement sa place dans l’univers narratif du poilu de Verdun (cf tranchée des baïonnettes)
p. 122 Tout à coup, un 420 éclate plus près ; je l’avais entendu venir et j’étais rentré dans la redoute. Au moment où je ressortais pour voir où il avait éclaté, un soldat arrive du ciel… mort… Il tombe à mes pieds… Un culot d’obus d’un diamètre de zéro mètre quarante-deux vient doucement rouler sur la plate bande pour s’arrêter à la porte.
Ce soldat… mort était du 233e Régiment d’infanterie. Il avait un habillement de temps de paix : képi rouge et pantalon rouge, capote bleue. Il n’était aucunement défiguré et avait même encore les joues rouges. Cette chose nous fut incompréhensible !
Notre capitaine nous expliqua que ce soldat, sans doute garde-voie… territorial, avait dû être enterré depuis le début de l’offensive. Admirablement conservé, il fut projeté par l’obus de 420. Il nous donna l’ordre d’aller le mettre en terre.
Payen réussit à échapper à la mort ou la captivité- Lettre à ses parents, 15 mars 1916
p. 132 « Enfin, ne vous troublez plus pour moi. Je suis rescapé de la bataille de Verdun. Pour la première fois que le 409e va aux attaques, il est bien reçu par les boches. De ma compagnie, nous restons à 117 sur 250. »
La Somme
montée en ligne fin août 1916 à Soyécourt facétie macabre dans les ruines du village, montrant un humour particulier, mais ne pourrait-on pas le transposer dans la guerre du Pacifique (P. Fussel) ou au Vietnam, voire en Afghanistan ?
p. 139 « Nous avons creusé une tranchée dans ces ruines, l’occasion de retrouver le cadavre d’un boche en décomposition ; après lui avoir décapité la tête avec une pelle bêche, je l’empalais sur un pieu et, muni d’une tenaille, je lui arrachais les dents pour me faire une renommée de dentiste amateur, au grand amusement général de mes camarades. »
Offensive du 10 septembre 1916 Ablaincourt, le 409e attaque après deux jours de préparation, le succès se traduit par une avancée de plus d’un kilomètre.
p.141 « Les poilus courent vers les tranchées ennemies. Je saute dans l’une d’elle. Là je trouve deux Allemands assis, fumant une cigarette et qui aussitôt me font : « – Camarade!» Je les fais monter sur le parapet de la tranchée. Lorsqu’ils y sont, je fais feu. Ils tombent tous les deux. Nous avons reçu l’ordre de ne pas faire de prisonniers.
Je me rends compte quelque temps après que seulement l’un d’eux a été tué. Le second fait le mort. Je le fais déguerpir vers l’arrière où il est zigouillé par un adjudant, d’un coup de révolver à la gorge. Un peu plus loin dans la tranchée, je trouve deux boches ensevelis jusqu’à la poitrine, à l’entrée d’un abri éboulé. Une balle, tirée à bout portant dans la poitrine, les libère de la vie. »
L’édition de « Mille-Feuille » propose aussi ensuite la reproduction d’une lettre de Payen à ses parents (datée du 13 octobre) qui narre les mêmes événements (orthographe d’origine conservée)
p. 143 « Mes Chers Parents, (…) début de l’attaque (…) Ceux qui accourent vers moi en levant les bras, malheureusement pour eux, nous ne faisons pas de prisonniers. On les tue à bout portant. Arrivés dans les tranchées allemandes, à coup de fusils, nous tuons les occupants qui criaient « -Kamérat !! » Et à coup de grenades, nous nettoyons les abris qui sont maintenant encombrés de cadavres Bôches ! Suivis de deux copains, je cours dans la tranchée. Je trouve deux bôches assis et fumant une cigarette. D’un coup de fusil, j’en tue un. Et un de mes copains, tue l’autre.
Nous continuons notre course, nous voyons deux bôches à moitié ensevelis ; nous approchons. Ils nous tendent les mains pour les tirer de là, mais deux balles bien placées les firent rester sur place.
Nous étions fou, par l’alcool que nous avions bu, et par l’odeur de la poudre. »
La lettre aux parents est un témoignage bien antérieur à la rédaction définitive des carnets ; Les courriers, d’ordinaire, sont volontiers elliptiques pour ne pas inquiéter les proches. Ce type de récit est d’autre part interdit par la censure. La lettre montre que le récit se reconstitue avec ce courrier qui viendrait aider la mémoire pour la rédaction ; des changements apparaissent : le copain qui tue l’un des « bôches » fumant une cigarette, devient un adjudant, avec un revolver. La question de la véracité est également posée, avec l’authenticité de : « nous ne faisons pas de prisonniers » qui devient « nous avons reçu l’ordre de ne pas faire de prisonniers » : cette ordre a-t-il existé ?
Une autre aventure, dotée de deux versions, alimente cette problématique
p. 147 lendemain « Soudain, à vingt mètres en avant de moi, je vois un boche, puis deux, trois, quatre… cinq, montés sur la tranchée : « – Camarades ! » font-ils, les bras levés en l’air. Mon fusil en mains, je monte sur le parapet de la tranchée et leur fais signe de venir. Les boches se décident, d’abord lentement. J’avance également. Mais bientôt, ils sont douze à courir vers moi. Je les arrête pour les rassembler et les fais descendre dans notre tranchée. Après les avoir fouillés, je les conduis au poste du colonel en évitant les tranchées toujours bombardées, à découvert et au pas de gymnastique. En cours de route, quatre d’entre eux sont chargés de porter une toile de tente dans laquelle est enroulée un des leurs couvert d’éclats d’obus. Sa figure est criblée de shrapnells, ses yeux crevés. Tous ses membres sont atteints.
Certes, c’est une lourde charge. Les artilleurs boches nous envoient une rafale d’obus. Soudain, mes prisonniers délaissent leur fardeau pour se sauver. J’arrête la troupe et tous se couchent en entendant le sifflement d’un gros obus qui semble venir vers nous. Seul, debout, je nargue les artilleurs boches en leur montrant le poing et en les insultant – comme s’ils me voyaient et m’entendaient ! – et le gros noir explose à dix mètres en avant de moi. Je n’eus absolument rien.
Heureusement, les boches n’ont pas continué à tirer. J’ai achevé sur place le moribond qui fut délivré de ses souffrances par une balle dans la tempe. Ensuite, j’arrivai au P.C. du colonel, où je me fis engueuler parce que je ramenais douze prisonniers !
Le Colonel me demanda ce qu’il allait faire de cette capture ? Qu’il allait les occuper comme brancardiers pour ramasser les blessés français. Et si besoin était, leur flanquer une balle dans le dos. »
En reprenant la fin du courrier évoqué plus haut, on trouve, pour le même fait :
p. 144 « Le soir, ma rage était apaisée. Six bôches se rendaient à moi. Je les ai recueillis avec un copain et les ai emmenés en arrière, chez le colonel. »
Les Allemands sont passés de six à douze, ils laissent achever leur blessé sous leur yeux, et Payen dispose d’une grande autonomie, sans passer par des gradés : pas de sergent, pas d’officier, pas de P.C. de bataillon… » ; ici on témoignera simplement d’une certaine perplexité dans un récit qui fait plus penser à Gaspard qu’au Feu.
En juin 1917, Payen se porte volontaire pour l’Armée d’Orient. Versé au 2e Régiment de Zouaves, le trajet de Lyon jusqu’aux tranchées en Serbie (rive gauche du lac Doiran) dure du 30 juillet au 19 septembre 1917.
Payen est occupé à faire des travaux dans un camp retranché, et son récit parle peu des ennemis ; il travaille, accueille dans son abri un « Bat’ d’Aff » condamné à dix ans de « Biribi », en liberté provisoire pour la durée de la guerre :
p. 174 « En bon camarade, il ne me lâcha plus. Ses compagnons d’infortune (le même convoi qui vient des bagnes d’Afrique) m’ont félicité du beau geste que j’avais eu envers lui. Ils me protègeraient contre les violences de n’importe qui. »
Il remonte en ligne en mars 1918 sur le Vardar. Les préoccupations tournent autour du moral fluctuant, des conditions matérielles, des nouvelles de la famille et de sa fiancée..
p . 183 « le 27 avril 1918. Relevés et mis en réserve du Bataillon, au ravin de l’aéroplane. Cantonnés dans un abri souterrain, individuel. Là, j’ai fait ma provision d’un litre de gnôle d’avance. Nous touchions journellement une bonne ration de cette gnôle, tous les matins. Et plusieurs copains me la donnaient. »
Légèrement blessé le 14 juin 1918 face aux Bulgares et évacué à l’Ambulance transformée en hôpital temporaire, à Gumendzé. Fin juin, il quitte l’hôpital pour servir en ville, comme ordonnance des infirmières.
p. 189 Lettre Mes chers Parents, Ma santé est excellente, mes blessures sont presque guéries. Hier, l’infirmière major, une dame de la croix Rouge, m’a fait appeler et m’a demandé si je voulais faire l’ordonnance des dames de l’hôpital. Alors, naturellement, j’ai accepté avec beaucoup de politesse ; (…) Il n’y a qu’à arranger leurs chambres, faire la vaisselle et leur servir à manger à table. Et nous serions deux pour faire ce petit boulot. Elle m’a aussi dit que je pourrai rester trois mois, six mois, même plus. Si seulement je pouvais choper ce filon ! C’est bien mon tour de pouvoir être embusqué à l’arrière. »
Il reçoit l’autorisation du médecin major et s’occupe alors en ville des neuf chambres des infirmières: il apprécie cette situation protégée. « Le temps se passait mieux qu’aux tranchées » Il évoque aussi de façon particulière ce monde féminin :
p. 190 « Comme consigne, on m’avait dit : Vous êtes aveugle et sourd. J’avais compris. Et puisque je n’ai pas le droit de vous raconter quelque chose, sachez seulement que pour des femmes honorables, elles étaient tombées bien bas ! Mademoiselle Matignon était une ancienne fille soumise d’une maison de tolérance de Marseille. Mademoiselle Delaporte également car elle sortait d’une boîte de Boulogne-sur-Mer. Elles partaient souvent en auto, en compagnie d’officiers. On les ramenait le matin vers les quatre heures : c’est moi qui leur ouvrais ! Curieusement, il évoque plus loin une autre infirmière d’un tout autre milieu, et on peut supposer que la proximité avec d’anciennes prostituées ne va pas de soi :
p . 190 « Parmi les infirmières, il y avait Madame Giraud. Son mari était commandant à l’Etat Major. Son fils était lieutenant aviateur et venait journellement survoler l’hôpital de Gumendzé-ville. » Payen réévoque une des infirmières citées, lorsqu’un copain lui demande « (p . 195) comment il ferait bien pour avoir le plaisir de parler à une infirmière qui lui plaisait beaucoup. – Qui ? lui demandais-je. – mademoiselle Matignon ! C’est alors que je l’informais sur ce qu’était réellement la demoiselle en question : une ancienne fille soumise dans une maison de tolérance à Marseille, maîtresse de tous ceux qui lui plaisaient, même Sénégalais à peau d’ébène !!! (…) C’est elle qui visitait tous les blessés légers et leur faisait les pansements dans son bureau et à l’intérieur duquel se trouvait un divan lit d’une personne. Chacun d’eux, même à une main, devait se déshabiller nu comme un ver de terre ! C’est ainsi qu’elle assouvissait ses désirs sexuels parmi les blancs et les noirs. » et plus loin (p .197) l’auteur, tout en nous donnant un indice sur l’époque de la rédaction définitive de ses carnets, tire les enseignements de son expérience « …Mes infirmières !! Elles avaient toutes le béguin envers les officiers. Quoiqu’il en soit, j’ai toujours déconseillé à mes filles de faire un tel métier, même dans le civil.
S’agit-il ici de fantasme ? L’évocation en elle-même est précieuse car les poilus évoquent très peu le sexe dans leurs témoignages (J. Y. Le Naour) ; on ne sait rien de l’attitude de Payen lui-même, sinon qu’il se montre très épris dans ses courriers à sa fiancée (p. 164 «je suis pour toujours ton Maurice qui t’aime. 1000 bons bécots. Ma langue dans ta bouche. ») A un autre moment, il évoque une jeune tzigane de dix-neuf ans qui faisait la lessive et le repassage pour les infirmières :
p. 199 Catarina était une fille très sérieuse et obéissait, comme toutes les femmes en général, aux mœurs de son pays si différentes des nôtres. J’ai vu un jour un capitaine de cavalerie qui voulait l’attirer en lui faisant miroiter une grosse liasse de billets de banque. Cela eut lieu malgré ma présence. D’ailleurs ce vulgaire salopard ne cachait pas l’immoralité de son geste. Elle le repoussa alors dédaigneusement en le priant de s’en aller s’il ne voulait pas avoir des ennuis. En Grèce comme en Macédoine, le respect des femmes est sacré. Il y eut peut-être de rares exceptions, mais je n’en ai jamais connues. »
L’auteur n’évoque pas de liaison personnelle et sous-entend une certaine chasteté par ailleurs :
p. 199 « Il existait dans ce pays comme partout ailleurs, des maisons de tolérance tenues par une ou deux femmes, parfois plus, et qui ouvraient de telle heure à telle heure. Il y faisait queue plus de deux cent poilus de toute race : grecs, serbes, albanais, monténégrins, français, anglais, chinois, sénégalais… Ceux qui voulaient revenir en bonne santé en France s’abstenaient de cette répugnance. »
Après l’armistice, Payen passe en Serbie puis en Bulgarie, est à Sofia en décembre 1918. Le 9 février 1919, c’est le rapatriement vers la France où il arrive le 11 mars ; il est démobilisé le 24 août 1919.
Vincent Suard 10/05/2012
Clergeau, René (1886-1920)
René-Louis-Paul Clergeau, né le 20 octobre 1886 à Sainte-Lheurine en Charente Inférieure, aujourd’hui Charente Maritime. Il est issu d’une famille d’instituteurs. Son père, Adolphe, et sa mère, Louise berthe Lebrun exerçant tous deux cette profession, comme lui-même. La guerre déclarée, il est affecté au 206e RI de Saintes, régiment dans lequel il est chargé du ravitaillement. Le 8 août 1911, il épouse à Saintes Augusta Lacan, elle même institutrice (puis professeure d’anglais, de français et de mathématique, et qui s’éteindra le 2 avril 1977), avec laquelle il a un fils né le 6 avril 1918. René Clergeau décède le 9 mars 1920 des suites des gazages reçus en 1918.
Clergeau, René, Les cahiers de René Clergeau, 1914-1919. La Grande Guerre au jour le jour… Villebois, La Plume du Temps, collection Histoire, 2002, 337 p.
René Clergeau, instituteur charentais affecté au 206e RI et chargé du ravitaillement, a reproduit dans 6 carnets de guerre, écrits au crayon de papier, parfois en style télégraphique, de format 110×170 mm, qu’il appelle affectueusement ses « chers petits compagnons », sa campagne contre l’Allemagne, du 12 août 1914 au 24 février 1919. Il dit dans l’introduction de ceux-ci : « Ce carnet est pour ma femme, pour mon fils, pour moi si je reviens » et nous renseigne sur sa volonté de transmettre : « J’ai donc écrit au jour le jour, tout simplement les évènements survenus durant la campagne, soit dans mon régiment, soit à moi personnellement. Je ne cherche pas à faire le plus petit étalage sensationnel de faits plus ou moins authentiques n’ayant qu’un but, celui de donner un semblant de valeur à leur acteur. (…) D’ailleurs, je ne fais point un roman mais un simple recueil qui devra aider pour ma mémoire dans l’avenir » (page 8).
Principalement affecté en Lorraine, il subit de plein fouet la bataille de Verdun dans le secteur d’Avocourt et renforce parfois d’autres secteurs en ébullition, notamment au cours de la deuxième bataille de la Marne. Caporal puis caporal-fourrier, il traverse toute la guerre sans aucune blessure – sauf une égratignure de ronce et une grippe espagnole peu active – mais il décède toutefois des suites des gazages de 1918.
3. Résumé et analyse
Formidable document d’une continuité et d’un intérêt descriptif remarquables. Instituteur, son esprit est vif et clair et sa plume, parfois sans concession. René Clergeau nous donne à lire un carnet de guerre référentiel dans la littérature testimoniale. De nombreux éléments peuvent être dégagés de son étude et sa longue affectation en Lorraine, ainsi que la vision du choc de Verdun sont autant de tableaux d’intérêt. Tout y est ; description du front, organisation du régiment, noms de lieux et de personnes, le texte ne manque pas d’informations utiles à l’Historien même si les notes s’espacent pour l’année 1918, étant regroupées mensuellement par le scripteur. Certes, René Clergeau se fait promoteur d’un certain bourrage de crâne dans les premières pages mais il ajuste ses tableaux au fil du temps et livre parfois ses sentiments, vindicatifs contre la presse ou l’arrière. Sa vision, même sommaire, des mutineries est également d’intérêt mais il est singulier de constater le laconisme du 11 novembre 1918 où René Clergeau ne semble faire montre d’aucun sentiment particulier à cette date pourtant mémorable. Cette note révèle l’attrait d’une étude psychologique pouvant être effectuée sur ce témoignage. Est-il un héros du front ? Le témoin se décrit comme un « poilu de derrière la tranchée » type de combattant auquel il rend hommage (page 160). Mais non combattant, il n’est pas un « non souffrant » et, à Culmont, le 16 février 1916, il déclare : « Mes yeux sont encore malades mais cette fois ce sont seulement les paupières, intérieurement. Si je dis cela à ma chère femme, elle va s’inquiéter et je sais d’avance quelle fâcheuse répercussion cela produirait sur sa santé, la sachant impressionnable et prête à s’alarmer. Me faire voir au major, c’est me faire évacuer, ma femme l’apprendra et se frappera encore bien plus. Evacué, je peux suivre un traitement court et rester dans la zone des armées, je pourrais revenir à mon régiment mais si le traitement est long et qu’on me fasse filer dans un hôpital de l’intérieur, c’est ensuite le dépôt et le départ pour un régiment quelconque où je ne connaîtrais personne. Tout cela m’ennuie bien et cependant je ne peux écrire cela à ma chère femme, je préfère lui mentir un peu plutôt que de l’inquiéter » (page 128). Ainsi sont résumés plusieurs raisons répondant aux questions de l’autocensure et du pourquoi ils ont tenus.
Certes il rapporte au début de la campagne qu’ « on a vu dans leurs tranchées, des hommes debout morts, se soutenant mutuellement tellement ils sont nombreux » (page 12), il souscrit à une espionnite qu’il voit durable (pages 14, 30, 96, 123 et 244), constate l’inexplosion des obus allemands, n’explosant pas dans une proportion de 20/50 (pages 12, 49 et 67) ou rapporte les ruses allemandes (pages 23 et 69), comme les puits volontairement empoisonnés par les Allemands avec leurs propres cadavres (page 40). Il dit rencontrer d’ailleurs deux agents secrets et recueillir leurs confidences (page 42). Il rapporte la lecture de l’ordre Stenger d’assassiner les prisonniers français le 20 décembre 1914, à Champenoux (page 43) ou les martyrologes, tel celui de l’instituteur d’Hoéville, revenu de captivité le 22 février 1915 (page 53). Il rapporte également des combats au corps à corps épiques et sanglants mais surréalistes, venant d’un non-combattant, et bien entendu, « les Allemands ont employé dit-on » des balles explosives et dum-dum (page 70).
Il n’est pas tendre dans son appréciation de la population locale Meurthe-et-Mosellane, qu’il trouve grossière et sale, en un tableau peu reluisant (pages 22 et 23) et décrira de même plus loin les Auvergnats ! (page 57). Son tableau d’après bataille de la récupération du matériel abandonné, souillé est intéressante (page 24) et il confirme l’utilisation du vin en remplacement d’une eau insalubre (page 26). Il renseigne à plusieurs reprises sur les pratiques mortuaires (pages 26 et 32). Il décrit l’engagement d’un enfant de troupe (page 34 mais aussi pages 78 et 99 pour savoir ce qu’il est devenu). Le 10 mars 1915, il voit des condors qu’il prend pour des Taube (page 57) ! Il rencontre également des soldats devenus fous (pages 69 ou 188) et évoque un tir ami sur un homme perdu et tué (page 100). Il évoque également des déserteurs (page 127) mais fait aussi un éloge des soldats sobres (les Martiniquais) (page 187) ! A Verdun, le 8 septembre 1916, il rapporte horrifié une attaque de Sénégalais décapiteurs « sans s’occuper d’autre chose que leur zigouillage » (page 197) qui lui fait hiérarchiser l’horreur : « la guerre du fusil est terrible, le pilonnage de l’artillerie est épouvantable mais ce massacre au couteau, ce travail de boucher est monstrueux. Quelle affreuse chose que ce corps à corps au couteau ! Non, ce n’est plus la guerre, c’est… je ne peux pas le dire » (page 198).
Côtoyant plus souvent que le poilu la gent féminine, il voit à Velaine-sous-Amance quelques jeunes filles « malades », terme militaire pour syphilitiques, et qui « trouvent quand même quelques imbéciles pour s’occuper d’elles » (page 75). Comme pour la population, la vue de ces adolescentes enceintes, ces filles malpropres, aux sales mœurs (pages 82 et 84) voire dépravées et malades (page 165) apparaît récurrente. Il évoque aussi les « légitimes » telle cette veuve deux fois ayant épousé deux frères morts successivement (page 238) ou ces femmes (dont la sienne) rejoignant presque simultanément leur mari en cantonnement parisien de repos (page 242). Il parle aussi des occupées, évoquant les relations consenties de femmes avec l’occupant allemand à Berlencourt (page 255) et a même un mot sur les femmes belges (page 264) pour lesquelles il a plus de dilection.
Comme beaucoup, il se prononce parfois sur la durée prévue de la guerre ; ainsi Clergeau pense au 22 novembre 1915 que la guerre ne peut matériellement durer plus de 2 ans (page 112).
Soldat de l’arrière, il avoue avoir acheté « pour 20 sous, une belle fusée de 130 en cuivre et une bague de 105 » pour faire faire un coupe-papier en artisanat de tranchée (page 114) dont il évoque les dangers (pages 180 et 181). Il parle de la guerre psychologique, arguant que des cadavres allemands sont laissés sciemment sur le terrain pour démoraliser l’ennemi (page 136). De sa durée aussi, criant son amertume quant au sentiment du peuple envers le soldat le 1er avril 1917 (page 176), contre les journalistes quand ils évoquent le moral du poilu à cette période (page 194 ) ou contre ceux de l’arrière « que la guerre ne touche pas » (page 222). Les mutineries sont proches, et les mouvements collectifs qu’il décrit au théâtre aux armées du camp de Bois l’Evêque, près de Toul, où la Marseillaise est sifflée en présence des officiers supérieurs, ne sont pas équivoques (page 230). Dans ce camp, il précise que la mutinerie du 17 juin 1917 est partie d’un non-paiement du prêt par les officiers de peur s’enivrement des hommes (page 231). Il n’y prend pas part et précise que « tout cela est noté sans commentaire » (page 231) mais il constate les cas, y compris des trains aux portes arrachées par les permissionnaires (page 235).
A Hoéville, le 22 février il relate l’affaire de l’évasion et de la re-capture au front d’un prisonnier de guerre allemand en bleu horizon (page 212). Devant un « essai de vaccin », il suppute le poilu cobaye médical (page 217). Il peste contre les Américains et les Anglais, plus au café qu’au front (pages 244 et 257), évoque les effets physiologiques de l’ypérite (page 262) ou l’omniprésence du gaz à Esnes, qui gâte jusqu’aux vivres (page 269). Enfin sa vision de la cote 304 et du Mort-Homme en mars 1918 est impressionnante (page 269).
Il en ressort un ouvrage formidablement intéressant sur le plan du contenu mais souffrant d’une présentation médiocre, à l’instar de la reproduction iconographique, qui font leur cette observation d’Egger, historien de la littérature : « … car des milliers d’écrits nouveaux qui se publient chaque année, il n’y a jamais qu’un petit nombre d’œuvres qui méritent d’être distinguées par leur valeur scientifique ou littéraire, et celles-là ne trouvent pas toujours des éditeurs dignes d’elles » (in Egger, Emile, Histoire du livres depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, Hetzel, ca. 1880, page 236).
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Vaubourg, Henri-Louis (1875-1935)
Henri-Louis Vaubourg est entrepreneur de travaux Publics au Val d’Ajol dans les Vosges, société créée en 1850 et située en face de la gare. Il a 39 ans et est donc mobilisé comme réserviste. Technicien, cela semble logique qu’il soit affecté au 5e régiment du génie de Versailles auquel il dit appartenir en août 1914 (page 13). Il effectue en guerre de multiples emplois et dit après sa blessure, « le 10 février 1919, je quittais l’hôpital de Beauvais. Deux jours après, à Bourges, par un détournement de majeure, je ravissais à l’assistance Publique sa plus jeune surveillante » (page 323). On sait après guerre qu’il aura des enfants, dont Jacques, né en 1924, à qui il dédiera son pacifisme.
Vaubourg, H., O crux ave. Morituri te salutant. Val d’Ajol (Vaubourg), 1930, 323 pages.
Henri Vaubourg reçoit l’ordre de mobilisation à Versailles et rejoint le régiment du 5e génie, affecté à la compagnie de réserve des chemins de fer à Lyon. Il précise alors que la mobilisation effectuée par train nécessitait de la part de la compagnie des chemins de fer un effort énorme et de la part du gouvernement une surveillance accrue pour éviter d’éventuels sabotages. « Dans toutes les régions de France, une compagnie de sapeurs de chemins de fer fut envoyée à la mobilisation, avec tout le matériel de secours nécessaire. Stationnant à un nœud important de voies ferrées, elle était prête à intervenir immédiatement pour réparer les dégâts, si un accident se produisait dans son rayon d’action ». Ce qui ne se produira pas, reléguant Vaubourg à des emplois éloignés de la guerre. Il est alors affecté comme chef de gare à Pont-à-Mousson où un accident stupide – l’éclatement d’un détonateur d’obus – l’oblige à un séjour hospitalier à Nancy dont il décrit l’ambiance. Sorti peu de temps après, Noël 1914 est passé « au front », dans la forêt de Champenoux.
Milieu avril 1915, il est affecté dans une compagnie de réservistes territoriaux à Lempire (Landrecourt-Lempire), dans la région meusienne où il participe à des constructions de voies ferrées. Il en profite pour visiter et décrire Verdun et quelques impressions avant de bouger à nouveau pour participer à la construction du funiculaire de Bussang, dans les Vosges, qu’il quitte à la veille de Noël 1915. Il est affecté à Perrigny où un grand centre de triage ferroviaire est projeté puis à Clermont-Oise pour du terrassement et enfin à Proyart (Somme) où un ravin est à combler de remblais.
Septembre 1916, le territorial doit organiser la gare de Montauban-de-Picardie puis de Guillemont (Somme).
Aux alentours du début de 1917, sur sa demande, Vaubourg parvient « au piston » à se faire verser dans une unité combattante et rejoint le 152ème R.I. au dépôt divisionnaire de la 164e DI à Château-Thierry. Il va d’ailleurs, à cette place, contempler la détresse de l’armée qui sombre dans les remous des mutineries de 1917. Témoin de réunions antimilitaristes, il nous affirme qu’ « à l’arrière, c’est lamentable ». Les trains dégradés amènent un lot d’apaches débrayés, pris de boissons fortement, gardés par les gendarmes avant que le général Pétain ne « brise dans l’œuf l’anarchie naissante ». Pour ce faire, il créée des sections de discipline divisionnaires, unités chargées de mater les punis (à une moyenne de cinq ans de travaux publics avec suspension de peine) et les récalcitrants. Il en explique d’ailleurs le fonctionnement et les caractéristiques des sections disciplinaires (page 162 à 166). Gradé, Vaubourg en sera l’unique volontaire et fera ses armes à Dormans où il prend en main, hors du front, cette bande d’hommes « peu sûrs ». La discipline étant la force des armées, ces sections seront un véritable succès et la rébellion définitivement matée.
Le 25 juin 1917, le 152e est à Craonnelle, où il participe à l’affaire de la Caverne du Dragon et l’hiver 1917 transporte la section de discipline à Verdun, où elle est chargée du ravitaillement des troupes en ligne. Six mois plus tard, la section passe au 133e RI à Blainville-sur-l’Eau, dans la forêt de Parroy puis Neuilly-Saint-Front (Aisne) où s’est déclenchée la Friedensturm. Balancé sur divers points de l’arrière front, il se trouve le 17 juillet à Chezy-en-Orxois (Aisne). Le 15 août, il sauve des blessés contaminés par un obus à gaz et est atteint aux yeux ; aveugle, il est transféré à l’hôpital de Bourges. Là, il fait un long rêve allégorique (41 pages) emmenant ses hommes au Paradis. Il termine la guerre sur son lit de souffrances, qu’il ne quittera que fin décembre. Attiré par les femmes, qu’il parvient à côtoyer tout le long de sa campagne, il se marie au début de 1919.
3. Résumé et analyse
L’auteur nous donne à lire un livre simple et très singulier. En effet, mobilisé comme réserviste, il ne verra le front que par épisodes encore éloignés et bien que gradé, n’accèdera pas à une unité combattante. Vaubourg ne nous trompe pas d’ailleurs et l’affirme lui-même à plusieurs reprises ; « je ne vis pas grand’chose à la bataille ». Il donne ainsi une bonne définition de lui-même « guerrier jusqu’auboutiste pour la défense de mon pays, je répugnais au meurtre, même dans l’exercice de la guerre. Je suis rigoureusement certain de n’avoir tué, ni blessé personne, même par imprudence, mais sans le savoir par une balle perdue car je n’y ai jamais tiré un coup de fusil ». Militaire pacifique, il abhorre les bellicistes tout en restant lucide : la force et la résolution sont les garantes de la tranquillité des peuples. Son ouvrage, autoédité, paraîtra d’ailleurs avec un bandeau intitulé « Le droit chemin du pacifisme ».
L’ouvrage est également un bon témoignage sur les réservistes du train, arme méconnue du conflit où l’absence de gloire apparente de la fonction a peu fait écrire les protagonistes. Dans l’ensemble, Vaubourg décrit bien, par épisodes, ce qu’il a vu de sa guerre. Il se rappelle les lieux et les hommes et pointe de nombreuses anecdotes vues ou rapportées sans détail et avec un certain regard philosophique. Toutefois, comme souvent, ces témoignages ne sont pas vérifiés et la part de légende ou de fausseté est parfois importante. Qu’en est-il quand, au cimetière du Faubourg Pavé de Verdun, il dit être témoin de ses fossoyeurs jouant aux boules avec une tête de mort (page 57). Il en est ainsi aussi de quatre historiettes sensées se dérouler à Senones (Vosges) pendant la guerre, narré par procuration, et vantant la bonté des Allemands occupants la ville-front. L’histoire de cette localité sous le feu de la guerre pendant quatre ans ne fut en fait que souffrances et privations croissantes et aucune autre source ne vient corroborer ces histoires extraordinaires.
Singulier est aussi son rapport avec les femmes qu’il parvient à côtoyer sur les arrières de la guerre. Il en parle d’un ton badin mais avec finesse.
Globalement d’un grand intérêt, l’ouvrage pêche principalement par 41 pages d’allégorie religieuse, grand délire comateux amenant l’auteur au Paradis pour discuter avec la Sainte Trinité. Les lignes sont belles mais l’historien y perd en témoignage sur la matière.
L’ouvrage est finalement un mélange de témoignage, de roman et d’inutile. La partie témoignage est intéressante du fait de la position de réserviste de Vaubourg qui nous dépeint, certes superficiellement, mais correctement des aspects méconnus de la guerre (réserve du train ou sections de discipline). Sa vision des choses et des hommes qui l’entourent est réfléchie, teintée d’un humour fin et agréable. L’homme ne fait aucune esbroufe et ne ment pas sur sa qualité de guerrier non-combattant. Il ne raconte que peu de combats auxquels il n’a pas pris part. Quelques renseignements sont donc à tirer de l’ouvrage dans lequel l’attrait principal peut être trouvé dans les portraits des unités spécifiques qu’il intègre et les réflexions de guerre exprimées par l’auteur. Il convient donc de se reporter au texte pour retrouver les passages intéressants et pour suivre le déplacement de l’auteur au sein des arrières des 152e et 233e RI.
On peut suivre l’itinéraire géographique de Vaubourg tout au long de son périple et quelques dates éparses permettent une chronologie utile. En frontispice, un portrait de l’auteur.
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Rodiet, Jacques-Antoni
Le livre du Docteur Antoine, Au village pendant la guerre, Sentiments, idées et caractères, par un médecin de campagne, a été publié en 1924 à Paris, aux éditions de la Revue mondiale. Ce livre de petit format, de 156 pages, est assez mystérieux. L’auteur désigne la plupart des personnes et des lieux par une initiale ; ce souci exagéré de discrétion conduit à se demander si Antoine est un nom, un prénom ou un pseudonyme. Nous ne savons rien de lui, en dehors de sa profession et du fait qu’il n’a pas été mobilisé, soit à cause de son âge, soit parce qu’il était réformé. Au point de vue politique, il n’aime pas les socialistes, ni la droite cléricale antirépublicaine. Ni les Méridionaux. Il laisse cependant quelques indices qui permettent d’identifier avec certitude le département du Cher ; la petite ville où il exerçait est La Guerche-sur-l’Aubois (ce n’est donc pas un village). Or, il existe aussi un livre de Jacques-Antoni Rodiet, médecin, de même titre, même nombre de pages, publié à Bourges la même année. L’édition parisienne l’a repris en cherchant à le détacher de son ancrage, ce qui n’étonne pas mais qui est une aberration pour l’historien.
L’ouvrage contient d’une part des observations justes sur la résolution au moment de la mobilisation car « il faut en finir », puis sur l’inquiétude des populations faute d’informations ; il décrit la ruée sur les banques pour obtenir de l’or à la place des billets, la hausse des prix, la cherté et l’insubordination de la main-d’œuvre agricole, puis les profiteurs et les nouveaux riches ; les réfugiés sont rapidement considérés comme encombrants et refusant de travailler. Il rapporte d’autre part quantité de phrases péremptoires prononcées par des habitants sur la guerre provoquée par les calotins, prolongée par les galonnés ; il consigne les rumeurs les plus folles. Si on peut admettre que toutes ces paroles ont été prononcées, il est difficile de savoir s’il s’agit de cas particuliers ou de situations représentatives. Sur la vie à l’hôpital dont il s’occupe, les notations sont plus précises et rejoignent celles de Léon Jouhaud : dames fières de porter la tenue des infirmières, mais répugnant à soigner les vénériens ; jeunes filles « trop audacieuses avec leurs blessés » ; zèle clérical de certaines ; jalousies… Quant aux amputés, ils affirment hautement qu’ils entendent désormais vivre sans travailler.
Le Dr Antoine estime que l’Union sacrée est un masque. Les haines anciennes et les clientélismes subsistent ; la situation nouvelle oppose ceux qui luttent et souffrent à ceux qui ne cherchent que leur intérêt. Ces derniers se demandent si la guerre ne va pas amener un bouleversement politique, que le Dr Antoine lui-même croit inévitable. Le « moral » des blessés et des permissionnaires est variable et plutôt à la baisse ; les ouvriers des usines du chef-lieu (Bourges) « ont, paraît-il, très mauvais esprit ». Les femmes aspirent à la paix : « elles reçoivent sans doute des journaux qui leur prêchent le découragement ». Au début de 1917, le mécontentement croît. « La vie devient chaque jour plus chère. Les lamentations et les plaintes montent de toutes parts, avec la haine contre les dirigeants, qu’on accuse de tous les maux. » Nombreuses sont les lettres anonymes de dénonciation de voisins. Sur le front et dans les trains de permissionnaires, « l’indiscipline des hommes devient inquiétante ». En mai : « Période trouble. La Révolution russe inquiète l’opinion publique. Des poilus viennent en permission. Ils racontent que la dernière offensive a été suivie d’événements fâcheux. Des bataillons de chasseurs, des régiments d’infanterie (on cite les numéros) se sont mutinés. [… Des hommes], mécontents de ne pas avoir une permission, sur laquelle ils comptaient, ont déserté. [… Un médecin, de retour du front, raconte :] Des officiers sont frappés ou tués par les troupes mutinées. […] Il a vu, au chef-lieu, passer des wagons de permissionnaires avec ces mots écrits à la craie : La Paix ou la Révolution. […] Le discours de Ribot à la Chambre, repoussant toute idée de paix autrement que par la victoire, doit mieux exprimer le sentiment de tous les bons Français. »
Rémy Cazals, décembre 2011
APPEL : Si un lecteur a des précisions sur ce Dr Antoine et son témoignage, il est prié de nous les communiquer. Merci.
Jury, Jean-Elie (?-?)
1. Le témoin
On sait peu de choses de Jean-Elie Jury qui ne donne que des indications biographiques floues dans ses carnets. Il est peut-être originaire de l’ancienne commune de Saint-Julien-en-Jarez dans la Loire, où son frère, Stéphane-Irénée est né le 3 juin 1877. Il dit d’ailleurs quitter, le 1er août son lieu de résidence pour aller à Saint-Chamond. Sur son parcours militaire, il indique dans sa très courte préface « quand éclata la première guerre mondiale de 1914-1918, j’étais déjà un réserviste chevronné, j’avais exécuté mes périodes de réserve, dont j’étais sorti brigadier à l’une, sous-officier aux autres. Je fus affecté au parc d’artillerie de la 27e division » (page 5). Semble-t-il fonctionnaire du ministère des finances, il est mobilisé à la déclaration de guerre comme maréchal des logis affecté à la conduite et au ravitaillement de l’artillerie régimentaire du 155e RI de la 27e division du 14e corps. Il est promu sous-lieutenant dans une section d’artillerie le 16 mars 1918.
2. Le témoignage
Jury, Jean-Elie, Mes carnets de guerre. 1914-1918, chez l’auteur, 1964, 171 pages.
« Comme toujours, depuis ma plus tendre enfance, j’ai confié à de petits carnets mes intimes pensées de chaque jour ; j’ai continué pendant ces quatre années de 1914-1918 » (page 5). Sa pratique d’écriture est déjà ancienne et son rôle de ravitaillement ne l’expose pas au combat. Ainsi, il parcourt les arrières du front mobile de la bataille des frontières dans les Vosges d’août 1914, témoignant des visions sommaires qui s’offrent à lui. Après une entrée anxieuse et sans débordement de joie en pays reconquis, il recule et retraite par Bruyères avant de quitter les Vosges le 14 septembre pour renforcer l’armée du Nord, dans la Somme. Il reprend ses corvées de cantonnement, ponctuées de ravitaillement, mais sans réelle activité ; les jours passent dans une immobilité commentée.
En août 1915, il est transféré sur la Marne où là aussi, il rapporte peu d’activité sauf un ravitaillement de l’avant qui lui permet de s’approcher de la ligne de feu. La fin de 1915 le ramène dans les Vosges quand en février 1916 les lignes s’allument à Verdun. La division renforce le front menacé de la ville martyre mais Jury égrène les jours dans la même monotonie. Au cours d’un de ces ravitaillements vers l’avant, le sous-officier reçoit une blessure légère à la jambe, qui lui vaudra la croix de guerre. Il ne quitte ce secteur qu’avec la fin de 1916.
De retour dans la Somme en 1917, il ressent superficiellement les mutineries du printemps alors que les jours succèdent aux mois et les changements d’affectation sont rares. La deuxième offensive de la Marne le conduit à colmater les brèches sans toutefois bouleverser la placidité de sa vie d’arrière front.
Août 1918 signe la fin des offensives allemandes et le début de la débâcle, l’auteur délaisse alors son carnet et apprend l’Armistice alors qu’il est en congé. Lassé de la guerre et de la licence qu’elle occasionne, il pense sans joie, ce 11 novembre 1918, à ceux que l’on semble déjà oublier.
3. Résumé et analyse
Le journal de guerre de Jean-Elie Jury est original sous deux aspects : le premier est la vision d’un non-combattant, chargé du ravitaillement d’artillerie régimentaire stationné à l’immédiat arrière front et y faisant des incursions aussi épisodiques que brèves. Cette vision offre un regard particulier mais superficiel car n’apportant pas le témoignage vécu de la guerre. L’auteur suit les événements militaires par procuration, selon les ragots de cuisine et son récit se réduit en proportions égales à des prospectives et des banalités. Il se qualifie d’ailleurs lui-même de « demi-guerrier » (page 37). Le 3 août 1914, il constate en gare de Saint-Chamond « les trains pris d’assaut. Enthousiasme. Des cris, des hurlements, quelques ivrognes malheureusement » (page 7) mais en guerre, il rapporte les ragots : « Il paraît qu’à Saint-Dié les ennemis n’ont pas enterré leurs cadavres et que la région empuantie est inabordable » (page 18) ou cette odyssée du capitaine Boust et de 22 soldats du 140e RI parvenus à regagner les lignes françaises déguisées en paysans ! (page 19), rapporte le 14 septembre que « les soldats allemands commencent à se mutiler » (page 23). Si un de ses chefs lui donne une définition cocasse du drapeau : « Ça qu’il faut se faire casser la gueule pour », il n’est pas concerné par son emploi militaire. Plus loin il analyse deux sortes de courages : « Celui que nous avons quand nous traversons des populations qui nous acclament (…) et « l’autre qui consiste à faire simplement chaque jour, à toute heure, son métier, son devoir, de se mesurer quotidiennement avec la camarde. Celui-ci est le plus admirable » (page 27). Plus tard, il continue de rapporter une guerre dont il ne perçoit que les bruits : « D’aucuns prétendent que d’une tranchée à l’autre on fait des échanges de cigarettes » (page 43). Parfois, son analyse est plus personnelle et opportune : le 23 novembre 1914, « nous voyons défiler deux régiments, le 115ème et le 117ème qui traversent Harbonnières pour aller à Hangest. Quelle tristesse de voit tant d’hommes âgés parmi eux ! Quelques-uns, fatigués, mal rasés, paraissent des vieillards. Ils défilent bien ; on surprend dans leurs yeux des rêves qui ne sont pas très belliqueux, mais ils sont résolus. Ils n’ont plus le patriotisme paonnesque des débuts devant les femmes ; ils ont souffert ; ils ont senti le souffle de la camarde, maintenant, ils marchent froidement, résolument parce qu’il le faut et parce que beaucoup d’entre eux, qui ont vu tomber à côté d’eux d’excellents camarades ont des comptes à régler avec les Boches » (page 49). Parfois, il s’emporte contre ses supérieurs, quand, le 4 avril 1916, il « trouve à [s]on retour nos deux officiers occupés à faire un petit jardin autour de leur cagna. Jamais, jamais, je ne les ai vus s’occuper du bien-être des hommes. C’est un peu écœurant » (page 95) et y revient en mai 1916 : « Il faut que je confie à mon petit carnet tout l’écœurement que me donne nos officiers. Je ne parle pas de tous les officiers naturellement, mais des nôtres, de ceux de la 1ère S.M.I. Ils ne font rien, rien » (page 104). Il étend cette acrimonie aux généraux : « Qu’on foute donc nos généraux en 1ère ligne pour observer les mouvements de leurs troupes ! ils feraient peut-être moins de gaffes. (…) Maintenant ces messieurs après avoir fait massacrer des milliers d’hommes vont tranquillement jouer au bridge à Limoges et jouir des douceurs d’une grosse retraite. Quand je vois les souffrances et la mort autour de moi, je ne peux m’empêcher de dire comme les poilus : « Tas de crapules ! » (page 138). Cela participe du sentiment rencontré le 15 juin 1917, à l’esprit gâté de la troupe proche de la rébellion (page 139). Il participe également à l’ostracisme constaté contre les « gens du midi » : « Oh ! ces corps du midi toujours à la blague et à l’honneur, jamais à la peine » (page 102) et plus loin, le 4 juin 1916, « on murmure que tous les corps méridionaux ont flanché (une fois de plus) » (page 107).
La seconde originalité présente une attirance marquée du soldat pour un élément de sa vie dont le manque est cruellement ressenti : les femmes. Ce sentiment n’est toutefois pas développé, le récit n’étant émaillé que de quelques annotations ponctuelles sur le sujet. Cette thématique est finalement assez peu évoquée dans les témoignages de soldats, s’accordant tous à la pudeur ; le texte de Jury éclaire un peu l’historien sur ces sentiments éludés. Il indique en effet, dans la Somme en octobre 1914 : « Il y a de jolies ouvrières qui nous sourient. On ajuste son uniforme, on frise sa moustache, on se drape dans sa dignité de guerrier. Des regards s’échangent qui ne sont point chastes… Beaucoup d’entre nous, hommes et femmes, souffrent du besoin d’aimer » (page 40). Il connaîtra d’ailleurs un amour furtif en septembre 1915 (page 76). Cette préoccupation des femmes reste une préoccupation récurrente dans son parcours, favorisé par sa position de front-arrière.
Ces deux points sont malheureusement les seuls qui offrent un attrait à cet ouvrage superficiel et répétitif très fortement entaché d’une imprécision toponymique et patronymique qui confine à une systématique perturbatrice car faisant perdre ses repaires au lecteur. L’ouvrage perd de sa substance au fur et à mesure de l’avancée du conflit, se traduisant par un ressassement des jours et des expériences, à peine rehaussé par quelques missions « dangereuses » dont l’auteur sent de lui-même la pauvreté de l’intérêt. Certes, l’on sent que les souvenirs sont livrés bruts, sans retouches apparentes mais surtout sans vérification. Dès lors, cette qualité apparaît comme un défaut très largement souligné par le peu d’intérêt que revêtent la plupart des dates reportées. L’auteur dévoile des sentiments selon ce qu’il vit et une certaine incurie qui l’irrite mais c’est surtout l’ennui, le répétitif qui prévaut au fil des pages où les mois sont représentés par quelques dates éparses et quelques paragraphes délayés. Beaucoup d’erreurs toponymiques augmentent encore ce sentiment.
Au final, les carnets de guerre de Jean-Elie Jury n’offrent que peu d’intérêt à l’historien du fait de la pauvreté documentaire et descriptive du témoignage qu’il semblait vouloir apporter. L’ouvrage, semblant d’un tirage limité à compte d’auteur, est correctement rédigé, dans un style diariste simple et n’est pas iconographié. Cette présentation très austère peut rappeler les carnets dont le texte est issu.
Yann Prouillet, CRID14-18, décembre 2011
Maréchal, Maurice (1892-1964)
1. Le témoin
Il est né le 3 octobre 1892 à Dijon où son père était receveur des postes. Sa mère est présentée dans le livre cité ci-après une fois comme institutrice, une fois comme professeur à l’Ecole normale d’institutrices de Dijon. Maurice est reçu au Conservatoire de Paris en novembre 1905 ; il devient violoncelliste soliste en 1911. Il fait le service militaire à Rouen à la musique du 74e RI et, en temps de guerre, dépend alternativement du 274e et du 74e. Il ne combat pas les armes à la main, mais se trouve exposé comme brancardier et agent de liaison cycliste. Dès mars 1915, il fait « de la musique plus que jamais » et, en février 1916, il vient compléter le quatuor de Durosoir (voir cette notice) après avoir reçu cette invitation : « Ne vous frappez pas, vous ne serez pas malheureux, il nous manque juste un violoncelliste pour faire de la musique devant le général Mangin. » Son instrument, fabriqué à partir de bois de caisse, est surnommé « le Poilu ».
Il est évacué pour faiblesse générale le 6 juillet 1918, vers l’hôpital de Dijon. Il se marie après la guerre, entreprenant une carrière internationale de violoncelliste. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est professeur au Conservatoire de Paris.
2. Le témoignage
Maurice Maréchal a rempli pendant la guerre 9 carnets de petit format dont le contenu a été reproduit en quasi totalité dans le livre : Maurice Maréchal, Lucien Durosoir, Deux musiciens dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2005, 358 p., photos. La plupart des coupures sont les longues citations faites à partir de ses lectures. Dans ces carnets, il se parle à lui-même et il leur livre des confidences sur ses amours et ses ruptures, sur son vice, le jeu, qui lui coûte cher et qu’il se promet de surmonter (31 décembre 1914) pour entrer dans l’année nouvelle « pur comme on doit entrer au séjour éternel ». Une confidence étonnante (17 septembre 1914) : « Jamais je n’ai senti autant d’antipathie contre moi. A part quelques-uns, les brancardiers me détestent. Oh, petite mère que j’aime, comme tu serais contente de me consoler ! »
3. Analyse
Le premier jour de la mobilisation, malgré le spectacle d’un commandant abruti et des réservistes saouls qui se vautrent sur le trottoir, il note de belles pensées : « Un artiste doit se dévouer pour la plus noble cause, et la plus noble, en temps de guerre, n’est-ce pas de mourir pour le drapeau ? » Quelques jours plus tard, il précise : « Je vais faire tout ce que je pourrai pour quitter cette compagnie où, comme cycliste, je suis vraiment trop exposé. Si j’étais à la Croix Rouge, je serais du moins plus sûr de revenir. Je ne suis pas, je ne veux pas être lâche, mais l’idée que je pourrais, pour une balle idiote qui ne prouvera rien ni pour le Droit ni pour la Force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l’édifice édifié péniblement par ma chère petite mère au prix de tant et tant de sacrifices, je suis pris d’un tremblement d’angoisse qui me tord. »
Il connaît alors l’épuisante retraite d’août et les horribles visions de guerre. Il compatit sur « la malheureuse infanterie » dont « la tâche est bien facile à résumer : se faire tuer le moins possible par l’artillerie ». En septembre et octobre, il note que la cathédrale de Reims crie « Vengeance ! » ; mais il trouve stupides « les articles haineux des journaux de Paris » contre les œuvres des artistes allemands. Dès février 1915, on apprend qu’il travaille son violoncelle en Champagne, puis en Artois ; le 9 août, il écrit trois fois « je m’ennuie ».
Le 24 septembre 1915, à la veille de la grande offensive, installé à l’observatoire du colonel, il pense que « le sort de la guerre va se jouer ». Le 27, il décrit un poste de secours encombré de blessés : « Je ne peux plus y tenir, odeur de sang caillé, chaud, mêlée de l’odeur des intestins ouverts. Les blessés sont partout dans tous les coins, les brancards s’empêtrent. » Le 28 : « Résumé de l’attaque jusqu’à aujourd’hui : pertes formidables. » Et le 1er octobre : « Mon avis est que notre victoire est une bûche puisque, même en y mettant le prix, on n’est pas parvenu à passer. »
Peu de temps après, il faut constater que « la musique ouvre bien des portes ». Maurice passe plusieurs semaines au château de Mme de F. ; il répète, il joue devant les officiers, il reçoit même la visite de sa mère. Fin décembre, retour en ligne pour retrouver la boue, les rats, les ruines, les morts. A Verdun, en avril 1916, c’est à nouveau une vision d’enfer, les arbres déchiquetés, les trous d’obus, les cadavres, les trop nombreux blessés. Mais c’est pour peu de temps. La musique reprend ses droits et, le 2 mars 1917, partant pour Paris afin de faire réparer son instrument, il note : « Retourner en permission parce qu’on a cassé son violoncelle, quelle chose plus naturelle ? »
Plus tard, c’est un nouveau constat d’échec à propos de l’offensive Nivelle du 16 avril. Son carnet personnel n’étant pas redevable de la censure, il peut livrer un témoignage sur les mutineries, mais il ne se trouve pas vraiment au cœur de l’action. Le 29 mai, il signale l’influence des permissionnaires retour de Paris et, à propos du capitaine Lebrun, il écrit : « Il paraît qu’il a voulu parler aux types et on ne l’a pas écouté. Quelques-uns l’ont traité d’ordure, d’embusqué, de con, etc. Il a l’air anxieux lui aussi. Tout à l’heure sont passés des manifestants des trois régiments. Ils sont calmes, crient à peine. Quelques cris seulement de « A bas la guerre », « Vive la grève ». Les officiers sont tous rentrés un peu précipitamment, m’a-t-il semblé, au château, et n’ont soufflé mot. On s’endort avec la sensation bien nette que la situation devient grave. » Le 30 mai, il décrit encore quelques troubles, des cris contre un officier, mais il conclut de curieuse façon, peut-être influencé par son entourage de gradés : « N’est-ce pas le gouvernement qui fomente tout cela pour dégager sa responsabilité ? »
Rémy Cazals, 17 novembre 2011